Lectures de 2025
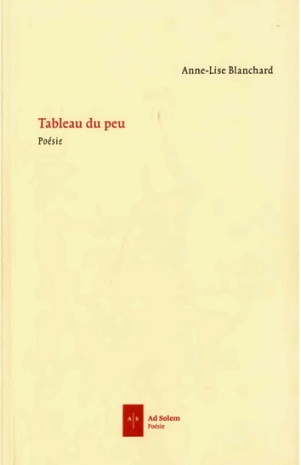 |
Anne-Lise Blanchard, |
| Tableau du peu |
|---|
On ne doit pas s’étonner qu’une adepte du haïku comme l’est Anne-Lise Blanchard cultive cette « nécessaire ascèse » dont elle parle dans son nouveau livre. Son Tableau du peu arrive à dire « entièrement tout » avec « presque rien ». Sept tableaux surgis de rien pour dire l’attente, la patience et l’émerveillement.
« L’entièrement tout », c’est d’abord le territoire de l’enfance (« champs et chemins parcourus ») que la poétesse évoque avec nostalgie dans un des poèmes, territoire d’enfance devenu, à ses yeux, « continent en dérive » sous les coups de boutoir de « la ville qui débarque ». L’entièrement tout, c’est aussi « l’absence des disparus », notamment celle d’une mère aimée, mais « un ange veille / qui apaise » et « desserre les nœuds / du vertige ». L’entièrement tout, c’est finalement au bout de la douleur, « l’incoercible désir / du plus grand ciel / à l’intérieur de soi ». Et que dire de ces « battements de cœur » auprès de l’être aimé (« je m’ancre à des hanches / de grand chêne »). Anne-Lise Blanchard est là, dans ce livre, pour dire ce monde qui nous tend les bras et, en définitive, pour « écrire l’espérance ». Car, nous dit-elle, il faut savoir « entendre la saveur du royaume » et « grignoter le visible ».
Son Tableau du peu nous entraîne, sur le mode du « presque rien », dans une approche sensorielle de la vie comme le ferait un haïku. Il y a d’abord, dans ce livre, le feu d’artifice des couleurs au jardin. Festival de fleurs déclinées au fil des pages (jacinthes, narcisses, tulipes, renoncules, iris, dahlias…). La vue, donc. Mais aussi le goût quand « arrive sous la dent le suc acidulé » des tomates. Le toucher quand, au potager, la main « débusque le haricot ». L’odorat quand, dans la campagne « l’odeur du mazout a effacé/la fragrance du lait cru ». L’ouïe quand surgit « la chorégraphie légère » des mésanges ou que vous parviennent, de-ci de-là, « des voix d’enfants ».
Poésie des cinq sens prenant la « démesure de l’infime ». Il importe, nous dit Anne-Lise Blanchard, de « récurer le poème ». Elle cite Anne Perrier, François Cheng, Giuseppe Ungaretti… Signant la préface, le poète breton Jean-Pierre Boulic note à juste titre, à propos de l’autrice, « un regard sur le réel de manière encore plus concrète » que dans ses précédents livres et salue chez elle cette manière particulière de souligner « l’importance de ce peu où flottent des odeurs de vie ».
Tableau du peu, Anne-Lise Blanchard, Ad Solem, 2025, 85 pages, 15 euros.
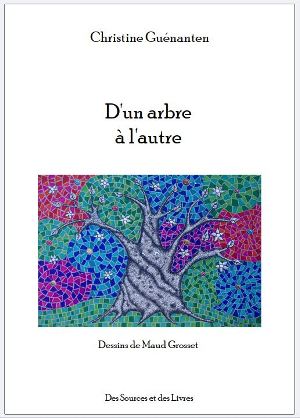 |
Christine Guénanten, |
| D’un arbre à l’autre |
|---|
Christine Guénanten ne déroge jamais à ce qui fait la nature profonde de sa poésie : la simplicité, l’humilité, la contemplation. Avec des poèmes marqués du sceau de l’enfance et d’une forme d’innocence. La voici, dans sa dernière livraison, au rendez-vous des arbres.
« Le matin qui m’accueille /a des yeux de forêt ». Ces mots ne sont pas de Christine Guénanten mais du poète Charles Le Quintrec (1926-2008) qui avait reconnu, très tôt, les talents de la poétesse bretonne. En forme de clin d’œil, elle cite d’ailleurs ces deux vers au cœur de son nouveau livre. Car Christine Guénanten (elle est née à Vannes en 1958) a cet art, elle aussi, d’accueillir le jour qui vient en trouvant dans la nature de multiples sources d’émerveillement. À commencer par les arbres.
La voici donc qui donne vie à ce vrai peuple des arbres qui s’offre à elle lors de ses déambulations, notamment le long du chemin de halage, là où elle vit au cœur de l’Ille-et-Vilaine. Pourquoi, s’interroge-t-elle, un arbre s’appelle saule-pleureur ? Elle trouve la réponse dans l’histoire d’un saule qui se mirait dans l’eau d’une rivière et vivait en compagnie d’une carpe un jour capturée par un pêcheur. C’est peu dire que Christine Guénanten arrive très vite, à donner des sentiments aux arbres ou, pour le moins, à partager leur condition.
Le don de la parole
Ainsi se penche-t-elle avec compassion sur le sort d’un platane de cour de récréation désertée le temps des vacances. « Joyeuse était mon âme / Quand les petits-enfants / Dessinaient, coloriaient / Mes larges feuilles d’or », fait-elle dire à ce platane esseulé. Ailleurs elle se penche sur le sort d’un châtaignier dans le grand parc d’un château. « Tu n’a jamais connu / Le mouvement rythmé / Des marées aux rochers » (…) Est-tu content de vivre / Éloigné de la mer ? ». Parfois les arbres dialoguent avec les plantes environnantes, par exemple avec les fougères qui poussent à leurs pieds. À d’autres moments ce sont les oiseaux et les arbres qui se trouvent en harmonie : « Grâce aux oiseaux / Le vieil arbre renaît / en cerisier sonore ». Ou encore ceci : « En compagnie des arbres / Les passereaux se parlent / En sifflant leurs poèmes ». Et que dire des écureuils qu’elle cite à plusieurs reprises, au point d’écrire un « Poème du hêtre » dont les branches bercent « les nouveaux écureuils ».
Les exercices de contemplation de Christine Guénanten ne s’arrêtent pas là. Elle s’émerveille des « éventails dorés » du peuplier, elle s’amuse des « percussions » sonores du mot baobab, elle s’inquiète pour le sort d’un pin maritime au bord d’une falaise qui recule peu à peu, elle s’incline devant le « chêne centenaire » et s’apitoie sur le sort d’un « sapin solitaire » dans la nuit de Noël. C’est à une véritable « Enfance des arbres » que nous convie la poétesse aurait pu noter le regretté poète Jean Lavoué (1955-2024), créateur d’une maison d’édition placée précisément sous le signe de l’arbre.
Des dessins de Maud Grosset, aux allures d’enluminures, accompagnent avec bonheur cette promenade féerique dans l’univers des arbres, apportant une touche supplémentaire de lumière et de fraîcheur dans ce livre pour enfants et grands enfants. À lire à Noël. Car si les animaux trouvent, en Bretagne selon la tradition, le don de la parole dans la nuit de Noël, pourquoi n’en serait-il pas de même pour les arbres ?
D’un arbre à l’autre, poèmes suivis d’un « conte de l’écureuil », Christine Guénanen, Des Sources et des Livres, 2025, 65 pages, 15 euros.
 |
Jean-Claude Bourlès, |
| Le jour où Prosper Mérimée m’invita à sa table |
|---|
Qu’est-ce qui peut donc relier un écrivain breton, Jean-Claude Bourlès, et un célèbre écrivain français, Prosper Mérimée ? Conques, tout simplement. Conques parce que l’écrivain-voyageur Jean-Claude Bourlès connaît sur le bout des doigts cette halte incontournable du chemin de Compostelle. Conques, parce que Prosper Mérimée (1803-1870) qui fut inspecteur général des Monuments historiques, était aussi tombé sous le charme de cette cité. Cela méritait bien d’être raconté dans un livre mêlant fiction et réalité.
Conques est cette charmante cité de l’Aveyron rendue célèbre par son abbatiale romane contenant la mirifique statue de Sainte Foy (qui donne son nom à l’édifice). La route du Puy du Chemin de Compostelle a fait la renommée de cette petite cité. Jean-Claude Bourlès (né en 1937, il vit dans le pays de Rennes) s’en est fait l’écho dans ses livres, notamment dans Retour à Conques : sur les chemins de Compostelle (Payot, 1993).
Dans le livre qu’il nous propose aujourd’hui (réédition augmentée d’un livre publié en 2008), voici qu’il se met dans les pas de Mérimée pour un récit à la fois documenté et imaginaire. Dans cette entreprise, Jean-Claude Bourlès suit à la trace Lucien Estambles, architecte-adjoint aux service des Monuments historiques de l’Aveyron. Ce jeune homme a 27 ans quand, en 1837, son supérieur hiérarchique (Étienne Boissonnade) lui annonce la venue de Prosper Mérimée pour une inspection générale dans le département et lui confie d’accueillir cette personnalité. « Tachez de le retenir si possible deux jours avant qu’il ne s’en aille vers Espalion où il envisageait de se rendre», intime-t-il au jeune Lucien. Mérimée restera trois jours à Conques et fera preuve d’une grande délicatesse à l’égard du jeune fonctionnaire qui lui servit de guide (jusqu’à l’inviter à sa table, d’où le titre du livre). Mais surtout il tomba, lui aussi, sous le charme de Conques.
Jean-Claude Bourlès raconte tout cela dans une langue alerte, mêlant descriptions ou entretiens imaginaires à des correspondances de Mérimée ou des notes de voyage. Parlant de Conques, Mérimée écrit: « Je suis agréablement surpris par le style de cette église qui se languit avec la patience des vieilles pierres meurtries ». Il dira aussi dans une lettre adressée à une amie, datée du 2 juillet 1837 : « Conques me fascine. Ce matin en tirant les rideaux usés et crasseux de ma chambre, j’ai pu concevoir son incommensurable pouvoir de séduction ».
Le résultat de cette visite fut, en tout cas, la mise en route d’un chantier pour la restauration d’un édifice alors plutôt mal en point dont le pouvoir de séduction est plus que jamais intact. Le grand poète Christian Bobin qui occupa la chambre n°6 de l’hôtel Sainte Foy à Conques écrit dans La nuit du cœur (Gallimard, 2018) : « Conques c’est l’effacement total et l’accomplissement parfait. Une fraîcheur aux épaules nues de l’âme ». Avec son livre sur les pas de Mérimée, Jean-Claude Bourlès ne nous dit pas, à sa manière, autre chose.
Le jour où Prosper Mérimée m’invita à sa table, Jean-Claude Bourlès, avant-texte de Ronan Guillot, éditions À l’Index, 2025, 63 pages, 15 euros.
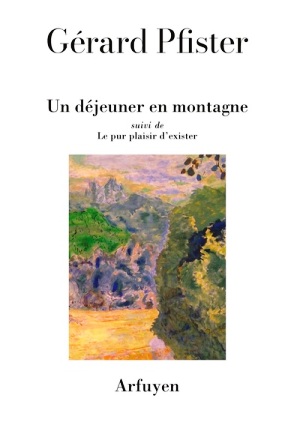 |
Gérard Pfister, |
| Un déjeuner en montagne |
|---|
Concevoir un déjeuner en montagne comme un banquet : c’est l’objet de ce nouveau livre de Gérard Pfister. Inspiré de traditions philosophiques ou religieuses qui placent le banquet au cœur d’une rencontre authentique entre les hommes, l’auteur nous conduit sur les chemins de l’amitié, de la fidélité, de la gratitude.
Tout part de l’injonction d’un ami disparu : se réunir chaque année, lors d’un repas, le jour anniversaire de sa naissance. Le cadre ? Une montagne. « Là-haut, seul nous importe d’être ensemble comme si jamais nous ne nous étions quittés ». Le banquet s’annonce frugal. Ce seront des « agapes étrangères à toute tristesse comme à toute austérité » (…) « Il n’y aura pas de bombance, pas de mets choisis » car «Le repas ne sera fait de rien d’autre que ce que nous avons apporté ». Nous sommes ici, d’abord, dans la célébration de l’amitié, dans cette agapé chère aux Grecs. Et d’ailleurs, l’un de plus fameux d’entre eux, Épicure, inaugure le livre par ces mots : « Toujours nous est doux le souvenir d’un ami disparu ».
Mais il n’y a pas, dans ces retrouvailles, que le banquet grec (ce Banquet que l’on rattache si fort à Platon). Par petites touches, nous voici introduits dans des traditions nous rattachant à la « parole rituelle » de la culture juive. Voici aussi qu’apparaissent, parmi les convives, ces « châles de soie aux longues franges, certains sont blancs, d’autre bleus ou oranges ». Pour autant, on n’est pas à ce banquet pour s’arc-bouter aux dogmes ou aux lois (dont l’ami « aurait ri »). Car, écrit Gérard Pfister, « notre liberté seule nous porte là-haut. Celle que nous a donnée l’ami ».
Nous voilà bien loin des « exégètes » ou des « scoliastes » car, parlant des paroles de l’ami, l’auteur nous dit qu’elles étaient « si fluides, si limpides, à peine y sentait-on le poids d’un enseignement ». Et d’ailleurs, « il moquait à demi-mot notre stérile exaltation ». Dans ce déjeuner en montagne, il se passe autre chose. Les cœurs se dilatent, car « ici le temps se fait espace et l’espace éternité ». Les enfants (dont l’ami en eut sept) ont ici toute leur place. À la manière dont en parle Gérard Pfister, reviennent même en mémoire ces versets de l’Évangile : «Si vous ne devenez comme des petits enfants » (Mathieu 18, 3-5). Car si les cultures grecques ou juives imprègnent les textes de ce déjeuner en montagne, il y a aussi en filigrane les paroles d’un autre Ami, celui qui pérégrinait avec les pèlerins d’Emmaüs avant de rompre le pain avec eux.
C’est à une Cène symbolique et à un rite mémoriel que nous convie donc Gérard Pfister dans ce livre composé de brefs textes en prose poétique. Philosophie, religion, poésie se rejoignent pour donner tout son poids à une parole sur l’amitié. Avec, au bout du compte, ce constat : « Nous qui de toujours nous sommes crus exilés, nous voici rendus à notre terre natale ».
Un déjeuner en montagne, suivi de Le pur plaisir d’exister, Gérard Pfister, Arfuyen, 2025, 128 pages, 15 euros
 |
Pavel Florenski, |
| Lettres du Goulag |
|---|
Scientifique, philosophe et théologien orthodoxe russe, Pavel Florenski (1883-1937) a passé les dernières années de sa vie au Goulag dans une île de la Mer Blanche. Ses Lettres du Goulag, adressées à son épouse Annoulia, sont pétries de leçons de sagesse. L’homme fut parfois comparé par ses contemporains à Blaise Pascal ou à Léonard de Vinci du fait de l'étendue des domaines auxquels il s'intéressait et dans lesquels il excellait.
Pavel Florenski aimait surtout profondément la nature. Dans l’Extrême-Orient soviétique, où il fut un moment exilé, il avait beaucoup étudié le pergélisol (appelé encore permafrost), ces sous-sols gelés depuis des millions d’années. Au Goulag dans la Mer Blanche, sur la grande île de l’archipel des Solovki, il avait réussi à mener des études poussées sur les algues. Mais cet homme, au-delà d’être un brillant scientifique, portait un regard acéré sur le monde et la vie. Dans une lettre du 23 novembre 1936 à sa femme, il insistait ainsi pour que Mik, l’un de ses fils « fasse davantage provision d’impressions concrètes : de la nature, de l’art, de la langue ».
Selon Florenski, en effet, il était important d’aborder « les occupations sérieuses avec un bagage de perceptions pour ne pas se construire sur du vide et abstraitement ». Ainsi préconisait-il de disposer d’une « réserve d’images concrètes, de couleurs, de sons, de goûts, de paysages, de plantes… ». Il en tirait une conclusion, dont on mesure aujourd’hui, plus que jamais, la pertinence : « Je juge absolument indispensable, quand on est jeune, de faire provision de perceptions concrètes du monde et de ne les mettre en forme qu’à un âge plus avancé ».
Le scientifique et théologien russe disait aussi : « Notre tâche est de prendre sur nous le souci et l’angoisse. Le but de la vie, du reste, n’est pas de vivre sans angoisse, mais de vivre dignement et de ne pas être une nullité ni un poids pour son pays ». Pavel Florenski distillait dans ses Lettres du Goulag de prodigieuses leçons de vie. « Je n’aime pas les espaces illimités et l’informe, Je cherche le grandiose et non la grandeur, et un petit espace est plus facile à percevoir comme un monde grandiose qu’un grand espace ».
Parole d’entomologiste, penché sur les sols gelés ou les algues, découvrant le grandiose dans l’infime, à l’image d’un auteur de haïkus navigant du macrocosme au microcosme. Il fut exécuté en 1937 et jeté dans une fosse commune.
Lettres du Goulag, Pavel Florenski, Rivages/poche, 2025, 150 pages, 9 euros
 |
Collectif, |
| Poésie irlandaise dans Les carnets du ShannOdet |
|---|
L’initiative est originale et mérité d’être soulignée. Dans le cadre du comité de jumelage entre la ville de Quimper et la ville irlandaise de Limerick, des contacts ont été établis par les Quimpérois avec des poètes irlandais. Des extraits de leurs œuvres ou parfois des inédits sont aujourd’hui publiés en bilingue anglais / français par les éditions Eireanna, pour le comité de jumelage, dans Les carnets du ShannOdet (contraction de Shannon, nom de la grande rivière irlandaise, et de Odet, la rivière de Quimper).
Ces Carnets, qui en sont à leur 4e numéro, se veulent une passerelle entre poètes irlandais et bretons vivants. Ils rassemblent les traductions de poèmes, partagés à l’occasion des événements littéraires organisés par le comité de jumelage. Cette initiative est menée en partenariat et avec l’accord des poètes, éditeurs et institutions culturelles irlandaises et françaises concernées. La Poetry Ireland review sert souvent d’intermédiaire pour établir le contact avec les poètes irlandais.
Voici donc qu’apparaissent au fil des textes de poètes de Galway, Dublin, Limerick … Autant de femmes que d’hommes. Elles ou ils s’appellent John Liddy, Jo Slade, Vivienne Mc Kechnie, Emily Cullen, Richard W.Halperin, Gerard Smyth, Lorna Shaugnessy (dont des textes ont été publiés déjà dans les premiers Carnets) et Mary Noonan, Tom Collins, Ross Cogan, Lauren McNamara, D’or Seifer, Lauren Lawler, Roisin Ni Neactain (dont les noms apparaissent dans le numéro 4 des Carnets). Les poèmes sont présentés sur feuilles volantes, pliées dans un carnet fermé par une petite ficelle aux couleurs de l’Irlande.
Poésie et aussi musique
Le numéro 1 de ces carnets du ShannOdet s’était attaché à montrer la disparité des écritures dans la diaspora irlandaise. Le numéro 2 s’était focalisé sur la fête nationale des femmes nouvellement créée en Irlande. Le troisième sur l’intelligence des mains, l’habileté intellectuelle et technique. Le quatrième, qui vient de paraître, parle de l’envol, des oiseaux, des « plumes de la paix ». Lauren Lawler évoque ainsi en ces termes le troglodyte : « Une petite miette de brun qui bouge / et décharge les dards de son chant / deux notes de psalmodie rouillée / dures comme un ressort sans huile ». De son côté, Laurent McNamara écrit : « Nous sommes oiseaux. / Migrer, ça fait partie de nous./ Chez nous, c’est là où nous vivons. / Là où nous vivons, c’est où la vie nous porte », écrit Lauren McNamara. Comment ne pas penser ici à ces vers de leur prestigieux prédécesseur Seamus Heaney (1939-2013) qui a aussi écrit sur les oiseaux : « J’ai beaucoup cru aux migrateurs attardés, / surestimé le sang-froid des merles / et le folklore des pies » (dans son livre Station Island)
Ces Carnets de ShannOdet, souligne le poète quimpérois Elpée (Lionel Poiraudeau), membre du comité de jumelage, sont « une belle illustration de ce à quoi vise le jumelage : découverte, partage, mise en lien ». Il ajoute : « Le temps de la poésie s’y prête. Le voisinage avec la musique aussi. Cette sensibilité celte, un peu scandinave et slave quelque part, aime se laisser porter par la musique plutôt que de rester dans l’austérité de la lecture en deux langues ». La poésie irlandaise vivra en effet, prochainement, dans un pub quimpérois après avoir été lue dans le cadre de rencontres littéraires, « Les rendez-vous de Max ».
.Les carnets du ShannOdet, Pour tout contact : quimper.limerick@gmail.com
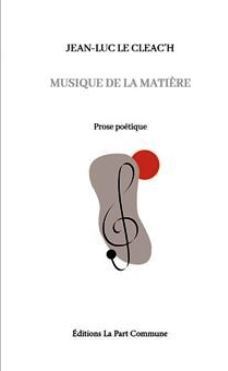 |
Jean-Luc Le Cléac’h, |
| Musique de la matière |
|---|
Le titre d’un tel livre pourrait faire penser à un livre de scientifique ou de musicologue. Il n’en est rien. Jean-Luc Le Cléac’h nous propose, dans des courts textes en prose poétique, ses réflexions et méditations autour du monde minéral. Car la « musique de la matière » dont il est question ici, c’est d’abord celles des minéraux dont l’écrivain nous propose une approche inédite.
Il n’en finit pas de nous surprendre. Écrire un livre sur L’élégance des eaux vives (La Part Commune, 2016) était déjà une gageure. Poursuivre avec L’hiver, saison de l’esprit (La Part Commune (2021) semblait ajouter à la difficulté. Que dire alors, aujourd’hui, d’un livre consacré à la matière, plus précisément aux minéraux. Comment passionner son lecteur sur un tel sujet si l’on ne se prétend pas un peu géologue quand il s’agit d’expertiser les sols ou encore historien quand vient le moment de parler des pierres au cœur des monuments ? Jean-Luc Le Cléac’h relève le défi en abordant le sujet sous un autre angle et en commençant par nous dire que « dialoguer avec les pierres, c’est faire reculer les limites du silence, repousser les frontières de l’inaudible » ou en concluant son ouvrage par ces mots : « Les pierres existent dans une réalité étrangère à notre expérience du monde, elles nous offrent la possibilité d’un décentrement bien venu, je dirais même salutaire ».
Paroles de poète qui s’emploie dans son livre à nous livrer toutes les sensations éprouvées au contact du monde minéral. Son regard sur les pierres est, le plus souvent, prétexte à appréciations ou considérations d’ordre philosophique sur notre époque gagnée par la vitesse et l’immédiateté. Il s’appuie souvent, pour le dire, sur des auteurs dont il a fait son miel (et qui ont, eux aussi, parlé des minéraux) : Roger Caillois, Gaston Bachelard, Jorge-Luis Borges, Julien Gracq, Pierre Bergounioux, François Cheng, Wang Weï… « Avec Roger Caillois, note Jean-Luc Le Cléac’h, Il était admis qu’on pouvait s’extasier devant les pierres ».
Comme « la pierre est partout chez elle en Bretagne », l’auteur (il vit dans le Pays bigouden) s’en donne à cœur joie. Défilent, aux fil des pages, les calvaires en pierre de Kersanton, les menhirs du pays de Guillevic, les forteresses et les citadelles, les cales de mise à l’eau au bord de la Rance, les quais minéraux de Concarneau ou du Guilvinec… Jean-Luc Le Cléac’h voit et collectionne. « Au début, les galets trouvés sur les plages de la baie d’Audierne », raconte-t-il. Puis sa curiosité s’est élargie à la mesure de ses escapades, notamment en Europe du nord. Il admire ces pierres aujourd’hui sur des étagères de sa maison : « grès paysager » ou « bloc de malachite » par exemple, ou encore ces pierres volcaniques ramenées d’Islande. Au point d’avouer ; « Dans le voisinage des pierres, je mène une vie recluse qui à certains égards n’est pas sans parenté avec la leur ». Pas question, pour autant, de figer le minéral dans un état. Rien ne plaît autant à Jean-Luc Le Cléac’h que « l’effacement » de « la frontière entre le minéral et le végétal ». Ainsi évoque-t-il ces racines du chemin qui « affleurent » et deviennent « lisses » au point de les confondre avec des pierres. «Je cherche les points de convergence, écrit-il, ce qui réunit, ressemble, rassemble ». Quant à la musique de la matière, dans son côté le plus élémentaire, elle peut surgir tout simplement à l’oreille de tout homme attentif : « Un frisson me parcourt l’échine au moment où la pluie commence à tomber à grosses gouttes sur la paroi de schistes bleus ».
La pierre, selon lui, suscite des plaisirs esthétiques parce qu’elle « revêt toutes sortes d’apparence pour nous séduire». La pierre, nous dit-il encore, il faut parfois la porter sur soi, la palper. «Instituer une nouvelle relation». Il cite à ce propos Delphine Horvilleur : « Poser un caillou sur une tombe, c’est déclarer à celui ou celle qui y repose, que l’on s’inscrit dans son héritage ». Jean-Luc Le Cléac’h en convient et peut écrire : « La mort et les pierres ont de tout temps été liés. À l’opposé des fleurs qui fanent vite, les pierres durent ».
Musique de la matière, Jean-Luc Le Cléac’h, La Part Commune, 2025, 110 pages, 13,90 euros
 |
Jean Le Besnerais, |
| Lettres d’un hôte à ta fenêtre |
|---|
À l’occasion d’une rentrée littéraire, il est habituel de mettre sur la sellette un premier roman. Saluons cette fois un premier livre de poésie. Son auteur, Jean Le Besnerais (il vit dans la région de Lille), propose une série de fragments en prose poétique dans lesquels il s’adresse à une personne absente qui lui est chère. Sous le titre Lettres d’un hôte à ta fenêtre, son livre est une vraie révélation.
Il mêle des leçons de sagesse à des considérations sur la solitude, sur le temps qu’il fait, sur la nature et sur la beauté : Jean Le Besnerais cultive un art de l’émerveillement et de la contemplation qui n’exclut pas un regard parfois acide sur les turpitudes de notre époque, « ce monde insensé qui s’offre à nos sens ».
Un poète parle, « dessinateur de mots sur papier libre », comme il le dit lui-même. Ce poète-là s’adresse à une personne « dont la lumière rôde autour de (sa) demeure ». On sait peu de cette personne (mais en dire moins, n’est-ce pas en révéler plus ?). Seulement qu’elle est artiste, qu’elle écrit aussi des poèmes et qu’une « différence d’âge » les sépare (à moins qu’elle ne les unisse). « J’admire ton intelligence sensible. Tu sais prendre le point de vue de toute âme en ce monde », lui écrit-il. « Tu parles de ce monde comme si tu l’avais vu en premier ». Éloge de la fraîcheur du regard, nous faisant penser à ces mots du cinéaste-poète Andreï Tarkovski : « Un poète est comme un enfant, il ne décrit pas le monde, il le découvre ».
Jean Le Besnerais ne reste pas figé à sa fenêtre. Il marche, il visite, il explore, il hume l’air du temps. Le voici au « lac du H. », à « la plage de T. G. », aux « jardins d’eau de A. », au « parc de l’abbaye de L. »… Il y fait provision de mots et de couleurs. « Prêter mes yeux à toute chose vue, veiller au surgissement de la beauté dans les communs ». L’écrivain Jean Sulivan ne disait-il pas : « Tout est encore à dire, les lieux communs peuvent devenir révélation ». Oui, « redoubler d’attention », nous dit Jean Le Besnerais. Mais, surtout, savoir se détacher, tourner le dos à l’excès, au trop-plein, à la possession. Démarche très franciscaine. « J’entends à tous les temps le verbe avoir conjugué dans les bouches, mais ce sont quelques résistants dont j’écoute la parole : ceux qui défendent, à corps perdu, la conjugaison de l’être à chaque espace ». Christian Bobin n’est pas loin.
En toile de fond, il y a de bout en bout cet appel à « investir » le présent, à le faire « si fort » qu’un « goût d’éternité » peut pointer au cœur. L’auteur (de formation scientifique) le dit dans une langue parfois « savante » d’où surgissent notamment des mots révélant une belle connaissance de la botanique. Jean Le Besnerais nous invite foncièrement à prêter son regard « à toute lumière rencontrée ». Une lumière qui peut émaner des fleurs, des arbres, des oiseaux ou d’un chat. Mais une lumière l’irradie, lui, en permanence : celle d’un hôte dont la présence-absence imprègne toute sa vie intime.
Lettres d’un hôte à ta fenêtre (depuis le temps que je regarde, Jean Le Besnerais, La Part Commune, 2025, 125 pages, 13,90 euros.
 |
Gérard Le Gouic, |
| Je suis né sans terre natale |
|---|
Sous un titre cultivant le paradoxe, Je suis né sans terre natale, Gérard Le Gouic nous parle de son ancrage cornouaillais, sa vraie terre natale, lui qui a vu le jour à Paris où il ne s’est jamais plu. « Enfant, je m’évadais par les fenêtres ». En Bretagne, il respire et nous le dit.
« Je ne veux pas revenir vers les théâtres de mon enfance », affirme le poète breton. Il a quitté « le sol d’une immense cité » (où il est né en 1936) pour rejoindre « les rêves d’un pays que je me croyais interdit ». Un pays dont il salue ici « les horizons, les aubes aux odeurs de terre,/le silence, les arbres, la liberté ». Il en avait eu un avant-goût durant ces vacances chez des grands-parents meuniers du côté de la Laïta. Une riche expérience sensorielle qu’il a évoquée dans Une rivière bretonne (éditions des Montagnes noires, 2024), remarquable évocation de ces temps passés au contact de la nature.
Gérard Le Gouic nous dit aujourd’hui vivre des « jours paisibles » dans sa « nef de Karmadeoua » dans l’arrière-pays de Pont-Aven après avoir été ce marchand de souvenirs bretons que l’on a connu sur la place de Quimper. « J’ai tenu humble boutique / à Quimper-Corentin centre-ville ». Et il ajoute parlant de Quimper : « Je ne cesserai de t’appeler ma ville (…) J’ai le sentiment d’être né de toi », écrit-il dans un hommage à la préfecture du Finistère.
Mais le temps passant, voici que « soufflent » aussi « les vents mauvais des souvenirs ». Gérard Le Gouic les rameute, par bribes, dans ses poèmes. « On vit d’attentes/et de printemps disparus », note-t-il. Mais il ne s’attarde pas, préférant glorifier le moment présent, dialoguer avec un rosier à sa fenêtre, s’émerveiller de ces « lunes blanches qui remplissent/de leurs glaces les bassins et les auges », s’émouvoir du « son grêle d’une cloche » ou être à l’écoute des « voix des génisses/pour l’hiver dans l’étable ».
De tout ce qu’il a amassé, il n’entend pas en faire un quelconque patrimoine. « Ne léguer ni terre ni toit, / que les arbres et les murs du poème ». Et il a même cette saillie : « Oyez ! / À ma disparition je lègue / mon corps à la science / entendez : à la poésie ». Mais le disant, il ne manque pas d’autodérision, se qualifiant de « poète mondialement inconnu ». Façon de mettre sur la plus haute marche ce qui constitue le fil rouge de toute une existence : la poésie, dont il dit qu’elle est « le jardin de la solitude ». Ce qui lui fait concevoir une « mort solitaires » car, de toute façon, dit-il, « elles le sont toutes ».
Le poète s’interroge : « Que savons-nous des instants ultimes / de ceux qui nous quittent dans leur sommeil ? ». Gérard Le Gouic qui vit aujourd’hui « entouré de morts » dont il est devenu le « gardien », fait un vœu avant de les rejoindre : « Je voudrais que les morts / nous voient du ciel encore ».
Je suis né sans terre natale, Gérard Le Gouic, Des Sources et des Livres, 2025, 100 pages, 15 euros
 |
Jacques Josse, |
| Vestiaire de la mémoire |
|---|
« Les faits parlent d’eux-mêmes », nous dit Jacques Josse dans un des textes qui composent son nouveau livre Vestiaire de la mémoire. Avec l’écrivain et poète rennais, nous touchons toujours au sensible, au vécu, à l’humanité dans ce qu’elle a de plus charnel. Toujours sur la base de faits réels « transfigurés » par une écriture qui fait revivre des êtres qui le hantent.
« La plupart d’entre eux ne sont plus de ce monde. Quelques uns sont partis sans faire de bruits mais non sans douleur », nous dit Jacques Josse. Ce sont bien ces hommes, ces femmes, souvent peu épargnés par la vie, que le Rennais n’a jamais cessé d’approcher dans ses livres. C’est en effet le fil conducteur d’une œuvre placée sous le signe de l’importance à accorder aux gens « de peu », sous le signe aussi d’une forme d’empathie et souvent de compassion. Né dans le Goëlo, Jacques Josse a bien connu toutes ces gueules cassées ou ces vies brisées, aussi bien issues de la campagne que du monde maritime. Voici qu’il nous les sort à nouveau aujourd’hui du « vestiaire de la mémoire » en reprenant des textes publiés en 1999 et 2001 (Un habitué des courants d’air et Ombres classées sans suite, Éditions Cadex), auxquels il ajoute quelques inédits.
Dans des textes de une à deux pages, on voit donc défiler tous ces êtres que la vie n’a pas souvent épargnés. « Hier soir, un homme s’est pendu avec la laisse de son chien. Les brumes de la vallée n’ont rien dit », écrit-il dans un texte intitulé En apesanteur. Voici Benoît B., 25 ans, « incapable – affirment les voisins – de faire du mal à une mouche (qui) a froidement abattu un inconnu avec une Winchester calibre 16 ». Tandis que « Là-bas un homme sort de l’ombre. Il se lève, reluque ses godasses, marmonne des paroles inaudibles. C’est le dernier d’une longue lignée, une espèce de relique… ». Plus loin voici qu’il nous parle d’une femme qui vole du linge sur les séchoirs.
Des hommes, des femmes. Des lieux aussi. Des cafés, des bars, une tombe, un hôpital, un bourg désert, un lavoir désaffecté, un rivage, les quartiers sud d’une grande ville, un quai… Toute une géographie (mentale et affective) qui porte la marque de l’auteur et que l’on retrouve invariablement au fil de ses livres. Des ombres s’y faufilent. Des destins se croisent. La camarde veille toujours. L’œil aux aguets Jacques Josse raconte ces vies sur le fil du rasoir.
Comme Paul qui vit « aux pays des voix immémoriales » (on aura reconnu le poète et potier Paul Quéré), Jacques Josse vit et écrit « loin des bavards et des hommes en vue » (n’a-t-il pas obtenu le Prix Loin du Marketing en 2014). Ses livres ne manquent pas non plus de références littéraires. Grand lecteur, y compris la nuit autrefois sur les sacs du tri postal où il travaillait, il nous évoque ici Bohumil Hrabal, Thomas Bernhard, ou encore Elfriede Jelinek. Il y a aussi l’hommage au marin-poète Alain Jégou, l’ami disparu, ou encore à Danièle Collobert. Incontournables poètes du vestiaire de sa mémoire.
, Jacques Josse a également publié en 2025 un petit livre titré Au bar de l’oubli (Le Réalgar, 60 pages, 7 euros) où l’on retrouve son univers.Vestiaire de la mémoire, Jacques Josse, Les Hauts-Fonds, 2025, 120 pages, 18 euros.
Jacques Josse a également publié en 2025 un petit livre titré Au bar de l’oubli (Le Réalgar, 60 pages, 7 euros) où l’on retrouve son univers.
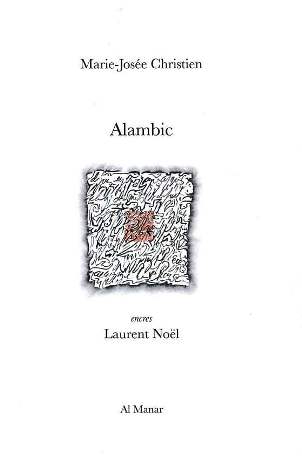 |
Marie-Josée Christien, |
| Alambic |
|---|
Sous le titre elliptique Alambic, Marie-Josée Christien nous propose rien de moins qu’une approche du pourquoi et du comment de la poésie. En une cinquantaine de poèmes courts, parfois aux allures d’aphorismes, elle sonde les mystères de l’origine de l’écriture poétique.
L’alambic, nous dit le dictionnaire, est un appareil pour distiller, en particulier l’alcool. Dès les premières pages de son livre, Marie-Josée Christien ne nous parle-t-elle pas (s’agissant cette fois de la poésie) d’un « élixir des mots / goutte à goutte / dans l’alambic de la nuit / secrète du silence ». Car ce silence ne serait-il pas le lieu ou le moment privilégié de l’expérience poétique ? On pourrait le penser à la lecture de son livre tant ce mot silence revient avec insistance au fil des pages. « La saveur du savoir / prend corps / dans le silence ». Plus loin : « Le silence /ne se contemple pas / il s’éprouve ». Ou encore ceci : « Je scande le silence / pour désapprendre /l’orgueil des savoirs dérisoires ». Le silence donc, encore et toujours, garant de l’émergence d’une vraie parole poétique.
Mais il y a plus que le silence dans l’alambic de Marie-Josée Christien. Au cœur de cette « alchimie intérieure » qui est la sienne, s’impose le poids de la mémoire. Ce qu’elle appelle « le limon de la mémoire » ou encore « les scories de la mémoire ». Nous sommes ce que nous avons vécu et le poème est là pour en témoigner. « On garde des souvenirs / pour se réfugier / quand on a froid », écrit-elle dans un poème triptyque dédié à Guy Allix, compagnon de route dans la poésie. « Toute langue est un temple / où s’enclôt le temps », écrit-elle ailleurs dans un hommage au poète Armand Robin.
On comprend donc que Marie-Josée Christien tienne, dans ce livre, à entretenir la mémoire de ces auteurs qui l’ont profondément marquée : de Glenmor à Xavier Grall en passant par Youenn Gwernig. Cela concerne aussi les artistes qui ont compté pour elle, à commencer par Marc Bernol (1940-2022), auteur d’encres ou de dessins destinés à certains de ses livres.
Dans le chemin de la vie, Marie-Josée Christien dit qu’elle avance « mot à mot ». Elle confie aussi se dépouiller des « mots morts-nés » parce que « vivre / exige / de se dépouiller / de tout / même /de l’attente ». C’est ce dépouillement (produit d’une distillation réussie) qui caractérise fondamentalement son nouveau recueil. Pas de gras. L’os à nu. Avec cette part de mystère qui entoure de nombreux poèmes. « Au fond des mots / se dépose /ce que je ne peux prononcer ». La poète peut alors, dans un forme de pirouette, clore son recueil par cette citation d’Apollinaire extraite de Alcools : « Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire ».
Alambic, Marie-Josée Christien, encres de Laurent Noël, éditions Al Manar, 85 pages, 19 euros.
 |
Estelle Fenzy, |
| Lisser les pointes |
|---|
Estelle Fenzy raconte poétiquement sa vie d’enseignante dans une ZEP (Zone d’éducation prioritaire). Son carnet de collège raconte les difficultés du métier mais sait aussi apporter de petites bouffées d’optimisme dans un milieu qui concentre de nombreuses problématiques sociales ou sociétales actuelles.
Le livre de Estelle Fenzy a été écrit alors que de lourds phénomènes de violence au cœur de collèges ou lycées n’avaient pas encore défrayé la chronique. Ce qui n’empêche pas l’auteure de nous faire toucher du doigt le profond malaise d’un milieu qu’elle connaît sur le bout des doigts. « Trente ans de ZEP. Des collections d’âmes bancales. D’enfance couronnées d’épines. D’humanité déglinguée. Concentrée. Je me demande comment c’est d’enseigner ailleurs. Les enfants ont-ils les mêmes fêlures ? Sans doute, oui. Il n’y a que leur profondeur qui change ».
Ce sont presque les derniers mots de ce carnet en prose poétique dans lequel Estelle Fenzy nous amène à prendre la mesure de cette lassitude qui peut parfois la saisir face à l’immensité de la tâche. « Tout fait défaut, écrit-elle, sauf le soleil et le vent » (nous sommes dans un collège de Provence). Certains jours, « le calme devient l’objectif. Le seul. Sinon rien n’est possible ». Alors, face au « bruit » et à la « brutalité », il faut parfois hurler. Mais l’enseignante raconte aussi que, le lendemain, ses élèves « tendent un fil entre ma planète et la leur ». Au bout du compte, elle avoue souffrir à l’idée « de ne pouvoir tous les sauver ».
Estelle Fenzy ne tombe jamais dans la caricature ou dans le misérabilisme, même si elle se compare volontiers à Sisyphe (« Répéter, reformuler, réactiver »). Elle aime ses élèves, elle les rencontre parfois au centre commercial et des regards s’échangent. Elle nous parle aussi de ses collègues de travail : cette enseignante, par exemple, qui ne sait plus « comment faire » ou cette femme du CDI qui a « demandé un mi-temps pour tenir ». Avec ce petit moment de respiration pour évoquer cet homme à tout faire du collège, « pinceau ou perceuse à la main » qui, au printemps, « sent l’herbe fraîchement coupée » et « à l’automne, les feuilles tombées ». Puis retour à des moments qui la révoltent quand, raconte-t-elle, un parent d’élève « ne viendra pas au rendez-vous que je sollicite » parce que « je suis une femme ».
C’est ainsi que passent les cours avec leurs joies ou leurs déconvenues. Estelle Fenzy ne nous dit pas ce qu’elle enseigne. Elle évoque avec humanisme un univers où il faut « s’adapter. Relier : des heures fourchues, lisser les pointes ».
Lisser les pointes, Estelle Fenzy, La Part Commune, 2024, 90 pages, 13,90 euros
 |
Sophie Tessier, |
| Les eaux froissées |
|---|
Les eaux froissées de Sophie Tessier sont celles de la Loire. Elle a côtoyé le grand fleuve sauvage au cours d’une résidence d’écriture à la Maison Julien-Gracq à Saint-Florent-le-Vieil. Elle tire de cette riche expérience un petit livre en prose poétique. On y découvre une auteure (elle est native de Rennes) qui soulève finement les enjeux de la crise écologique mais qui, surtout, part à la recherche d’elle-même à l’écoute du fleuve.
Qui parle dans ce livre ? Est-ce la Loire ? Mais n’est-ce pas plutôt Sophie Tessier ? « Si je pouvais, je brandirais d’autres couleurs, mieux assorties à ma colère », écrit la poétesse parlant de la Loire, mais on ne peut s’empêcher d’y voir ainsi révélées ses propres colères. Dans une dense préface, l’écrivain breton Alexis Gloaguen souligne à juste titre l’habileté de ce témoignage à double visage. « La Loire et l’écrivaine se présentent l’une à l’autre, écrit-il, mêlant comme en miroir ce qu’elles transportent dans une flux de molécules et de pensées ».
D’un côté une femme qui questionne la Loire et se questionne elle-même. De l’autre un fleuve que n’épargnent pas tous ces phénomènes actuels de pollution, avec ce « risque prochain de ne plus arborer qu’une généalogie de reflets morts », écrit Sophie Tessier. Aussi entend-elle la Loire lui faire cette confidence (à moins qu’elle ne parle d’elle-même) : « Aux grandes chaleurs qui piétinent le monde, je survis comme d’autres en me recroquevillant ». Les grandes chaleurs, donc, mais aussi les inondations, les déchets de toutes sortes (« sous la dorure des plages... les relents de vos pacotilles »), ou encore ces plantes invasives que l’exotisme (« sa fleur contagieuse ») a installé dans les eaux du fleuve.
Mais Sophie Tessier n’est pas ici pour rédiger un savant traité d’écologie appliquée. Tout juste un « testament pour la planète » encore à l’état de « brouillon » mais où, en quelques phrases percutantes elle pointe du doigt les dérives contemporaines. « Se creuse un lit de mort dans la ruine des fleuves », note-t-elle. « L’air s’est universellement tendu d’un dais plus noir ». Elle nous voit même « à l’orée du désastre ». À chacune de ses phrases, on ne peut s’empêcher de lire en transparence les propres troubles de l’écrivaine. « Les marques d’impatience qui meurtrissent vos jours se cicatrisent mal ». Une Loire blessée ? Sans doute. Une femme blessée ? Sûrement. « Le fleuve est toujours ce que l’on rejoint pour s’ouvrir à soi-même », confirme Alexis Gloaguen.
Malgré ses « fêlures », Sophie Tessier ne veut pas pour autant noircir le tableau. Il y a des issues de secours. La nature est là qui nous invite à la rejoindre. Ainsi cette « lévitation de libellules bleues » ou encore cette offrande de « la tige glabre de la renoncule ». Plus loin, c’est la vision d’un martin-pêcheur qui a « plongé son feu turquoise dans l’obscur ». Et, enfin, cette révélation plus qu’apaisante : « Dans le giron d’un arbre, un enfant lit ».
Les eaux froissées, Sophie Tessier, Diabase, 2025, 64 pages, 12 euros.
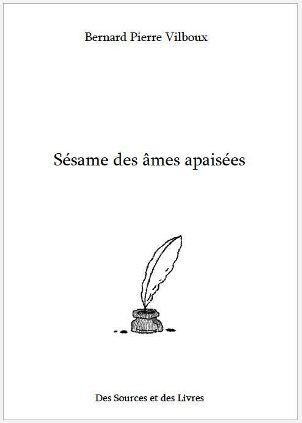 |
Bernard-Pierre Vilboux, |
| Sésame des âmes apaisées |
|---|
Le sésame dont il est question dans ce livre de Bernard-Pierre Vilboux est bien la poésie. L’auteur (né à Rennes en 1961) livre ici un vibrant hommage à des auteurs qui remplissent les rayons de sa bibliothèque. Mais il le fait avec cette conscience aiguë d’un certain effondrement de la poésie. Un sentiment exacerbé par la disparition de ceux qui pouvaient lui être les plus chers.
« Les poètes s’en vont / Chacun à leur tour / ils s’en vont par les chemins / Affronter leur nuit (…) Il s’en vont les Beaucarne, les Murat, les Lavoué, les Bobin »… nous dit Bernard-Pierre Vilboux. « La poésie ne se lit plus », « La poésie tombe en lambeaux », « Un temps, elle fut un art de vivre ». Pour affirmer son amour persistant de la poésie, il confie écrire lui-même des poèmes « sous les combles », dans un « bocage luxuriant ». Et, ajoute-t-il, « La poésie il convient de l’aborder / Avec mesure, jamais de front ».
Le poète Vilboux est d’abord un lecteur. Il a beaucoup lu et s’enthousiasme toujours à la lecture des figures tutélaires de la Beat Generation : Snyder, Ginsberg et quelques autres. Il a lu Brautigan, Emerson, Thoreau et Whitman (« Whitman coule dans mes veines »). Mais on le voit aussi emprunter les pas de Herman Hesse à Lugano ou ceux de Pasolini à Rome. Côté français, la liste est longue. Retenons l’hommage à Jaccottet « pour la pléiade des éléments que la plupart ignorent », à Bobin « parce que ses livres agissent même quand ils sont fermés », à Grall dont il vante « la mémoire granitique d’une mémoire monde »
Du poète il dit qu’il « donne à voir la face cachée de toute chose / Il aime à croquer le vivant, la mélancolie ». Vilboux s’y emploie lui-même, plutôt sur le registre humoristique ou sarcastique pour croquer ce vivant dont il prend le pari de tordre le cou, s’agissant par exemple de nos travers ou de nos petites manies. Ainsi lit-on avec délectation cet « inventaire à la Prévert » sur nos très indispensables objets du quotidien : sur l’aspirateur qui est là « pour avaler la dernière génération d’acariens », sur la tondeuse qu’on utilise « pour décapiter le peuple des pâquerettes », sur la cocotte-minute que l’on s’en va acheter « pour approcher les vendeuses du rayon électro-ménager ».
Bernard-Pierre Vilboux ne se prend pas au sérieux. Ce qu’il veut, c’est en lecteur et poète, « Voler ici ou là / Quelques bribes / D’existence / Pour l’éternité ». Ou, encore, « Escalader le verbe, encore et encore / Revenir sur l’ouvrage, toujours ». Ce qu’on appelle être un taulier de la poésie.
Sésame des âmes apaisées, Bernard-Pierre Vilboux, Des Sources et des Livres, 123 pages, 15 euros.
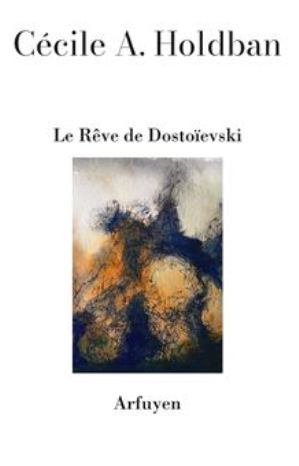 |
Cécile A. Hodban, |
| Le rêve de Dostoïevski |
|---|
De Cécile A. Hodban, son éditeur affirme qu’elle « possède un paysage imaginaire bien personnel » et qu’elle l’exprime à la fois dans la poésie et dans la peinture. C’est bien le cas avec Le rêve de Dostoïevski, livre au titre énigmatique dans lequel l’auteure associe sa démarche poétique à six grandes figures de la littérature, tous écrivains en marge.
Mais, d’abord, pourquoi Dostoïevski ? Parce que « un être qui s’habitue à tout, voilà la meilleure définition qu’on puisse donner de l’homme », affirmait le grand auteur russe dans ses Souvenirs de la maison des morts. Cécile A. Holdban cite cette phrase pour introduire son livre et en donner par le fait même, d’emblée, la tonalité.
Pour ce qui est du rêve (attribué à Dostoïevski dans le titre du livre), il s’agit selon elle de ce « désir insensé d’approcher la singularité de l’expérience humaine dans un monde disloqué. De faire alliance avec la vie, envers et contre tout ». Elle ajoute : « Le territoire du rêve est un entre-deux permanent, à la fois prolongement de la réalité et témoignage de l’impossible adhésion à celle-ci ».
On comprend donc que Cécile A. Holdban ait choisi de s’appuyer sur un « chœur de solitaires » pour exprimer cet entre-deux. Et pas n’importe lesquels. De ces « solitaires » célèbres, elle n’indique pourtant que le prénom et la première lettre du nom, à quoi elle ajoute une date ainsi que le nom d’une ville à laquelle on les identifie volontiers. Comme pour entretenir une forme de mystère autour de ces écrivains (Robert Walser, Franz Kafka, Mickhaïl Boulgakov, Fernando Pessoa, Samuel Beckett, Jorge Luis Borges). Marchant dans leurs pas, elle écrit des poèmes qui parlent d’eux mais aussi sûrement d’elle dans cet « entre-deux de la vie ». Petits morceaux choisis :
Robert W., Herisau, 1956 : « Ce matin nous n’étions / que quelques corneilles et moi / à picorer le bleu du blanc ».
Franz K., Prague, 1921 : « Le soir s’enroule / main de porcelaine / close sur sa rumeur ».
Mickhaïl B., Moscou, 1938 : « Ton angoisse craque / comme l’assise des vieilles chaises / sur lesquelles trop de temps a pesé ».
Fernando P., Lisbonne, 1916 : « Tu n’as plus de dieu / mais tu crois au chevreuil / à la lueur des matins ».
Samuel B., Paris, 1974 : « Sur la pierre l’eau glissera / polira les galets de mots / bousculera ton inquiétude ».
Jorge luis B., Buenos Aires, 1946 : « Là / où nous pensions / nous déplacer / d’un lieu à un autre / nous n’avons fait / que traverser le temps »
Ces vers extraits des chapitres consacrés à ces six écrivains sont ceux d’une poétesse qui entend témoigner de leur façon d’être au monde (et aussi de la sienne). « Je noue chaque matin / brin par brin / veine par veine / mon corps au monde », écrit Cécile A. Holdban. Pour autant, pas de désenchantement. « Buvons à la gravité du jeu / à la gravité de l’instant / à la gravité des corps ». Elle dit aussi faire confiance à « ce petit or / que chacun espère secrètement forger / dans la banalité du jour ».
En publiant un tel livre, Cécile A. Holdban réitère en quelque sorte une expérience littéraire engagée dans un précédent livre, remières à éclairer la nuitP (Arléa), où elle faisait parler quinze femmes poètes du XXe siècle dans des lettres (imaginaires) adressées à des êtres chers : un projet original et surtout ambitieux qui nous faisait traverser les plus grands drames du siècle passé. Avec Le rêve de Dostoïveski ce sont des drames plus personnels qu’elle nous laisse entrevoir, autour de la difficulté d’adhérer au monde tel qu’il est.
Le rêve de Dostoïevski, Cécile A. Holdban, Arfuyen, 2025, 176 pages, 16 euros.
 |
François de Cornière, |
| Ces traces de nous |
|---|
Rivé à son « atelier des instants », François de Cornière nous invite à partager poétiquement ces moments si ordinaires – mais si précieux – de la vie quotidienne. Parlant de lui, c’est aussi de nous qu’il parle. Le titre de son dernier livre est, à cet égard, bien évocateur : Ces traces de nous.
Avec François de Cornière, il ne faut pas s’attendre à de grandes envolées. Ce qui lui importe, c’est de « garder un invisible poids / dans des mots assez légers ». Lui que nous avons connu Nageur du petit matin (Le Castor Astral, 2015) sur la côte du pays de Guérande, ne rechigne toujours pas à se lancer, par tous les temps, dans la grande bleue. Il nous le raconte encore aujourd’hui : « La ligne d’horizon la mer / l’île posée juste dessus / moi nageant vers midi ». Avec sa compagne – car le nageur n’est pas toujours solitaire – il s’accorde de petits défis communs comme, par exemple, « aller jusqu’aux bouées blanches là-bas ». Pour un homme de 75 ans, ce n’est jamais négligeable de continuer à tester ce monde où il s’ébroue avec bonheur.
Ce monde, il nous le raconte à travers les petits riens de la vie. Casser des noix, par exemple, poser sur platine un disque de Nougaro ou de Stéphane Eicher, s’interroger sur un panneau de permis de construire, passer une soirée à la pizzeria… Il lui arrive même de faire un poème sur l’élastique jaune qui retient la chevelure de sa compagne. « Quand elle plonge dans les premières jaunes / il est éclatant // Quand elle l’enlève / il libère tout le reste de l’histoire // Et je ne sais vraiment pas par quel bout / se termine mon poème ».
Ainsi va François de Cornière avec ses « mots minuscules ». Ils lui « parlent d’une histoire personnelle / qui s’achève peut-être avec celle des autres ». Ces mots sont ceux qui scandent nos heures. Comment ne pas les reconnaître ? Qui d’entre nous n’a pas, un jour, lancé à la cantonade : « Je regarde si je n’ai rien oublié », « j’ai senti une goutte », « on a perdu une heure », « l’hiver s’est bien passé ? », « j’ai gardé ta polaire », « c’est toi qui a les clés ? », « on ne peut jamais savoir »… Le miracle, c’est d’en faire des poèmes. Mais cet inventaire « à la Prévert » (ou à la Philippe Delerm) va bien – on s’en doute – au-delà de ce prosaïsme lexical.
Dans ces poèmes qui ne cherchent pas à être des poèmes, pointe une forme de nostalgie, de chagrin enfoui, voire d’inquiétude que le poète exprime par ces mots : « Je ne guéris pas ma vie par la poésie ». Il fait même cet aveu : « C’est vrai je vis à l’écart / et l’écart a tendance à se creuser / de plus en plus pour moi ». Alors François de Cornière s’arc-boute, comme il le dit à cet atelier des instants « qui tiennent à pas grand-chose / mais qui me parlent encore // puisque c’est la vie ». Un lecteur avisé ne lui avait-il pas écrit ces quelques mots qu’il publie aujourd’hui dans son livre. « En fin de compte elles sont un peu compliquées / les choses simples que tu écris ». Car, effectivement, de Cornière a cet art consommé de magnifier la vie et l’instant présent tout en nous révélant leurs abysses cachés.
Ces traces de nous, François de Cornière, Le Castor Astral, 160 pages, 15 euros. À signaler la parution simultanée de son anthologie personnelle Un peu de nos vies (éditions Points Poésie)
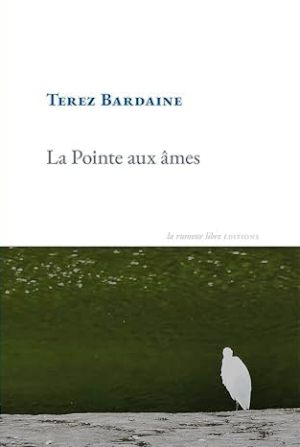 |
Terez Bardaine, |
| La pointe aux âmes |
|---|
« Je pars en exploration de ce quelque chose d’indéfinissable qu’on appelle l’âme », nous dit Terez Bardaine à propos de son nouveau livre. Pour être à la hauteur de l’immense défi qu’elle se donne, elle fait appel au poème. Parce que dit-elle, « le poème est la pointe aux âmes ».
L’âme, c’est ce qui signe notre personnalité profonde, aimait à rappeler l’écrivain et poète François Cheng, auteur du fameux Livre De l’âme (Albin Michel 2016). Il citait dans son ouvrage ces mots de son ami Jacques de Bourbon Busset : « L’âme est la basse continue qui résonne en chacun de nous ». Nous y sommes. Il y a bien, en effet, cette basse continue dans le livre de Terez Bardaine. Elle est d’abord alimentée par une histoire familiale vécue au plus près de la nature. L’autrice a connu la vie de la ferme, au contact des animaux, à commencer par les vaches qu’elle évoque dans le dernier chapitre de son livre intitulé « Réminiscences ». La voici se nourrissant de la chaleur d’une vache alors qu’elle l’attache, la voici nous racontant la séparation du veau de sa mère… Aussi peut-elle nous inviter « à percevoir cette vibration qui nous relie au monde animal ou végétal ».
La basse continue de Terez Bardaine, c’est aussi le lien resté charnel avec les disparus. Ici une mère « au bord de la tombe de son fils ». Là un père dont elle reconstitue la figure en cousant à ses propres mots des mots extraits de l’œuvre poétique de Xavier Grall. Fine experte de la littérature scandinave (Ah ! le Norvégien Tarjei Vessas), elle peut aussi bâtir un poème intitulé « ma consolation » en référence à l’écrivain suédois Stig Dagerman dont on connaît le fameux petit essai intitulé Notre besoin de consolation est impossible à rassasier.
Le besoin de consolation de Terez Bardaine est immense. Le poème est une planche de salut en continuant « coûte que coûte / à créer écrire / à l’envers du temps / contre l’air du temps ». Elle peut même aller jusqu’à cultiver une forme de confiance : « Le temps est au poème / à l’éternel recommencement / aux fois toujours premières / quand on vit au présent ». Ce qui n’empêche pas de lancinantes références à la mort au cœur de son livre. « Pense à ce que tu ne peux comprendre / cette réduction à néant / des corps de celles et ceux à qui nous disons adieu ». La voici même évoquant sa propre disparition. « Que l’on fasse de mon corps inerte / soupe pour les poissons ou les oiseaux de mer ». Elle invente, pour l’occasion, le mot d’aquamation (à rebours de la crémation) après l’usage d’un procédé de « réduction organique naturelle » du corps.
Terez Bardaine n’a pas peur de nommer crûment les choses. Elle nous dit ses angoisses, mais aussi ses ferveurs, avec le point d’ancrage que peut offrir à nos vies une littérature explorant les tréfonds de l’âme humaine. Elle rend hommage à ceux et celles qui lui ont apporté beaucoup dans la vie. « Le souvenir est une plante vivace », nous dit-elle.
La pointe aux âmes, Terez Bardaine, La Rumeur libre, 115 pages, 16 euros.
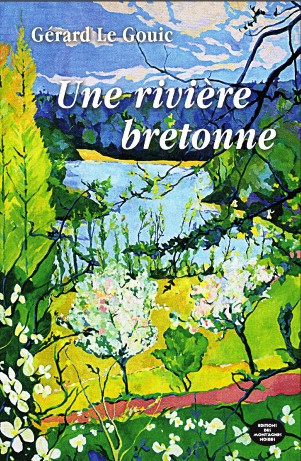 |
Gérard Le Gouic, |
| Une rivière bretonne |
|---|
La rivière bretonne de Gérard Le Gouic, c’est la Laïta. Elle est le fil conducteur d’une très touchante chronique familiale. Le poète breton évoque ici ses années d’enfance, « le temps des vacances d’été », auprès de grands-parents paternels qui exploitaient un moulin en Cornouaille. Ici pas de cliché, pas de folklore. Une parole nue et forte dans l’ombre tutélaire d’Auguste Brizeux.
En une série de tableaux poétiques (faut-il dire « prose poétique » ?), Gérard Le Gouic, qui vit dans l’arrière pays de Pont-Aven et de Concarneau, propose une plongée dans un monde rural disparu et plus précisément, ici, dans « l’histoire simple » de sa « famille meunière ». Il le fait en s’inspirant directement de vieilles photographies prises par son père. Le lisant, on pense à un autre poète breton, Armand Robin, qui s’est aussi appuyé sur des photos réalisées dans son pays natal de Rostrenen pour écrire Le cycle du pays natal (La Part Commune, 2010). Gérard Le Gouic, lui, ne publie pas les photos. Ses textes parlent d’eux-mêmes avec une puissance d’évocation qu’il faut ici saluer.
C’est ainsi que la Laïta devient sous sa plume une forme de Létâ de la mythologie grecque. Il parle du « cheminement hésitant de son corps mouvant ». Il la dit « casanière de sa propre progression immuable comme une lave ». Entre palude, « couleur d’une dépouille » et falaise de granit, la Laïta irrigue le livre. Sur ses bords, s’ébroue une parentèle dont il cerne les différentes personnalités et notamment « ce grand-père qu’on pourrait croire l’hôte essentiel de l’espace ». Autant d’images furtives qui englobent aussi un « molosse au pelage noir », un « morne cheval », une « chèvre barbue » ou « des biquettes » auxquelles le petit Gérard « offrait sa complicité ». De cet univers à part, il en tire aujourd’hui – revisitant des photographies – « d’infimes instantanés dont l’accumulation érige l’éternité », ainsi qu’il l’écrit lui-même. « Des ombres menues se répandaient entre les herbes comme des cortèges tâtonnants de fourmis ».
C’est sous ce ciel de Cornouaille (« le moutonnement d’un ciel et ses bans de sable à la dérive ») que le jeune Gérard a sans doute appris à « s’abreuver de la vie en maraude ». Mais le voici se retrouvant sur une photo alors qu’il n’a que 2 ou 3 mois : « Ronde est sa bouille, clairsemés ses cheveux blonds ». Et aujourd’hui il peut affirmer : « Je n’aurais pas pu me développer ailleurs ».
Ce livre, il l’écrit aussi dans le sillage du poète breton Auguste Brizeux (1803-1858), son « poète bien-aimé » qui, lui aussi, chanta « le doux Létâ » (« Et coulent les vers de Brizeux dans mes veines »). Ce retour à la rivière, comme un leitmotiv musical au cœur du livre, devient vite le symbole fort du temps qui s’écoule inexorablement. « Elle n’a peur de rien parce que n’ignorant rien de sa destination », ajoute Le Gouic parlant de sa rivière bretonne.
Une rivière bretonne, Gérard Le Gouic, Éditions des Montagnes Noires, 120 pages, 12 euros
 |
Chantal Couliou, |
| Des restes de bleu |
|---|
Chantal Couliou aime le bleu. Est-ce parce que cette couleur lui manque trop souvent, elle qui vit au bord de la rade de Brest ? Dans un court recueil, conçu sous forme de haïbun (texte en prose incrusté de haïkus), elle nous propose en tout cas une « échappée bleue » où elle décline toutes les nuances du bleu.
« Même la mer s’est adaptée aux exigences du bleu ici, à l’extrême pointe Ouest », affirme d’emblée la poétesse bretonne, prix Paul-Quéré 2022 pour son livre Une traversée de soi. Alors, elle en fait son festin de ce bleu-là. « Du plus clair au plus foncé ». Forcément quand ce bleu est intense, il « rend la vie plus légère », Et du bleu du ciel il n’y a qu’un pas avec ce qu’elle porte sur elle : « J’aime ce petit vent fripon qui se glisse sous ma robe de coton bleu pâle ». Le moment est alors venu de boire « un verre de rosé bien frais tout en observant le ballet des goélands sur la rade ».
Chantal Couliou n’est pas la seule à décliner le bleu, couleur fétiche de tant d’artistes. On se souvient des bleus de l’écrivaine Anne-José Lemonnier, disparue en 2024. La baie de Douarnenez était son horizon. Mais comment ne pas souligner ici la parenté de regard entre ces deux femmes : la même sensibilité à la nature, l’aptitude à la contemplation, l’art de traduire par des mots ces nuances subtiles de la météo du bout du monde.
Ce bleu, Chantal Couliou l’a encore plus ressenti au moment de la pandémie. Avec ses mots à elle, voici qu’elle évoque « les mots bleus ». Ceux de la célèbre chanson de Christophe. L’artiste avait été transféré à Brest par TGV médicalisé. C’est là qu’il décédera le 16 avril 2020. « De l’immeuble voisin s’envole Aline », raconte Chantal Couliou évoquant la célèbre chanson de Christophe. Voici donc, de sa part, « Un hommage modeste à un homme victime d’un virus tueur qui n’épargne personne ».
Mais le bleu souvent s’absente. C’est le gris qui s’installe et pourquoi pas le blanc, plus fugitivement. Il a neigé à Brest. « Le silence me réveille ce matin ». Et elle a bien raison de rappeler que « la neige est si rare ici à l’extrême pointe bretonne ». Aussi peut-elle écrire ce haïku : « Le blanc a tout gommé / sauf les rires d’enfants / batailles de boules de neige ».
Chantal Couliou parfois s’évade. Son livre devient alors un carnet d’escapades dans divers horizons : chez un poète ferrailleur à Lizio, aux environs de Mirepoix en Ariège, à l’abbaye bénédictine d’En-Calcat, au Mont Saint-Michel où elle note « les pèlerins accrochés à leur smartphone et adeptes du selfie à tout crin ». Et puis voici une virée à l’île Molène. « Le ronron des moteurs / dans le bleu infini de l’île / marche à pied ». Le bleu, toujours le bleu…
Des restes de bleu, Chantal Couliou, illustrations Yves Barré, Gros Textes, 66 pages, 8 euros.
 |
Marc Baron, |
| Tant que le poème n’aura pas dit son dernier mot |
|---|
Marc Baron a de la constance. Il écrit la nuit et avoue que le poème est sa « seule issue ». Il invite donc ses lecteurs à lire ou relire « les poètes qui traversent l’obscurité ». Nuit métaphorique, bien sûr, celle qui laisse entrevoir une aube nouvelle dont le poème est le premier témoin.
Ne dit-on pas volontiers que le poète est un veilleur? C’est bien le cas de Marc Baron dont l’écriture se nourrit de la nuit. « La nuit c’est mon heure / j’entends ce que le monde dit », écrit-il. Auteur fécond d’une trentaine de livres, organiste à Fougères où il a dirigé le Salon du livre pour la jeunesse, Marc Baron (né en 1946) confie que « écrire est une violente avancée dans le chant ». Son nouvel opus est un véritable traité d’art poétique. Mais rien de savant. Aucune approche théorique. Non, dire tout simplement le surgissement du poème « dans une terre jamais labourée ». Dire aussi que la poésie est un art du peu et de l’humilité. « N’écris pas pour éblouir // les mots t’ont choisi /non pour ton paraître / mais pour le fleuve caché que tu suis ». Ce fleuve caché charrie « une braise intime et vivante ». Marc Baron est du côté du « oui » à la vie en dépit de « ce monde où le bruit défait la semaison » et où arrivent « jusque chez nous / les poussières de la guerre ». Ailleurs il parle de « ténèbres si envahissants » ou de vie « si violente ». Écrire un poème, pour lui, c’est prendre acte de « chaque bonheur gagné sur l’obscurité ».
Le poète ancre son propos dans une pauvreté assumée aux allures franciscaines. « Il est temps de remettre le poème à sa place / dans les contrées les plus reculées de l’insignifiance / dans l’oubli les coins perdus ». Non au poème poudre aux yeux car, dit-il, « le poème n’est jamais en représentation ». Ce qui l’amène à fuir « les poèmes de surface ». Ce qui le motive, bien au contraire, c’est la profondeur (« le poème, c’est un puits dans l’herbe brûlée »).
Dans le sillage de Christian Bobin, pour qui la poésie n’était pas un genre littéraire, Marc Baron nous amène à considérer que le poème véritable est celui que nous inscrivons au cœur de nos propres existences. Un poème/vie qui « oublie la vanité », qui « m’ordonne de me relever » et à « chercher le souffle dans le rien ». Il rejoint aussi les propos du délicat écrivain italien Marco Lodoli évoquant la poésie comme « une attitude de fond, un regard sur le monde qui pénètre au plus profond, entre la lumière et l’ombre ». Profondeur, redisons-le, qui irrigue ce livre de Marc Baron, notamment, par les nombreuses références faites au puits. Un puits qui « désaltère » mais dans lequel il faut descendre car « la rencontre c’est le profond ».
Noter enfin que le poète fougerais (« 1 mètre 62, 61 kilos ») qui se qualifie volontiers de « poète de poche » entend écrire avec ses « mots d’enfant » et ses « racines ». Jusqu’à affirmer « je n’écris pas pour la gloire / mes poèmes le savent / je suis né dans les terres de mon père et de ma mère / avec les fruits et les légumes /et tout ce qui pousse dans un total anonymat // j’ai toujours su que mes poèmes finiront dans une fausse commune ». L’humilité, toujours l’humilité.
Tant que le poème n’aura pas dit son dernier mot, Marc Baron, frontispice de Julius Baltazar, éditions Le Taillis Pré, 145 pages, 17 euros
 |
Lucie Grall, |
| C’est toi qui mènes la danse |
|---|
Elle est une mère « brisée » comme le sont toutes les mères qui perdent un enfant. Lucie Grall raconte dans un livre émouvant la disparition de son fils aîné, décédé à l’âge de 25 ans. Poèmes de l’absence et de la douleur d’une « âme navrée » et au « cœur déchiré ».
Il s’appelait Tanguy et mordait la vie à pleines dents. Rebelle, « anar », il voulait connaître le monde sous toutes ses coutures. « Ton appétit de vivre toutes les fraternités / dans l’ivresse des fêtes et des joies de l’été ». Voilà un jeune homme qui était « parti chercher la promesse de la vie (…) vers « les rimes du soleil et de l’olivier ». Mais la camarde rôde. C’en est très vite fini pour ce « guerrier forcené ». S’engagent alors trois années de combat contre la maladie.
Pour parler de la perte, Lucie Grall rameute les souvenirs. D’abord celui de l’enfant que fut Tanguy (« tes petits pieds chauds de bébé sur ma peau »). Car c’est bien cet enfant-là qui s’en va et qui fait d’elle cette maman en détresse tentant de barrer la route à l’inéluctable. « Mon grand, mon tout petit / ne t’en va pas / agrippe-toi aux grelots de ma voix ». Mais le fils s’en va. À l’hôpital, à son chevet, la mère compte « ces heures perdues dans les couloirs glacés ».
Très peu d’années après, elle affronte avec ses mots l’heure fatidique du départ. Et même cette stupeur muette au sein de la chambre mortuaire. « Pas un cri, pas un sanglot / pas même un chuchotement / dans le silence nu et glacé ». Des obsèques, elle dit qu’il furent « un jour si lourd de douleur / tissé au point de croix / à l’écheveau des peines ». La mort de Tanguy frappe de stupeur les amis, la parentèle. Quand au père, Youn, il masque son chagrin dans le labeur « Remuer la terre / semer pailler moissonner / il a tant à faire / pour tenter de tarir cette douleur ».
Écrivant ce livre, Lucie Grall retrouve parfois les accents des poèmes de son père Xavier. Car bon sang ne saurait mentir. On trouve ainsi dans ses textes fiévreux cette forme d’exaltation qui exprime la présence éternelle d’un disparu. « Tu vis au bord de mes rêves (…) Ta voix console et murmure (…) Mais d’où vient-elle cette voix ? ». Lucie Grall formule au passage le vœu que son fils ait retrouvé son grand père. « Je veux croire que vous êtes aujourd’hui l’un près de l’autre. Le cœur à l’unisson, le cœur en paix ». Dans l’instant, il y a aussi ces signes mystérieux d’un contact avec l’au-delà. Ainsi cette complicité étonnante avec le chant d’un oiseau, « solitaire passereau / à gorge coquelicot / qui ravigote et console ». Comme si le fils interpellait sa mère par un chant.
C’est toi qui mènes la danse, Lucie Grall, La Part Commune, 65 pages, 13,90 euros.
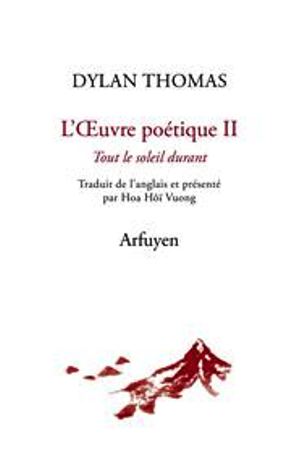 |
Dylan Thomas, |
| L’œuvre poétique II, Tout le soleil durant |
|---|
Le 2e tome, en édition bilingue, de l’œuvre poétique complète de Dylan Thomas vient de paraître aux éditions Arfuyen, sous le titre Tout le soleil durant, après un 1er tome publié en 2024. La complexité de l’écriture du poète gallois n’a pas rebuté son traducteur, Hoa Hôï Vuong, qui nous donne ici des clés pour aborder l’œuvre d’une personnalité excentrique.
Né à Swansea en 1914 sur la côte du Pays de Galles, Dylan Thomas est mort en 1953 à New-York. Il repose dans son pays natal, au cimetière de Laugharne. Sa vie n’a jamais été un long fleuve tranquille. Il beaucoup bourlingué, passant du pays de Galles à Londres, puis à New-York. Avec des allers-retours incessants. Il publie son premier recueil en 1934 grâce à un prix local, il enregistre des émissions de radio pour la BBC, publie en 1940 un recueil de nouvelles (Portrait de l’artiste en jeune chien). Puis autres recueils de poésie avant qu’on le retrouve scénariste de films.
Le 2e tome de son œuvre poétique complète chez Arfuyen comprend son quatrième recueil intitulé Morts et entrées, publié en 1946, ainsi que son dernier recueil, Dans le pays du sommeil, publié lui aux États-Unis en 1950. Ce sera le point de départ d’une tournée de conférences et d’enregistrements de ses lectures à New-York. Il attire pour l’occasion à la poésie un large public. À noter enfin que ce 2e tome comprend aussi de nombreuses pièces jusqu’à présent inédites en français.
À propos de Dylan Thomas, son traducteur a ce commentaire : « Pour le poète gallois, écrire, c’est mourir au milieu de la vie et vivre au milieu de la mort ». Cette mort, il l’évoque précisément dans Morts et entrées truffé de références aux drames de la Seconde guerre mondiale. Parmi les victimes d’un raid mené à l’aube, il y avait, nous dit-il, un vieillard centenaire dont il parle en ces termes : « À l’heure où le matin se réveilla face à la guerre, / il s’habilla, passa le seuil, et mourut, /boucles bées, loquets bâillants, tout explosa en l’air, / il tomba où il avait aimé, sur les pavés fendus, / au pied de cette boucherie, parmi les grains funéraires ». Plus loin, il parle de cet enfant « qu’aucun chant de coq ne touchera plus ».
La tonalité est différente Dans le pays du sommeil. On y trouve une « senteur terrienne », note le traducteur, qui nous ramène plus volontiers aux terres natales de l’auteur. Comme dans ce très beau poème intitulé « Fern Hill », où le poète gallois retrouve une forme de simplicité qui contraste avec ses textes les plus excentriques. « Du temps-ci que j’étais jeune et à mon aise sous les branches du pommier, / Pas loin de la maison allante, et heureux autant que l’herbe était verte / Et la nuit sur le val étoilée, / En ce temps qui voulait bien que j’aille grêler / Et grimper dans l’or des beaux jours de ses yeux… » Dans sa Correspondance (La Part Commune, 2024) Dylan Thomas écrivait : « Un bon poème est une contribution à la réalité. Le monde n’est jamais plus le même lorsqu’un poème s’y ajoute. Un bon poème contribue à changer l’aspect de l’univers. Il aide à étendre les connaissances de chacun sur chacun et sur le monde qui l’entoure ».
L’œuvre poétique II, Tout le soleil durant, Dylan Thomas, traduit de l’anglais et présenté par Hoa Hôï Vuong, édition bilingue, Arfuyen, 336 pages, 24 euros
 |
François Cheng, |
| Une nuit au cap de la Chèvre |
|---|
François Cheng a choisi la Bretagne pour un livre en forme de testament. L’écrivain et poète d’origine chinoise (95 ans), académicien, a été « saisi » lors d’un séjour au cap de la Chèvre à la pointe de la presqu’île de Crozon. Il nous parle du Cosmos, de la Vie et de la Mort. Un petit livre qui résume bien l’itinéraire d’une existence féconde, ouverte sur le monde et sur les autres.
Une nuit au cap de la Chèvre. Ce pourrait être le titre d’un polar. Mais le titre de ce livre, nimbé de mystère, nous renvoie à une expérience personnelle qui a profondément marqué François Cheng. Le voici, grâce à une amie qui possède une petite maison sur ce bout de rivage finistérien (et qui la lui confie), plongé dans une nature puissante et envoûtante. Il y a d’abord le fracas répété des vagues qui, après l’avoir envahi, voire obsédé, lui révèle « l’ampleur cosmique du phénomène », suscitant progressivement chez lui « une sensation de bercement quasi enivrante ». Puis, levant la tête vers le ciel étoilé, il voit « le cosmos dans son étalement au sein de l’espace ».
Ce contact avec une nature brute et enveloppante suscite de sa part toute une méditation mi-poétique mi-philosophique sur la place de l’homme dans l’univers, sur ce qu’il appelle aussi « le don de la vie » qui nous pousse « vers l’urgence de vivre, en vue d’une forme d’accomplissement et de sublimes dépassements ». François Cheng reprend ici, en les épurant, des considérations qui furent au cœur de son livre à succès intitulé Cinq méditations sur la mort et donc sur la vie (Albin Michel, 2013, Livre de poche, 2015 et 2019).
On retrouve aussi, dans ce livre, ces liens subtils qu’il établit entre le taoïsme (le courant spirituel dont il est issu) et le christianisme. « Celui qui cède à l’amour en se donnant au monde, à lui sera confié le monde » est cette prédiction du Tao qu’il cite dans son livre, rappelant le message « d’amour radical » exprimé de son côté par le christianisme. C’est d’ailleurs sur ces bases poético-spirituelles qu’un échange fécond a pu s’engager, dès la fin des années 1990, entre François Cheng et le moine-poète Gilles Baudry de l’abbaye de Landévennec, implantée à quelques encablures du cap de la Chèvre. C’est la poésie qui a beaucoup réuni les deux hommes. François Cheng, qui dit « venir d’un pays héritier d’une poésie ininterrompue depuis trois mille ans », raconte, dans son livre, son approche de la poésie occidentale par le mythe d’Orphée. « Par son chant qui s’apparente à la prière reliant les vivants et les morts, il est en constant rapport avec la transcendance qui anime les être par le Souffle vital ».
Puis vient le moment de quitter ce cap de la Chèvre où il a fait un court et fructueux séjour. « Le hasard du destin, écrit François Cheng, m’a déposé sur ce rivage de la terre d’Extrême-Occident, là où finit le continent eurasiatique, en Finis-Terre ». Comme si la boucle était bouclée, lui venu un jour d’Extrême-Orient.
Une nuit au cap de la Chèvre, François Cheng, Albin Michel, 2025, 74 pages, 12,90 euros
 |
Bluma Finkelstein , |
| Pour tout l’or du Rhin |
|---|
Bluma Finkelstein a des comptes à régler avec Dieu. La poétesse israélienne le dit dans un livre à la tonalité plutôt sombre où lui reviennent en mémoire, par bribes, les drames suprêmes de la Shoah et où elle s’alarme de la cruauté d’un monde qui n’en finit pas de décliner le massacre des innocents.
Pétrie de culture judéo-chrétienne, Bluma Finkelstein, professeure émérite de l’université de Haïfa, apostrophe un Dieu tout-puissant qui assiste impuissant au désordre du monde, suscitant de sa part cet avis : « Clore le chapitre de la miséricorde divine ». Elle le dit dans de courts textes en prose poétique particulièrement percutants, le plus souvent désabusés. « Je suis fière de ma place dans le cendrier de l’humanité ». Ailleurs, parlant de la résurrection de Lazare voulue par le Christ, elle écrit qu’il « ne sortit pas de sa tombe », mais « ne cessait de courir dans les couloirs surchauffés de Birkenau ». Plus loin, évoquant le Massacre des Innocents évoqué dans l’Évangile, elle a cette remarque douloureusement ironique à l’adresse d’un Messie qui, comme le raconte l’Évangile, sauve sa peau : « Je te félicite, car tu es revenu en bon état, sans même une égratignure ».
Quant à la Terre d’Israël, faisant référence à ce pays décrit dans la Bible comme étant celui où coule le lait et le miel, elle ces mots très durs : « Ton lait ne m’a pas désaltérée. Ton miel m’a rendue malade, j’ai dû me piquer à l’insuline ». Et, au bout du compte, ce terrible aveu : « je n’espère plus (…) je ne suis qu’une anonyme de passage dans une longue histoire d’errance ». Cette histoire d’errance est bien sûr celle des Juifs. Elle est aussi celle de tous les errants contemporains, « toujours les mêmes déplacés, chassés, déportés (…) ils chantent en arabe et en hébreu ».
Pour autant, doit-on se contenter d’un cri de désespoir ? Avoir été « formatée à la douleur » est une chose. Mais il y a eu, avant, « la trame d’une vie heureuse » et aussi ce « passé lointain qui nous semblait plus accueillant que ce qui nous attend ». Aussi La poétesse peut affirmer : « Mes nostalgies sont restées prisonnières de la beauté du monde ». Est-ce suffisant pour tenir debout ? Pas certain du tout, à cause de cette « machine infernale qui tourne sans arrêt ». Alors, écrire pour s’en sortir ? Oui, mais « c’est comme mourir pour la patrie en se croyant utile », affirme Bluma Finkelstein.
Malgré tout une petite lueur d’espérance palpite encore. « Cependant on avance, on continue le combat contre le temps, on arrose la terre de notre sueur et on envoie au bon Dieu des suppliques sans valeur ». Cette supplique, par exemple : « Pour tout l’or du Rhin, nourris ton peuple de cette manne fraîche, comme le coton. Donne-lui, le pot de viande laissé sur le feu en Égypte ».
Dans un précédent livre, La dame de bonheur (Diabase, 2019), Bluma Finkelstein avait sorti sa « grammaire de survie », affirmant que « le bonheur est l’effet de la connaissance ». Elle le dit encore, implicitement, aujourd’hui, mais en empruntant un chemin semé de doutes.
Pour tout l’or du Rhin, Bluma Finkelstein, Diabase, 2025, 81 pages, 14 euros.
 |
Yvon Le Men, |
| Un soir d’avoir été |
|---|
Chez Yvon Le Men, il y a toujours « un pays derrière le chagrin ». On le sait depuis la parution en 1979 d’un de ses livres portant ce titre (éditions Les Presses d’aujourd’hui). Cette fois-ci, on le retrouve parlant d’un ami mort de la tristement célèbre maladie de Charcot. Pour en parler, il va disperser sur la page blanche des vers mis deux par deux (avec du blanc autour) comme pour signifier le besoin de retrouver sa respiration et de ne pas se laisser envahir par l’émotion. Texte éclaté, donc. On pourrait même dire en morceaux, mais dont des mots rebondissent l’un vers à l’autre, dans une forme de balbutiement. « Respirer / expirer // vivre / entre ces deux verbes // par le verbe / espérer // respirer / d’avoir respiré // le parfum de la rose / le jour de la première fois // l’odeur du pain frais / un matin d’avril ». Nous parlant de cette existence désormais corsetée, Yvon Le Men persiste à faire le choix de la vie. Un mot vie » qui avait donné la tonalité de son premier livre précisément intitulé Vie. C’était il y a déjà plus de 50 ans, en 1974. En racontant avec ses mots d’aujourd’hui cette vie empêchée de Philippe, le poète rameute les souvenirs, les complicités, les bonheurs du jour (par exemple autour d’un Romanée-Conti). Liens indéfectibles de la vraie amitié, sous le regard chaleureux de Chantal, la femme de Philippe (« Car la vie est là / elle a les yeux // de Chantal »). Racontant tout cela, Yvon Le Men nous amène aussi à changer notre regard sur la dépendance, la maladie, la fin de vie. Il faut dire que Philippe, de son vrai nom Philippe Bail (1951-2024) avait en quelque sorte précédé Yvon Le Men en publiant en 2023 un livre sous le titre Fidèle comme une ombre, journal d’un médecin malade. Il racontait avoir exercé la médecine générale à Lannion pendant trente-cinq ans après avoir investi dans la formation médicale et enseigné les soins palliatifs aux professionnels de santé. Atteint de cette maladie qui allait l’emporter un an plus tard, il pouvait déclarer : « J’ai été Charlie en 2015, aujourd’hui je suis totalement Charcot ». Cet homme-là, raconte Yvon Le Men, « avait dit / je me tuerai // si je ne peux pas me laver seul // aller aux toilettes / seul ».
En ces temps où la question de la fin de vie est au cœur de préoccupations contemporaines, le livre de Yvon Le Men apporte une contribution poétique au débat. « Tes rêves, dit le poète à son ami, sont plus grands que ta vie ». Un soir d’avoir été, Yvon Le Men, Éditions Bruno Doucey, 2025, 208 pages, 18 euros.
Cet homme dont parle Yvon Le Men est prisonnier de son corps. « C’est par un filet de voix / de sa voix // qu’aujourd’hui nous remontons / à la source // je m’approche / il se lève ». De cet homme, le poète dit qu’il est « inoffensif » dans « ce monde qui ne l’est pas « il souffre / par son âme // qui se tait / malgré les mots qu’il a ». Cet homme, qui était son ami, a la « paupière épuisée », a des lèvres « qui se serrent sur ses mots ».![]()
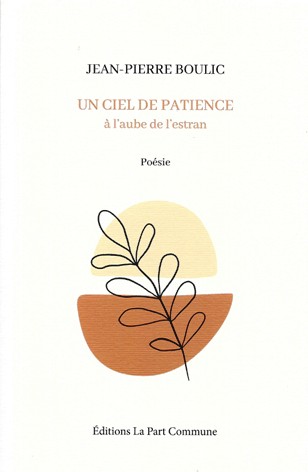 |
Jean-Pierre Boulic, |
| Un ciel de patience |
|---|
Dans un précédent recueil, Quelques miettes tombées du poème (éditions Illador), Jean-Pierre Boulic avait entonné, dans cette veine mystique qui est plus que jamais la sienne, le chant de la Création. Le voici, dans un nouveau livre, creusant le sens du poème et de la vie en poésie. Mais toujours sous les cieux capricieux (mais inspirants) du pays d’Iroise où il réside.
Le Ciel de patience, qui donne son titre à ce nouveau livre du poète breton, se nourrit de sensations éprouvées « sous la pesanteur des heures ». Plusieurs mots-clés émergent au fil des pages : « Lumière », « souffle », « silence », « chant », « présence »… Autant de mots à même, selon le poète, de « déchiffrer les paysages de l’âme ». Il suffit pour cela, parfois, de simples « reflets sur les galets », de « nuées d’oiseaux » qui « effleurent les eaux », du « cri d’un passereau » qui « ébrèche le silence » ou d’un « vrai parfum de varechs ». Même « l’estran est trouvaille ».
La poésie peut ainsi être faite, de bout en bout, avec ces petits riens. Il faut pour cela cette « attention soutenue » (comme le disait Czeslaw Milosz) à ce qui advient. Ce que Jean-Pierre Boulic appelle une quête des « Signes et prodiges / De la création ».
Le poète n’est pas avare de mots pour le dire. Encore faut-il être à même de « servir le mot juste ». C’est à cette condition que des mots, comme il le dit, peuvent « se risquer » sur « la feuille blanche ». Oui, dire avec ces mots-là, l’indicible, « Ce lieu du sacre / De l’être et du vent ! » dans l’instant vécu avec plénitude.
Ce qui n’empêche pas, à l’occasion, un retour sur le passé et ses « trésors d’enfance », sur tous ces « songes qui ont traversé l’horizon ». On croit, de-ci de-là, lire Jean Grosjean affirmant : « Les songes ont beau me visiter / Je vis avec le temps qu’il fait », ou encore Giuseppe Ungaretti disant de la poésie qu’elle « consiste à convertir la mémoire en songes et à apporter d’heureuses clartés sur les chemins de l’obscur ».
Le poète breton, lui, évoque Etty Hillesum et son « cœur sans obscurité » ou encore Philippe Mac Leod, le poète trop tôt disparu à la « secrète parole ». Référence à des êtres de haute exigence, conduisant Jean-Pierre Boulic à formuler cette interrogation : « Que peux-tu chuchoter / Si tout a été dit ? // Naître au poème du vivant / Et ne jamais y renoncer ». Car « Tout demeure à dire / Au monde de ce temp ».
Un ciel de patience, à l’aube de l’estran, Jean-Pierre Boulic, préface de Béatrice Marchal, La Part Commune, 2025, 110 pages, 13,90 euros.
 |
Pierre Dhainaut, |
| Et pourtant |
|---|
Il aura 90 ans en octobre prochain. Le poète Pierre Dhainaut est un auteur fécond. On lui doit en effet une cinquantaine d’ouvrages. Et pourtant est le 10e qu’il publie aux éditions Arfuyen. Un livre aux allures de traité d’art poétique.
« Et pourtant ». Est-ce un soupir ? Est-ce l’expression d’un regret, d’une déception ? Inscrits en quatrième de couverture, il y a en tout cas ces mots qui donnent quelques clés : « L’air / demande / une aide, / les poèmes / parfois /l’exaucent ». Oui, trouver sa respiration grâce à la poésie dans un monde où l’air se raréfie et où l’on perd volontiers pied. « On reçoit un écho, de qui, pour qui ? », souligne Pierre Dhainaut pour parler de cette « voix qui nous libère », de cette « voix inconnue » dont nous sommes les hôtes. Sous d’autres cieux, à propos du poème, Gustave Roud avait parlé de cette « quête de signes au cœur d’un monde qui ne demande qu’à répondre, interrogé il est vrai par une certaine intonation de voix ». Pierre Dhainaut, lui, écrit plutôt : « Ce qui doit venir / viendra / sans être attendu ».
Pour Pierre Dhainaut, qui vit à Dunkerque, c’est l’air puissant de la mer du Nord qui lui donne sa respiration. « Au-dessus de la dune, tu feras face / à tous les horizons, tu seras disponible ». Des mots, comme autant de points d’ancrage d’un littoral familier, essaiment son recueil : « oyats », « écume », « nuages », « sel », « sable », « embruns », « craie », « galets »… Mais il y a aussi – et pourquoi pas ? – l’exubérante glycine. « Reste après d’elle, reste avec elle, / la glycine effectue l’orbite / où la joie n’a pas la mort pour rivale ».
Pour autant le poète ne se berce guère d’illusions. S’il ne peut compter que sur les mots, il en connaît aussi toutes les limites. « Aucun mot ne nous a sauvés » Ce qui n’empêche pas de garder le cap des mots car « quelques uns / malgré tout persistent, palpitent, confondent / le tréfonds, le très haut… ». En définitive, écrit Paul Dhainaut, « seul un poème / rend l’inquiétude heureuse ». Et le voici affirmant, au cœur du grand âge : « Demain, demain encore, tu auras l’âge / où l’on ne consent pas aux ruines, / tu caresseras le moindre caillou, /tu le feras reluire avec tes larmes ».
Dans Un art des passages (éditions L’herbe qui tremble, 2017), le poète affirmait : « C’est pour moins respirer mal que, très jeune, j’ai eu recours au poème ». Et dans Ici (Arfuyen, 2021), il faisait aussi cet aveu : « En compagnie des mots tu n’as qu’une envie, relier, réconcilier ». Une démarche dont Pierre Dhainaut n’a pas dévié d’un pouce.
Et pourtant, Pierre Dhainaut, Arfuyen, 140 pages, 15 euros.
 |
Cypris Kophidès, |
| Ce monde en train de naître |
|---|
Cypris Kophidès saisit le drame contemporain des réfugiés pour nous proposer un récit poétique sur les désastres de l’exode et les douloureuses reconstructions après les traumatismes subis. Le personnage d’Anna est ici la poignante figure de toutes ces femmes et de tous ces hommes ballottés par l’histoire. La poétesse, pour nous parler de ce drame, alterne habilement dans son récit des passages en vers et en prose.
Anna a fui son pays comme d’autres, sous d’autres cieux ou à d’autres époques, ont fui la Grèce des colonels, le Chili de Pinochet, la Syrie d’Assad, ou, aujourd’hui, l’Afghanistan des talibans ou la Russie de Poutine. Anna fuit la guerre. La voici engagée, nous dit Cypris Kophidès, dans une « interminable marche / sous le gris cendre des nuages », dans « le fracas des bombes ». Avec, à l’horizon, « les fumées rouges et noires des incendies » et, tout près, « les aboiements des ordres criés ». Anna est une artiste. Dans son pays, elle peignait. Elle cuisinait aussi. Anna fuit. Elle se sauve. Mais la voici enfin à l’abri. « La guerre est là-bas au loin / mais cogne toujours dans les entrailles ». Dans sa folle traversée, un vers du poète grec Yannis Ritsos l’apaisait : « La paix est un verre de lait chaud et un livre posés devant l’enfant qui s’éveille ».
Dans ce pays où elle arrive et qui n’est pas en guerre, il y a Lucia et François qui tiennent une brasserie et qui l’accueillent. Deux bons samaritains qui « cherchent avec elle des locations ». De fil en aiguille, des liens se tissent avec des femmes qui « viennent d’ailleurs » et qui « elles aussi ont franchi des frontières ». Anna respire. Elle pourra même, bientôt, exposer des peintures. Mais peut-on vraiment se guérir du malheur ? La voici happée métaphoriquement par une forêt, « un monde aux lois obscures / un monde surgi des profondeurs noires / de la terre ». Mais Anna surmontera l’épreuve, se libérera progressivement de ce fardeau. Le récit de Cypris Kophidès laisse entrevoir, au bout de la nuit, une forme de résilience après son « périple intérieur ». Anna se réconcilie avec le monde. Elle découvrira même l’amour.
À travers ce portrait de femme, Cypris Kophidès nous parle, certes, d’une grande tragédie contemporaine et de ses impasses, mais elle laisse poindre de bout en bout, à travers son personnage, la force du désir. Tout est sans doute possible, en dépit du malheur, « tant que la poésie n’aura pas dit son dernier mot » (titre du dernier livre de Marc Baron). Et d’ailleurs la voix des poètes n’en finit pas de résonner dans son récit poétique. Elle cite Khalil Gibran : « La terre est ma patrie, l’humanité ma famille ». Ou encore le grec Odysséas Elytis : « Voilà pourquoi j’écris. Parce que la poésie commence là où la mort n’a pas le dernier mot ». Née d’un père grec et d’une mère française, Cypris Kophidès a de solides références.
Ce monde en train de naître, Cypris Kophidès, Diabase, 128 pages, 16 euros.
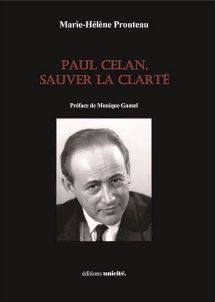 |
Marie-Hélène Prouteau, |
| Paul Celan, sauver la clarté |
|---|
L’œuvre du grand écrivain d’origine roumaine Paul Celan (1920-1970) n’en finit pas de passionner la nantaise Marie-Hélène Prouteau. La voici sur ses pas à Paris mais surtout à la pointe du Finistère, là où Celan, écrivit les poèmes de sa « période bretonne ». Elle le raconte dans un livre aux allures de vagabondage littéraire.
« Sauver la clarté ». Ce sont les mots que Marie-Hélène Prouteau rattache à l’œuvre poétique de Celan. « Sauver la clarté », c’est en effet le titre de son nouveau livre. Mais est-ce possible de sauver la clarté quand on est né dans une famille juive de Bucovine et que l’on est devenu, comme l’écrit Marie-Hélène Prouteau, « l’inconsolable du 29 juin 1942, du temps de l’assassinat de ses parents et des rafles antisémites dans sa Roumanie natale ». Celan émigrera en France où il sera traducteur et lecteur d’allemand à l’École normale supérieure.
Mais pourquoi l’écrivaine nantaise s’intéresse-t-elle à ce point à l’œuvre de ce réprouvé ? Un lieu les réunit en réalité : la ville de Brest. Brest, où est née Marie-Hélène Prouteau dans les ruines de l’après-guerre. Brest et ses environs où Paul Celan a séjourné à deux ou trois moments de sa vie. Le grand écrivain a découvert le Finistère pour la première fois en 1954 dans un périple qui le fit déjà passer par Brest et aussi Camaret sur les lieux où vécut Saint-Pol-Roux. Il revient en 1957 accompagné de sa femme, l’artiste-graveuse Gisèle Celan Testrage. C’est cette année-là qu’il écrit un poème intitulé « Matière de Bretagne », commençant par ces mots : « Lumière des genêts, jaune ; les pentes / purullent contre le ciel ; l’épine / courtise la blessure… »
À l’été 1960, Paul Celan prend une location au domaine de Kermorvan, à Trébabu, près du Conquet. C’est de là qu’il écrit le 20 juillet une lettre à l’écrivaine Nelly Sachs, poète juive de langue allemande : « Nous sommes depuis huit jours en Bretagne, sous des ciels sereins, dans une petite maisonnette, à la lisière d’un gigantesque parc à l’abandon qui est des plus amis du genre humain puisqu’ami du genre lapin. La mer est proche, les hommes que nous rencontrons, simples et amicaux ». Séduit par le lieu, il revient sur place durant l’été 1961. C’est de cette époque (« respiration heureuse » dans sa vie, note Marie-Hélène Prouteau) que datent sa visite à Brest et le poème inspiré par les lieux, intitulé « Après-midi avec cirque et citadelle », poème que l’on retrouvera en 1963 dans son principal recueil de poésie La rose de personne.
C’est ce poème brestois qui a beaucoup inspiré Marie-Hélène Prouteau. Elle avait déjà repris les derniers mots de ce poème (« Le cœur une place forte ») pour intituler un précédent livre sur le thème de la guerre et de la mémoire (La Part Commune, 2019). Cette fois, elle insiste beaucoup dans son livre sur la référence au poète russe persécuté Ossip Mandelstam dans le poème de Celan : « À Brest, face au cercle de flammes / sous la tente où bondissait le tigre, /j’ai entendu, finitude, ton chant, / et je t’ai vu Mandelstam ».
Comme l’explique Marie-Hélène Prouteau, Paul Celan tutoie le poète qu’il n’a jamais rencontré mais qu’il connaît pour l’avoir abondamment traduit. Les deux hommes ont connu des drames similaires au cœur de cette histoire tourmentée du XXe siècle. Et aussi la même solitude et la même fin tragique : Mandelstam au Goulag, Celan à Paris où il se suicide en se jetant dans la Seine.
De Brest, Marie-Hélène Prouteau nous conduit ensuite à Leyde, aux Pays-Bas (dans la ville natale de Rembrandt) où elle découvre une fresque murale reprenant le poème brestois de Celan (l’écrivain y a fait un voyage en 1964). Mais il n’y a pas que Brest dans le séjour finistérien de Celan. Il y a aussi un certain nombre de poèmes (du « cycle breton » de La rose de personne) sur lesquels s’attarde Marie-Hélène Prouteau, aux titres bien évocateurs comme « Les blancs sablons » ou encore « Kermorvan » qui commence par ces mots : « Toi, petite étoile de centaurée, / toi aulne, toi, hêtre, toi, fougère, : avec vous, proches, je vais au loin, – / pays natal, tu nous prends au piège ». Marie-Hélène Prouteau note à ce propos comment le regard du poète « se transfigure d’émerveillements et de légèretés » et comment des « voies intérieures (…) se trament dans le poème, au fil d’énigmatiques formules langagières ». On notera enfin que Celan rédigera dans le Finistère un court texte récemment traduit dans les Cahiers de L’Herne et étonnamment peu connu, sous le titre « Les aphorismes de Kermorvan ».
Avec tout ce matériau poétique, l’écrivaine nantaise livre une déambulation littéraire et un vagabondage poétique d’une grande richesse. Paul Celan en est le fil conducteur. Jusqu’à nous conduire, quittant Kermorvan, rue Tournefort à Paris, sur une autre fresque reprenant un de ses poèmes. C’est une autre partie du livre de Marie-Hélène Prouteau.
Paul Celan, Sauver la clarté, Marie-Hélène Prouteau, préface de Mireille Gansel, éditions Unicité, 141 pages, 14 euros.
 |
Yves Elléouët, |
| Carnets, 1947-1975 |
|---|
Il était le gendre d’André Breton dont il avait épousé la fille, Aube, en 1956. Le Breton Yves Elléouët (1932-1975) demeure un auteur méconnu. Proche du surréalisme, auteur de deux romans, Le livre des rois de Bretagne et Falc’hun (Le faucon, en breton), publiés chez Gallimard en 1974 et 1976 mais jamais réédités, il était un peu tombé dans l’oubli malgré la volonté affichée par certains, notamment en Bretagne, de faire connaître sa poésie. Ses Carnets sont aujourd’hui publiés.
Ceux qu’avait séduits l’écriture d’Yves Elléouët avaient jusqu’à présent entre leurs mains cinq livres de lui : le deux romans précités, deux livres de poèmes (Au pays du sel profond, éditions Bretagnes 1980 et Tête cruelle, éditions Calligrammes 1982). Plus récemment, sa poésie avait été regroupée dans un recueil intitulé Dans un pays de lointaine mémoire (Diabase, 2020), préfacé et annoté par Ronan Nédélec. C’est ce dernier qui a entrepris aujourd’hui d’assurer la publication de ses Carnets.
Yves Elléouët, comme son patronyme l’indique, avait des origines bretonnes, précisément du côté du Finistère, dans la commune de La Roche-Maurice près de Landerneau. Né à Fontenay-sous-bois où travaillait son père, il passa la période de la Seconde guerre mondiale dans la petite commune bretonne, auprès de sa grand-mère paternelle, de ses tantes et oncles, cousins et cousines. Le jeune Yves en sera profondément marqué car il fit l’expérience d’un environnement très particulier, marqué notamment par la présence sur place d’un enclos paroissial où s’imposait (dans la statuaire) la figure de l’Ankou, messager de la mort dans les croyances populaires bretonnes. Diplômé des arts appliqués, attiré par le mouvement surréaliste, Elleouët fit donc la connaissance d’André breton (et de sa fille Aube) mais se tint toujours en marge de ce courant littéraire. À Paris, il se lia d’amitié avec Calder, travailla en imprimerie, dans l’héliogravure et collabora même par ses dessins au magazine Elle. Il était à la fois artiste peintre et écrivain mais mourut prématurément d’un cancer à l’âge de 43 ans.
Ce qui domine dans l’œuvre d’Elléouët, c’est ce que résumait le poète Xavier Grall, après sa lecture de Au pays du sel profond, en parlant de « voyances brèves », de scènes surréalistes » et de « petits tableaux crépusculaires ». Qu’il s’agisse de romans, de carnets ou de poésie, c’est bien cette frontière ténue entre la vie et la mort qui domine l’œuvre de l’écrivain breton. « On retrouve dans ses notes ce que l’on perçoit également dans sa peinture ou dans ses dessins (…) c’est-à-dire des compositions, des impressions presque jazzy tout autant que des tentatives d’expulsion », souligne Ronan Nédélec. Il ajoute : « Au même titre que le peintre Elléoüet jette sur la toile une rythmique, l’écrivain crée des accords musicaux au sein d’un langage qui lui est propre, au flux très vite reconnaissable et dont le lecteur aura du mal à s’extirper ».
…/…
Les Carnets d’Elléouët nous font beaucoup voyager. De Saché (en Indre-et-loire), où il partit habiter, à la Bretagne qu’il arpenta toujours avec ferveur, notamment le Finistère mais aussi Plougrescant dans les Côtes d’Armor. Dans ses écrits, il mêle notations brèves et vrais tableaux de genre. On y découvre aussi des poèmes ou des textes qui serviront de matrices à des œuvres ultérieures plus élaborées. C’est parfois déroutant, frôlant l’énigme, mais il y a toujours une sensibilité à fleur de peau. Écorché vif, Elléouët écrivait en 1972 dans ses Carnets, s’adressant à Aube : « Sans doute ce qu’il convient d’appeler la difficulté d’être me tient. Sans doute aussi la difficulté de vivre. Sans doute, sans doute. Peut-être suis-je une de ces pauvres bêtes qui se tiennent dans le chemin de la vie qui peut les mouvoir et pourquoi ? Peut-être suis-je autre chose que cela. Je n’en sais rien. Je t’aime de toute façon et tout le reste me chante peu ». Tout d’Elléouët est dit dans ces quelques lignes. Lisons ou relisons cet auteur fécond à la vie si brève. Celui qui avait vécu dans la peau de Falc’hun (le faucon), le héros de son livre le plus connu.
Carnets 1947-1975, Yves Elléouët, édition établie, préfacée et annotée par Ronan Nédélec, La Part Commune, 345 pages, 28,90 euros. Avec des reproductions de peinture de Yves Elléouët.
Vient également de paraître, du même auteur, Récits, nouvelles, théâtre, La Part Commune, 446 pages, 29,90 euros (édition également établie par Ronan Nédélec)
 |
Ève Lerner, |
| Un tant soit peu de lumière |
|---|
Ève Lerner récidive. Convaincue que Le chaos reste confiant, titre d’un précédent livre (Diabase 2020), elle nous dit tout le mal qu’elle pense de ce monde qui part en vrilles. Son verdict est implacable avec, cette fois, une petite couche de noirceur supplémentaire. Mais tout n’est pas perdu : il y a toujours la vie qui palpite, il y a la poésie, il y a l’amour…
« C’est le temps de l’obscur », écrit la poétesse lorientaise. Il faut dire que, depuis 2020, la pandémie et la guerre à l’est de l’Europe sont passées par là, sans parler du réchauffement climatique dont on connaît les effets les plus délétères. Ève Lerner commence par lancer une charge contre « les hommes de pouvoir » et « les décideurs » qu’elle qualifie de « briseurs de rêves, fossoyeurs de la pensée ». Elle n’attend plus grand-chose d’eux. « Tu voudrais écrouer ceux qui déroulent sans fin la fausse parole et les fausses images ». Cette « fausse parole », elle l’avait déjà dénoncée dans son précédent livre, comme l’avait fait en son temps le poète Armand Robin (La fausse parole, 1953). Poussant l’acte d’accusation, elle va aussi jusqu’à dire : « On cherche à nous faire peur ».
Que faire dans ce maelstrom ? « Il faut tenir », nous dit Ève Lerner. « Aller jusqu’au bout du chaos triomphant, l’épuiser, le retourner comme une crêpe, l’embobiner, le réduire à moins que rien, et l’envoyer aux travaux forcés ». Mais comment s’atteler à un si gigantesque chantier ? La poétesse, qui s’exprime ici sous forme de fragments, ne nous conduit pas sur les chemins de la rébellion, même si son souhait est bien que l’on puisse arriver un jour à « déboulonner les statues des oppresseurs, cisailler les grillages de chasseurs, ceux des camps et ceux des burkas intégrales ». Mais son livre n’est pas un manifeste politique. Plutôt un manifeste poétique quand elle écrit : « Tout acte infime peut changer la donne qu’on nous impose. Sauver un orque, une femme, un jardin, une source, un oiseau, un marais peut ouvrir une veine de vie ». Plus loin, elle ajoute : « Soigner les blessés, les arbres, les oiseaux, les chevaux, soigner la terre, la mer, soigner son style ».
Il y a, dans ces propos, quelque chose qui relève de l’acte de foi. Ou du moins d’une espérance. Elle la place dans notre capacité d’émerveillement (« que ton cœur s’envole, que ton sang vire à la sève… »). Mais Ève Lerner apporte d’emblée un bémol. Pour pouvoir s’émerveiller (injonction qu’elle juge un peu trop dans l’air du temps), « il faudrait assagir la part sauvage de l’homme et retrouver la part sauvage du monde ». Alors il reste à célébrer inlassablement l’amour et le désir, « un refuge, un havre de bien-être » dans « la noirceur du monde ». Ou, comme elle le dit aussi : « Pouvoir encore dire à un être, à une idée : je tiens à toi. Réussir tout cela, qui nous tient à cœur, tient du miracle. Il ne tient qu’à nous de le faire. Il faut tenir la distance ».
Pour elle, « tenir la distance » devient un redoutable défi. Elle fait, sans fard, le constat d’une forme d’éloignement progressif du monde. « Je ne sais plus recevoir et ne sais plus si j’ai encore quelque chose à partager, à transmettre ». Qu’elle se rassure. Ses lecteurs ont encore la conviction qu’elle n’a pas dit son dernier mot. Ses propos sont dans le droit fil de ce que disait le poète italien Giuseppe Ungaretti : « La poésie consiste à convertir la mémoire en songes et à apporter d’heureuses clartés sur les chemins de l’obscur ». Ou de ce qu’affirmait le Marocain Abdellatif Laâbi : « De l’homme à son humanité / la poésie est le chemin le plus court / le plus sûr ».
Un tant soit peu de lumière, Ève Lerner, Diabase, 100 pages, 14 euros.
Lectures de 2024
 |
Jean-Claude Albert Coiffard, |
| Au vitrail des mots |
|---|
Un testament poétique ? Il semble bien que ce soit le cas avec le nouveau livre du Nantais Jean-Claude Albert Coiffard, Au vitrail des mots, qu’il publie à l’âge de 91 ans. Livre de gratitude et d’émerveillement de la part d’un homme pour qui « tout était bleu lorsqu’il avait sept ans » et qui n’a jamais cessé de glorifier la vie simple au plus près de la nature.
« Lorsque le grand silence / aura saisi mon âme / reverrais-je l’enfant / courant sur une plage / en serrant sur son cœur / l’ombre bleue de son frère ? » Pour Jean-Claude Albert Coiffard, tout vous ramène à l’enfance. À plus forte raison, bien sûr, quand le grand âge vous a saisi. Son nouveau livre est pétri de notations sur une époque aujourd’hui totalement révolue mais dont le poète se plaît à noter à la fois la grandeur et le mystère. Nous voici dans un pays, en bord de Loire, où l’on se tenait volontiers « au chevet des étoiles » sous une « averse d’oiseaux ». Un pays où il suffisait d’un « simple rai de lumière / sur le vitrail des mots » pour que « la page s’éclaire / sur le vol d’une abeille ». Oui, note Jean-Claude Albert Coiffard, « l’enfant se souviendra » de « la Loire immobile », de « la table bien cirée », de « la rose bien droite ».
Dans ce monde-là, « la vie était très simple / sous les poutres / autrefois / de l’aurore à la nuit / on tirait les rideaux / et soufflait la bougie ». Ce monde-là (qu’il côtoie encore, parfois, aujourd’hui) était un jardin de « fruits mûrs » et de « figues éclatées ». C’était un monde d’abeilles, de libellules et de « papillon blanc » posé sur « le blanc d’une feuille ». Un monde où les roses pouvaient avoir des « larmes » à leurs « paupières ». Jean-Claude Albert Coiffard nous laisse entrevoir une forme de paradis, celui qu’il aspire sans doute à rejoindre ou retrouver. S’adressant à son Seigneur, il écrit : « Reverrai-je le ciel / qui éclairait la nuit /dans la mansarde bleue / et le livre perdu / où s’endormit l’enfant / entre les bras d’une ombre ».
Le poète ligérien (du pays nantais) n’a jamais cessé d’écrire sous le regard de René Guy Cadou. Même « fraternité au cœur » comme le disait Jean Lavoué à propos de l’instituteur de Louisfert. Mais Jean-Claude Coiffard a aussi d’autres références dont il fait mention dans ce livre, à commencer par Christian Bobin (« Tu creusais l’or des mots / pour trouver de la terre / où pousse le poème ») et bien sûr Jean Lavoué lui-même, disparu en mai dernier (« Mon ami est parti / dans la forêt du Père / sous les sous-bois aimés / et la paix des clairières »). Les hommages, dans son livre, s’étendent à Rose Ausländer, Maurice Courant, Jean-Paul Mestas…
En quittant ce monde, Jean-Claude Albert Coiffard aimerait emporter « les éclats de lumières / qui tremblent sur la Loire ». Et il confie : « J’entends ma vieille lampe / écrire un dernier mot : / kenavo ».
Au vitrail des mots, Jean-Claude Albert Coiffard, dessins de Nathalie Fréour, postface de Marie-Laure Jeanne Herlédan, éditions Des Sources et des livres, 115 pages
 |
Marc Baron, |
| Tant que le poème n’aura pas dit son dernier mot |
|---|
Marc Baron a de la constance. Il écrit la nuit et avoue que le poème est sa « seule issue ». Il invite donc ses lecteurs à lire ou relire « les poètes qui traversent l’obscurité ». Nuit métaphorique aussi, bien sûr, celle qui laisse entrevoir une aube nouvelle dont le poème est le premier témoin.
Ne dit-on pas volontiers que le poète est un veilleur ? C’est bien le cas de Marc Baron dont l’écriture se nourrit de la nuit. « La nuit c’est mon heure / j’entends ce que le monde dit », écrit-il. Auteur fécond d’une trentaine de livres, organiste à Fougères où il a dirigé le salon du livre pour la jeunesse, Marc Baron (né en 1946) confie que « écrire est une violente avancée dans le chant ». Son nouvel opus est un véritable traité d’art poétique. Mais il n’a rien de savant. Aucune approche théorique. Non, dire tout simplement le surgissement du poème « dans une terre jamais labourée ». Dire aussi que la poésie est un art du peu et de l’humilité. « N’écris pas pour éblouir // les mots t’ont choisi / non pour ton paraître / mais pour le fleuve caché que tu suis ». Ce fleuve caché charrie « une braise intime et vivante ». Marc Baron est du côté du « oui » à la vie en dépit de « ce monde où le bruit défait la semaison » et où arrivent « jusque chez nous / les poussières de la guerre ». Ailleurs il parle de « ténèbres si envahissants » ou de vie « si violente ». Écrire un poème, pour lui, c’est prendre acte de « chaque bonheur gagné sur l’obscurité ».
Le poète ancre son propos dans une pauvreté assumée aux allures franciscaines. « Il est temps de remettre le poème à sa place /dans les contrées les plus reculées de l’insignifiance /dans l’oubli les coins perdus ». Non au poème poudre aux yeux car, dit-il, « le poème n’est jamais en représentation ». Ce qui l’amène à fuir « les poèmes de surface ». Ce qui le motive, bien au contraire, c’est la profondeur (« le poème, c’est un puits dans l’herbe brûlée ».
Dans le sillage de Christian Bobin, pour qui la poésie n’était pas un genre littéraire, Marc Baron nous amène à considérer que le poème véritable est celui que nous inscrivons au cœur de nos propres existences. Un poème / vie qui « oublie la vanité », qui « m’ordonne de me relever » et à « chercher le souffle dans le rien ». Il rejoint aussi les propos du délicat écrivain italien Marco Lodoli évoquant la poésie comme « une attitude de fond, un regard sur le monde qui pénètre au plus profond, entre la lumière et l’ombre ». Profondeur, redisons-le, qui irrigue ce livre de Marc Baron, notamment, par les nombreuses références faites au puits. Un puits qui « désaltère » mais dans lequel il faut descendre car « la rencontre c’est le profond ».
Noter enfin que le poète fougerais (« 1 mètre 62, 61 kilos ») qui se qualifie volontiers de « poète de poche » entend écrire avec ses « mots d’enfant » et ses « racines ». Jusqu’à affirmer « je n’écris pas pour la gloire / mes poèmes le savent / je suis né dans les terres de mon père et de ma mère / avec les fruits et les légumes / et tout ce qui pousse dans un total anonymat // j ’ai toujours su que mes poèmes finiront dans une fosse commune ». L’humilité, toujours l’humilité.
Tant que le poème n’aura pas dit son dernier mot, Marc Baron, frontispice de Julius Baltazar, éditions Le Taillis Pré, 145 pages, 17 euros.
 |
Aïcha Dupoy de Guitard et Gilles Baudry, |
| Infinitudes |
|---|
Une photo-poète et un moine-poète nous disent à leur manière, dans un superbe album, les horizons insoupçonnés que leur révèle la grande bleue. Aïcha Dupoy de Guitard et Gilles Baudry vivent tous deux à Landévennec, à l’entrée de la presqu’île de Crozon : d’un côté l’Aulne maritime, de l’autre la baie de Douarnenez. De quoi, forcément, s’émerveiller.
Comment ne pas avoir une idée de l’infini face à l’immensité qui s’offre quotidiennement au regard de la photographe et du moine ? Oui, le mot « infinitudes » qui donne le titre à ce livre exprime bien cet horizon qu’il faut aller chercher derrière l’horizon. Au fond, un « arrière-pays » comme le dit l’éditeur Yvan Guillemot.
La photographie, ici, est première. Le moine-poète accompagne de ses courts poèmes aux allures d’aphorismes les exercices d’admiration d’Aïcha Dupoy de Guitard. Parlant d’elle, Alain-Gabriel Monot écrit dans la postface : « Aïcha refonde le monde. À sa façon tranquille et entêtée (…) Partout nous sommes saisis par le sentiment océanique ici à l’œuvre ». La photographe, en effet, fait corps avec les éléments. Adepte du kayak de mer, souvent pratiqué aux premières lueurs de l’aube, elle capte des moments « rares » où la lumière le dispute à la nuit déclinante. « L’émergence du monde / la lisière tremblante des ailleurs / aux premières lueurs / et tout ce qui affleure au jour / à la lumière neuve / dans l’aube étincelante de la baie », écrit Gilles Baudry en écho à l’une de ses photos.
La mer, ici, est parfois bleue mais elle est le plus souvent verte ou grise. Des taches de lumière la parcourent sous des cieux toujours imposants, gonflés de nuages lourds. La photographe nous dit souvent la vague et la houle, son corps à corps avec la mer qu’elle parcourt en côtoyant surfeurs, véliplanchistes ou amateurs de paddle. Mais, invariablement, le personnage entrevu est un point dans l’image, perdu dans l’infini de la mer, solitaire comme dans les anciennes peintures chinoises où l’homme se fond dans la nature.
Comment une réalisatrice de programmes d’exploration sous-marine n’aurait-elle pas été sensible à ces photographies et à ces poèmes ? Préfaçant ce livre, Emmanuelle Périé-Bardout, une habituée des écosystèmes marins, salue en effet « ce voyage de l’instant » qu’instaure ce livre et « la possibilité de se reconnecter à la beauté du monde », y compris ce monde précisément sous-marin que Aïcha Dupoy de Guitard fréquente à l’occasion, lui permettant d’heureuses rencontres comme avec ce phoque qu’elle « saisit » vers les grottes de Morgat.
…/…
Gilles Baudry apporte ici une ponctuation poétique. Ce n’est pas sa première collaboration avec la photographe. Ils ont déjà publié de concert Matin des arbres et Eaux intérieures (Poésie de l’instant, 2017 et 2019). Quittant les forêts et les rivières qui sont au cœur de ces deux livres, le terrien Gilles Baudry, arpenteur des estrans et au pied très peu marin, s’est cette fois aventuré dans un univers qu’il appréhende habituellement à distance. Mais les photographies de Aïcha Dupoy de Guitard sont pour lui un beau sujet de méditation. « Horizon du souffle », « miracle sonore », « immensité intime », « pays de patience », « rêves hauturiers », « transmigrations des âmes » : autant de mots qui surgissent sous sa plume. « La mer // la seule qui nous apprenne / la patience de l’horizon / reçu en héritage », écrit encore le moine bénédictin de l’abbaye de Landévennec.
Infinitudes, Aïcha Dupoy de Guitard et Gilles Baudry, préface d’Emmanuelle Périé-Bardout, postface d’Alain-Gabriel Monot, Éditions Calligrammes/Bernard Guillemot, 125 pages, 25 euros
 |
Alain-Gabriel Monot et Aïcha Dupoy de Guitard, |
| Bleu est le paysage, la vie en poésie de Jean-Pierre Boulic |
|---|
Avoir une biographie de son vivant, ce n’est pas si courant. Et pourtant c’est aujourd’hui le cas pour Jean-Pierre Boulic dont l’universitaire et écrivain Alain-Gabriel Monot raconte l’original itinéraire en poésie. Il est accompagné dans son livre par la photographe Aïcha Dupoy de Guitard qui s’est rendue en pays d’Iroise, sur les lieux où vit le poète.
Il y a des poètes qui sont ou ont été enseignant, bibliothécaire, marins-pêcheur, employé du tri postal, fonctionnaire, moine… Le cas de Jean-Pierre Boulic est aussi très particulier. Voici un poète qui a fait toute sa carrière professionnelle dans la banque, très précisément au Crédit Lyonnais. Un tel cas de figure ne pouvait pas ne pas intéresser Alain-Gabriel Monot, déjà auteur de la biographie de poètes au parcours très particulier. On pense à l’ouvrage qu’il a consacré à Louis Bertholom, infirmier en psychiatrie et rockeur, sous le titre Le poème comme un cri (Yoran Embanner, 2020) ou encore à la discrète et talentueuse institutrice Émilienne Kerhoas dans son livre Soie de feu sur l’étoffe du ciel (Calligrammes / Bernard Guillemot, 2023).
En intitulant Bleu est le paysage le livre sur Jean-Pierre Boulic qu’il a conçu avec Aïcha Dupoy de Guitard, Alain-Gabriel Monot fait référence à ce vers du poète dans Enraciné (La Part Commune, 2023), un de ses derniers recueils : « Ferme les yeux écoute / Bleu est le paysage / C’est l’hymne de la beauté ». Nous sommes en effet à la pointe du Finistère, un territoire que Jean-Pierre Boulic arpente avec ferveur et qui constitue la matrice d’une œuvre « attentive à la beauté fragile des êtres et des lieux », comme le note Alain-Gabriel Monot.
Jean-Pierre Boulic (au patronyme « bien de chez nous ») est d’une famille originaire de Brest mais c’est un enfant de l’exode. Il naît en 1944 dans le Loir-et-Cher de parents fuyant les bombardements de la grande ville du Ponant. Mais après la guerre, il fera ses études à Brest. Événement marquant : les conseils avisés d’un professeur de français du collège Charles de Foucauld qui le conduiront sur les chemin de la poésie. On sait ce que Albert Camus doit à son instituteur Monsieur Germain comme il le raconte dans son livre Le premier homme (Folio). On pourrait parler de la même façon d’un certain monsieur Pronost qui déclare un jour au jeune Jean-Pierre : « Vous écrivez avec des images et des couleurs, vous devriez lire des poètes ». L’enseignant lui confie des livres de Cadou et de Le Quintrec. C’est le déclic. Suivra la découverte des œuvres de Mounier, Bernanos, Maritain… et de tant d’autres.
Alain-Gabriel Monot raconte comment cette vie bifurquera vers le monde de la banque et non pas celui de l’enseignement, comme Jean-Pierre Boulic l’avait d’abord envisagé. Carrière brillante menée dans plusieurs villes de France et publication d’un premier livre en 1976 sous le titre Anne de la mer deux ans après avoir écrit à Charles Le Quintrec. Au fil de son livre, Alain-Gabriel Monot fait état de toutes les rencontres ou échanges épistolaires que le poète put entretenir avec des écrivains au cours de sa carrière, renforçant ses convictions de poète. Mais il faudra vraiment attendre son départ de la banque en 1999 pour qu’il se fasse véritablement connaître comme poète. « À partir des années 2000, Jean-Pierre Boulic publie en recueils successifs tous les poèmes écrits depuis les années 1970/1975 », note Alain-Gabriel Monot. « La poésie lui apparaît comme le contraire de la paresse spirituelle. Elle est une force pour aimer la vie, une présence intérieure », ajoute-t-il. Le poète n’a jamais renié le terme de poète chrétien qu’on peut lui accoler et le choix de ses poèmes publiés dans ce livre l’atteste s’il en était besoin.
Quant à la photographe Aïcha Dupoy de Guitard, elle nous montre le poète à l’écoute attentive des dunes, des plages, des criques, des estrans et des sous-bois, dans la proximité du port du Conquet et dans la fidélité à des chapelles quoi parsèment le paysage. « C’est l’heure / C’est maintenant / Les yeux de la rosée s’émerveillent / De la clarté de l’herbe », écrivait Jean-Pierre Boulic dans Prendre naissance (La Part Commune, 2017). A 80 ans, il poursuit inlassablement son chemin, annonçant dès à présent trois nouveaux recueils.
Bleu est le paysage, la vie en poésie de Jean-Pierre Boulic, Alain-Gabriel Monot et Aïcha Dupoy de Guitard, éditions A l’Ombre des Mots, collection L’œil du ciel, 167 pages, 22 euros.
 |
Nicole Laurent-Catrice, |
| À peine un souffle |
|---|
Le défi poétique n’était pas mince. Écrire des poèmes à partir de ces « vieilles histoires » ou de ces « paroles anciennes » qui parcourent les textes sacrés, à commencer par les Évangiles. Nicole Laurent-Catrice est pourtant convaincante dans cet exercice de haute voltige en irrigant toutes ces histoires d’un sang nouveau. Pour nous dire leur actualité et jeter aussi un regard décalé sur ce monde qui va mal.
« Chacun y reconnaîtra ce qui est sien », prévient d’emblée Nicole Laurent-Catrice (née en 1937). Comme la poète rennaise a pris de parti de procéder « par allusions », il faut sans doute disposer d’un minimum de bagage judéo-chrétien pour s’y retrouver et goûter pleinement la subtilité de ses poèmes. Ce qui l’a motivée, c’est probablement ce discours sur « la mort de Dieu » qui tient aujourd’hui le haut du pavé dans un monde occidental largement sécularisé. « Dieu, c’est fini, disent-ils / désorientés ». La poète, elle, ne s’y résout pas. Elle va donc s’employer à changer le regard sur ces paroles anciennes pour en révéler leur inaltérable valeur.
Car elle part d’un constat simple : « le monde marche sur la tête ». La preuve ? « Le brigand est relâché et l’innocent condamné », faisant ici référence à l’arrestation de Jésus et la libération du brigand Barrabas. Avant cet événement, il y eut la trahison de Judas que Nicole Laurent-Catrice revêt d’habits contemporains. « Il est parti en milieu du repas / un message urgent sur son portabl / pour une transaction financière ». Et pour ce qui est du fameux miracle de la Multiplication des pains, elle lui donne une étonnante coloration en parlant de cet enfant « qui donne son goûter à la récré », symbole, à petite échelle, de cette générosité à même de grignoter le mur des égoïsmes. Puis, allant jusqu’à prendre les intonations de la prière au Père, Nicole Laurent-Catrice écrit : « Donne-nous aujourd’hui le pain de demain / donne-nous ce dont nous n’avons pas encore besoin ».
Le recueil multiplie ainsi les références à la Bible et aux Évangiles (le Jardin d’Eden, l’enfant de la crèche de Noël, Véronique sur le Chemin de Croix, Le Golgotha, les pèlerins d’Emmaüs…). Mais la poète le fait sans lourdeur. « Préparez vos sandales / et cheminez sereins », écrit-elle, même si « de nos jardins ne subsistent / que des mirages / reflets d’un Eden perdu ». Cela ne l’empêche pas d’emprunter une forme de légèreté, voire de s’amuser, comme c’est le cas au début du recueil, dans une évocation de toutes ces « bêtes à Bon Dieu » qui poursuivent inlassablement leur chemin dans les arcanes de toutes ces vieilles histoires : la souris qui « visite les placards de la sacristie », l’hirondelle qui fait son nid dans la nef d’une église, sans oublier « la grenouille sculptée au fond du bénitier » dans le monastère italien de Madona Della Angola. Un livre surprenant, hors des modes. À découvrir.
À peine un souffle, Nicole Laurent-Catrice, La Part Commune, 67 pages, 11 euros.
 |
Jeanne Tsatsos, |
| Paroles du silence |
|---|
Elle était la sœur du grand poète grec Georges Séféris, Prix Nobel de littérature 1963, et elle n’a pas connu sa notoriété. Jeanne Tsatsos, qui avait épousé celui qui deviendra Président de la République grecque, était aussi poète. Un ouvrage bilingue (grec / français) rassemble aujourd’hui son premier et son dernier recueils, parus en 1968 et 1992.
Née en 1902 à Smyrne, Jeanne Séfériadès, était issue d’une famille de grande culture. Bernard Grasset qui a traduit, présenté et annoté cet ouvrage, note qu’à cette culture se mêlaient « hellénisme, christianisme et poési ». Celle qui deviendra Jeanne Tsatsos était profondément une humaniste. « La Grèce m’a enfantée / Mais moi aussi je l’ai enfantée », écrivait-elle dans un de ses poèmes, « J’ai souffert pour elle jusqu’à la mort, / dans toutes ses maladies / je l’ai veillée, gémissante, toute la nuit. / Je me suis chargée de ses pierres ensanglantées / et ses âpres montagnes / mon âme les traverse. // Mais les rares grâces qu’elle m’a accordées / étaient vastes et azurées / pareilles au firmament ».
Lors de la Seconde guerre mondiale, Jeanne s’était engagée dans la Résistance. Plus tard on la découvrira dans l’action sociale et humanitaire. Sous la dictature des colonels elle fera connaître son opposition au régime. Engagée, donc, pétrie de culture chrétienne orthodoxe (où elle trouvera une grande partie de son inspiration). Pour elle, note Bernard Grasset, « la vie est une marche intérieure vers la lumière ». D’où l’importance qu’elle accorde, dans ses poèmes, au silence et au mystère. « Dans la lutte des jours, son rôle est de défendre, à contre-courant souvent, une éthique de justesse, de retenue, de noblesse », souligne encore Bernard Grasset.
Cette retenue caractérise notamment sa poésie. Ses poèmes sont brefs. Jeanne Tsatsos cultive avec bonheur l’art du dépouillement, de la sobriété. C’est ce qui en fait sans doute, aujourd’hui, sa modernité. « La nuit tombe, / l’âme comblée de lumière / embrasse l’instant / qui s’allonge indéfiniment dans le crépuscule ». Elle exprime souvent sa sensibilité particulière à la nature dans de courts poèmes qui sont autant de petits tableaux de maîtres. Ainsi ce poème intitulé précisément Tableau : « Les dernières gouttes / du ciel / baignent le balcon. // Plus loin l’antique fontaine / de marbre / rassemble les blanches colombes /qui s’y désaltèrent ».
Souvent proche des élans d’une poésie mystique, Jeanne Tsatsos a creusé inlassablement la question « Pourquoi nous est donnée l’existence terrestre ? », souligne Bernard Grasset en introduisant cet ouvrage. N’est-ce pas, en effet, le rôle de la poésie ? La poète grecque l’avait bien compris. Elle nous a quittés en septembre 2000, laissant une œuvre qui associe étroitement le profane et le sacré. « Le silence, parole de l’âme / pour qui écoute le mystère ».
Paroles du silence suivi de Lumière dans l’obscurité, Jeanne Tsatsos, éditions le bois d’Orion, 2024, 217 pages, 19 euros.
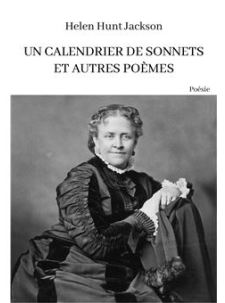 |
Helen Hunt Jackson, |
| Calendrier de sonnets |
|---|
Helen Hunt Jackson (1830-1895) est-elle la plus grande poète américaine du XIXe siècle ? C’était en tout cas la conviction du transcendantaliste Ralph Emerson. Au lecteur de s’en faire une idée à la lecture de la première édition en langue française des poèmes de cette autrice qui fut l’amie d’Emily Dickinson. Ses sonnets nous donnent en particulier une bonne idée de son talent.
« Son travail poétique se concentrait en grande partie sur la beauté et la pureté de la terre, comme nous le dévoile, à travers les mois et les saisons, un calendrier des sonnets ». Le mots sont de Lydia Padellec qui a traduit et préfacé ce recueil de poèmes. Les sonnets de Helen Hunt Jackson ont été publiés en 1891 aux États-Unis. Elle y évoque les mois un par un, ce qui nous fait penser, au premier abord, à cette approche poétique caractéristique des poètes chinois ou japonais marquée par la simplicité et l’approche concrète de la vie à travers les saisons. Mais Helen Hunt Jackson y ajoute un zeste de lyrisme, voire de symbolisme, pour évoquer les différentes tonalités de l’année. En mars, « les violettes lèvent / leurs têtes, sans émoi sans stupeur / et dorment dans tout ce vacarme comme dort un enfant ». En mars, la poète contemple « des averses de pétales roses qui tombent / des branches du pommier ». Voici l’été où, en juillet, « s’épuisent de frêles giroflées » tandis qu’en août, « chaque jour moqueur déplume / la fleur ». Arrive l’automne quand « les feuilles cuivrées du bouleau / scintillent comme des pièces enfilées / sur des baguettes ». Puis vient l’hiver quand « demeurent encore les neiges abritées, intactes et blanches ».
Dans la deuxième partie du livre, Lydia Padellec a regroupé des poèmes extraits d’une anthologie posthume de l’œuvre de Helen Hunt Jackson publiée en 1893. Ces poèmes, très disparates, révèlent une militante de la cause amérindienne (comme le suggère le poème « Montagne Cheyenne ») et aussi profondément engagée dans sa dénonciation de l’esclavage. « Chaque souffle fut arraché / À la poitrine des esclaves », écrit-elle dans un poème intitulé « Liberté ».
Un voyage en Italie sera aussi l’occasion pour Helen Hunt Jackson de saluer les combats du révolutionnaire et patriote Giuseppe Mazzini (1805-1872). « Qu’il soit mort, les fils de rois s’en réjouissent ; / Et dans leurs lits, les tyrans dorment plus profondément ». Mais de ce voyage en Italie, elle ramène aussi des poèmes qui signent son indéfectible attachement à la nature. À l’image du poème Coquelicots dans les blés. « Sur les collines d’Ancône miroite la chaleur, / Une marée d’air tropicale avec flux et reflux / baigne tous les champs de blé (…) Les coquelicots souples et flottants / Semblent courir, flambeaux ardents, d’avant en arrière / Pour marquer le rivage ». C’est dans ce type de poème que Helen Hunt Jackson marque toute sa puissance créatrice. Ce qui n’est pas forcément le cas dans tous ses poèmes.
Calendrier de sonnets et autres poèmes, Helen Hunt Jackson, présenté et traduit par Lydia Padellec, La Part Commune, collection Les Grands Classiques, 95 pages, 15 euros
 |
Jean-Yves André, Jacques Poullaouec |
| Femmes de pierre |
|---|
Qui sont ces femmes de pierre « croquées » par l’artiste Jean-Yves André et le poète Jacques Poullaouec ? Elles sortent de la statuaire religieuse bretonne. Femmes de pierre profondément sensuelles, exhibant le plus souvent leur nudité. Avec, en toile de fond, l’image de la femme pécheresse et tentatrice véhiculée par la religion chrétienne. Aujourd’hui, un poète leur redonne vie avec la complicité d’un dessinateur.
« Je suis une femme de pierre, / ni pétrifiée ni lapidée. / Je ne sais qui m’a donné ce visage. / Vous tournez autour de moi. / Vous me voyez, me regardez-vous ? / Si vous me regardiez, vous m’entendriez / chuchoter quelques mots sans âge », écrit Jacques Poullaouec à la vue de cette femme de pierre dans le porche sud de l’église de Landivisiau. « J'ai opté pour une conversation silencieuse avec ces femmes de pierre, un dialogue au-delà du visible », souligne le poète. Il a également convoqué des grands noms de notre littérature (Villon, Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Claudel, Malraux ...) pour situer ce livre dans une optique littéraire qui, selon lui, « dépasse le simple aspect artistique ou historique de la statuaire ». Ainsi, faisant référence à François Villon, il écrit pour accompagner ce visage de femme sur le baptistère de Plougasnou : « Quels rêves sous ses paupières ? / Pies et corbeaux leur ont les yeux cavés / Faut-il la réveiller ? ».
Voici, en tout cas, des femmes démons, des femmes sirènes, des femmes serpents ou encore des femmes oiseaux. Et même, comme l’écrit Jacques Poullaouec, « des sirènes lèche-culs, sodomistes, onanistes ». Elles ont été inscrites dans la pierre sous l’Ancien régime, au cœur des enclos paroissiaux bretons, à une époque où « l’anatomie et la religion faisaient bon ménage », note le poète. Au fond, voici « la scatologie au service de l’eschatologie ». Car, qu’on ne s’y trompe pas, il s’agissait bien pour l’Église catholique (notamment celle de la post-Réforme) d’asséner que la luxure était bien, souligne Poullaouec, « le péché capital qui menait à l’enfer » et de marteler qu’au début de la grande histoire de l’humanité, il y avait la tentatrice du Jardin d’Eden. La voilà donc, à Guimiliau, représentée par un serpent à tête de femme.
Le poète réserve un sort particulier à celle que l’on appelait Katell Gollet (Catherine la damnée) en lui consacrant deux poèmes. « Ta danse s’arrête là / dans les flammes de granit. / La danse était ton paradis / ton enfer sera froid comme la pierre // Trois cavaliers à la gueule d’Enfer / Trois diables arrêteront tes pas / Trois démons te mèneront au trépas // tu avais à peine 15 ans / quand tu te mis à danser / tu courais comme une biche / quand on a 15 ans on aime / à courir le galant » Mais, un peu paradoxalement, ces femmes de pierre qu’ont si amoureusement approchées l’artiste Jean-Yves André et le poète Jacques Poullaouec, « s’exhibent sans être exhibitionnistes ». Il peut même arriver que « leurs bouches susurrent les voix du silence » ou que leur beauté éclate à l’image de cette femme en granit du porche sud de Guimiliau. « La Joconde n’est pas si loin », note le poète. À ces femmes de pierre « figées » et « affligées », « prisonnières de la pierre, habillées de lichen », Jacques Poullaouec consacre, en définitive, un grand poème d’amour. Et il pose la question : « Comment vous libérer ? »
Notons enfin que, dans l’inventaire de ces femmes de pierre très particulières, la Vierge Marie ne trouve guère sa place. On la découvre seulement en Mater dolorosa dans la Pieta du calvaire de Daoulas. Jean-Yves André, en effet, s’est d’abord intéressé aux femmes absentes du calendrier des saintes. La « vierge en gésine » du tympan de la basilique du Folgoët ou celle du tympan de l’arc de triomphe de La Martyre sont, par exemple, aux abonnées absentes. On ne doit pas s’en étonner. Car le dessinateur, en naviguant de Berven à Gouézec et de Porspoder à Plougasnou (au cœur des enclos paroissiaux, mais pas seulement) a d’abord conçu un inventaire aux allures de bestiaire féminin. Il a su exprimer avec talent « le grain de leur peau de granit / sur le grain du papier », comme le dit si joliment Jacques Poullaouec.
Femmes de pierre, Jean-Yves André et Jacques Poullaouec, Géorama, 96 pages, 18 euros
 |
Estelle Fenzy, |
| N’oublie pas |
|---|
Estelle Fenzy raconte sa mère atteinte d’une maladie dégénérative fulgurante. Cette expérience intime et douloureuse, elle la transcende par la poésie. Sans pathos, dans cette sobriété et cette simplicité qui est la marque de son écriture. C’est ainsi qu’elle nous touche et que son vécu peut devenir celui de tous quand une mère « s’absente ».
Évoquer la figure d’une mère, lui rendre hommage, témoigner de sa vie… Les exemples ne manquent pas dans le roman ou la poésie. Môman, pauvre môman, écrivait Jean-Pierre Nédélec dans un livre portant ce titre (La Part Commune, 2010) tandis que Nicole Laurent Catrice érigeait un Cairn pour sa mère (La Part Commune, 2008). Chez Estelle Fenzy il y a la même ferveur, le même amour exprimé sobrement. « Je n’ai pas fini d’être ton enfant ». Belle déclaration d’amour filial. « Mon plus lointain souvenir, c’est toi ».
Les moments vécus ensemble défilent. Les lieux, aussi, qu’il faut quitter. La maison, entourée de rosiers, qui sent « le linge frais ». La poète recueille quelques vestiges (sucrier, bibelots, verres en cristal…) au moment de tourner définitivement la clé dans la serrure de la porte et de rejoindre une maison de retraite. La figure de la mère, maîtresse des lieux et gardienne du temple, revient au grand galop. « Ta jupe droite, ton tablier noué sur tes reins ».
Le nouvel horizon, c’est la chambre 46 où la mère « toute de travers dans son fauteuil », s’absente définitivement, sombrant dans des gestes compulsifs et répétitifs (épousseter, déplacer, déplier…). Estelle Fenzy vacille elle aussi. Elle le dit à mots feutrés du bout de ses courts poèmes. « Tu monologues / dans une langue nouvelle / mystérieuse ». L’univers a tourné sur ses gonds. « C’est quoi maman / la folie dis-moi / maintenant qu’elle est / de ton pays ». Que dire de plus ? Aimer plus que jamais, en dépit de tout. « J’entre /tu ne manifestes aucune surprise ». Constater que le temps fait son œuvre. « Le temps affamé / n’a laissé que l’encre des veines / et les lignes ».
Pour accompagner ces poèmes, cinq photographies de l’artiste Aurélia Frey témoignent à leur manière du temps qui passe (cette patine du temps que les japonais appellent le sabi). Tentures, couvertures, tapisseries, miroir, façade couverte de lierres : tout nous rattache à une autre époque, à un monde en voie de disparition. Celui de la mère.
N’oublie pas, Estelle Fenzy, L’ail des ours/n°23, 55 pages, 8 euros.
 |
Pierre Adrian, |
| Hotel Roma |
|---|
Pierre Adrian n’aime pas que la Bretagne. Il aime aussi profondément l’Italie et ses écrivains. Son premier livre il l’avait consacré à Pasolini (Les Équateurs, 2015) Le voici aujourd’hui sur les traces de Cesare Pavese, immense écrivain italien trop méconnu chez nous, auteur notamment de La lune et les feux, Le bel été, Le métier de vivre. Pavese s’est suicidé le 27 août 1950 à l’Hotel Roma de Turin. Il avait 41 ans. Pierre Adrian nous dit comment cet auteur a particulièrement compté dans son chemin d’écriture.
« Que reviennent ceux qui sont loin ». C’était le titre du précédent livre de Pierre Adrian dont l’action se déroulait en Bretagne (Gallimard, 2022). Ce titre lui avait été inspiré par les mots mêmes de Cesare Pavese du 8 février 1949 : « Pour que la gloire soit agréable, il faudrait que les morts ressuscitent, que les vieux rajeunissent, que reviennent ceux qui sont loin ». Ces personnes évoquées par Pavese, Pierre Adrian les ressuscitait dans un récit/roman où il évoquait des étés passés, enfant et adolescent, au pays des abers, dans une vaste maison de famille où se côtoyaient plusieurs générations. Il nous disait dans ce livre combien il avait été imprégné par l’ambiance de ce lieu et par les paysages du littoral nord-finistérien. Son amour de la Bretagne ne s’arrêtait d’ailleurs pas là puisque, sensible à l’œuvre de Xavier Grall, il avait préfacé une réédition de L’inconnu me dévore, un essai du poète breton (Les Équateurs, 2018).
Le voici aujourd’hui en Italie. Il en a fait sa terre d’élection puisqu’il vit à Rome. En publiant un livre sur Cesare Pavese, Pierre Adrian (33 ans) nous dit comment la lecture de cet écrivain provoqua chez lui « un bouleversement peu avant l’âge de 30 ans ». Mais il ne nous le dit pas dans une biographie qui aurait pu être assommante. Son livre est habilement construit autour d’un cheminement à la fois littéraire et méditatif sur les lieux où a vécu Pavese. Il le fait par petites touches, associant à cette quête une « fille à la peau mate » qui lui enseignera « qu’avant le verbe était le regard ». Ce compagnonnage amoureux pimente le récit et permet une forme de prise de distance. « La fille à la peau mate » vient de Paris, lui de Rome. Ils se retrouvent sur les quais de la gare de Turin.
Pierre Adrian est curieux, fouineur. Une âme de journaliste sûrement, avec cet art d’approcher avec tact et douceur les lieux où Pavese a laissé son empreinte : sa maison natale, bien sûr, mais aussi cette localité calabraise (Brancaleone) où Pavese a passé quelques mois en 1935 lors d’un confinement (« le sort réservé aux intellectuels dissidents »). Plus loin, le voici dans « la maison sur la colline » qui fut le refuge de Pavese pendant la dernière guerre… Ailleurs, c’est la rencontre avec l’une des dernières personnes encore vivantes à avoir connu Pavese.
Dans ce livre, passionnant de bout en bout, Pierre Adrian nous dresse le portait d’un auteur à la « vie monacale », faisant partie des « grands recalés de l’amour fou » comme il l’écrit à la page 145 : « Le plus violent de la pauvre vie de Pavese n’était pas sa mort de chat sauvage. Plus brutale était encore cette soif d’amour jamais étanchée ». Pierre Adrian dit aussi avoir été particulièrement sensible à cette simple phrase de La lune et les feux, livre d’un retour aux sources dans les collines de Langhe, au sud-est de Turin, et véritable testament spirituel de Pavese : « Un pays, ça veut dire ne pas être seul et savoir que chez les gens, dans les arbres, dans la terre, il y a quelque chose de vous qui, même quand vous n’êtes pas là, vous attend patiemment ».
Il n’est pas nécessaire de connaître l’œuvre de Pavese pour se plonger dans le livre d’Adrian. Par contre tout nous amène, grâce à ce livre, à lire ou relire un écrivain italien qui avait mis au cœur même de son œuvre la simple et douloureuse question de notre présence au monde.
Hotel Roma, Pierre Adrian, Gallimard, 2024, 185 pages, 19,50 euros.
Le livre de Pierre Adrian a été sélectionné pour le Prix interallié qui sera décerné le 13 novembre prochain. Il rencontrera les lecteurs le 14 novembre à la librairie Dialogues à Brest.
 |
Nan Shepherd, |
| La montagne vivante |
|---|
Quel bol d’air frais ! Nan Shepherd nous entraîne dans les Highlands, plus précisément dans les Cairngorms au nord-est de l’Écosse, région montagneuse à laquelle elle vouait un véritable culte. Nous voici plongés dans une nature sauvage, intacte, qu’elle détaille avec une précision d’entomologiste. Au-delà de la découverte d’un massif montagneux, c’est aussi la découverte d’une femme éprise de grands espaces que nous propose ce récit.
Enseignante à Aberdeen, Nan Shepherd (1893-1981) avait écrit son livre sur les Cairngorms à la fin de la Seconde guerre mondiale mais n’avait pas trouvé d’éditeur. Son ouvrage était resté dans ses tiroirs jusqu’en 1977 pour être finalement publié à cette date par l’Aberdeen University Press. Il faut dire que ces années 1970 sont marquées par l’intérêt grandissant du public pour les écrivains de la nature (le phénomène nature writing). C’est en 1977, en effet, que Bruce Chatwin publie En Patagonie ou que sort En Alaska de John McPhee. C’est l’année suivante que sera publié Le léopard des neiges, livre fameux de Peter Matthiessen. Mais il fallu attendre quelques années encore avant que le livre de Nan Shepherd ne soit publié en France : en 2019 aux éditions Christian Bourgois et désormais en format de poche.
Nan Shepherd nous parle d’une zone montagneuse qui n’a pas encore été contaminée par la modernité et l’industrie des loisirs. Elle nous dit tout de son osmose avec ce milieu naturel qui n’en finit pas de l’émerveiller à l’occasion de ses promenades au long cours (seule mais souvent aussi en groupe) ponctuées de bivouacs et de nuits à la belle étoile. Une nature avec laquelle il faut, néanmoins, savoir composer car des bans de brouillard peuvent en quelques minutes perturber (parfois sérieusement) le cheminement vers les sommets ou vers les lochs. Nous sommes à plus de 1200 mètres d’altitude (le point culminant est le Ben Mac Dhui) dans un monde qui ruisselle d’eau de toutes parts. Elle évoque à plusieurs reprises ces « cours d’eau qui tombent du plateau ». Ils sont « clairs », nous dit-elle. « De fait, l’Avon est devenu synonyme de clarté. À contempler ses profondeurs, on perd le sens du temps, comme le moine du conte ancien qui écoute le merle ». La voici, une autre fois, dans un de ces « recoins » quelle affectionne, du côté d’un loch « exceptionnel », le Coire an Lochain. « Ce loch tient son pouvoir de son inaccessibilité, écrit-elle, le silence lui appartient. Si les jeeps le trouvent, ou un funiculaire le défigure, une partie de son sens disparaîtra. Le bien du plus grand nombre n’a pas cours ici ».
Pour Robert Macfarlane qui préface ce livre, « il est essentiel que La montagne vivante soit comprise comme une œuvre régionaliste dans son sens le plus étendu. Au siècle dernier, le terme avait pris une connotation péjorative ». Le préfacier s’en désole, citant le grand poète irlandais Patrick Kavanagh pour qui « le régional est l’universel. Il traite du fondamental », voulant dire par là, selon Macfarlane, que « la connaissance consiste en l’étude minutieuse de ce qui est à notre portée ».
En fait d’étude minutieuse, Man Shepherd ne fait pas dans la demi-mesure. Ses Cairngorms sont abordés dans une série de chapitres consacrés chacun à un thème particulier : l’eau, le gel et la neige, l’air et la lumière, la vie (les plantes), la vie encore (les oiseaux, les animaux, les insectes), la vie toujours (l’homme), le sommeil, les sens… À propos des cinq sens sollicités par des parcours en montagne, Nan Shepherd écrit : « Chaque sens exalté à sa puissance la plus délicate est lui-même une expérience totale. Voici l’innocence que nous avons perdue ».
Cette expérience intime a entraîné chez elle un changement progressif d’approche de la montagne qui se résumait, au début, à la sensation de hauteur ou d’effort. À force de parcourir ses Cairngorms, elle a acquis la conviction que la randonnée en montagne est « un voyage de l’être ». Car, ajoute-t-elle, « à mesure que je pénètre plus profond dans la vie de la montagne, je pénètre aussi dans la mienne ».
Nan Shepherd est décédée il y a 43 ans. Son massif écossais est aujourd’hui le plus grand parc naturel de Grande-Bretagne. Il est parcouru de sentiers de randonnées et comprend trois stations de ski. L’autrice, elle, est aujourd’hui représentée sur les billets de cinq livres d’Écosse. C’est dire la notoriété qu’elle a acquise.
La montagne vivante, Nan Shepherd, Christian Bourgois éditeur, format poche, 2024, 203 pages, 9,50 euros
 |
Antonia Pozzi, |
| Un fabuleux silence |
|---|
Voix majeure de la poésie italienne, Antonia Pozzi (1912-1938) est aujourd’hui publiée intégralement en France grâce à une traduction de Thierry Gillyboeuf chez l’éditeur Arfuyen. Voici après La vie rêvée (Arfuyen, 2016), la deuxième partie de son Journal de poésie, publiée sous le titre Un fabuleux silence et couvrant la période 1929-1935.
Si l’on devait résumer en deux mots le contenu de l’œuvre poétique d’Antonia Pozzi, on dirait « Montagne » et « Amour » (mais un amour désespéré). La montagne parce que la poétesse italienne lui a voué un véritable culte. Fidélité à l’enfance, elle qui connut ses premiers émois d’alpiniste à partir du village de Pasturo, dans la vallée de Valsassina, non loin du lac de Côme, où sa famille avait une résidence. On la découvre ainsi, dans ses poèmes, ardente arpenteuse des Dolomites où elle trouve un véritable refuge spirituel. « Oh ! Les montagnes / ombres de géants, / comme elles oppriment / mon petit cœur ».
La montagne, donc, mais aussi l’amour (coup de foudre) qu’elle portera très tôt – elle n’avait que 15 ans – à son professeur de latin et de grec, Antonio Cervi, de quatorze ans son aîné. La liaison prendra fin en 1934 sous les coups de boutoir d’une famille peu disposée à accepter ce genre de liaison. « Tu étais le ciel en moi / le grand soleil qui transforme / en feuilles transparentes les mottes de terre », écrit Antonia Pozzi dans un poème du 11 novembre 1933. « Je ne verrai donc plus jamais tes yeux / purs comme je les vis / le premier soir, blonds / comme des cheveux – et clairs / comme de faibles lampes ».
Ce chagrin amoureux sera-t-il à l’origine de sa tentative de suicide par barbituriques le 2 décembre 1938 ? On peut le penser quand on la découvrit inconsciente dans un fossé de la banlieue de Milan. Elle devait mourir le lendemain et fut enterrée dans le petit cimetière de Pasturo.
En présentant ce Journal de poésie d’Antonia Pozzi, Thierry Gillyboeuf fait opportunément le lien entre cet amour contrarié et l’appétit qu’elle avait pour les versants abrupts. « Antonia Pozzi, écrit-il, avait fait de la montagne un refuge spirituel où il lui était possible de s’affranchir d’un monde où la place qu’elle recherchait lui était toujours refusée ».
Des poètes italiens, parmi les plus grands, et notamment Vittorio Sereni et Eugenio Montale ne manqueront pas de souligner la force et l’originalité d’une œuvre placée sous le signe de la limpidité, de la pureté et probité d’esprit.
Un fabuleux silence, Journal de poésie, 1933-1938, édition bilingue, Arfuyen, 275 pages, 22 euros
 |
Guénane, |
| Sourcellerie |
|---|
Où veut-elle donc nous entraîner avec sa « sourcellerie » ? Guénane crée un néologisme pour nous parler à la fois de source et de sorcellerie. « Remonter à la source, remonter à la matrice de la mélancolie », explique la poète. Quant à la sorcellerie, elle coule de source en quelque sorte, tant elle imprègne ces lieux magiques qu’elle arpente entre terre et mer.
Guénane avait évoqué dans Ta fleur de l’âge (Rougerie, 2019) l’empreinte du temps qui passe. « Tu contemples tes friches / tu souffles sur tes derniers feux », écrivait-elle sans pour autant sombrer dans l’apitoiement. Bien au contraire. « Ne laisse plus le passé t’étrangler / cultive une bonne entente / avec tes démons coriaces ».
Aujourd’hui on a le sentiment que ces « démons coriaces » ont repris, chez elle, un peu du poil de la bête. Le premier de ces démons s’appelle la mélancolie que Guénane n’hésite pas à qualifier « d’étrange animal de compagnie ». Elle ajoute même : « Nous nous entendons bien / même si elle ne simplifie pas le monde / n’assourdit pas le bruit / des herses où se brisent les ombres errantes ». Mais Guénane « refuse tout remède » à sa mélancolie. Elle s’en accommode d’une certaine manière. « Ma mélancolie peut tout faire éclater / germer essaimer / elle pénètre et tout la pénètre ».
Pour remonter à la source de cette mélancolie, il faut emprunter ce fleuve qui « draine les souvenirs ». Fleuve qu’elle qualifie de « fleuve océan », « fleuve marin breton bavard » et qu’on imagine être le Blavet au pays marin de Lorient. Après Un rendez-vous avec la dune (Rougerie, 2014), voici donc ce rendez-vous avec le fleuve, dans un exercice d’introspection, forme de petite musique intérieure qui s’empare de la poète arpentant son passé. « Ce que je fus est lourd bagage / le fleuve s’en fiche lui ne trébuche / ne se retourne pas perd tout de vue / l’opacité lui sied ».
En se retournant, la poète pointe « le mal d’enfance » et sa litanie de contraintes ou d’interdits. « Enfance / de grosses voix enseignent / comme si grandir veut dire / sauter d’une règle à l’autre ». Aussi, on ne doit pas s’étonner que « demain est lent à venir / les mots récités ne savent guérir ». Guénane raconte alors avoir passé « une vie à chercher / des liens qui rassurent ». L’écriture a toujours été là pour ne pas perdre pied, car « l’univers niche / dans des miettes de poésie fluette ». C’est sans doute la leçon à retenir de ce livre écrit à la première personne. Nous dire qu’un destin individuel se forge aussi par les mots au point d’affirmer comme la poète : « Je reprendrais bien une part de vie / avec mots choisis ».
Sourcellerie, Guénane, Rougerie, 61 pages, 12 euros.
 |
Marie Hélène Prouteau, |
| La petite plage |
|---|
Pour la romancière Marie-Hélène Prouteau, il y a un lieu « fondateur » : une petite plage de la côte sauvage du Nord-Finistère, du côté de Kerfissien en Cléder. Elle le dit dans une évocation en prose poétique, éclatée en autant d’évocations du lieu qu’elle garde en mémoire. Un lieu qu’elle n’hésite pas, quittant la métropole nantaise où elle habite, à arpenter régulièrement pour y humer toutes les senteurs la rattachant à son enfance.
Publié en 2015, ce livre est aujourd’hui réédité et enrichi, avec une préface de Mona Ozouf. La philosophe et historienne bretonne a bien connu, enfant, cette petite plage du Haut-Léon. Et elle est tombée sous le charme du livre de Marie-Hélène Prouteau. « Vous allez découvrir, écrit-elle, avec quel talent Marie-Hélène Prouteau établit sa filiation avec ce lieu, au fil de vingt-six fragments où elle convoque ses souvenirs et ses admirations littéraires ». Mona Ozouf ajoute : « Pour moi l’essentiel est qu’elle a ouvert le chemin de la mémoire : je retrouve l’odeur puissante du goémon qui prenait possession de moi, dès le pied posé sur la dune ; le bruit de la vague, du clapotis au fracas ; le grenu du granit sous les pieds nus des vacances ; la palette des couleurs d’un lieu voué au bleu ».
Il y a en effet tout cela dans le livre de Marie-Hélène Prouteau. « L’enfance est peuplée de cabanes. Les miennes étaient ces rochers et ces grottes », souligne-t-elle. « Née dans ce Finistère, je ne peux parler comme une visiteuse. Je le ressens vivement : c’est un pays que j’ai quitté mais qui ne me quitte pas. L’amour de loin pour un être lointain très aimé nous grandit, écrit le poète, je me dis qu’il a raison ».
Encore faut-il exprimer cela de façon personnelle et originale. C’est le cas ici car Marie-Hélène Prouteau prend le parti d’associer cette petite plage non seulement à des souvenirs d’enfance mais aussi à des événements actuels ou à des œuvres culturelles qui l’ont marquée. En définitive, partir du local (et d’un local bien exigu) pour nous parler de ce qui la fait vibrer aujourd’hui. Faire surgir du passé des images nouvelles et contemporaines. Ainsi la vue de ces « femmes qui peinent dans les vagues sous un effort intense » la ramène-t-elle au tableau de Gauguin Pêcheurs de goëmon. Plus loin, à la vue de la marée montante, c’est La vague d’Hokusaï qui surgit. Ailleurs, les rochers lui font penser aux sculptures de Hans Arp.
La petite plage charrie tout cela. Elle devient une caisse de résonance du monde. Une chambre d’écho. L’autrice en fait une relecture à l’aune de ses propres expériences et de son bagage culturel. Marie-Hélène Prouteau parle joliment de « champ magnétique » ou de « promenoir des songes », de « contrepoint lumineux », « d’épicentre naturel ». Son appétit des vagues, d’iode et de rochers, reste, en tout cas, insatiable. Évoquant François Cheng, elle parle de « sentiment-paysage » et n’hésite pas, faisant référence à Erri de Luca, à sous-titrer son livre « autobiographie d’un lieu ».
Son livre se poursuit par une évocation de la ville de Brest où elle est née. Dans un livre publié en 2019, Le cœur et une place forte (La Part Commune), elle avait déjà montré l’intérêt qu’elle portait à la grande cité du Ponant.
La petite plage, suivi de Brest, rivage de l’ailleurs, Marie-Hélène Prouteau, La Part Commune, 2024, préface de Mona Ozouf, 112 pages, 13,90 euros
 |
Vincent La Soudière, |
| Batelier de l’inutile |
|---|
Michaux et Cioran, dont il était l’ami, avaient reconnu son talent, mais Vincent La Soudière (1939 - 1993) demeure un inconnu. Il faut dire que sa singulière marginalité y a largement contribué. Mais aujourd’hui « la haute tenue littéraire » de ses textes, comme le disait Cioran, est mise au jour, notamment par la publication d’écrits autobiographiques aux éditions Arfuyen. Elles ont été les premières, en 2003, à lancer avec Brisants la publication de son œuvre.
L’ombre de Pessoa rôde dans l’œuvre de La Soudière. « Le secret, disait-il, c’est de laisser ta personnalité au vestiaire, et de laisser se défaire le fantôme de ton moi ». La Soudière écrivait mais n’était pas un écrivain. Plutôt un « écrivant ». Un homme taraudé par de profondes questions existentielles qui le conduiront notamment à chercher des réponses dans la vie religieuse au sein d’abbayes bénédictines. Expériences sans lendemain mais qui n’empêcheront pas La Soudière de vouer sa vie à la recherche spirituelle et à l’écriture. Mais il se méfiait beaucoup de publier. « Écrire est une chose. Se faire publier en est une autre ». Il ne publiera d’ailleurs qu’un mince livre de son vivant, intitulé Chroniques antérieures, en 1978.
Mais il faut bien vivre. Après des études de philo à la Sorbonne, il multiplie les petits boulots, vivant dans la précarité et une forme de dénuement. Le voici un jour « pilote de voiture de livraison », une autre jour « embauché dans les champs », plus tard « triant des livres dans un soupirail » ou encore « valet de chambre stylé ». Il s’en accommode, tout en traversant des phases dépressives. « Je n’ai qu’un seul regret : je ne connais pas les autres, mes contemporains (…) Je n’ai qu’un seul souci : que va-t-il se passer ? Vers quel nouveau tunnel vais-je m’élancer ? »
La Soudière vivait en connaissance de cause cette profonde marginalité, expression de son intrinsèque inadaptation au monde tel qu’il est. « Tu levais ton museau vers les étoiles, pendant que tes égaux mangeaient en famille, après une journée de travail rémunéré ». En postfaçant ce livre, Marc Wetzel parle à juste titre d’un « homme étonnamment lucide » sur sa condition. Un homme qui plaçait le poème au cœur de son approche du monde. « Tout poème qui se respecte, écrivait-il, est un essai pour ne pas tomber – un avant-dernier soupir si difficile à arracher, plus encore à nommer ».
Les fragments en prose de ce livre de La Soudière fourmillent de considérations sur le rôle-clé de la poésie. « Le poème devrait être le plus solide arrimage pour tant de visages en lambeaux » notait-il. Ou encore ceci : « La poésie fait des chants avec des douleurs ressuscitées ». La douleur a eu raison de son chant le 6 mai 1993 à Paris. Son corps a été retrouvé le lendemain dans la Seine.
Batelier de l’inutile, Vincent La Soudière, texte établi et annoté par Sylvia Massias. Posface de Marc Wetzel, Arfuyen, 160 pages, 16 euros.
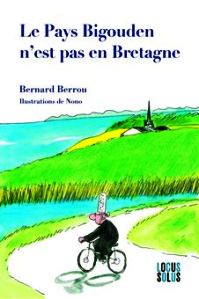 |
Bernard Berrou, |
| Le pays Bigouden n’est pas en Bretagne |
|---|
Bernard Berrou récidive. Après Un passager dans la baie (Locus Solus, 2017) où il disait son profond attachement au pays Bigouden natal, voici qu’il nous le fait découvrir aujourd’hui sous d’autres facettes. D’abord en évoquant les lieux qui lui tiennent à cœur, ensuite en dressant le portrait de plusieurs personnalités qui vivent ou ont vécu dans ce pays. Ceux qu’il appelle « les sentinelles ». En tout cas, ce sont des découvertes hors des sentiers battus que nous propose ce livre, loin d’une Bigoudénie « de carte postale ». Avec le coup de patte du dessinateur Nono pour livrer un regard décalé sur le récit de Bernard Berrou.
Il aime voyager. Aller au Portugal, par exemple, ou encore plus en Irlande qu’il a récemment évoqué dans son livre Frontières d’Irlande (Le mot et le reste, 2022). Mais l’étonnant voyageur qu’est Bernard Berrou peut aussi faire son miel de tout ce qui vit à portée de mains. Son pays Bigouden est ainsi un sujet constat de découvertes. Pays dont il détermine aussi des « frontières », évoquant ces « rubicons » que sont l’Odet, la rivière de Pont-l’abbé et le Goyen. Mais son pays bigouden intime n’épouse pas tout le territoire compris dans ces limites-là. « Il se situe, confie-t-il, dans une zone assez mal délimitée d’ouverture à l’ouest, celle de la baie d’Audierne, un territoire élargi, à demi estompé au fur et à mesure qu’il s’éloigne de l’est ».
Plus terrien que marin, Bernard Berrou trouve sa respiration dans des lieux sans « ornements intempestifs ». Il dit aimer « la terre meuble fraîchement labourée, un monticule orné de genêts, des prairies bordées de landes herbues, un sentier qui s’enfuit vers les broussailles » Et il ajoute : « Je me trouve dans des paysages qui me parlent ». Poursuivant, philosophe : « Faut-il penser que les seuls lieux qui méritent un détour sont ceux qui n’ont rien pour séduire ? »
Ce n’est donc pas dans ce livre que l’on trouvera une scène emblématique comme le retour de pêche au Guilvinec ou encore la déferlante de surfeurs à la pointe de la Torche. « J’ai mille difficultés à écrire sur Penmarc’h, confie même Bernard Berrou, commune qui se trouve à ma porte et pour laquelle je n’ai pas une vision juste ». Ce qui l’attire (et dont il veut parler), ce sont plus les villages de poche qui parsèment le pays ou encore tous ces chemins vicinaux qui les relient entre eux… Sans parler de tous ces étangs demi-sel qui sommeillent entre terre et mer dans leurs roselières. Pour autant, il n’oublie jamais la grande bleue, de préférence celle heurtant le cordon de galets de la baie. Enfin il y a ces belvédères, dont on sait l’attirance qu’il a pour eux (Belvédères, Locus Solus, 2020). « Je suis maintenant à Kerguen, écrit-il, mon regard embrasse la baie d’Audierne et son ampleur ». Une autre fois le voici à Peumerit (82 mètres) ou encore à Menez Huella, « le point culminant de Tréogat ». C’est dire…
…/…
« Avoir un attachement viscéral pour son pays est un concept poétique, estime Bernard Berrou, un accord intime avec le paysage, se sentir en connivence avec une absence de formes rationnelles dans sa structure, un paysage qui touche en vous quelque chose de primordial, en relation avec le passé ». Haro donc sur tout ce qui pourrait porter atteinte à cet univers. « J’ai besoin d’étendues dunaires, d’étangs sauvages, de friches, pas d’aménagements artificiels, de bidonvilles flottants, ni de rivieras ». Et l’écrivain pointe ainsi Loctudy, « une véritable marina entachée de bateaux en plastique » ou encore Lesconil « dont les terrasses ont été dénaturées par des esplanades marmoréennes ». Mais il y a bien d’autres sujets qui le fâchent et dont il parle dans ce livre.
Il n’est pas seul à dire l’amour de ce pays. De nombreuses figures - souvent hautes en couleur – sont évoquées sous sa plume. Des compagnons de route en quelque sorte. Certains disparus, d’autres toujours présents sur le terrain. De l’archéologue Pierre Gouletquer au journaliste Noël Guiriec, en passant par les quêteurs de mémoire comme Jakez Cornou (à qui il consacre un vibrant portrait) ou Serge Duigou, sans oublier ces écrivains ou artistes qui vivent et travaillent ici (François Bourgeon, Melaine Favennec, Gérard Bensoussan, Alain-Gabriel Monot, Jean-Yves Boudéhen …). Au dessus d’eux, il y a la « haute figure passagère » du peintre Jean Bazaine, décédé en 2001, auprès duquel Bernard Berrou raconte avoir tant appris. Et c’est ainsi, de tout ce foisonnement d’êtres et de paysages aimés ou appréciés que se construit l’amour d’un pays. Bernard Berrou nous le dit avec cette limpidité qui porte la marque de son écriture.
Le pays Bigouden n’est pas en Bretagne, Bernard Berrou, illustrations de Nono, Locus Solus, 140 pages, 14 euros.
 |
Gilles Baudry, |
| En filigrane et en aparté |
|---|
« En filigrane et en aparté » : c’est dire assez que cet art poétique ne joue pas les grandes orgues. On est ici dans le chuchotement, la confidence, la complicité fraternelle. C’est un « chant de plain-silence » que nous propose le poète, tout juste froissé par « le bruissement des arbres dans les pages » (titre d’un de ses précédents livres, chez Rougerie). Et s’il faut aujourd’hui, au-delà des arbres, laisser bruire en soi quelque chose, c’est bien « l’enfance phréatique ». Cette enfance que chantait Christian Bobin ou encore Jean Lavoué à l’enseigne de « L’enfance des arbres ».
Puisque, décidément, les arbres ne cessent de délivrer leur message, il faut, nous dit Gilles Baudry, laisser advenir « l’écriture aléatoire de la sève » ou encore « l’écriture buissonnière ». Au cœur de cet art poétique – celui d’un puisatier ou d’un « sourcier » de ses propres sources – il y a aussi cet « hommage à l’inaperçu » qui irrigue l’œuvre du moine-poète, cet hommage aux humbles et à « la splendeur cachée de l’anonymat ». Les auteurs de haïkus diraient : « Partir du banal pour sortir du banal ». Ainsi, dans la nature, exalter les simples du chemin. Ou encore, comme le disait Seamus Heaney, exalter « les humbles fleurs du dialecte ».
Autre constante de l’art poétique de Gilles Baudry : l’éloge des « heures creuses », y découvrir ce qu’elles ont « d’inouï » en dépit de leur absence « d’appâts ou d’apparat ». Pour donner corps à cette approche, le poète fait confiance aux « mots justes », aux mots qui vont « pieds nus », aux mots « prières imprononcées ». Il ajoute : « Les mots // il ne sied pas qu’ils meublent le silence / mais qu’ils soient / portes et fenêtres sur l’inconnu ». À ce propos, Marie Laure Jeanne Herledan rappelle opportunément la parenté avec ces mots de René Guy Cadou dans son Refuge aux oiseaux : « Je suis une fenêtre, ouverte, et je vois loin ». Cadou, Baudry : une même fraternité au cœur.
Pour accompagner cet art poétique, quoi de mieux que le bleu si profond – comme conçu « à contre-nuit » – des gravures abstraites de Marie-Françoise Hachet - de Salins. Il nous laisse entrevoir un monde primordial comme sorti d’abysses ou de galaxies, laissant vagabonder notre imagination et, encore plus (comme le font les poèmes de Gilles Baudry) nous laissant entrevoir « l’aérienne profondeur du poème ».
En filigrane et en aparté (art poétique), Gilles Baudry, gravures de Marie-François Hachet – de Salins, Des sources et des livres, 57 pages, 14 euros
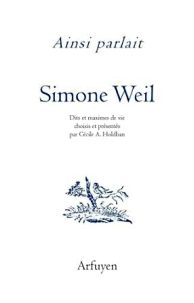 |
Cécile A. Holdban, |
| Ainsi parlait Simone Weil |
|---|
Relire Simone Weil. Avec la tentation de trouver dans ses écrits des réponses aux questions qui secouent aujourd’hui le monde. La célèbre philosophe, qui fut aussi travailleuse en usine et militante acharnée, a en effet pressenti bien des dérives contemporaines. Mais la richesse et la complexité de sa pensée nous tiennent, la concernant, à distance de tout discours réducteur ou simplificateur.
Simone Weil (1909-1942) n’a rien publié de son vivant. Ses principaux ouvrages, on le sait, qu’il s’agisse de La pesanteur et la grâce, de L’Enracinement, de La connaissance surnaturelle… ne seront publiés qu’après sa mort. Mais son œuvre a été « mise en ordre par deux artisans, gardiens ardents de sa pensée : Gustave Thibon, pour la partie spirituelle, et Albert Camus, pour la partie philosophie », souligne Cécile A. Holdban qui a finement analysé l’œuvre de Simone Weil. Elle nous présente ici une anthologie de ses écrits, qu’il s’agisse de lettres, d’articles pour Les Cahiers du Sud ou d’autres revues, de fragments de toute nature …
Puisque les guerres sont à nouveau à l’agenda de l’humanité (on pense notamment à celle menée par la Russie de Poutine en Ukraine), il est frappant de noter la justesse de vue de Simone Weil à leur propos. « La guerre efface toute idée de but, même l’idée des buts de la guerre », écrit-elle. Ou encore ceci : « D’une manière générale, la guerre renforce toujours le pouvoir central aux dépens du peuple » (…) « Toute société oppressive est cimentée par cette religion du pouvoir ».
Autre sujet explosif d’aujourd’hui : le conflit israélo-palestinien. Simone Weil (dont on sait les ascendances juives), affichait des opinions en rupture avec son milieu, disant son opposition au sionisme et à une installation juive en Palestine. Il y avait chez elle, souligne Cécile A. Holdban, la crainte exprimée aussi plus tard par Annah Arendt « sur le danger inhérent à la transformation d’une idée en idéologie ». Simone Weil allait aussi assez loin dans son approche critique du judaïsme : « Notre civilisation ne doit rien à Israël et peu de choses au christianisme. Elle doit presque tout à l’antiquité pré-chrétienne ». Cécile A. Holdban souligne ainsi que « la représentation de Dieu que se fait Simone Weil est profondément platonicienne : il ne peut être que le bien ». La philosophe se rapprocha néanmoins du christianisme à partir de 1937.
On pourrait ainsi poursuivre la liste des sujets brûlants (ou des interrogations métaphysiques) qui agitent aujourd’hui le monde et dont Simone Weil se fait prophétiquement l’écho. Morceaux choisis : « La tempête qui nous entoure a déraciné les valeurs, en a défait la hiérarchie » (…) « Le mécanisme même de la démocratie peut être utilisé pour supprimer une partie ou la totalité des droits des individusv» (…) « Nous vivons une époque privée d’avenir. L’attente de ce qui viendra n’est plus espérance, mais angoisse » (…) « Le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines ». À un siècle de distance, on mesure l’actualité de ces propos (et souvent leur pertinence). Cécile A. Holdban ne manque pas de souligner, au passage, l’hommage à Simone Weil qu’Albert Camus avait rendu en marge de la journée de remise de son prix Nobel : « Il y a des morts qui sont plus proches de nous que bien des vivants ».
Ainsi parlait Simone Weil, Dits et maximes de vie choisis et présentés par Cécile A. Holdban, Arfuyen, 187 pages, 14 euros
 |
Jean-Louis Coatrieux, |
| Fleur |
|---|
On peut avoir beaucoup bourlingué mais rester profondément attaché à ses racines. Pour le Rennais Jean-Louis Coatrieux, c’est la Bretagne intérieure du côté de Saint-Nicolas du Pélem et de Locuon. Afin de témoigner d’une enfance passée dans ce pays-là, l’auteur rennais va regarder le monde à travers les yeux d’une fillette dénommée Fleur.
Récit, conte, fable ? C’est tout cela à la fois le nouveau livre de Jean-Louis Coatrieux, écrit dans une élégante prose poétique découpée en courts tableaux. « Les rêves les plus fous se cachent ici, j’en suis convaincu », affirme Jean-Louis Coatrieux. Il faut dire qu’avant lui un autre écrivain breton (et non des moindres) avait, lui aussi, été convaincu de la capacité de cette Bretagne intérieure à nous envoûter. Dans Le cycle du pays natal (La Part Commune, 2010), Armand Robin évoque avec ferveur sa campagne natale du côté de Plouguernével. « Les fontaines, les plantes, les incertaines lunes / furent mon logis ; les ronces méprisées furent ma fortune ». Dans ces jours « abreuvés de lentes eaux », il s’émerveillait de tout, comme le fait aujourd’hui une fillette sous la plume de Jean-Louis Coatrieux. « Elle fit de sa rivière un théâtre, une aventure merveilleuse et réelle à la fois ». Ici, dans ce pays gorgé de mystères, « toucher à tout est la règle d’or ». Car sur cette « terre pauvre », il y a « la légende des pierres » et tous ces « contes étranges que le grand-père semblait tirer de sa poche aussi facilement que son tabac à rouler ».
Fleur arpente ce pays à pied, en vélo, ou dans ses rêves. Elle n’est pas seule. Il y a les présences rassurantes de « père » et de « mère ». Il y a les amis, les enfants attentifs comme elle aux « sauts inattendus » des écureuils ou éblouis par « les gerbes bouillonnantes » du bief. « Nous étions trois inséparables du même âge, Maria, Joseph, Fleur ». Ces enfants parlent une langue commune. Ici, breton et français sont « mélangés avec une assurance égale ». Jean-Louis Coatrieux ne lésine pas d’ailleurs sur l’usage de toponymes pour mieux nous ancrer dans ce terroir bretonnant : Bothoa, Kerfandol, Penhoët braz, Revelen, Kerguzul…
Les mots ont leur importance et Fleur en a vite la prescience. Elle dessine puis écrit dans son cahier les noms des plantes ou des fruits qu’elle ramène de ses promenades. Il lui fallait des mots pour « raconter le monde » et, sûrement, pour mieux l’appréhender. Comment ne pas penser ici à ces lignes merveilleuses de Mahmud Darwich sur « l’art de nommer les choses ». Dans son livre Présente absence (Actes Sud, 2016) le poète palestinien disait : « Écris correctement fleuve, il coulera dans ton cahier. Le ciel aussi sera un de tes biens personnels si ton orthographe est correcte. Qui écrit une chose la possède ». Fleur en était aussi convaincue. Et, à travers elle, Jean-Louis Coatrieux qui nous livre ici un émouvant récit poétique, à la fois sur l’enracinement et l’ouverture sur le monde.
Fleur, Jean-Louis Coatrieux, La Part Commune, 63 pages, 11 euros.
 |
Jacques Goorma, |
| Lucarnes |
|---|
D’origine belge mais vivant à Strasbourg Jacques Goorma est un spécialiste de l’œuvre de Saint-Pol-Roux. Il est aussi poète et son dernier livre est placé sous le signe de la grâce, thème du Printemps des poètes 2024.
Avec au total 336 poèmes courts (trois poèmes de quatre vers par page), Jacques Goorma a pris le parti du minimalisme dans son nouveau livre. Il confirme ici son contact étroit avec la nature, mais aussi sa sensibilité particulière aux grandes traditions spirituelles et littéraires d’Extrême-Orient. On en a pour preuve l’idéogramme chinois Kou (la bouche) placé en couverture de son livre et qui désigne la bouche béante dans l’instant de l’émerveillement. Cette « bouche » renvoie au titre du livre, intitulé simplement Lucarnes pour désigner ces petites ouvertures au monde extérieur ou à un autre monde.
Il y a, enfin, cette écriture elliptique qui caractérise si bien certains textes littéraires de la Chine ou du Japon. À commencer par le haïku dont on retrouve l’esprit dans plusieurs mini-poèmes de ce livre. « La main suspendue / hésite // la mouche / se frotte les mains » ou encore ceci : « la mangeoire / se balance // la mésange / est revenue ».
Mais l’essentiel du livre nous propose certains états de grâce qui relèvent plutôt de la sentence, de la pensée ou de l’aphorisme. « Les enfants / sont // la prunelle / des vieux », écrit Jacques Goorma. « Certains / mots // doivent rester / dans le noir ». Le poète ne renonce d’ailleurs pas à l’usage du mot « grâce » au cœur de ses textes. « Par le sourire en nous / de la clarté // la grâce demeure / invaincue ».
Loin des traités universitaires ou savants sur la place et le rôle de la poésie, Jacques Goorma distille aussi quelques bonnes vérités avec l’air de ne pas y toucher. « À chaque / lecture // le poème / change les draps » (…) « nul ne rencontre / le poème // sans / se rencontrer » (…) « le bruit / court // le poème / s’attarde ».
Le poète, dans ses vers lapidaires (et souvent fulgurants) nous fait toucher, de bout en bout, la saveur du monde. Les cinq sens sont en éveil. Le toucher avec ce « caillou » d’une épaule. La goût avec ce « grain de sel » éveillant « la saveur du radis ». Le toucher encore, avec cette « eau fraîche / des fontaines // aubaine / des mains rêches ». Le poème est là aussi pour nous aider à mieux voir, à mieux écouter, à mieux sentir. À condition, comme le dit Jacques Goorma, de savoir « diminuer le nombre / des mots // pour augmenter / leur poids de silence ».
Lucarnes, Jacques Goorma, Arfuyen, 126 pages, 14 euros.
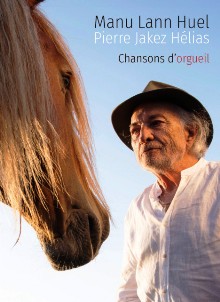 |
Manu Lann Huel, Pierre Jakez Hélias, |
| Chansons d’orgueil |
|---|
13 poèmes de Pierre Jakez Hélias interprétés par Manu Lann Huel. Quel bonheur et quelle forme de reconnaissance, de la part du chanteur breton, pour une œuvre poétique encore largement méconnue. L’auteur du Cheval d’orgueil, en effet, homme de théâtre, chroniqueur et romancier, était aussi et surtout un grand poète. Manu Lann Huel nous révèle la richesse de son œuvre à travers le choix de treize poème qu’il interprète en breton (evel just !) Le livre-CD de belle facture qui accompagne ces chansons propose une édition bilingue.
Manu Lann Huel et Pierre Jakez Hélias, c’est un long compagnonnage. Introduisant ce livre-CD audio, Francis Favereau rappelle l’amitié qui unissait les deux hommes et l’intérêt que, très vite, le chanteur breton a porté à l’œuvre poétique de l’écrivain bigouden. Hélias est décédé il aura bientôt trente ans mais Manu Lann Huhel ne l’a jamais perdu de vue, entretenant la flamme, par-delà l’écart des générations, en interprétant des chansons inspirées par les poèmes d’Hélias.
Aujourd’hui on doit se réjouir de voir réunis dans ce livre-CD treize poèmes judicieusement choisis puisqu’ils révèlent plusieurs facettes de l’écrivain bigouden. Dédicace, par exemple, poème publié dans An Tremen buhez, le Passe-vie (éditions Embleo Breiz, Le Signor, 1979) est un hymne en l’honneur des anciens. « En enor d’ar re goz / O-deux poaniet gwechall / Dindan bragez pe vroz / Da hounid ar bel all / E tisplegan o buhez / Gand azaouez ha truez » (« En l’honneur des anciens / Qui peinèrent jadis / Sous les braies ou la robe / Pour faire un autre monde /Je raconte leur vie /En estime et pitié »).
La chanson de Dolly Pentraeth, dédiée à la dernière femme qui a parlé le cornique au 18e siècle (poème publié dans Ar men du, La pierre noire, Emgleo breiz, 1974), est l’un des poèmes les plus touchants d’Hélias. Il trouve opportunément sa place dans ce CD. « Ma yez a gan a-dreuz peb ger / An tadou koz, ar paour-kêz treued / Ar beo, ar maro, se zo henvel / Harlu ar bed ha deiz ar varn » (Ma langue chante avec ses mots / Les grands aïeux, les pauvres bougres / La vie et la mort, c’est tout comme, / L’exil du monde et le Grand Jour »). Mais il y a aussi dans ce CD, des poèmes sur les îles (Batz, Sein, les Glénan…) ou encore cette fameuse ballade pour Morvan Lebesque.
S’il nous parle d’un monde en voie de disparition, Hélias ne garde pas moins intactes ses capacités d’émerveillement. Pour interpréter tous ces poèmes, Manu Lann Huel apporte sa voix à la fois sourde et rocailleuse dans des mélodies où vibre une forme de nostalgie. Le chanteur breton a su, pour l’occasion, s’entourer de musiciens de renom (Didier Squiban ou Eric Le Lann pour certaines compositions). Les arrangements musicaux, eux, sont signés de Jacques Pellen. Il s’agit d’ailleurs du dernier enregistrement du célèbre guitariste brestois décédé en 2020. Ajoutons que Nolwenn Arzel est à la harpe, Bernard Le Drian au saxo, Yann Pelliet à la cornemuse écossaise… Au total douze instrumentistes différents. Que du beau monde pour faire vibrer ces Chansons d’orgueil, à l’unissson de la voix si singulière et si envoûtante de Manu Lann Huhel.
Chansons d’orgueil, Manu Lann Huel, Pierre Jakez Hélias, Livre/CD, Paker Prod, distribution Coop Breizh, 36 pages, 19 euros
Les poèmes en breton du livret sont publiés selon l’écriture de Pierre Jakez Hélias dans son œuvre poétique complète D’un autre monde/A-berz eur bed all (éd. Ouest-France, 1991)
 |
Olivier Risser, |
| La sève et le ruisseau, poésie de la présence avec Jean Lavoué |
|---|
Un livre sur l’œuvre de l’écrivain, poète et éditeur breton Jean Lavoué. Il a été publié peu de temps avant sa disparition le 8 mai dernier. Son auteur : Olivier Risser, professeur de lettres dans le Morbihan et particulièrement sensible à la « poésie de la Présence » chez Jean Lavoué. La présence à soi, aux autres et à la beauté du monde.
Avant d’être l’écrivain et l’éditeur que l’on connaît (à l’enseigne « L’enfance des arbres ») Jean Lavoué a mené une vie professionnelle dans la cadre de la Sauvegarde de l’enfance du Morbihan. Séduit par l’œuvre de Jean Sulivan, il a placé toute son activité littéraire sous le signe d’une spiritualité invitant à la fois à l’enracinement et à l’exode. D’où son attrait pour des figures d’auteurs ou de personnalités mettant en question nos certitudes, à l’image de Félicité de Lamennais, d’Etty Hillesum et de bien d’autres.
C’est donc l’œuvre ce Jean Lavoué-là, amoureux des arbres, qu’Olivier Risser a entrepris de décrypter, dans une forme d’enthousiasme et de gratitude qui parcourt tout son livre. « Cette écriture s’offrait à moi comme un baume apaisant, un souffle vivifiant », écrit-il à propos des de Jean Lavoué et notamment de sa poésie dont il se plaît à souligner « la richesse de sens, la profondeur et la tonalité lumineuse qu’elle recèle en chacun de ses vers ».
Pour mieux nous faire toucher du doigt les subtilités des texte de Jean Lavoué, le professeur Olivier Risser n’hésite pas à proposer au passage une approche grammaticale ou syntaxique de l’œuvre. Ici l’usage du temps présent par Jean Lavoué, là son recours à l’impératif, plus loin l’utilisation de la 2e personne du singulier (comme approche d’un dialogue avec ses lecteurs). À propos de celui qu’il désigne aussi comme « le poète du Blavet », Olivier Risser tient aussi à souligner le lien que Jean Lavoué établissait entre l’écriture et la prière. Il parle de lui comme d’un ami « entièrement tourné vers les autres » et dont le vrai centre de gravité était la pauvreté.
Le livre d’Olivier Risser est sorti à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du Printemps des poètes dont le thème était cette année la grâce. « Nous avons la chance d’habiter une région du monde où la poésie affleure au moindre éclat de la lumière sur l’eau, l’arbre, le rocher, le nuage, l’aile des oiseaux… Et c’est pourquoi, de tout temps, les poètes aiment y dialoguer, se rencontrer », écrivait Jean Lavoué. Aujourd’hui, Olivier Risser sait se faire l’écho de cette parole lumineuse.
La sève et le ruisseau, Poésie de la Présence avec Jean Lavoué, Olivier Risser, préface de Gilles Baudry, éditions L’Ombre des Mots, 22 euros, 250 pages.
 |
Wolfgang Matz, |
| Du bonheur de la vie poétique |
|---|
La poésie ne se réduit pas à la production de livres mais elle doit aussi se traduire par une certaine « justesse » dans la vie elle-même. C’est la conviction exprimée dans ce livre par Wolfgang Matz en s’appuyant sur l’itinéraire de trois auteurs de la même génération, mais pourtant bien différents les uns des autres : André du Bouchet (1924-2001), Yves Bonnefoy (1923-2016) et Philippe Jaccottet (1925-2021).
Il les connaît tous les trois par cœur. L’auteur et traducteur allemand Wolfgang Matz a traduit une partie de leurs œuvres. Il peut nous faire vivre « de l’intérieur » le parcours de ces trois grands poètes français contemporains qui se connaissaient bien et s’estimaient. Une simple montagne, d’ailleurs, séparait André du Bouchet de Philippe Jaccottet. Le premier vivait à Truinas, le second à Grignan dans le même département de la Drôme.
À la mort de Du Bouchet, Jaccottet écrira un livre simplement intitulé Truinas, le 21 avril 2001 (La Dogana, 2004), « un livre sur la poésie et la réalité, une réalité qui inclut inévitablement la mort », note Wolfgang Matz. Et suite à sa propre rencontre avec Du Bouchet peu de temps avant sa mort, l’auteur peut écrire : « La poésie n’est pas un art coupé de la vie ; la poésie est la condensation les plus poussée, la plus intense, de la vie même. Et c’est précisément ce que nous voyons quand nous pensons à André du Bouchet dans son jardin de cognassiers, pendant qu’il parle de ses poèmes, qu’il parle des mots, des arbres, de la montagne ».
Pour Wolfgang Matz, l’idée de la mort hante aussi toute l’œuvre de Bonnefoy qui, lui aussi, vécut dans le sud de la France, à Valsaintes, entre le Mont Ventoux et le Lubéron. L’auteur évoque notamment les derniers livres de Bonnefoy, Ensemble encore et L’écharpe rouge qui, note-t-il, font « de la conscience de sa mort prochaine l’objet de la poésie ». Ce qui n’empêche pas que L’écharpe rouge soit « un récit saturé de réalité tiré de l’enfance et de la jeunesse » et que Ensemble encore puisse nous parler d’une poésie « conçue comme une conversation avec des poètes, des peintres, des photographes, des philosophes ».
À propos de Philippe Jaccottet, Wolfgang Matz souligne que des trois poètes présentés dans son livre, il fut le seul à s’être totalement établi loin de Paris, à Grignan, avec cette « ouverture sur un réel vivable » qu’il a expérimentée sur place. Sa poésie s’en ressentira dans la mesure où elle « n’est pas un exercice mallarméen, mais se réclame de la vie d’un homme, de son labeur quotidien, des jours qui passent ». Et il ajoute : « Peut-être toute sa poésie prend-elle sa source dans ce conflit, entre, d’un côté, le pathos mélancolique, quasi baroque de la fugacité des choses et, de l’autre, l’expérience irréfutable de la beauté et de la vérité dans la nature et l’art ».
…/…
Comme pour Du Bouchet et Bonnefoy, Wolfgang Matz s’attache à noter que l’ombre de la mort hante aussi l’œuvre de Jaccottet. Avec une ouverture dans son dernier livre, La clarté Notre-Dame, sur une forme de sacré, mais « le sacré comme savoir, que ce monde matériel n’est pas tout, ne peut être tout ».
Voilà, en tout cas, rassemblée dans un petit livre, une somme de considérations fécondes sur la poésie et le poème de la vie. Autant d’encouragements à nous pencher, plus que jamais, sur les œuvres de ces trois immenses poètes.
Du bonheur de la vie poétique, Wolfgang Matz, éditions Le Bruit du temps, 70 pages, 13 euros
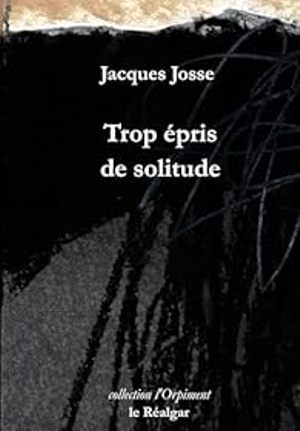 |
Jacques Josse, |
| Trop épris de solitude |
|---|
Jacques Josse aime les êtres vivant dans les marges et tous ces pas de côté qui nous apprennent tant sur la nature humaine. Le voici, cette fois, du côté des « épris de solitude » hommes ou femmes qui assument, cahin-caha, leur mode de vie. Il nous en parle dans des poèmes ou dans de courtes proses poétiques qui sont autant de tableaux de genre bien sentis.
« Ce n’est que parmi les pauvres ratés que je trouve les gens que j’aime le plus ; les riches ne peuvent, en termes de généralisations, parvenir à l’originalité qu’en devenant légèrement dingues ». Ce n’est pas Jacques Josse qui le dit mais le poète gallois Dylan Thomas. Des propos que l’auteur rennais pourrait, par contre, reprendre volontiers à son compte.
Nous voici, en effet, plongés avec son nouveau livre dans l’univers de « fantômes à vélo », d’écorcheurs de lapins ou de piliers de bistrot. Voici un homme « pris de boisson » qui « insulte trois tombes ». Voici « le son rauque d’un cri qui monte du fonds d’un puits ». Voici celle qui voit « des vipères partout ». À trop s’éprendre de solitude, jusqu’à s’en mordre les doigts, on peut tomber dans l’alcool, dans la folie et, au bout du compte opter pour le suicide comme celui-là qui « s’est accroché » à l’une des branches d’un pommier.
Le monde de Jacques Josse n’est pas rose. Mais son attention soutenue aux gens et aux choses nimbe de lumière tant de scènes de la vie quotidienne. C’est le cas dans ce quartier populaire de Rennes où il vit. « Allée d’Herzégovine, une grosse femme voilée traîne un caddie d’où dépasse une botte de poireaux ». Plus loin, « Cours du Danube, un homme assis sur un ban partage son sandwich avec un berger allemand ». Quittant les grands ensembles de la métropole, il croque des scènes de la vie rurale qu’on imagine volontiers celles de son Goëlo natal. Voici ce paysan « soixante ans / lit froid, vie rêche » qui « lance, remorque pleine / son tracteur dans les ornières ». Voici aussi, car la mer est toute proche, « ce pan de roches noires où dansent, / dit-on, certaines nuits / des squelettes de marins perdus ».
Jacques Josse fait vibrer son monde, celui des vivants mais beaucoup, aussi, celui des disparus. Il rend hommage à ces héros du quotidien, ces combattants dont on ne trouve les noms sur aucune stèle, à ces « invisibles, couchés dans des caisses, à l’est ou au nord de la ville » qui « se souviennent des braseros, de la fatigue, des bières bues au goulot, des brusques cris de colère ». Jacques Josse dit qu’ils ont « le sommeil perturbé par le vacarme qui résonne dans les galeries ».
Ces « invisibles », il les associe dans son livre à des hommes sans doute aussi épris d’une forme de solitude, partis tragiquement, mais dont l’histoire a retenu les noms. Ainsi Victor Ségalen dont Jacques Josse évoque la mémoire et la brutale disparition en forêt du Huelgoat (« Cela remue dans les branches / quelqu’un froisse des fougères et du bois »). Ainsi, aussi, l’écrivain tchèque Bohumil Hrabal dont il a vu la silhouette « danser sur la paroi / d’un mur rayé ». Lisant l’auteur rennais on pense à ces mots du poète marocain Abdelattif Laâbi : « Entre les vivants et les morts / La poésie n’a pas de préférence ».
Trop épris de solitude, Jacques Josse, Le Réalgar, 77 pages, 13 euros
 |
Gérard Le Gouic, |
| Journal de rien et au-delà |
|---|
Nous avions quitté Gérard Le Gouic avec ses Lettres de Bretagne et d’ultimes chagrins (Diabase, 2022). Le revoici dans cette forme d’autoportrait poétique qu’il affectionne pour nous parler de ce qui le hante et aussi de ce qui continue à l’animer profondément, en dépit de tout.
Sept vers par page, comme dans son précédent recueil. Avec, cette fois, un plus fréquent coup d’œil dans le rétroviseur. Vingt de quatre-vingt textes de ce nouveau livre commencent par la formule « C’étaient » ou « c’était » comme pour revivre un passé que le poète breton se garde pourtant d’enjoliver, préférant parler « d’entassements de strates » ou « d’enlisements de souvenirs ». On notera, malgré tout, une forme de nostalgie dans l’évocation de ces « temps anciens de la poésie », de ces « temps irréversibles de la poésie » et de cette époque où la poésie lui « remplissait les yeux » et « comblait ses sens ».
Mais un jour arrive ce que l’on pense ne jamais devoir arriver. « C’était sur le coup de telle heure, / je ne m’en étais pas inquiété ». Et pourtant, « cela devait se produire / j’en guettais les prémices ». A 88 ans, en effet, on sait bien que tout peut arriver. Mais Gérard Le Gouic a l’élégance de ne pas s’apitoyer. Simplement dire : « La fatigue commençait à me diminuer ». Et, en définitive, faire ce constat : « Je bute sur l’ultime, ou presque, étape / que je ne pensais jamais rejoindre ».
Arrive alors le moment d’effectuer, à mots feutrés, un voyage dans le temps pour raviver des moments, des lieux, des êtres. Pour parler de la femme aimée disparue : « Tu m’étais apparue (…) comme une aurore qui m’éclaira d’un coup ». Et encore aujourd’hui, le poète peut écrire : « J’ai des relents de ton parfum / sur mon visage… ».
Cet autoportrait (plus que jamais en noir et bleu, comme il le titrait en 1980 dans son recueil publié chez Rougerie) le conduit aussi à nous parler, à nouveau, de ses rapports à l’époque, au monde et aux autres. « Je suis plus sensible à la douleur / qu’à l’absence de mes semblables / à mes côtés qui resteront à jamais / des étrangers, des mondes à part, /impénétrables comme je le suis à moi-même ». Gérard Le Gouic nous raconte ici aussi être « encombré de défauts ». Il nous demande d’être « patients » comme il s’efforce lui-même de l’être. Et dans une pirouette donc il a le secret, il tient à rassurer des congénères pour lesquels il a eu, parfois le dent dure : « Ma traque touche à sa fin ».
Journal de rien et au-delà, Gérard Le Gouic, Diabase, 96 pages, 14 euros
 |
Patrick Moazon, |
| Pagan |
|---|
« Pagan ». Le mot claque, comme la mer le fait sur les balises ou les rochers. Être de ce pays-là, païen, sauvage. Patrick Moazon y a fait son nid, sensible à la rudesse des lieux, à l’histoire qui s’y raconte en million d’années.
« Avec l’haleine de nos mots / sculpter notre colère dans le granit des silences », écrivait, il y a cinquante ans, Patrick Moazon, dans son premier recueil de poésie (Celte présence, PJ. Oswald, 1973). La colère du jeune militant breton s’est sans doute assagie mais le granit est toujours là, celui de ce pays pagan sur la côte léonarde, où rochers gigantesques et mégalithes s’imposent au regard.
Patrig Moazon avait déjà abordé ce terroir dans Un désir de brumes (La Part Commune, 2022). Il récidive mais en donnant cette fois toute sa place à ces pierres qui « viennent du temps d’avant la mémoire ».À Ménéham, note-t-il, voici « charnier de granit ossuaire de rocailles ». À Beg ar c’hoaz, les gros rochers sont « l’Everest de gamins ». Penché sur la carte littorale, il inventorie « les noms des récifs ». Et jour après jour, souligne-t-il, « les rochers délivrent un visa à la marée montante ».
Ce monde minéral, gigantesque, venu du fond des siècles, cohabite avec « les cratères de taupinières » mais aussi avec les lieux communs de nos existences si précaires : le Breizh market, le Food truck ou Les Hespérides. Patrig Moazon s’en amuse. Par contre il se désole de certaines « profanations ». « Le Mein Marz demeure debout malgré l’outrage », écrit-il à propos du menhir christianisé de Brignogan.
Les « paganeries », aphorismes souvent teintées d’humour, qu’il distille à la fin de son livre, lui permettent d’enfoncer le clou pour dénoncer l’emprise chrétienne sur une terre « païenne » (c’est la racine du mot « pagan ») ou pour brocarder les « crânes bien-pensants » qui avaient entrepris de dénoncer le culte réservé sur la plage du Rozmeur à un phallus de granit familièrement appelé « le zizi de pépé ».
Familier de ce pays pagan devenu sa terre d’adoption (Patrick Moazon est originaire de Rennes), le poète accueille « les giboulées en riboule sur les ribines » ou s’extasie devant « un nuage de mouettes ». Dans ce pays qu’il ausculte avec ferveur, il y a « toujours les mêmes rochers / jamais les mêmes vagues ». Il constate que « les calvaires et les croix des carrefours sont au chômage technique » (face à « la mécanique des ensileuses »). Ce qui fait dire à Patrick Moazon que, ici sans doute plus qu’ailleurs, « le paysage mental commerce avec le paysage réel ».
Pagan, Patrig Moazon, La Part Commune, 75 pages, 13,90 euros
 |
Abdul Ghafour Al Khatib, |
| Ce que dit le poème |
|---|
Exilé syrien à Nantes depuis 2016, le journaliste et poète Abdul Ghafour al Khatib (né en 1968) nous fait passer, dans ses poèmes, de la plaine de la Goûtha aux bords de la Loire. Des poèmes écrits à Damas entre 2007 et 2010 côtoient des textes écrits dans la capitale du duché de Bretagne entre 2018 et 2023. Le poète, contemporain d’une « histoire submergée de sang », nous dit croire en « un autre monde plus lumineux ». Grâce à la poésie.
Ce que dit le poème ? Jamais l’auteur ne le dira en face. Il tourne, pourrait-on dire, il tourne autour et n’entend pas – on s’en doute – faire une savante démonstration sur la place du poème dans nos vies. Il nous entraîne, en réalité, dans un univers qui échappe à notre rationalité occidentale pour nous parler des « oiseaux de la nostalgie », du « feu de nos peines » ou des « hiboux de nos déceptions ». Nous voici, à sa suite, pistant « les traces du vent », recueillant « les acquis du brouillard » et même « le sang de la grenade ». Guillevic avait raison de le dire : « La poésie, c’est autre chose ».
Car après les grands désastres de la guerre en Syrie, on aurait pu concevoir sous la plume du poète syrien un appel à la révolte, à l’engagement militant. Non, il n’y a pas ici de poésie engagée au sens où on l’entend en Occident. Abdul Ghafour Al Khatib rejoint, à ce propos, les convictions exprimées par Mahmud Darwich. Dans un livre d’entretiens (<La Palestine comme métaphore, Payot 2002), le poète palestinien soulignait que « le poète n’était pas tenu de fournir un programme politique à son lecteur » et que la poésie était, avant tout, « la trace de l’absence ». Lui l’exilé faisait, comme Abdul Ghafour Al Khatib, confiance à la poésie pour affronter les drames de l’existence. « Si l’on t’interroge sur la force de la poésie, dis : l’herbe n’est pas aussi fragile qu’il y paraît », affirmait Mahmud Darwich.
Le poète syrien, lui, revient de cette plaine du nord de Damas où le gaz sarin a été utilisé contre les civils en 2013. Dans cette plaine coule la rivière Barada, à laquelle il pense quand ses pas le mènent au bord de la Loire. Il y aussi ce plateau de Qualamoun qu’il associe volontiers aux « plaines de Bretagne ». Des lieux entretiennent la nostalgie, ravivent les souvenirs, rouvrent sans doute des plaies. Mais en passant « de l’est du cœur » à « l’ouest de la Loire », Abdul Ghafour Al Khatib sait que « les douleurs de la nuit sont inévitables / pour une nouvelle naissance ». Il s’agit, pour l’instant, de survivre « avec les mots les moins pires / les plus éloquents ». Et il ajoute : « La fleur sauvage que j’ai mise dans mon livre / S’est ouverte, est devenue poèmes et sonnets / Et son parfum s’est répandu / Dans les plaines de Bretagne ».
Adonis, le grand poète d’origine syrienne, a écrit un jour ces lignes sur la place de la poésie. « Ton état le plus haut est d’être une preuve / De lumière et de nuit (…) Ton état le plus haut est d’être la cible, le carrefour, / Du silence et de la parole » (Les poètes de la Méditerranée, anthologie, Poésie/Gallimard, 2010). Avec Abdul Ghafour Al Khatib nous sommes bien, aussi, dans cette veine-là de la poésie.
Ce que dit le poème, Abdul Ghafour Al Khatib, Des sources et des livres, édition bilingue, avec un CD d’enregistrement de la voix du poète, Après-lire de Marie-Laure Jeanne Herledan, 105 pages, 18 euros
 |
Jean-Pierre Boulic, |
| Quelques miettes tombées du poème |
|---|
Il vit à Trébabu, juste en face de l’île d’Ouessant, à la pointe du Finistère. Le poète Jean-Pierre Boulic baigne dans une forme de nature primordiale où il trouve, sans faillir, son inspiration (et sa respiration). C’est encore le cas dans ce nouveau recueil constitué de courts poèmes comme autant de miettes éparpillées sur son chemin d’écriture.
Mais que sont donc ces miettes étonnamment « tombées du poème ? » L’expression ne manque pas de surprendre. S’agit-il de « chutes » tombées d’un poème principal, comme on le dirait de « chutes » d’un morceau de bois que l’on vient d’équarrir ? Mais ne s’agirait-il pas plutôt, en réalité, de miettes tombées du Poème de la Création, autrement dit d’une évocation – rendue ici très contemporaine par le poète – d’un monde conçu par la puissance divine (L’Elohim de la Genèse) dont il conviendrait de « réunir les morceaux épars » selon les mots du poète Novalis ?
On est tenté de le penser à la lecture des poèmes de Jean-Pierre Boulic quand il écrit: « Aller en genèse // Ouvrir la parole / primordiale / d’un nouvel espace (…) Venir à la source / où le grain de lumière germe / sur la bonté des herbes // aller en genèse ». Plus loin le poète écrit : « Tu te retrouves à contempler / infiniment / les choses de la terre ». Ou encore ceci : « Paysage apprivoisé / infiniment contemplé / en lui bruisse une voix ».
La contemplation est au cœur de la démarche poétique de Jean-Pierre Boulic. La nature est l’espace où elle peut s’exercer sans répit, sous « les berges du ciel », sous « le châle noir des nuages » ou « les brèches de la pluie ». Nous sommes au bord de l’océan sur des terres qu’un « napperon d’embruns » ou un « tamis de rosée » peut investit sans coup férir.
Parcourant ces terres océaniques, le poète fait corps avec cette création qui l’environne jusqu’à « tressaillir / à profusion / d’une joie inépuisable ». Les oiseaux, les fleurs, les arbres, qu’il désigne avec application, sont les messagers d’une sorte de révélation (« Au faîte des châtaigniers / le coucou / répète la patience des heures ») pouvant aller jusqu’à ces petits miracles que sait nous révéler le regard du poète : « La mousse de la dune / encore mouillée / allume des étoiles ».
Il y a dans ce nouveau livre de Jean-Pierre Boulic – n’hésitons pas à le dire – une tonalité encore plus mystique que dans ses précédents ouvrages. Car de cette contemplation, en dépit des temps mauvais, il s’agit d’en faire quelque chose. « Habiter dans la confiance », nous dit-il, ou encore « Tressaillir / à profusion / d’une joie inépuisable ». Et, nous le rappelle-t-il : « Aller en genèse » pour recueillir ces morceaux épars d’un « paradis dispersé sur toute la terre» (Novalis)
Quelques miettes tombées du poème, Jean-Pierre Boulic, Éditions Illador, 90 pages, 16 euros.
 |
Janine Mesnildrey , |
| Au pays de Jean Follain |
|---|
Qui était vraiment Jean Follain ? Dans un brillant essai, Janine Mesnildrey invite à mieux connaître l’œuvre et la personnalité du grand poète normand. L’autrice, originaire de Saint-Lô près de Canisy où est né Jean Follain, nous parle d’un « poète des chemins de l’ombre, un poète de la mesure et de prudence, de la bienveillance et de finesse en toute chose ». Quelqu’un qui eut l’art de « faire parler tout ce qui ne parle pas ».
Jean Follain (1903 – 1971)) n’est guère mis aujourd’hui sur le devant de la scène. Et pourtant que ne nous apprend-il pas sur nous-mêmes et, à quelques décennies de distance, sur notre époque si tourmentée. Jean Follain fait sans doute partie de ces auteurs, à l’image par exemple de Charles-Ferdinand Ramuz, dont « le progrès de la technologie vient heurter son monde d’élection », comme l’écrit Janine Mesnildrey. Pour autant, il n’est pas question de voir en lui un auteur passéiste. Follain, c’est d’abord, « l’art de faire porter aux choses modestes le tragique de la vie ». Il y a, nous dit l’essayiste, « cette folie de Follain de vouloir tout sauver par l’écriture ! Le plus fragile, le plus menacé, le plus invisible à force d’usage. Les herbes folles, les plus petits insectes, le bruit fin des râteaux, celui d’une pomme qui tombe ».
Évoquer sa poésie, c’est parler de son immersion dans le nature (la pluie et les nuages d’une météo changeante), c’est parler des petites gens qu’il met en scène, des servantes de fermes (« petites madones de l’aube »), c’est beaucoup parler des femmes, de leur vie dure, mais aussi de leur beauté, et, à travers elles, de « la sensualité des choses vécues ». Janine Mesnildrey note à plusieurs reprises l’attrait de Follain pour les femmes mais aussi « son incapacité à tomber amoureux ». L’homme est solitaire. Une solitude qu’il « aime » et « protège ». Elle masque un certain mal-être. Janine Mesnildrey rapporte ainsi des propos tenus par Jean Follain sur France Culture : « C’est pour se délivrer dans une certaine mesure de certaines angoisses que la poésie s’écrit ».
Guillevic, qui fut l’ami du poète normand, l’avait bien cerné. « Pour Follain, écrit-il, tout porte la marque d’absence d’éternité. Une absence qui lui est cause de souffrance, comme l’infini qui l’effraie, l’angoisse ». Janine Mesnildrey souligne, pour sa part, que pour Follain la seule transcendance était « le monde d’en bas ». Ce qui n’empêche pas de parler, à son propos, d’une forme de « mysticisme païen ».
L’autrice raconte dans son livre qu’elle reçut, à un moment de sa vie, les poèmes de Follain « comme des coups de gong ». À la lecture de L’usage du temps, elle vit changer son rapport à la poésie qui souvent la laissait sur sa faim car elle mettait « la barre trop haut » et la désespérait par son « manque d’élan ». Avec Follain elle découvrit une poésie « qui touche au cœur quand elle délivre en même temps que l’inquiétude, son remède ». Son essai, superbement écrit et plein de ferveur, est là pour nous l’attester.
Au pays de Jean Follain, Janine Mesnildrey, Diabase, 160 pages, 17 euros
 |
Marie Sizun, |
| 10, villa Gagliardini |
|---|
On avait aimé La maison de Bretagne qu’elle avait publié en 2021 chez Arléa. On a aussi de quoi aimer ce nouveau livre de Marie Sizun consacré à son enfance et adolescence dans un appartement parisien. Récit touchant pour nous parler d’un lieu fondateur auprès d’une mère aimante qui lui ouvrit des horizons insoupçonnés.
Avant de s’appeler Marie Sizun (une patronyme choisi pour marquer son attachement à la Bretagne), la petite Marie s’appelait Marie Dahlquist. Nous la découvrons au début de son nouveau livre dans ce petit appartement (10, ville Gagliardini) qu’elle qualifie à la fois de « coquille », d’« écorce », de « nid ». À chacun, on le sait, sa découverte des premières odeurs, des premières lumières, des premières couleurs de la vie. Pour Marie Sizun, ce sera donc là, dans cet appartement modeste. « Je le quitterai. Je vivrai ailleurs. Loin. Mais il sera toujours là. Au fond de moi ». À tel point que l’autrice peut le reconstituer, par les mots, dans le moindre détail. « Dans le prolongement de l’évier et de sa paillasse carrelée, il y a une petite table rectangulaire en bois blanc sur laquelle nous prenons nos repas tous les jours, maman et moi… »
Dans ce royaume aux dimensions modestes, il y a une maman pleine d’entrain qui conduira sa fille sur les chemins de la lecture, mais aussi du cinéma. « Elle parle beaucoup maman. Pas seulement des livres, pas seulement des objets qui peuplent l’appartement ». Mais cette période de joyeuse insouciance subira un choc. « Le séisme du retour de captivité de mon père », raconte Marie Sizun, suivi d’un chapelet de déconvenues : incompréhensions, malentendus dans le couple, et finalement le divorce.
C’est de cette époque que date le premier contact de Marie Sizun avec la Bretagne. La voici à six ans avec sa mère, au moment de la séparation, dans une petite maison au bord de la mer dans le Morbihan. Plus tard ce seront des séjours en colonie de vacances. « Ici à Loctudy, la mer était neuve et son parfum salé innocent. Pourtant je me languissais de rentrer à Paris, retrouver ma mère et l’appartement ». La Bretagne, elle la retrouvera pourtant avec plaisir, cette fois comme monitrice de centre de vacances. Une passion naissante pour notre région qui se confirmera plus tard par son installation à l’Île-Tudy.
Mais le cœur du livre demeure bien sûr l’appartement parisien. C’est le lieu où elle a grandi avec son cortège de joies et de déconvenues, notamment celles éprouvées au collège quand les différences sociales éclatent pour elle au grand jour. La jeune Marie, issue d’un milieu plutôt modeste, l’éprouvera dans sa chair. Il faudra aussi, un jour, quitter l’appartement devenu trop petit (ils sont quatre : la maman que la maladie gagne, le petit frère et aussi, bientôt, une demi-sœur) pour s’installer ailleurs dans un plus grand espace. « Je partis en claquant la porte derrière moi. Et j’eus le sentiment que je laissais là, dans l’appartement, un monde, notre monde, le souvenir inoubliable de ce que nous avions été dans ce petit espace, les uns pour les autres, et que plus jamais nous ne retrouverions ». En l’écrivant, Marie Sizun nous ramène à nos propres expériences. À des douleurs intimes, à des pertes. Chacun peut retrouver dans ce livre des traces de sa propre enfance. C’est ce qui lui donne une tonalité universelle.
10, villa Gagliardini, Marie Sizun, Arléa, 235 pages, 20 euros
 |
Rainer Maria Rilke, |
| Lettres à une jeune femme |
|---|
On connaît de Rilke les Lettres à un jeune poète mais beaucoup moins ses Lettres à une jeune femme dont l’intégralité est aujourd’hui publiée, pour la première fois, en français. Le célèbre poète a répondu entre 1919 et 1924 à du courrier que lui adressait une jeune Allemande confrontée à de lourdes difficultés personnelles. Cet échange révèle un Rilke attentif et bienveillant, mais jamais donneur de leçons.
Elle a 26 ans quand elle adresse sa première lettre à Rilke (il a 44 ans). Cette inconnue s’appelle Lisa Heise. La jeune femme avait découvert en 1902 Le livre des images du poète et en avait été marquée. Quand elle engage cette correspondance, elle vit dans la précarité. Ses « petits boulots » – comme on le dirait aujourd’hui – d’horticultrice et de pianiste ne lui permettent pas de vivre décemment. Elle vient aussi de divorcer.
Sa première lettre met d’ailleurs en exergue les difficultés de relation entre l’homme et la femme. « Tout ce discours sur la libération du monde, écrit-elle, n’est-il pas vain tant que la justice reste incomplète dans les relations entre l’homme et la femme ? L’homme ne devrait-il pas aussi au fondement de sa vie intérieure respecter une image de l’amour qui ne soit pas entachée de tant d’erreur ? Pourquoi est-il si mal préparé à l’amour ? ». Rilke lui répond, dans une lettre du 30 août 1919 et abonde dans son sens, soulignant que « l’homme ne répond à l’amour et à la vérité de son amante que par une ébauche d’amour inaccomplie ». Il dit même de l’homme qu’il est « cet aveugle, ce forcené qui veut faire le tour du monde et ne réussit pas même à parcourir le chemin qui mène autour d’un cœur ».
Comme le rappelle Gérard Pfister, éditeur et traducteur de ces lettres, Rilke « n’a jamais cessé de s’interroger sur l’amour et sur ces grandes amoureuses – de Sappho à Gaspara Stampa – qui l’ont porté ». Et il ajoute : « Pour le poète des Élégies, il y a une intime parenté entre l’amour le plus profond et la plus haute poésie ». C’est sûrement ce qu’avait perçu la jeune Lisa Heise en prenant le parti de s’adresser à Rilke.
Une première publication de cette correspondance (limité à 9 lettres) eut lieu en 1930, soit quatre ans après la mort du poète. Mais il fallut attendre 1934 pour connaître l’identité de la jeune femme avec la publication de ses propres lettres. L’occasion pour elle d’évoquer « une relation humaine des plus fécondes et des plus exaltantes ». Il faut dire que la correspondance ne s’est pas cantonnée au strict domaine de l’amour humain ou des relations homme-femme. Elle aborde aussi la question des périls qui montent à nouveau dans le monde alors qu’on sort tout juste de la Grande guerre. Rilke évoque notamment le cas de cette Allemagne qui « ne s’est pas fondamentalement renouvelée et repensée » (lettre du 2 février 2023).
Mais l’essentiel tourne quand même autour de l’attention que porte Rilke aux tribulations de la jeune femme. Il peut s’apitoyer quand le sort lui est contraire ou, au contraire, se réjouir quand elle trouve un vrai travail dans l’horticulture près de Weimar. « Ah, croyez-moi, c’est beaucoup, c’est presque tout ce qui peut être accordé à un être : cette soumission, cette sujétion à un travail tangible… » (lettre du 27 décembre 1921). Et il en vient à regretter lui-même qu’il lui « manque le savoir-faire et l’économie des gestes » et cette capacité de « passer du travail de l’esprit à un tel travail manuel » (lettre du 19 mai 1922)
Il n’y a que 9 lettres de Rilke dans cette correspondance mais elles ne manquent pas d’étonner par leur profondeur d’analyse et l’empathie qu’elles révèlent (surtout quand l’on sait que le poète ne rencontra jamais son interlocutrice). Il lui dédicacera même un poème d’amour. « Être la fleur qui se sent bousculée / par l’incessant assaut du ruisseau sans malice /qui n’a souci d’elle quand sa hâte distraite / et trop précipitée la retourne // Ah, c’est ainsi que nous sommes livrés / au bruissement impétueux des émotions ; / se soucient-elles de nous ? … Être au monde / compense cependant ce trop-plein de hasards ».
Lettres à une jeune femme et autres écrits sur l’amour, Rainer Marie rilke, Arfuyen, 165 pages, 17 euros
 |
Gilles Baudry, |
| Le chant du balancier |
|---|
Placé sous le signe du temps qui passe, Le chant du balancier de Gilles Baudry marque une étape dans l’œuvre poétique du moine-poète de l’abbaye de Landévennec. Jamais il n’a autant évoqué dans ses recueils ces oscillations entre hier et demain au cœur de son éloge constant du « temps intérieur ».
Devenu septuagénaire, l’écrivain et poète Claude Roy avait écrit : « Je rentre dans l’hiver de ma vie ». Il y a sans doute aussi, les soixante-dix ans passés, ce sentiment profond chez Gilles Baudry. On le ressent quand il affirme lui-même : « Le temps est une ombre. Tout passe ». Regardant dans le rétroviseur, il peut encore écrire : « Nos années / en allées / les jours noués aux jours / dans l’urgence des tâches ». Ailleurs, il évoque « l’âge venant » (titre de l’un de ses poèmes) où l’on se sent plus « démunis ». Dans une totale lucidité sur ce basculement dans un autre chapitre de la vie, il peut aussi confier : « Ce jour d’aujourd’hui / est le premier des jours / qui te reste à vivre ».
Gilles Baudry parle sans doute de lui, mais plus généralement de tous ceux qu’affecte le même sentiment de la fugacité du temps. Un sentiment exacerbé par la disparition d’être chers ou d’écrivains et poètes dont il se sentait proche. Le cas de Christian Bobin, de Philippe Jaccottet (« Vous faites vos premiers pas / dans les propriétés de la lumière », écrit-il à son propos) ou de Philippe Mac Leod dont il dit qu’il avait su « prendre congé de nous sans vraiment nous quitter ».
Mais il ne faudrait surtout pas croire que cette conscience aiguë du temps du temps qui passe puisse se figer dans une forme de nostalgie. Certainement pas – on s’en doute bien – sous la plume du moine-poète pour qui le chant du balancier, tel « un battement de cœur », est aussi là pour nous dire de « sanctifier le temps ». Oui, laisser « affleurer l’éternel » dans l’instant vécu avec intensité. « Combien nous gagnerions / parfois / à perdre notre temps // à contempler / les petits riens / des jours les plus quotidiens ». C’est le Gilles Baudry que l’on connaît, insatiable dans son désir d’offrir « l’hospitalité » à cet « invisible » qui affleure ici dans toutes les pages.
Il faut pour cela une constance de l’accueil, un état de veille assidu (« Demeure le veilleur » !) dans une fidélité sans faille à des horizons familiers (Landévennec, l’Aulne, les « vents d’Arrée »…). Il faut aussi savoir affronter des temps mauvais, savoir faire pause, tenir à distance les frénésies de l’époque car « comme les pluies / des météorologistes / notre temps est entré / en précipitation ». Il y a des remparts. Le silence sûrement. La musique aussi, celle qui nous « étreint », celle de violonistes ou violoncellistes dont il vante ici les interprétations qui nous font approcher ce « paradis / que chacun porte en soi ». Plus important encore, car « l’heure est venue de congédier l’inessentiel », il s’agit de faire son miel de la prière et de la poésie. Car, nous dit le moine bénédictin, ils se « pollinisent ».
Le chant du balancier, Gilles Baudry, Ad Solem, 2024, 110 pages, 17 euros.
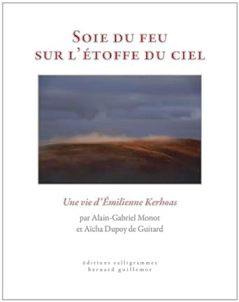 |
Alain-Gabriel Monot, |
| Soie du feu sur l’étoffe du ciel, une vie d’Émilienne Kerhoas |
|---|
Elle a publié moins de vingt recueils de poésie à tirage limité et préservé toute sa vie une farouche indépendance et liberté d’esprit : la Finistérienne Émilienne Kerhoas (1925 – 2018) n’a jamais connu la notoriété de son vivant. Un très beau livre, signé de l’universitaire et écrivain Alain-Gabriel Monot et de la photographe Aïcha Dupoy de Guitard, nous fait aujourd’hui prendre la mesure de son immense talent.
Née Émilienne Salaun en 1925 à Landerneau, Emilienne Kerhoas fut institutrice toute sa vie. Après sa formation à l’École normale de Saint-Brieuc où elle fit la connaissance de Louis Guilloux (l’épouse de celui-ci était sa professeure de Lettres), la jeune Émilienne occupa un premier poste à Locmélar puis fut nommée à Saint-Cadou au cœur des Monts d’Arrée. C’est là qu’elle écrivit en 1957 son premier recueil intitulé tout simplement Saint-Cadou. Elle y parlait d’un « Pays sauvage / fruit âpre / au goût de solitude et de vent ». Après son mariage avec Jacques Kerhoas, instituteur comme elle et fondateur des classes de mer, elle enseigna à Daoulas puis à Brest où elle fut directrice d’école au quartier de Kerinou avant de se retirer au Faou au moment de la retraite.
Émilienne Kerhoas aimait profondément ce Finistère où elle a vécu, en particulier la côte sauvage du Léon, du côté de Kerlouan, Brignogan et Plounéour-Trez, mais aussi les Monts d’Arrée auxquels elle resta fidèle. C’étaient ses « lieux sacrés », disait-elle. La photographe Aïcha Dupoy de Guitard, revenue sur ces lieux qui l’ont profondément imprégnée, nous en fait mesurer l’intense beauté. Quant à Alain-Gabriel Monot, il souligne que si Émilienne Kerhoas a « le sens du paysage », elle ne verse jamais dans le folklore ou dans un vague régionalisme. « Plage et ciel, ô double anneau / Ma double fontaine / Où chante, fragile oiseau / Mon enfance reine », écrit la poète en évoquant cette Côte des légendes qu’elle arpenta très jeune. À propos des poèmes de son premier recueil, Saint Cadou, Alain-Gabriel Monot note aussi que « s’ils se défient de l’abstraction pure, ils n’en demeurent pas moins d’abord presque toujours chose mentale ».
En présentant ce livre, l’éditeur Yvan Guillemot souligne pour sa part que « la vocation » d’Émilienne Kerhoas était de « se laisser traverser par la vie et (de) nommer les fils intérieurs qui peuvent la transformer ». Et si on pouvait la comparer à une autre grande poète, il cite le nom d’Andrée Chedid.
Voilà donc au bout du compte, entre nos mains, un très beau livre d’admiration et de reconnaissance à une femme engagée avec ferveur dans l’écriture. Alain-Gabriel Monot, qui fut un grand ami d’Émilienne Kerhoas et entretint avec elle une longue correspondance, se souvient de « la longue table de chêne clair de la maison toujours ouverte aux amis ». Il mêle habilement dans ce livre l’analyse d’une œuvre et la publication de quelques poèmes de la poète finistérienne, parlant notamment des « pages solaires » de son dernier recueil La pierre du jardin. Reste maintenant à tenir une promesse faite à la poète disparue : réunir dans un ouvrages ses œuvres complètes.
Soie du feu sur l’étoffe du ciel, une vie d’Émilienne Kerhoas, par Alain-Gabriel Monot et Aïcha Dupoy de Guitard, édition Calligrammes/Bernard Guillemot,120 pages, 25 euros.
 |
Dylan Thomas, |
| Lettres 1926 – 1953 et autres textes |
|---|
Figure importante de la littérature européenne du XXe siècle, le gallois Dylan Thomas a entretenu une importante correspondance à laquelle on a désormais accès dans une traduction française assurée par le breton Ronan Nédélec. Le livre est, en outre, publié par une maison d’édition (La Part Commune) implantée en Bretagne. Autant de clins d’œil, peut-on dire, à nos cousins gallois.
« Au cœur de ses lettres, l’on trouve l’ivrogne, le discoureur, le voleur, le fauché, l’intéressé, l’arnaqueur, mais aussi un gars bien, serions tentés de dire », souligne Ronan Nédélec qui a aussi préfacé et annoté cette correspondance. Il faut dire que le « Rimbaud gallois », comme on l’a parfois désigné, ne jouait pas dans la dentelle. Sa carrière sera à la fois fulgurante et chaotique. Né à Swansea en 1914, il meurt à 39 ans dans un hôpital de New-York. Homme de tous les excès, notamment porté sur l’alcool, il se sera fait un nom dès l’âge de 20 ans en publiant ses premiers poèmes. Il bourlinguera entre le Pays de Galles et Londres, fera quelques incursions en Amérique où il sera invité. « Primo je suis Gallois, écrivait-il, secundo je suis ivrogne, tertio je suis amoureux de la race humaine et en particulier des femmes ».
Voici entre nos mains le livre qui réunit aujourd’hui l’essentiel de The collected letters, sa correspondance publiée en 1985 en langue anglaise. 27 années d’écriture entre 1926 et 1953, avec de multiples interlocuteurs d’où émergent les figures de Pamela Handsford Johnson (poétesse, dramaturge anglaise), Vernon Watkins (poète gallois), Caitlin Thomas (apprentie danseuse rencontrée dans un pub londonien et qui sera le grand amour de sa vie). « Au quotidien, c’est l’ordinaire qui l’attire », souligne Ronan Nédélec. « Incidents domestiques et petits désastres constituent les faits d’une journée qui l’accompagnent dans son travail et dont il narre volontiers les détails dans ses missives ». On ressent souvent chez l’homme, en lisant certaines de ces lettres, un profond sentiment de solitude qu’il combat par des beuveries au pub ou par l’échange de lettres.
Sa correspondance nous éclaire aussi sur sa démarche poétique. Dans une lettre du 16 mai 1938 à Henry Treece (poète et critique), il écrit : « Une grande partie de ma poésie est, je le sais, une enquête et une terreur effrayante de l’attente, une découverte et un face-à-face avec la peur. En moi résident une bête, un ange et un fou, et mes recherches portent sur leur fonctionnement ». Ronan Nédélec rappelle que si Thomas admettait le rôle de l’inconscient dans son écriture, il réfutait toute influence du surréalisme, « cherchant à situer son œuvre comme entièrement novatrice et indépendante de tout mouvement ».
Nous voici aussi plongés, grâce à ces lettres, dans le monde intellectuel, littéraire ou artistique de l’époque. Dylan Thomas côtoie des auteurs et reçoit de courriers de beaucoup d’entre eux. Il nous parle d’interlocuteurs fameux : Malcom Lowry, Heny Miller et même Charlie Chaplin et Igor Stravinsky. Le petit Gallois aux cheveux frisés s’était fait un nom rapidement. En Bretagne, son œuvre fut notamment appréciée par Georges Perros ou encore Armand Robin qui traduisit trois de ses poèmes pour la NRF en 1954.
Pour ce qui est du Dylan Thomas gallois, sa correspondance nous révèle, certes, un homme attaché à son pays natal. Mais il sait prendre ses distances. Il est Gallois mas pas gallophone. Dans une lettre du 28 novembre 1949 à Margaret Taylor, une de ses mécènes, il écrit à un moment où il vit dans des conditions précaires : « Peut-être que quelque chose arrivera de l’université du Pays de Galles, bien que je ne sois pas populaire auprès des autorités, étant non gallophone, non nationaliste, non diplômé, non vacataire et indigne de confiance ». Ronan Nédélec souligne néanmoins que Thomas comprenait le gallois et qu’il existait sans sa poésie, « les traces d’un système de rimes héritées de la langue galloise ». Ce qui lui permettait sans doute de se mêler à ses congénères dans certains moments-clés de l’année : « C’est un jour férié gallois, écrit-il un lundi de Pâques 1937, un jour très social, et bientôt je rejoindrai les pique-niques froids sur les falaises, boirai de la bière dans le dépôt de bus ». En novembre 1939, il écrivait aussi : « Les Gallois aiment presque autant les ventes que les funérailles ».
Ainsi allait Dylan Thomas, perclus de failles et de doutes. Poète sûrement mais aussi rendu célèbre par son recueil de nouvelles Portrait de l’artiste en jeune chien, par son conte touchant sur le Noël d’un enfant au Pays de Galles ou encore par sa pièce radiophonique Au bois lacté.
Lettres 1926-1953 et autres textes, Dylan Thomas, préface, traduction et notes de Ronan Nédélec, La Part Commune, collection Silhouettes Littéraires, 420 pages, 25,90 euros. Ce livre comporte une annexe dans laquelle on peut trouver de nouvelles traductions de certaines œuvres de Dylan.
À noter que le premier tome de l’œuvre poétique complète de Dylan Thomas vient d’être publié par les éditions Arfuyen (336 pages, 24 euros)
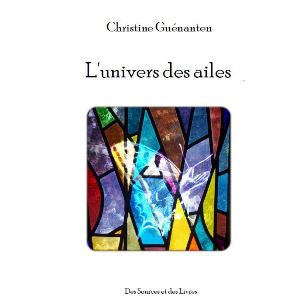 |
Christine Guénanten, |
| L’univers des ailes |
|---|
Christine Guénanten aime les anges, qui le lui rendent bien. Ces anges créent un monde qu’elle appelle L’univers des ailes. Mais qu’on ne s’y méprenne pas : la poète bretonne ne crée pas un monde surnaturel. Ses textes s’enracinent bien dans le réel et invitent d’abord à la contemplation.
Pour ce qui est des anges, on connaissait déjà la Petite déclaration d’amour aux anges d’une autre Bretonne, Gaële de la Brosse (Suzac éditions, 2020). Elle y voyait des compagnons de route, des guides, mais aussi des messagers venus de l’au-delà. « Le chant des anges n’est-ce pas cette musique intérieure ? », interrogeait-elle. Avec Christine Guénanten on est bien dans cette même musique là. Les anges nous environnement mais on ne le conçoit pas vraiment. Et pourtant, ne nous arrive-t-il pas d’affirmer, au détour d’une phrase, qu’« un ange passe » ?
Cet ange dans L’univers des ailes peut prendre le visage d’un SDF, « ange adolescent » aux cheveux « blonds comme blés », ou de celui qui « crie en slamant / son solo d’amour ». Christine Guénanten vit dans le monde tel qu’il est. Avec ses beautés et ses laideurs. Elle connaît bien « les étranges humains », souvent « tristes humains ». Elle les voit vivant « dans la cage de l’écran » et le « ventre rempli d’infinis connaissances ». Elle connaît les « sanglots sanglants du monde ». Et, dit-elle, « s’il n’y avait pas humains / il n’y aurait plus de fusils ».
Fuir le monde ? Non, d’abord savoir épouser les saisons : le printemps et ses « nouveaux papillons », l’été et ses « champs de blé », l’automne et ses « flammes de feuilles ». Quant à l’hiver, écrit-elle, il « se couche en moi et me voilà étoile / prête à bercer l’enfant des neiges éternelles ». Mais L’univers des ailes est d’abord fait de respiration tranquille au jardin et d’attention soutenue à ce qui advient (fut-il le plus infime). Cet univers est peuplé d’oiseaux et de fleurs. « S’il fallait vivre sans les fleurs / Où s’enracinerait la Paix ? // Sans la présence des oiseaux / Où s’entrelacerait l’amour / L’amour du ciel avec la terre, / Le chant du merle au mimosa ? ». C’est ainsi, estime Christine Guénanten, qu’on peut « se guérir de la violence » et rêver d’un « jour meilleur / Plein de muguet / Un autre en trèfle / Pour quatre mains ». Sous sa plume, le rose devient une fée et le jardin veille « l’ange gardien des fleurs » qui « cherche un pétale où reposer ses doutes ».
Christine Guénanten est, à coup sûr, une voix originale dans la poésie bretonne. Elle n’a jamais cessé de nous parler d’un autre monde. Mais cet autre monde n’est pas extérieur au nôtre. Il en fait partie. Sa parole poétique, qui le débusque, est toujours proche de la prière et de l’incantation. Mais jamais sans forcer le trait.
L’univers des ailes, Christine Guénanten, Des Sources et des Livres, 35 pages, 15 euros
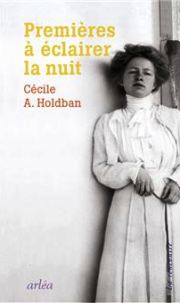 |
Cécile A. Holdban, |
| Premières à éclairer la nuit |
|---|
Faire parler quinze femmes poètes du XXe siècle dans des lettres (imaginaires) adressées à des êtres chers : un projet original et surtout ambitieux que l’autrice, poète et peintre, Cécile A. Holdban a réalisé dans un livre qui nous fait traverser les plus grands drames du siècle passé.
« Elles furent les témoins des grands drames qui sont les marqueurs du XXe siècle », souligne d’emblée Cécile A. Holdan. Le nazisme pour les Allemandes Nelly Sachs et Gertrud Kolmar. Le stalinisme pour la Russe Anna Akhmatova. L’apartheid pour la Sud-Africaine Ingrid Jonker. Le fondamentalisme islamisme (toujours d’actualité) pour l’Iranienne Forough Farroghzad… « Ce qui leur est commun, ajoute Cécile A. Holdban, c’est le besoin de transcender la vie par les mots, de ne pas accepter l’insupportable, de braver les habitudes, de porter le poids du destin ».
Mais pourquoi cet intérêt de l’autrice de ce livre pour ces femmes au destin souvent tragique (près de la moitié d’entre elles se suicideront) ? C’est « parce que ces poétesses ont été traversées par cet histoire dont j’ai hérité une part de mes grands-parents, que leur œuvre résonne en moi », explique Cécile A. Holdban (évoquant notamment une grand-mère maternelle née dans l’Autriche-Hongrie du siècle dernier). Pour autant, en choisissant ces femmes écrivains, il ne s’agissait pas, pour elle, de faire un livre à connotation féministe. Ce serait réducteur de parler d’une poésie féminine », convient-elle, même si le titre du livre, Premières à éclairer la nuit, entend bien souligner le rôle éminent joué par les femmes en ces périodes troublées.
Il ne s’agit pas non plus, ici, d’une biographie de ces femmes poètes, mais de récits de 8 à 10 pages, où « chacune de ces voix s’adresse, à la première personne du singulier, à un être cher ». L’Autrichienne Ingeborg Bachman s’adresse à Paul Celan, l’Américaine Sylvia Plath à son mari le poète anglais Ted Hughes, Nelly Sachs à Selma Lägerlof, la Russe Marina Tsvetaieva à sa sœur cadette, la Finlandaise Edith Södergran également à sa sœur.
L’originalité du texte de Cécile A. Holdban est d’avoir incorporé dans son récit des passages en italique qui sont extraits des poèmes, journaux ou correspondances de ces quinze femmes. Ainsi quand l’Allemande Gertrud Kolmar s’adresse à sa sœur Hilde Wenzel, on peut lire : « Les persécutions dont nous étions victimes semblaient ne pas devoir connaître de fin (…) Je me disais : je vais mourir comme meurent la plupart, le râteau passera au travers de cette vie et mettra mon nom en copeaux dans la glèbe ». Quand l’Italienne Antonia Pozzi évoque son amour de la montagne à son ami Tullio Gadenz, poète et alpiniste, on peut lire : « Je me suis toujours représenté le paradis de Dante comme un refuge de montagne. Ici il est impossible de mourir. J’y ai connu les premiers émois de ma chair, dans une communion presque érotique avec la nature ». Et Cécile A. Holdban ajoute, en italique, ces mots recueillis dans l’œuvre de Pozzi. « Aujourd’hui, je me cambre nue dans la pureté du bain blanc, et je me cambrerai nue demain sur un lit, si quelqu’un me prend »
…/…
Tout est l’avenant dans ce livre en faisant cohabiter habilement des lettres imaginaires (mais fondées sur l’histoire) avec des textes authentiques de ces femmes poètes. Cécile A. Holdban nous révèle, par le fait même, sa profonde connaissance de la littérature féminine du XXe siècle. Elle éclaire pour nous le chemin qui a conduit ces femmes à l’écriture de poèmes pour pointer du doigt des drames absolus, mais aussi pour témoigner de leur amour et de la beauté du monde.
Premières à éclairer la nuit, Cécile A.Holdban, Arléa, 240 pages, 21 euros
 |
Jacques Josse, |
| Postier posté |
|---|
L’auteur et poète rennais Jacques Josse (né en 1953) nous raconte sa vie au tri postal de Trappes avant sa mutation en Bretagne. Un récit empreint de chaleur humaine où l’on découvre combien la poésie fut pour lui, à l’époque, une forme de bouée de sauvetage. Eugène Guillevic ne le disait-il pas : « La poésie aide à tenir dans la vie ».
Dans ses précédents livres, Jacques Josse a souvent évoqué son pays natal, du côté de Liscorno en Lannebert, dans le Goëlo costarmoricain. Il y a trouvé matière à des récits ou à quelques proses autobiographiques bien senties autour de quelques figures marquantes de ce terroir breton à la fois agreste et marin, le plus souvent des gens un peu (ou beaucoup) cabossés par la vie et trouvant dans l’atmosphère d’un caboulot, autour d’une bonne bière blonde, des raisons de croire encore en l’humanité.
L’humanité dont il est ici question est celle d’employés d’un centre de tri postal en région parisienne. Jacques Josse ne nous épargne rien sur les rudes conditions de travail (« la vacation débute à vingt heures et se termine à six heures du matin »). Il faut trier 500 lettres au quart d’heure sous la pression de chefs sourcilleux. « Parfois ça coince, ça dérape. Souvent à cause d’un chef trop zélé », note Jacques Josse. Comment trouver un moment de répit dans ce maelström ? En lisant des poèmes, « assis contre les sacs », au moment de la pause, par exemple ceux de Franck Venaille, d’Yves Martin ou de Jacques Réda. Mais aussi en se rattachant par la pensée à l’ami poète Alain Jégou qui, à 4 heures du matin, largue les amarres à bord de son chalutier de Doëlan.
Jacques Josse ne nous fait pas ici de récit misérabiliste. Au cœur de ce travail de nuit, il y a d’abord et avant tout ces visages et ces voix des collègues de travail. Ainsi Jeannot « qui zieute » par-dessus l’épaule de Josse quand il se met à lire des poèmes. Ainsi « Henri qui revient tout juste de cure ». Ainsi Denis « usé par des crises d’épilepsie ». La solidarité est à l’œuvre quand un drame familial frappe tel ou tel mais aussi, bien sûr, dans les combats menés autour des « braseros » et des « piquets de grève salvateurs ».
Avant de s’endormir, après être passé dans un bar avant l’aube, « calé dans l’étrangeté des matins blêmes », le postier posté dévore quelques lignes de John Fante ou de Charles Bukowski (« des types qui ont vécu pas mal de galères »). Il se réveille avec une forte « sensation de gueule de bois » puis griffonne quelques pages – ce qu’il appelle ses « écritures pauvres » – avant de rejoindre à nouveau le centre de tri. Quand arrivent les journées de repos, notre jeune postier fait une petite escapade, forcément littéraire, dans la Capitale. Le voici pour « un arrêt obligé » au pied de l’ancien Beat Hôtel « où Allen Ginsberg, Gregory Corso, William Burroughs et tant d’autres auteurs de la Beat Generation logèrent à la fin des années cinquante ».
Ainsi allait le jeune Jacques Josse, forgeant son identité d’auteur « sous lumière artificielle », parcourant le monde en triant des lettres venues de la planète entière. La merveille de son court récit, c’est aussi qu’on l’aborde en découpant soi-même les pages avec un coupe-papier (comme on le ferait d’une lettre). C’est aussi la couleur particulière que lui apportent les pastels à l’huile de Georges Le Bayon (dont certains en format de timbres-poste). C’est enfin cette lettre émouvante, sous enveloppe et accolée au livre, dans laquelle un ancien du tri postal, âgé de 88 ans, s’adresse à Jacques Josse en réponse à sa lettre « aux odeurs de poésie ». Merveilleux !
Postier posté,Jacques Josse, éditions Folle Avoine, 35 pages, 15 euros
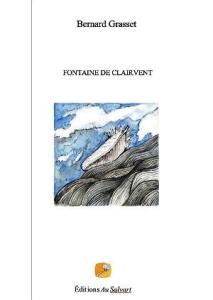 |
Bernard Grasset, |
| Fontaine de Clairvent |
|---|
Bernard Grasset a plus d’une corde à son arc. Poète, philosophe, traducteur, il nous propose aujourd’hui 74 « quatrains de saisons » rédigés entre 2021 et 2023 en différents endroits de l’hexagone mais aussi en Irlande, avec un petit penchant pour des terroirs qui lui sont chers : le pays nantais et la Bretagne sud.
Fin connaisseur du grec et de l’hébreu, Bernard Grasset peut nous amener, dans ses livres, à découvrir aussi bien l’œuvre de Yorgos Thémélis que celle de l’israélienne Rachel. Mais cette fois, en abordant le quatrain, il nous conduit vers d’autres horizons littéraires, sans doute plus en prise avec l’Orient ou l’Extrême-Orient. Comment en effet, quand on parle de quatrains, ne pas penser à ceux du Perse Omar Khayyam ou à ceux, tout récents, de François Cheng (Enfin le royaume, Poésie/Gallimard, 2023).
Les quatrains de Bernard Grasset nous ramènent aussi aux principes de base du haïku, tels que les définissait le japonais Bashô, père fondateur de ce genre littéraire : « Dire ce qui arrive, à un moment donné, à un endroit donné ». C’est bien le cas ici puisque tous les quatrains de l’auteur sont datés avec précision (le jour de la semaine, la date) et toujours localisés. Ainsi ce vendredi 24 décembre à Saint-Gildas-de-Rhuys : « Les vagues de siècle en siècle / Heurtent sans fin la falaise, / Une croix, sacre des saisons, / Tu dis, tais l’énigme du vent ». Ainsi, aussi, ce mardi 10 janvier 2023 à Nantes : « Loire, ô grise et calme, / Source lointaine, vagues prochaines, / Mélodie d’un autre âge / Où les yeux aimaient la lumière ».
Comme pour le haïku, il s’agit « d’une écriture de la brièveté, écriture qui se rapproche du silence », ainsi que l’affirme lui-même Bernard Grasset, avec le sentiment qu’il a de poser son écritoire dans la nature comme le ferait un peintre avec son chevalet. « Les mots s’allient à la vie », note l’auteur en quête de « splendeurs oubliées » ou de « mélodies murmurant au secret de nos existences ». On ne doit donc pas s’étonner qu’il ait pu être aimanté par des lieux aussi emblématiques que Vézelay, Lérins, La Grande Chartreuse, le Mont Beuvray ou Locmariaquer, sans oublier une escale en Irlande, comme ce samedi 7 mai 2022 du côté de Killarney : « Épée brisée, arbre de paix, / Soleil sur les tombes, arpèges, / Et tu longes le lac, murmure / Scintillant, signet d’aventure ».
Dans un style presque télégraphique, Bernard Grasset (né en 1958), se fait le greffier des jours et de lieux arpentés avec ferveur, à un moment où, avoue-t-il, son « chemin en poésie aperçoit son terme ».
Fontaine de Clairvent, Bernard Grasset, peintures d’Isaure, éditions Au Salvart, 49 pages, 12 euros
 |
Anne-José Lemonnier, |
| Le cap en octaves |
|---|
Concilier la contemplation de la nature et la composition d’une œuvre musicale : Anne-José Lemonnier évoque dans un roman / poème l’expérience d’un musicien installé au Cap de la chèvre à l’extrémité de la presqu’île de Crozon. Récit polyphonique où l’on reconnaît la patte de la poète finistérienne.
« Ici commence la musique du monde », écrivait Xavier Grall dans l’un de ses poèmes à propos de la pointe bretonne. Comment ne pas y penser en lisant ce nouveau livre de Anne-José Lemonnier où l’on voit un compositeur se mettre au diapason de la musique émanant de ce monde qui l’environne. Et quel monde ! « Le cap dépasse en création les plus grands musiciens », souligne Anne-José Lemonnier qui ne lésine pas sur les mots (jouant parfois les grandes orgues) pour dire la magnificence d’un « cap dans la sagesse de son grès et la folie de son écume ».
Le compositeur de musique s’appelle Mathurin Ebrel. Sa chienne est la bien-nommée Toccata. « C’est là qu’il habite, sauvage et modelé de la pâte même du cap ». L’homme « hiberne avec les Variations Goldberg et les suites pour violoncelle » et « ses deux femmes pourraient s’appeler la mer et la musique ». Pour Mathurin Ebrel « l’atelier des falaises (est) son atelier de création » et, dans cette crique où vient déferler la grande bleue, « les rouleaux blanchis lui servent de métronome ».
On suit le musicien dans ces déambulations sur ce cap où il puise, insatiablement, son inspiration. « Voici Rouantelez… le prénom d’un hameau sur le cap. Rouantelez… Rouantelez… quatre notes par lesquelles tout pourrait commencer ». Et le voilà essayant de « prononcer le nom de Rouantelez avec son violoncelle », avant de confier à chaque hameau rencontré son instrument. « Rouantelez garde le violoncelle et Rimadell le violon, il confie à Gwenavel le piano et à Rusinec la flûte » (car l’œuvre dont il rêve est un quatuor). Une œuvre musicale s’élabore ainsi à la fois dans la sonorité particulière des noms de lieux et dans le chant de la mer au fil des saisons. Sans oublier, comme l’applique à le faire Mathurin Ebrel, cette attention particulière aux variations du ciel. « Dans l’aigu du bleu, le soir émerge d’une journée nuageuse, hésitante entre le majeur et le mineur, la note pure et son altération ».
Mathurin Ebrel parviendra-t-il, comme il le souhaite, à composer « une musique plus austère, plus dépouillée que les suites de Bach ? » Anne-José Lemonnier arrive à nous convaincre que ce sera le cas dans ce récit très particulier, véritable hymne à cette presqu’île où elle réside elle-même et où elle n’en finit pas d’y décliner toutes les nuances du bleu.
Le cap en octaves, Anne-José Lemonnier, Diabase, 2023, 13 pages, 16 euros
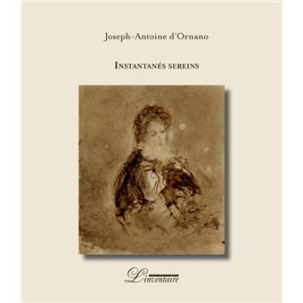 |
Joseph-Antoine d’Ornano, |
| Instantanés sereins |
|---|
Un univers à part, un peu hors du temps. Des tranches de vie saisies par un poète qui est aussi artiste-peintre. Les Instantanés sereins de Joseph-Antoine D’Ornano (né en 1948) ont une forme de douceur doublée de la conscience aiguë du temps qui passe. Voilà, en tout cas, une voix originale dans le paysage poétique actuel.
On peut faire des poèmes avec peu de choses. Les auteurs chinois ou japonais nous ont beaucoup appris là-dessus. Joseph-Antoine D’Ornano n’écrit pas des haïkus mais capte à sa manière des instants de vie, souvent dans leur banalité la plus extrême. Dans ses poèmes il y a des « lilas aux fenêtres », des « limonades roses », une rue discrète, un banc de pierre, un lit défait, un parapluie qui se retourne, « des petites fleurs qui jouent les coquettes », un « pré charmant », des fontaines… Voilà qui nous éloigne du tohu-bohu ambiant. Avec le sentiment, néanmoins, de se retrouver au cœur d’un monde un peu révolu.
Les aquarelles, encres et autres pastels de l’auteur, qui accompagnent les poèmes, sont au diapason. Le gris, le brun ou l’ocre, tonalités dominantes des tableaux, sont là pour nous signifier que le temps a passé (si c’était de la photographie, on parlerait de sépia) et que les couleurs éclatantes de la vie ont un peu fané. On découvre ici des paysages ou des visages sur lesquels le temps a fait son œuvre.
Car c’est une forme de retour sur des souvenirs enfouis qui imprègne ce recueil. Les personnages évoqués sont parfois des figures évanescentes et quand elles ne le sont pas, ce sont des hommes ou des femmes vivant avec le « dos cassé ». De celui-ci, le poète dit qu’il « ne sort presque plus », de celle-là que « parfois, elle quitte son fauteuil ». Les maisons sont habitées de souvenirs ou de regrets. Mais ce n’est jamais dit avec lourdeur. Non, plutôt avec une forme de douceur, dans une série de poèmes d’une étonnante clarté (sans recours aux images ou au procédés poétiques classiques). Il y a dans tout cela, au bout du compte, une forme discrète de nostalgie dans l’évocation, par exemple, de « l’amour d’une seule saison » ou de « la tristesse de ces instants disparus ».
Joseph-Antoine D’Ornano ne se paie jamais de mots. Ses Inventaires sereins font la part belle aux gens âgés et aux enfants. L’atmosphère y est légère en dépit de ce temps qui file entre les doigts. On peut découvrir, au détour d’une page, des « gens heureux » et parfois « Sous la voûte étoilée du ciel / Le village en fêt / Au son de l’accordéon ».
Instantanés sereins, Joseph-Antoine D’Ornano, L’inventaire, 2023, 60 pages, 12 euros.
 |
Estelle Fenzy |
| Une saison fragile |
|---|
La saison fragile d’Estelle Fenzy évoque, dans de très courts poèmes, ces moments de la vie où l’on tremble un peu sur ses bases : parce qu’un père meurt ou parce qu’un enfant prend son envol. La poète le dit en mots pesés, retenus, fidèle à cette écriture limpide qu’on avait déjà relevée en 2015 et 2019 dans Chut (le monstre dort) et La minute bleue de l’aube, deux livres également publiés à La Part Commune.
« L’absence / un silence très fort / avec la nuit autour », écrit Estelle Fenzy. Oui, faire le deuil. Faire aussi advenir le poème. « Écrire vient / de la perte / et du manque ». Estelle Fenzy pleure un père dont la figure imprègne encore les lieux où il a vécu. « Maman a gardé / ta chemise blanche / c’est un peu ton ombre / pliée dans l’armoire ». On croit parfois entendre Christian Bobin quand elle imprègne de merveilleux l’instant le plus banal. « Pluie sur le jardin / une princesse dans le ciel / crache des perles et des pétales / à chacun de ses mots ».
Dans ce monde transfiguré par le regard du poète, il y a la conscience aiguë d’un dialogue ouvert avec les disparus. « Parfois / mes vivants et mes morts / font une étrange famille // une conversation du dimanche / autour d’une table d’absence ». Plus frappant encore, ce sentiment d’une présence éternelle derrière le rideau des instants les plus familiers. « Peut-être / les âmes des morts / attendent au fond des tasses // d’être bues d’être reconnues ».
S’il y a la mort et la conscience d’une perte irrémédiable, il y a aussi ce qu’on appelle les petites morts. Estelle Fenzy s’en fait l’écho en parlant de ce qui l’étreint quand un enfant quitte le nid familial et part vivre sa vie. « On tisse des cordons / que l’on coupe au matin / sur le tarmac brûlant /d ’une samedi de juin ». Le signe de la main, au moment du départ, ravive des visions d’enfance. « Ta main menue / si longtemps dans la mienne / me fait signe de loin ».
Alors il faut bien alléger les jours. « Faire comme si », raconte Estelle Fenzy dans une série de petits textes inaugurés, chaque fois, par cette expression. « Faire comme si », c’est parfois reconnaître quelques petits mensonges que l’on se fait à soi-même ou s’avouer tous ces vœux pieux que l’on se formule sans illusion. « Fais / comme si / le ciel de traîne // emmenait dans / sa robe de reine // les frimas les pluies / les chagrins aussi ». À propos de ciel de traîne, Estelle Fenzy a trouvé dans la ville de Brest, où elle a vécu huit ans, une ambiance à la mesure des sentiments contradictoires qui peuvent la traverser. Dans cette ville (où, selon la formule consacrée, il fait beau plusieurs fois par jour), « les gris / s’ajoutent aux gris // un seul rayon / et c’est sur la mer / un éclat sans fond ». Les Brestois ne manqueront pas d’être sensibles à ce regard à la fois juste et décalé sur la grande cité du Ponant.
Une saison fragile,Estelle Fenzy, La Part Commune, 105 pages, 13,90 euros
 |
Marie-Hélène Prouteau, |
| 12 poètes contemporaines de Bretagne |
|---|
Écrivain, critique littéraire et conférencière, la nantaise Marie-Hélène Prouteau réunit dans un livre des études ou entretiens qu’elle a pu effectuer à propos de 12 poètes contemporaines de Bretagne. Un choix forcément « subjectif », convient-t-elle, mais qui nous fait bien toucher du doigt – s’agissant ici de femmes – la richesse mais aussi la diversité de leur approche poétique.
La Bretagne de Marie-Hélène Prouteau est une Bretagne « d’ici, d’ailleurs et sans frontières ». L’autrice revendique un héritage : « Cet amour des langues et de la poésie venu des lointains de l’enfance ». Ce qui lui fait adhérer à une « Bretagne ouverte aux vents de l’esprit et aux langues multiples ». On comprend donc qu’elle ait été plus particulièrement sensible à des voix poétiques de femmes à l’unisson de ses propres convictions, loin du folklore ou de quelconques relents passéistes.
Ce qui ne l’empêche pas de constater, chez ces poètes qu’elle aime, des thématiques ou des approches d’une grande diversité. « Mérédith Le Dez a une prédilection pour le mystère des vies démunies, pour l’opacité des êtres touchés par une fêlure, avec qui partager un brin d’humanité », note Marie-Hélène Prouteau à propos de son livre Alouette (Obsidiane, 2023). Chez Denise Le Dantec elle note « son attention au sort des femmes créatrices ». Chez Cécile Guivarch, elle relève « cette expérience de l’altérité langagière » qui est « intimement liée à la quête de la mémoire ». Évoquant le livre de Marie-Josée Christien, Affolement du sang (Al Manar, 2019), elle parle d’une « élégie de la vie en souffrance ».
Si l’on ne peut donc, à proprement parler, trouver un dénominateur commun à toutes ces poètes, il y a quand même, relève Marie-Hélène Prouteau, quelques affinités autour de certaines thématiques. Ainsi, pour Denise Le Dantec, Nicole Laurent-Catrice ou Jacqueline Saint-Jean, il y a l’art de revisiter « cette substance poétique essentielle que sont les récits et les mythes ». Pour d’autres poètes, c’est l’attirance de l’ailleurs qui s’impose. Guénane en est la parfaite illustration, nous parlant aussi bien de la Patagonie que de la côte morbihannaise.
Plusieurs de ces poètes femmes (ou femmes poètes), souligne encore Marie-Hélène Prouteau, « s’avancent aussi en ces lieux pluriels de la poésie que sont les rencontres ou les revues ». On pense ici à la quimpéroise Marie-Josée Christien, fondatrice de la revue Spered Gouez, à la regrettée Brigitte Maillard (éditions Monde en poésie), à Cécile Guivarch et à la revue Terre à ciel, à Ghislaine Lejard et aux rencontres poétiques du Passage Sainte-Croix à Nantes, à Lydia Padellec et ses éditions de La Lune bleue…
Voici aussi des femmes qui peuvent « déborder les limites du seul art poétique ». Guénane, Chantal Couliou et Mérédith Le Dez ont écrit des romans, Anne Bihan des pièces de théâtre. Marie-Hélène Prouteau souhaite que ces 12 poètes bretonnes contemporaines « puissent bénéficier de nouvelles formes de visibilité ». Son ouvrage y contribuera à coup sûr.
12 poètes contemporaines de Bretagne, Marie-Hélène Prouteau, Les Éditions Sauvages, 2023, 115 pages, 13 euros
Lectures de 2023
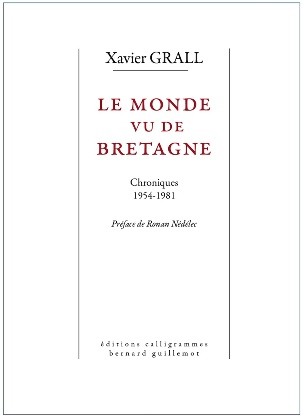 |
Xavier Grall, |
| Le monde vu de Bretagne |
|---|
On n’en finit d’inventorier l’œuvre de Xavier Grall. Deux ans après le 40e anniversaire de la mort du poète et journaliste breton, voici réunis des chroniques et billets publiés pour la plupart dans Le Monde. On y retrouve le Xavier Grall lyrique que l’on aime, profondément attaché à son pays, témoin de menus faits ou de plus grands événements dont il sait toujours faire son miel.
Xavier Grall a publié sa première chronique dans Le Monde le 4 octobre 1972. Sa collaboration sera régulière à partir de l’automne 1973 dans l’édition dominicale du quotidien national. Une première sélection de ses chroniques (une quarantaine de textes) avait été publiée en 1983 par Calligrammes, à Quimper, sous le titre Et parlez-moi de la terre . « Impossible dans un seul ouvrage de tout éditer, précisaient Bernard et Mireille Guillemot, les fondateurs des éditions Calligrammes, aussi avons-nous effectué un choix ». Quarante après, Yvan Guillemot reprend le flambeau en publiant l’intégralité des chroniques publiées dans Le Monde auxquelles il a ajouté celles (plus rares) publiées dans Bretagne Magazine, Le Cri du monde, Les Nouvelles littéraires, Autrement, Hors jeu…
Cette publication arrive après celles consacrées aux chroniques publiées par Grall dans La Vie catholique sous le titre Les billets d’Olivier puis Les vents m’ont dit (réédition Terre de brume, 2017 et 2018) et aussi après celles qu’il livrait à la revue Croissance des jeunes nations sous le titre La chronique de l’Indien (Terre de Brume, 1995 et 1996), sans oublier celles qu’il avait publiées dans la revue militante bretonne Sav Breizh et regroupées sous le titre >Mémoires de ronces et de galets (An Here, 2002, Terre de brume, 2014).
Nous voici donc aujourd’hui devant un « corpus » quasi complet des chroniques de Xavier Grall, nous rappelant qu’au-delà d’être un grand poète il fut aussi un brillant journaliste, profondément attaché à ce métier. C’est depuis son repaire de Botzulan dans la campagne de Nevez qu’il adresse, par la poste, ses chroniques au Monde. Une forme de télé-travail, mais c’était une autre époque. Il suffit de voir combien certains de ses billets nous font entrevoir une période aujourd’hui révolue. Un simple exemple : on meurt moins aujourd’hui dans la pêche au large alors que dans les années 1970 c’était encore souvent le cas. « Quel marin, cette année, ne reviendra pas ? » écrit Xavier Grall. À partir de ce questionnement, il bifurque vers les poèmes du Gallois Dylan Thomas, le seul qui, à ses yeux, « a su dire l’angoisse que soulève la mer en nos pays celtiques ».
Xavier Grall a toujours regardé la mer à distance. Elle l’impressionne toujours quand elle « conteste la rive » comme il le dit dans un de ses poèmes. Mais il se met à son écoute, entend mugir « les vents hurleurs » venus de l’océan. « À Botzulan, ce ne fut que gifles répétées, assauts secs et tonitruants. Les vents venaient du noroît », écrivait-il dans un de ses billets. Et il ajoutait. « Mais, s’il vous plaît, les vents, pour nos marins, pitié ».
Depuis son repaire cornouaillais, il voit aussi un monde qui bascule. Il parle des « maisons mortes », il se demande où sont passées « les toiles d’antan » (« Les Gauguin sont à Moscou, Paris, New-York »), il se désole de voir des « théories de touristes » envahir Pont-Aven (que ne dirait-il du sur-tourisme contemporain), il enrage devant les premières grandes atteintes à l’environnement (« milles trois cent tonnes de fuel s’écoulant de l’Olympic-Bravery… »). Préfaçant et annotant cet ouvrage, Ronan Nédélec note avec justesse que « bien qu’écrits il y a plus de quarante ans, ses textes résonnent en de multiples échos sur nos événements contemporains ».
Les points d’ancrage (et de réconfort) de Grall sont les chemins vicinaux, les bars où l’on échange, les fêtes de nuit et, bien sûr, les écrivains qu’il aime et dont il évoque, ici aussi, la figure : Lamennais « prophète maudit », Bernanos et son « invincible jeunesse », Rimbaud « le Somalien ». Sans oublier Georges Perros qu’il qualifie de « moine laïc » et dont il vante la « pureté secrète ». Ainsi allait Xavier Grall dans ses « fidélités bretonnes » sous « les vents verts » et « les vents gris », à l’écoute du « chant de la terre ». Journaliste jusqu’au bout des ongles mais poète avant tout : « Le réel ne se donne pas, il s’imagine, disait Xavier Grall, un article a pouvoir de poème ».
Le monde vu de Bretagne, Xavier Grall, préface et notes de Ronan Nédélec, éditions Calligrammes – Bernard Guillemot, 2023, 372 pages, 25 euros.
 |
Thierry Le Pennec, |
| Le visage du mot : fils |
|---|
Le thème de la filiation abonde dans les romans ou dans les livres de sociologie. Mais qu’un poète s’empare du sujet et nous voilà transportés vers d’autres horizons. Avec Thierry Le Pennec on n’est jamais déçu. Il donne toujours une enveloppe charnelle à tout ce qu’il écrit et le témoignage de la relation avec son fils est là, une nouvelle fois, pour l’attester.
Né en 1955, Thierry Le Pennec a été arboriculteur dans les Côtes d’Armor. Il l’a raconté dans son recueil Un tour au verger (La Part Commune, 2018), verger où l’auteur faisait « entrer le monde entier » comme l’a si justement dit Paol Keineg en présentant ce livre. En nous parlant cette fois de son fils, Thierry Le Pennec fait du cas particulier de cette relation un phénomène universel où chaque père pourra retrouver l’attachement à son enfant, le plaisir d’être ensemble, mais toujours dans la perspective du moment redouté de la séparation.
Le père et le fils, ici, parlent le même langage. Ce sont des manuels. Des hommes avec les pieds sur terre. Nous les voyons s’ébrouer dans les travaux et les jours, parcourant des sentes humides et des champs où prospèrent l’ortie ou la ronce. Le verger est l’épicentre de cet univers. Ils sont là, tous les deux sous des cieux incertains, dans « la longue remontée des bûches de bois blanc », dans « la réparation du pont sur le ruisseau » ou « sous le harnais d’une débroussailleuse ». Car, au fond, nous lance Thierry Le Pennec, « Paysans sommes ». Ajoutant, dans une sublime notation, « et lui et moi / de l’aube au crépuscule / dans la cartographie d’une même planète ».
Le père-poète hume son pays mais il aime le faire avec son fils à ses côtés : « Je pense à vie / aux nuages à la pluie / sur nos têtes encapuchonnées ». Thierry Le Pennec le dit dans un langage poétique qui se moule dans les gestes qui lui sont quotidiens (« Toujours le bricolage le tâtonnement »). Rien de linéaire dans ses poèmes. Il y a des pas de côtés et des ruptures. Quelque chose de brinquebalant, comme la vie. Mais toujours de l’émotion dans des scènes croquées sur le vif. Chaque poème raconte un moment à part, une petite histoire, un instant minuscule mais tellement chargé de sens.
Le fils, un jour, part avec sa compagne. En roulotte à cheval. Il part vers l’Autriche (« Mon garçon la tête en voyage »). Alors le père à « boule à la gorge au moment de l’accolade ». Mais le père ira, là-bas, rendre visite au fils. Il en retirera un carnet de voyage « par les grands plateaux de loess, vaguement ondulés : blés, orges, pommes de terre, courges… » Un paysan poète regarde le monde. « On aura vu le vieux Vienne – chaleur continentale et palais tremblés dans la lumière ».
Quand le fils reviendra pour de bon, les voici de nouveau ensemble « au talus de chênes » avec leurs tronçonneuses. Mais cela n’a qu’un temps. « Cette fois ils partent ». Mais pas si loin que cela. Ils resteront, quoi qu’il en soit, les « compagnons de ce temps passé / ensemble et sur la terre ». Ce récit-recueil de Le Pennec est poignant. Il a d’abord les accents de la sincérité.
Le visage du mot : fils, Thierry Le Pennec, La Part Commune, collection La Part Poétique, 92 pages, 13,90 euros
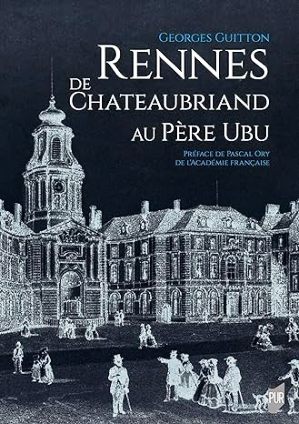 |
Georges Guitton, |
| Rennes de Chateaubriand au Père Ubu |
|---|
L’histoire littéraire de la capitale bretonne s’enrichit d’un nouveau livre. Après avoir évoqué le 20e siècle dans Rennes de Céline à Kundera (PUR, 2016), Georges Guitton, ancien journaliste à Ouest-France, aborde le 19e siècle à travers le portrait fouillé de 9 écrivains : certains ont vécu quelque temps à Rennes et en parlent dans leurs livres, d’autres y ont été conduits par les hasards de la vie ou dans le cadre d’un projet de livre.
Qui sont ces 9 écrivains « épinglés » par Georges Guitton ? Nommons-les : Chateaubriand, Paul Féval, Leconte de Lisle, Gustave Flaubert, Gérard de Nerval, Raoul de Navery (de son vrai nom Eugénie Saffray), Alexandre Dumas, Octave Mirbeau, Alfred Jarry. Leurs propres liens avec Rennes sont extrêmement divers. Gustave Flaubert, par exemple ne fit qu’y passer en 1847 à l’occasion de son voyage en Bretagne avec Maxime Du Camp (Par les champs et par les grèves). Il se contentera de s’attarder sur le sort d’un phoque dans une baraque foraine (Georges Guitton tirera de cette anecdote un précédent livre sous le titre Le phoque de Flaubert, PUR 2021).
Ce qui frappe à la lecture de ces différents itinéraires d’écrivains, c’est d’abord le rôle essentiel qu’a pu jouer, pour certains d’entre eux, la formation qu’ils ont reçue dans tel ou tel établissement scolaire de la ville (très attractive sur le plan éducatif). C’est vrai, par exemple, pour Chateaubriand qui entra dans le collège de la ville à 13 ans en 1781. C’est encore plus vrai pour Paul Féval, né natif de Rennes, qui fit sa scolarité au lycée avant d’entamer des études de droit puis de monter à Paris à l’âge de 20 ans. Georges Guitton affirme d’ailleurs que Paul Féval (1816-1887) est « le seul écrivain véritablement rennais de tous les siècles passés ». Leconte de Lisle, venu de l’île Bourbon, mena, lui, une vie d’étudiant bohème à Rennes. Quant à Octave Mirbeau, il fut pendant deux ans (de juin 1863 à décembre 1864) pensionnaire au collège Saint-Vincent, où il fut très malheureux : « Ce dont il souffre le plus, raconte Georges Guitton, c’est de l’indifférence. L’indifférence des professeurs devant la tristesse des élèves, l’indifférence des camarades dont il quête en vain l’affection et la solidarité ». Et pour ce qui est d’Alfred Jarry, on le découvre élève du lycée pendant trois ans de 1888 à 1891. Amateur de farces destinées à se moquer d’un professeur chahuté, il s’inspirera de ce dernier pour créer sa célèbre pièce Ubu roi.
Le livre de Georges Guitton fourmille ainsi d’informations sur la vie scolaire et universitaire de l’époque et, au-delà, sur la vie de certains quartiers à travers des épisodes et anecdotes concernant tel ou tel auteur présenté dans ce livre. Car c’est une image inédite de leur ville que l’ancien journaliste d’Ouest-France renvoie ainsi à ses lecteurs rennais. Rennes n’est plus tout à fait dans Rennes (celle qui fut la « Vieille capitale des États bretons » et une « métropole parlementaire »).
« À l’époque de Paul Féval, note Georges Guitton, ce qui caractérise Rennes, c’est la nostalgie, son inguérissable regret d’une époque idéalisée où la ville incarnait un pouvoir vigoureux face aux empiétements de la monarchie. Tout cela balayé par la Révolution ». Ce qui n’empêchait pas, malgré tout, l’auteur du Bossu d’affirmer que « la ville n’a point perdu de son élégante renommée » et qu’elle « a toujours le centre noble ». L’honneur est sauf, souligne Georges Guitton, parlant d’un Paul Féval « à la fois chauvin et détracteur » et « en cela très rennais ».
Car en fait de chauvinisme, Rennes pouvait s’enorgueillir d’avoir été le théâtre des prémices de la Révolution française comme le raconte Chateaubriand. À 20 ans, en mai-juin 1788, il vient, souligne Georges Guitton, « se mêler à la fronde des nobles contre le pouvoir royal ». Faut-il aussi rappeler que c’est à Rennes que se déroula le procès Dreyfus, l’occasion pour Octave Mirbeau de refaire surface dans la ville pour, finalement, ne pas écrire une seule ligne sur cet événement.
Préfaçant ce livre, l’académicien Pascal Ory souligne qu’il intéressera à coup sûr « les Rennais de naissance et de cœur, curieux de découvrir l’image qui leur est ainsi renvoyée de ce qui est moins une géographie qu’une histoire, moins une nature qu’une culture ». Mais il y a aussi tous ceux qui aborderont ce livre sous l’angle de l’histoire de la littérature, « ce qui finit par faire beaucoup de monde, note Pascal Ory, surtout quand l’auteur s’appelle Chateaubriand, Dumas ou Flaubert ». On pourrait y ajouter Gérard de Nerval qui trouva à Rennes le cadre de son roman inachevé Le Marquis de Fayolle. Quant à Alexandre Dumas il vint à Rennes avec l’ambition d’écrire un roman sur le suicide, dans un hôtel de la Rue Le Bastard, de l’amiral de Villeneuve, le vaincu de Trafalgar. Mais le roman ne vit jamais le jour.
Rennes de Chateaubriand au Père Ubu, Georges Guitton, Presses universitaires de Rennes (PUR), 2023, 180 pages, 20 euros
 |
Katina Vlachou, Vassilis Pandis, Cypris Kophidès, |
| Équilibre |
|---|
Un mot les réunit dans un livre conçu en commun : « Équilibre ». Deux poétesses et un poète, tous trois liés à l’île grecque de Corfou, confrontent leur regard sur ce mot inspirant. Mais on découvre que ce mot « équilibre » recouvre des réalités bien différentes selon les auteurs. Ce sont trois écritures, trois univers différents qui se révèlent ici.
Pour Katina Vlachou le premier équilibre à trouver dans ce monde est sans doute celui entre la langue apprise et la langue maternelle. Ainsi évoque-t-elle cette langue française qui lui fut à la fois « étrangère » et « familière » depuis l’enfance. « Maintenant, dit-elle, je peux revenir / à ma langue maternelle / en toute confiance / pour composer / un équilibre secret ».L’autre équilibre auquel elle s’attache est celui de l’enfance. La poétesse raconte comment a été battue en brèche « le tendre équilibre / de notre innocence enfantine ». Pour illustrer son propos, elle évoque l’équilibre précaire des châteaux de cartes que bâtissaient les enfants. C’est cet esprit d’enfance qu’il faut retrouver, estime-t-elle, garant de notre équilibre car « nous détenons encore dans l’âme / profondément cachés / les châteaux imprenables de nos rêves d’enfants ».
Katina Vlacou nous dit aussi que la poésie a bien des choses à nous apprendre dans l’art qu’elle a de maintenir une respiration entre les mots. « Silence et verbe / gardent le temps de l’équilibre / dans l’humble jardin de la poésie ». Mais peut-être suffit-il, pour commencer, de retenir les leçons de la nature dans le domaine de l’équilibre. Savoir, par exemple, s’inspirer de la libellule, du papillon ou de l’araignée dans leur exercice d’équilibriste. Car « un équilibre figé m’insupporte / je bouge », ajoute Katina Vlachou.
Comment traverser le temps et garder son équilibre ? Comment, dans la confusion du monde, survivre « à l’injustice / à la trahison / au mensonge / à la cruauté ? Comment survivre quand on est « froissée d’angoisse » ? Ce sont les grandes interrogations de la poétesse franco-grecque Cypris Kophidès. « Équilibre est quête / instant de suspension », affirme-t-elle. Rien n’est jamais gagné : le chagrin a beau être « enfoui » ou « bâillonné », on peut dire de telle personne qu’elle « tient l’équilibre ». En poète, Cypris Kophidès propose de « s’appuyer sur un arbre une étoile / même sur un rire / et certainement sur l’équinoxe / au printemps et à l’automne / cela s’appelle tenir ».
Vassilis Pandis, pour sa part, répond plutôt à mots couverts à toutes ces questions « existentielles ». Il n’emploie jamais le mot « équilibre » dans ses courts poèmes, préférant aborder le sujet par le truchement de visions intérieures ou de sensations vécues. « À partir d’une seule odeur /j e peux me tenir dans le monde », écrit-il. Poursuivant son exercice de contemplation il dit du « chêne des garrigues » qu’il « grandit dans sa gloire profonde ». Mais son propos un peu énigmatique (voire hermétique), dans la veine du surréalisme, cultive une forme de mystère pour maintenir l’équilibre.
Équilibre, Katina Vlachou, Cypris Kophidès, Vassilis Pandis, Diabase, 2023, 155 pages, 18 euros
 |
Nathalie Fréour, Gilles Baudry, |
| Cette enfance à venir |
|---|
Une artiste et un moine-poète. Leur collaboration ne date pas d’hier, mais les voici de nouveau réunis dans un recueil où Nathalie Fréour et Gilles Baudry déclinent à leur manière « cette enfance à venir ». Avec la complicité de l’académicien François Cheng.
« Toujours l’arbre déploie ses branches, / Toujours la pie vient y percher, / Toujours le temps joue à l’enfance, /Pour faire durer le bref été ». Ce sont les quatre vers que François Cheng (97 ans) a tenu à écrire, précise l’éditeur Jean Lavoué, « pour accompagner la naissance de ce recueil ». L’écrivain et poète français d’origine chinoise connaît bien l’éditeur tout comme l’artiste et le moine. Il est venu à quelques reprises à l’abbaye bénédictine de Landévennec où vit le moine-poète Gilles Baudry.
Son message de sympathie cerne d’ailleurs, en quelques mots, le cœur de ce recueil. On y trouve des branches, beaucoup de branches, mais aussi des feuilles, des racines, des troncs, des sous-bois, des clairières… L’arbre est le thème central des superbes dessins blancs sur papier noir de Nathalie Fréour. Monde végétal transfiguré par l’artiste nantaise… « De l’arbre apprendre la patience des racines / aller jusqu’à la nuit », écrit pour sa part Gilles Baudry.
Accompagnant ces dessins, le moine-poète nous parle « d’une enfance à venir » comme s’il s’agissait de remonter le temps vers « une source inconnue très en amont ». Énigmatique assertion qui nous conduit, en réalité, vers cette « seconde naissance » qu’il appelle de ses vœux. Ce Dies natalis évoqué par Gilles Baudry, on l’avait déjà entrevu dans un recueil plus ancien (Jusqu’où meurt un point d’orgue ? Rougerie, 1987) où le poète évoquait ce passage de la mort à la vie (pour une nouvelle vie) à l’occasion du décès de son père. « Que l’aube approche / blanche préface / sur le monde ».
Ce dies natalis il le chante à nouveau ici. « Voici le seuil / Le rendez-vous // Voici le terme / Où tout commence // La mort s’éteint / Derrière nous // Et devant nous / Voici l’enfance ». Cette enfance à venir est bien cette « enfance pérenne / inaliénable / où l’éternel du temps / s’accorde ». Car dans « les sortilèges de l’enfance » que souligne Gilles Baudry, il y a la prescience d’une forme d’éternité, par cette attention particulière de l’enfant à l’instant vécu en plénitude.
Et nous voilà, par petites touches, conduits à rejoindre les propos mêmes de François Cheng dans ses Méditations sur la mort et donc sur la vie (Albin Michel). Gilles Baudry, lui, célèbre « l’enfance phréatrique » et son goût d’éternité, Nathalie Fréour, elle, célèbre l’arbre et son cycle de renaissance. Avec, chez l’un comme chez l’autre, « ce sentiment, soudain, //de porosité entre lici et l’ailleurs », qui donne toute sa force aux poèmes comme aux dessins regroupés dans ce recueil.
Cette enfance à venir, Nathalie Fréour (dessins), Gilles Baudry (poèmes), L’Enfance des arbres, 2023, 70 pages, 15 euros.
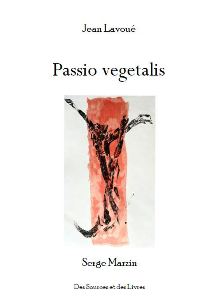 |
Jean Lavoué et Serge Marzin, |
| Passio vegetalis |
|---|
Passion de l’arbre. Passion du Christ. En ces temps de déréliction où la forêt vit sous la menace des incendies ou de la déforestation, le poète Jean Lavoué et l’artiste graveur-buriniste Serge Marzin unissent leurs talents pour évoquer à leur manière un arbre (en quelque sorte « christique » et symbole de vie) « que l’on martyrise par profit ou par négligence », comme l’affirme Serge Marzin.
12 gravures dites « en taille-douce » et 40 poèmes pour dire une Passio vegetalis. L’artiste a pris le parti de créer, ici, un « décharné végétal ». Il met l’arbre à nu « en lui ôtant son écorce », ajoute-t-il, sa façon à lui de dénoncer « la déforestation massive de la planète ». L’arbre devient ainsi le symbole et l’expression contemporaine de la souffrance qui peut affecter tous les types d’êtres vivants sur terre.
Cette Passio vegetalis nous parle aussi indirectement du bois de la croix et de Celui qui y fut suspendu. Les gravures de Serge Marzin ne manquent pas très vite d’évoquer la Passion du Christ. Les branches de l’arbre épousent les bras en croix décharnés du crucifié, les veines de l’arbre nous ramènent au sang versé.
En s’associant à Serge marzin, le poète Jean Lavoué poursuit pour sa part toute une démarche engagée de longue date sur le thème de l’arbre. Sa maison d’édition n’est-elle pas à l’enseigne de L’enfance des arbres et deux de ses derniers livres (Carnets de l’enfance des arbres en 2021 et Écrits de l’arbre au soleil en 2023) montrent cette fidélité à ce qu’il appelle « le domaine vertical ».
Jean Lavoué s’adresse à l’arbre. « Je te regarde vivre / de toutes tes forces neuves // Les miracles que tu fais / on ne les compte pas ». Mais, par glissements successifs, cet arbre épouse la silhouette du Christ quand il devient ce « compagnon », ce « pauvre à nos côtés ». Les allusions au message évangélique se découvrent ainsi au fil des pages. « Avance ta main / mets simplement ton doigt / sous mon écorce », peut-on lire quand l’arbre « christique » s’adresse à l’homme en proie au doute (référence au Christ ressuscité s’adressant au crédule Thomas). Et alors nous reviennent en écho ces vers du moine-poète Gilles Baudry : « Laisse la sève / infuser le silence / et irriguer les veines de ton âme ».
Passio vegetalis, Jean Lavoué et Serge Marzin, Des Sources et des Livres, 2023, 65 pages, 15 euros.
 |
Maurice Chappaz, Philippe Jaccottet, |
| Correspondance, 1946-2009 |
|---|
Ils étaient tous les deux originaires de Suisse, mais ils auraient pu ne jamais se lier d’amitié ni engager de correspondance. Il a suffi, pour les réunir, d’un livre de poésie, Verdures de la nuit de Maurice Chappaz, un recueil qui a ébloui le jeune Philippe Jaccottet. Il en fera une présentation élogieuse dans une revue de Lausanne. Les deux auteurs ne se perdront plus de vue, pourtant si différents mais vivant tous les deux dans l’ombre tutélaire du grand Gustave Roud.
Lire une correspondance entre deux grands poètes, c’est d’abord pénétrer dans une tranche d’histoire littéraire, ici celle de la Suisse romande du XXe siècle, avec ses écrivains et aussi ses artistes (d’où émerge la figure du peintre Gérard de Palezieu). C’est aussi mieux appréhender la vision que peuvent avoir deux auteurs sur la création littéraire, sur la poésie en particulier, mais aussi sur leur approche du monde et de la vie qui les entoure. C’est enfin entrer dans leur intimité, celle d’êtres de chair et de sang que taraude une forme d’angoisse ou pour le moins un questionnement sur la vie et la mort, mais à des degrés divers (d’une façon plus marquée, sans doute, chez Jaccottet).
Car tout différencie au départ ces deux auteurs. Maurice Chappaz (1916-2009) est plus l’homme de convictions sociales profondes et affirmées – notamment sur l’environnement – qui l’amènent à fustiger cette prospérité éloignant l’homme de la nature. N’est-il pas, en particulier, l’auteur d’un livre polémique, Les maquereaux des cimes blanches, sur le développement anarchique de l’industrie de la neige ? N’est-il pas aussi l’homme d’un attachement sans failles à ce Valais natal dont il fait une véritable patrie ? Installé au Châble près de Martigny, il a un chalet aux Vernys et exploite des vignes. Mais cet enracinement n’empêche pas, chez lui, une forme de nomadisme et son attrait pour des terres lointaines. Il voyagera, surtout vers l’Orient, et affichera (lui le « catholique païen »)son attrait pour les spiritualités orientales.
Philippe Jaccottet (1925-2021, lui, vit plus dans le retrait. Né à Moudon en Suisse, il a vécu un moment à Paris avant de s’installer à Grignan dans le Drôme. Mais jamais il ne perdra le contact avec sa Suisse natale. S’il approuve les engagements et les coups de sang de Chappaz, il est plus enclin à « intérioriser » (sa formation rigoriste protestante y est sans doute pour quelque chose) et il parle volontiers d’un monde suscitant de sa part « dégoût » ou « désespoir ». Dans une lettre du 13 juin 1986 il écrit à Maurice Chappaz : « Je vous envie cette foi dont je me sens bien incapable, moi qui cours le plus grand risque de me rabougrir ». Dans une autre lettre, le 5 juillet 2003, il souligne « la richesse d’expérience », « l’énergie » et « la vitalité » de son ami.
Malgré ces différences, les deux hommes conviennent qu’ils sont « du même temps, du même lieu » (Chappaz, dans une lettre du 1er juillet 2001) pour dénoncer « la confusion régnante ou, aussi bien, l’uniformité dans la surdité à ce que nous aimons » (Jaccottet dans une lettre du 6 novembre 2001). Les deux hommes ne vont donc pas cesser d’accueillir avec bienveillance leurs œuvres respectives et, surtout, d’en faire part au plus grand nombre. Jaccottet, notamment, ne manquera jamais d’évoquer les livres de Chappaz dans les revues auxquelles il collabore (La NRF, La Gazette de Lausanne, notamment).
C’est Jaccottet qui fera l’éloge de Chappaz en octobre 1997 à Sion lors de la remise du Grand prix Schiller à l’écrivain suisse. Il sera en 2006 présent à la soirée d’hommage organisée à Martigny à l’occasion des 90 ans de Maurice Chappaz et publiera aux éditions Fata Morgana, pour marquer cet anniversaire, toutes les chroniques qu’il avait rédigées sur l’œuvre de Chappaz. Leur correspondance évoque en détail, tous ces événements littéraires. Quarante-cinq avant, en 1961 (c’est dire la constance de leurs relations), c’est Chappaz qui s’était rendu à Grignan et il rappelle dans une lettre, le plaisir qu’il en avait retiré dans « la petite société des amis, les appels des hiboux, les rossignols le soir ».
Leurs rencontres, néanmoins, furent restreintes. La correspondance, par contre, demeurera un fil rouge. Tout comme le fut ce lien indéfectible qui les reliait au poète Gustave Roud (1897-1976) dont la figure est évoquée, par les deux hommes dans de très nombreuses lettres. Jaccottet et Chappaz, de concert, veillèrent à ce que l’œuvre de Roud « ne tombe pas entre des mains médiocres » et « soit ancrée comme un beau bateau sur des eaux un peu plus vastes que le lac Léman » (Jaccottet).
L’ultime lettre de leur correspondance est signée de Jaccottet le 5 avril 2008. Le poète réagit à la lecture de La pipe qui prie et fume, dernier ouvrage de Chappaz qui décédera le 15 janvier 2009. Comme le souligne José-Flore Tappy, qui a magnifiquement présenté et annoté cette correspondance, ces deux grands auteurs ont entretenu une relation épistolaire qui posait « la question très exigeante du rapport entre la poésie et l’existence ».
Correspondance, 1946-2009, Maurice Chappaz, Philippe Jaccottet, Gallimard, les cahiers de la Nrf, Gallimard, 297 pages, 23 euros.
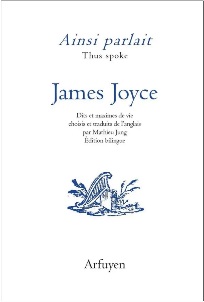 |
Mathieu Jung, |
| Ainsi parlait James Joyce |
|---|
Ainsi parlait James Joyce, dits et maximes de vie choisis et traduits de l’anglais par Mathieu Jung, édition bilingue, Arfuyen, 2023, 190 pages, 14 euros.
 |
Pierre Pachet / Georges Perros, |
| Correspondance, 1968-1978 |
|---|
Georges Perros aurait eu 100 ans cette année. Pour marquer cet anniversaire, les éditions Le Bruit du temps publient sa correspondance avec l’enseignant et écrivain Pierre Pachet (1937-2016). L’occasion d’approfondir notre connaissance de l’auteur des Papiers collés et de La vie ordinaire, mais aussi de découvrir en Pierre Pachet un interlocuteur « éclairé » et admiratif de celui qui avait choisi Douarnenez comme port d’attache.
Georges Perros (1923-1978) n’a jamais été avare de correspondances. On pense notamment à celles qu’il a entretenues avec Lorand Gaspar, Jean Grenier et Vera Feyder, pour citer celles publiées en 2001 et 2007 par Yves Landrein, créateur des éditions La Part Commune. N’oublions pas non plus les lettres de Perros à Michel Butor publiées en 1983 par les éditions Ubacs (fondées aussi par Yves landrein). La correspondance de Perros avec Pierre Pachet trouve son origine dans la collaboration des deux hommes à la revue littéraire Les Cahiers du chemin animée par Georges Lambrichs. Leur premier contact épistolaire date du 29 avril 1968. Pachet s’adresse à Perros avec la timidité et la retenue du cadet. Il lui dit son admiration pour ses écrits et pour ses livres (Perros vient de publier La vie ordinaire chez Gallimard). Pachet, dans cette lettre qui donne le ton de la correspondance à venir, révèle qu’il a saisi d’emblée la personnalité de Perros. Et il le dit dans une forme de balbutiement auquel Perros a du être sensible. « Dans un brouillon, je vous disais que vous me paraissiez semblable (que vous me sembliez pareil) à un qui n’aurait pas de mains pour protéger sa tête des coups, un enterré-vif peut-être… ». La réponse de Perros ne tarda pas : « Heureux de votre mot, qui m’a fait sortir d’une tombe d’enterré-vif ».
C’est le déclic. La première rencontre entre les deux hommes aura lieu au printemps 1969 dans le cadre de la revue : Pierre Pachet a 32 ans, Perros est son aîné de 14 ans. Les deux hommes vont s’apprivoiser (disons plutôt que Perros, dans un premier temps, se laisse apprivoiser). Pachet sera le plus souvent « à la manœuvre » mais Perros ne desserrera jamais cette douce étreinte même si la vie de l’un et de l’autre parait si dissemblable. D’un côté un auteur tirant le diable par la queue, lisant des manuscrits pour Gallimard, publiant des articles dans des revues littéraires… (« Pas question de bouger en ce moment, on mange, c’est déjà très suffisant », écrit Perros en réponse à une invitation de rencontre lancée par Pachet. De l’autre un enseignant de grec ancien à Orléans, invité aux États-Unis pour des séminaires, puis installé à Meudon près de Paris pour se rapprocher de l’Université (Meudon où Perros avait aussi vécu dans une autre vie) avant de rejoindre le centre de la Capitale près de Beaubourg.
Pierre Pachet enseigne. Il est aussi écrivain. Il prend des vacances, va en Grèce, en Provence… Mais aussi en Bretagne, à Loctudy ou en baie de Douarnenez, ce qui renforcera et facilitera les liens entre les deux hommes. La belle-famille de Pachet vit à Hédé au nord de Rennes. De Hédé à Douarnenez il n’y a qu’un pas qu’on franchit en voiture ou en train quand ce n’est pas en moto (s’agissant de Perros). Malgré tout, les rencontres seront exceptionnelles. Une photo publiée dans ce livre nous les montre tous les deux du côté de Ploeven où Pachet passa certaines vacances avec sa famille.
La Bretagne, donc, les réunit d’une certaine manière. « Le printemps n’irait pas sans une lettre inaugurale adressée à Perros dans son Far-West. Même les chemins creux du bord de mer n’iraient pas si gaiement sans certaine pétarade qui les fait résonner. Ainsi le monde feint-il de s’adapter aux intrus qui l’habitent » (lettre de Pachet du 19 avril 1971). Mais la Bretagne est l’arbre qui ne cache pas la forêt de leur profonde connivence et de leur amour de la littérature quand celle-ci est à même de raconter poétiquement la vie ordinaire. « Je voulais vous dire que je crois en ce que vous faites, écrit Pachet, par le besoin inscrit dans le monde où je nage, non d’une force spirituelle, mais plutôt d’une faiblesse résolue, contradictoire, irréductible. Mais me voici vous écrivant comme un vieux à un jeune poète. Peut-être l’êtes-vous. Pourquoi pas ? » (lettre du 18 mai 1971).
Les deux hommes échangent sur les textes ou les livres qu’ils lisent et qu’ils aiment. Perros apporte son soutien au livre Autobiographie de mon père de Pierre Pachet qui ne trouve pas d’éditeur. C’est la littérature qui nourrit surtout leur échange (mais aussi leur vie de famille). Ils nous parlent de Joubert qu’ils adorent tous les deux. « Joubert est rempli d’absence. C’est Novalis qui l’enveloppe génialement » (Perros). Ils épinglent volontiers certains auteurs ou certains écrits (Simone de Beauvoir par exemple sous la plume de Perros). « J’ai reçu quelques livres de la nouvelle cuvée. Personne n’est content de vivre, de mourir. Faudrait trouver autre chose » (Perros). À travers cette correspondance, c’est aussi tout un pan de la vie littéraire et intellectuelle de l’époque qui revit sous nos yeux (avec les figures de Michel Deguy, Jean Roudaut, Philippe Jaccottet et tant d’autres…).
Perros évoquera aussi, bien sûr, dans ses lettres les « cours d’ignorance » qu’il dispersait aux étudiants de l’université des Brest. « Je me demande ce que je vais leur raconter. Ce qui me caractérisera finalement, c’est un manque absolu de sérieux dans tous les domaines » (lettre du 18 novembre 1970). Quand la maladie s’installera et quand Perros ne pourra plus parler à la suite d’une laryngectomie, la relation des deux écrivains s’affinera autour de cette « ardoise magique » sur laquelle Perros livrait ses pensées et qui fera l’objet d’un livre (éditions Givre), livre réédité en 2015 à L’œil ébloui).
Difficile, au bout du compte, de rendre compte d’une correspondance aussi fournie et aussi riche, bourrée de références littéraires subtilement éclairées par Thierry Gillyboeuf qui a finement présenté et annoté cet échange de lettres. L’ouvrage intéressera vivement tous ceux que la vie littéraire passionne mais aussi les lecteurs, notamment bretons, avides d’approfondir leur connaissance de « l’oiseau rare » de Douarnenez. Ils ne seront pas déçus…
Correspondance, 1968-1978, Pierre Pachet / Georges Perros, Le Bruit du temps, 2023, 336 pages, 24 euros.
 |
Charles-Ferdinand Ramuz, |
| Le besoin des choses |
|---|
Ramuz chroniqueur. Le grand écrivain suisse (1878-1947) a collaboré à plusieurs revues de son pays entre 1907 et 1943. Voici ces chroniques réunies aujourd’hui sous le titre de l’une d’entre elles, Le besoin des choses. On découvre dans ce livre un auteur amoureux du beau et de la nature, mais sans concession dans son analyse de la société aussi bien suisse que française.
Les chroniques de Charles-Ferdinand Ramuz peuvent partir de simples faits ou de constats, de choses vues qui peuvent amorcer une réflexion sur son époque, par exemple une foire aux bestiaux, des jeux d’enfants dans la neige, des conversations entendues sur le temps qu’il fait et les saisons. Mais, le plus souvent, Ramuz se place en surplomb pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur : les valeurs de la société paysanne, l’emprise grandissante de la technique, le conformisme régnant dans son pays…
C’est d’ailleurs le ton acide d’une de ses chroniques sur le conformisme qui lui a valu un refus de publication de la part de La Gazette de Lausanne, revue à laquelle il collaborait. Dans cette chronique d’août 1918, intitulée « Valeurs moyennes », il s’en prenait à son pays « au milieu de tout, mais en même temps en dehors de tout (…) Un pays où il y a tout sauf une chose qui est essentielle : la grandeur ». La direction de la revue lui fit savoir que son article était « déprimant » et la collaboration s’effilocha. L’écrivain récidiva sur ce thème en 1931 dans une chronique intitulée « Conformisme » publiée par l’hebdomadaire Aujourd’hui (créé par l’éditeur mécène Mermod dont le poète Gustave Roud était le secrétaire de rédaction). Dans cette chronique Ramuz fustigeait l’autosatisfaction affichée par les habitants du canton de Vaud (où il résidait) à propos de livres d’histoire ou de récits les concernant.
Mais on ne saurait s’arrêter à ces jugements de valeur pour se faire un avis sur les chroniques de Ramuz. Ce « besoin des choses », titre d’une chronique qu’il publie en mars 1918 dans La Gazette de Lausanne, est une manière pour lui de signifier l’urgence de reprendre pied dans un monde qui ne tourne pas rond (nous sommes à la fin de la Grande guerre). « Il faut se secouer de ces mille haillons de l’âme et de tout ce brouillard intérieur, écrit-il, il faut recommencer à savoir par le bas, c’est-à-dire par sentir, et seules les choses familières et sûres conviennent qui nous connaissent, et qu’on connaît ». Et il donne un exemple : « Au sein de l’universel chaos, et parce qu’on y a peut-être trop consenti, rien ne vaut pour se retrouver ce jeu de quilles sous la tonnelle ».
Ramuz fait aussi confiance à la terre, au cœur d’une civilisation paysanne qu’il sent déjà menacée par la modernité et dont il vante « le contact étroit avec les choses, avec cette matière même dont le monde est fait, et qui va de la motte de terre qu’on écrase entre ses doigts à ce grand cortège d’étoiles qu’on voit le soir en rentrant chez soi, se développant entre les arbres ».
L’écrivain suisse profite de cette chronique de 1931 pour fustiger un certain esprit français, trop didactique et trop intellectuel à son goût, entraînant un certain mépris de ces valeurs paysannes auxquelles il tient et, parallèlement, une perte de contact avec les phénomènes naturels. Ramuz se range du côté de Péguy, Claudel et Alain-Fournier, « tous trois terriens », que la critique littéraire parisienne regarde de très haut. Ramuz dénonce un « phénomène de centralisation » qui concentre « les apports spirituels d’un pays dans un palais ceint de murs » et qui a « pompé toute la sève du pays (…) sauf peut-être dans les régions où la langue même, étant différente, s’opposait à toute expropriation » (et il fait allusion à la Provence et au poète Mistral).
Lisant ces chroniques aux sujets tellement disparates (allant d’analyses sur l’or et la monnaie, le travail, l’art et l’argent, les sciences…) on notera qu’elles ont été écrites – pour beaucoup d’entre elles – dans une période de drames immenses vécus au cœur d’une Europe frappée par deux guerres mondiales. Le malheur du monde arrive assourdi au cœur des textes de Ramuz mais on retiendra au passage la pertinente analyse qu’il fait du rôle de l’écrivain et notamment du poète en ces « temps de détresse » (Hölderlin). Alors que des voix s’élèvent pour demander aux poètes de soutenir l’effort de guerre, Ramuz affirme que « la poésie n’a pas d’ennemi – ou elle n’en a qu’un, qui est l’antiposésie ». Il ajoute, toujours à propos de la poésie : « Sa véritable rencontre avec l’événement n’est nullement dans le sujet, ni dans le choix des circonstances ou celui des personnages, ni la défense d’une cause même juste : elle est dans une certaine hauteur de ton ». Rejet, donc, de la poésie sur commande, engagée et militante. Ramuz insiste : « La poésie du temps de paix est la seule qui soit valable en temps de guerre » (chronique de 1939 dans le mensuel Guilde du livre).
Enfin, à propos de ces chroniques, on ne saurait passer sous silence l’avertissement (prémonitoire) que Ramuz adresse à propos de la planète. « La nature était consentie et aimée, écrit-il, la nature va être vaincue et méprisée ». C’est la fin d’une « époque d’adoration », estime-t-il, rejoignant les positions de l’écrivain Henri Pourrat qu’il a rencontré en Auvergne. Ramuz perçoit l’émergence de besoins infinis (« on les fait naître les uns des autres ») qui porteront atteinte à la nature et à l’environnement. « La limitation ne peut être que spirituelle : elle suppose un ton, un ton de vie qu’on considère le sien et d’où on ne sort pas », souligne-t-il dans une chronique de 1931 publiée par la revue Aujourd’hui. Déjà, de sa part, un appel à la sobriété, dans la lignée des positions du grand humaniste qu’il fut.
Le besoin des choses et autres chroniques, C.F. Ramuz, Zoé poche, 2023, 285 pages
 |
Jean-Luc Le Cléac’h, |
| Répertoire des solitudes |
|---|
Jean-Luc Le Cléach nous raconte, dans de courts fragments poétiques aux allures d’aphorismes, ses « quatre saisons au marais ». Grands moments d’introspection sur les bords d’un monde, mi-eau mi-terre, qui cultive le mystère et n’en finit pas d’interpeller les poètes. L’auteur breton (il réside dans le Pays bigouden) ne déroge pas à cette règle.
Pourquoi le marais est-il si souvent un thème poétique ? Souvenons-nous du merveilleux livre Le marais et les jours de Gérard Le Gouic publié en 1983 (éditions Telen Arvor). « Il faut des jours / et des mois / pour s’approcher du marais / /même à l’aide des mots », confiait le poète breton. Récemment, c’est Marie-Josée Christien qui nous a raconté ses Marais secrets sur des photos de Yann Champeau (Les Éditions Sauvages, 2022). « Le marais / est-il le seuil / de la mort / ou de la vie ? », s’interrogeait la poète quimpéroise.
Car la question est bien là et, comme en écho, Jean-Luc Le Cléac’h peut, pour sa part, écrire : « Si le marais fascine tant / c’est qu’il anticipe la dissolution de toutes choses ». Le disant, le poète nous renvoie par le fait même à ces croyance antiques – notamment celtiques – qui accordent une connotation surnaturelle ou magique aux marais. Jean-Luc Le Cléach peut ainsi nous raconter que « dans les marais de Scandinavie / on inhumait le corps / des chefs guerriers ». Il n’hésite pas on plus (lui, « l’athée », comme il le dit) à recourir à certaines références bibliques pour exprimer ce halo de mystère qui entoure les marais. « Le marais rejoue la Genèse / au commencement étaient les eaux ».
Mais le poète ne s’arrête pas là. Homme de l’instant, du temps présent vécu en plénitude, il aborde aussi (et surtout) le marais sous l’angle de la contemplation et de l’introspection. « Que laisse-t-on de soi / et du monde / lorsqu’on entre aux marais ? » Il convient aussi, ajoute-t-il, de « nommer au plus juste / pour faire advenir un monde ». Ce monde grouillant, il le confronte seul. « On est toujours seul / dans le marais / personne ne vient ici / ou si peu // Il existe tant de façon d’être seul //C’est peut-être cela le marais // Un répertoire des solitudes ». Le mot est lâché : il donne son titre au recueil.
Ce répertoire, s’il est celui des solitudes, est aussi celui d’une flore et d’une faune que le poète détaille sous nos yeux sans abuser, pour autant, de couleurs locales. Bonjour aux prunelliers, à l’aubépine et à sa « neige blanche », aux jeunes saules, aux iris d’eau, aux ajoncs, aux joncs ou au sedum. Bonjour aux poules d’eau, aux alouettes, à l’aigrette ou aux hérons cendrés. « Plus qu’ailleurs / vivre ici / c’est être aux aguets ».
Par petites touches, Jean-Luc Le Cléac’h nous fait ainsi pénétrer, comme le font les peintres et poètes d’Extrême-Orient, dans une nature « où la rumeur régulière de l’océan / parvient jusqu’au cœur du marais ». Il le fait aussi en passant en revue, à la manière des haijin japonais, les quatre saisons au marais. Et l’auteur commence par l’hiver, une saison qu’il chérit pour son ambiance feutrée et dont il salue, parcourant le marais, « la riche lumière / fraîche et acidulée ».
Répertoire des solitudes, quatre saisons au marais, Jean Luc Le Cléac’h, Éditions du Passavant, 2023, 66 pages, 16 euros. À noter qu’un livre d’artiste, sous le titre Marais, a été conçu par le peintre Michel Remaud à partir d’extraits de ces poèmes.
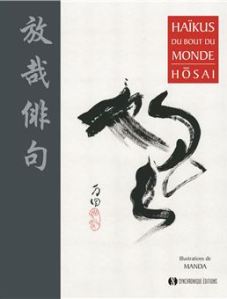 |
Hosai, |
| Haikus du bout du monde |
|---|
Quand on parle de haïkus, des noms reviennent invariablement à l’esprit : Bashô, Buson, Issa, Shîki… Ce sont les grands maîtres du genre. Mais on cite moins Osaki Hosai (1885-1926), auteur de l’ère Meiji qui gagnerait à être mieux connu en Occident. Ses Haïkus du bout du monde, écrits à la fin de sa vie, évoquent des instants vécus sur l’île de Sôdoshima où il s’était retiré pour vivre en ermite.
La vie de Hosai n’a pas été un long fleuve tranquille. Attiré par la poésie dès ses 18 ans, il végétait dans une compagnie d’assurances. Sa vie privée était chaotique, au diapason de sa vie professionnelle. Après avoir connu des amours malheureux, il s’était adonné au saké et avait rompu ce cycle infernal en menant une vie d’errance de temple en temple comme moine mendiant laïc, pour finalement s’installer dans un ermitage. On est le 12 août 1925. Il débarque sur l’île de Sôdoshima (dans la mer intérieure du Japon, une île aujourd’hui bien connue des touristes) grâce à un comité de soutien fondé par un ami. Il s’installe dans un ermitage privé appartenant au temple Saîko-Ji.
Hosai livre d’abord ses impressions sur sa vie d’ermite dans un texte en prose intitulé « Notes de Sôdoshima ». Il y parle de ses menues occupations quotidiennes, de la mer qu’il peut contempler depuis son ermitage, Il parle aussi beaucoup du vent qui souffle dans la région. « Vivant dans un nid, je connais les vents, vivant dans une tanière, je connais les pluies ». Il nous parle des insectes qui font grand bruit autour de lui par les grosses chaleurs, il parle des pierres et des cailloux, dont il dit qu’ils « sont vivants, assurément vibrants ». Hosai contemple et vit l’instant avec plénitude.
Son ermitage, écrit-il, « est situé sur un petit mont complètement à l’extrémité de la ville. Son implantation jouxte le grand pin solitaire exposé, à angle droit, aux vents de la mer » Hosai est à l’écoute de la nature qui l’entoure. Il s’y immerge dans la longue tradition littéraire japonaise ou chinoise. C’est ce que révèlent avec force ses haïkus d’une « nue simplicité » comme le dit la peintre et calligraphe Manda, illustratrice et traductrice des textes de Hosai. « Les chrysanthèmes sont fanés / on voit un bout de mer », écrit le poète japonais dont les haîkus sont écrits sur 1, 2 ou 3 lignes. Hosai faisait en effet partie de ces haijin adeptes du haïku libre, s’affranchissant volontiers de la métrique ou du mot de saison obligatoire. « Seul le bruit du vent / je puise de l’eau » (…) « Bruit connu / sur le tatami / les pattes d’un oiseau » (…) « Point du jour / Dans la brume un cochon / Un homme dans son sillage »
Son « statut » d’ermite ne l’empêche pas de se mêler au monde et de poser un regard empathique sur les gens qu’il côtoie. On retrouve chez lui cette forme de compassion qui caractérise de nombreux haïkus d’Issa. « Réprimandé / l’enfant en pleurs pleure de plus belles », écrit Hosai. « Il est aveugle / l’homme qui s’agrippe à mon épaule ». Ou encore ceci : « À un enfant un peu souffrant / j’offre un poisson rouge » (…) « Plus ou moins rétabli / le malade arrange les fleurs »... Cette « nue simplicité » que soulignait à juste titre la peintre Manda mérite toute notre attention, sans compter qu’on a entre les mains un petit livre soigneusement élaboré. À emporter dans son sac pour le savourer dans la nature.
Haïkus du bout du monde, Hosai, Synchronique éditions, 2023, 185 pages, 14 euros
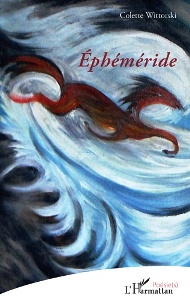 |
Colette Wittorski, |
| Éphéméride |
|---|
Elle vit aujourd’hui en Ephad dans le centre-Bretagne et publie un recueil sous le titre Éphéméride. Colette Wittorski (96 ans) parle de son grand âge, de tout ce qui l’anime ou l’agite, en une série de poèmes courts écrits au cours des trois dernières années.
Dans un précédent livre, L’immensité des liens (L’Harmattan, 2020) Colette Wittorski parlait déjà du « couteau des heures » qui « accomplit son office ». Mais, en dépit de tout, elle persistait à habiter la vie intensément (« Si bref est l’instant, hâte-toi ») et pouvait même affirmer que « décliner n’est pas mourir ». Trois ans après, on retrouve cette tonalité dans les mots d’une « vieille femme qui ne veut pas mourir » et se dit, pourtant, « réduite à l’inventaire de l’instant ». Lucide de bout en bout, elle fait aussi ce terrible aveu : « Je suis une plante en pot / restreinte / j’ai besoin d’être arrosée ». Mais avec un brin de malice, elle ajoute : « Je choisis mes jardiniers ». On saluera cette lucidité et cette capacité de prise de distance avec l’état de vieillesse qui est le sien.
Colette Wittorski n’est pas dupe. Il y a « la grande paix des bruits » qu’elle n’entend plus et cette solitude qui fait d’elle une « guetteuse de riens ». Évoquant son « âme encapuchonnée » et « le bois vermoulu » de sa mémoire, elle nous offre, dans le grand âge, des petites pépites poétiques arrachées à la chair de sa vie, tout en continuant à entretenir une profonde complicité avec la nature. Elle salue le vieil arbre qui lui offre ses pommes et la voilà « penchée pour les ramasser ». D’autres arbres, entrevus sur le talus, elle en parle ailleurs comme des « danseurs bien accordés » qui « se tiennent par les branches ».
Au cœur de ce « bord à bord mouvant », dans cette vieillesse qu’elle assume, demeure, indestructible, le sentiment fugitif d’exister encore, malgré tout, pleinement. « Du silence et de la solitude / parfois surgit la joie // une source entre deux pierres / dont soudain j’entends la voix ». Sa capacité d’émerveillement demeure intacte. « Splendeur ! / la lande est tachée par le sang des bruyères / criant leur déchirure ». Quant à l’au-delà, elle pose la question du droit d’accès. « Serons-nous dans l’autre monde / des émigrés de la terre / dont les anges et les déjà morts se méfient / comme nous le faisons avec ceux d’ici ». Manière aussi, pour elle, de reprendre les mots de Léo Ferré : « Poètes, vos papiers ».
TÉphéméride, Colette Wittorski, L’Harmattan, 78 pages, 12 euros.
 |
Hélène Dorion, |
| Mes forêts |
|---|
Hélène Dorion est née en 1958 à Québec. Après des études de philosophie, elle commence à écrire des poèmes qui paraîtront d’abord en revues. Elle n’a que 25 ans quand est publié son premier livre de poésie, L’intervalle prolongé, suivi de La chute requise. En 2002, une anthologie personnelle de ses poèmes paraît sous le titre D’argile et de souffle. Les deux décennies suivantes confirmeront son importance dans le paysage littéraire francophone, au point de devenir aujourd’hui une poète mise au programme du Bac 2024 en France avec son recueil Mes forêts.
« Mes forêts / quand je m’y promène / c’est pour prendre le large vers moi-même ». On ne doit pas s’étonner qu’une poète québécoise puisse faire de la forêt – si abondante et si menacée sans son pays – le véritable leitmotiv d’un livre. Les forêts de Hélène Dorion ont une âme. Elles sont « des bêtes qui attendent la nuit / pour lécher le sang de leurs rêves ». Elles sont « des greniers peuplés de fantômes ». Elles sont « un champ silencieux de naissances et de morts ». Hélène Dorion n’est pas là pour nous faire un inventaire poétique des forêts qu’elle a sous les yeux. Tout juste évoque-t-elle, subrepticement, l’emblématique érable.
Si la poète québécoise nous parle de ses forêts, c’est pour mieux nous parler de notre époque. Car, dit-elle, « il fait un temps de glace et de rêves qui fondent », « il fait un temps de foudre et de lambeaux / d’arbres abattus ». Prémonitoires, ces vers où elle évoque les incendies (si l’on songe à ceux qui ravagent aujourd’hui son pays). « Le feu / qu’on entend venir / on dirait une bête / prête à tout dévorer ». Hélène Dorion, visionnaire, nous parle de « l’onde du chaos » (et l’on songe au livre Le chaos reste confiant de la poète bretonne Ève Lerner, publié chez Diabase). Car voici, nous dit la poète québécoise, « le jardin où périt un monde / où l’on voudrait vivre ».
Peut-on alors parler d’un manifeste poétique écologique à propos de ce livre ? Sans doute un peu. On y trouve manifestement, sous la force su symbole ou de la métaphore, un appel à la vigilance. Les jeunes générations, celles qui se disent sensibilisés aux périls menaçant la planète, y trouveront du grain à moudre. Mais ces même jeunes trouveront aussi dans les poèmes de Hélène Dorion une critique en règle de certaines formes de consommation contemporaines dont ils sont férus. Car c’est fondamentalement l’appel à un retour au réel qui irrigue son recueil. « Mes forêts sont chemins de chair et marées de l’esprit / un verbe qui se conjugue lentement / loin du facebookinstagramtwitter ». Ailleurs, elle écrit : « Il fait rage virale / sur nos écrans / qui jamais ne dorment ». Élargissant la focale, elles pointe du doigt « pixels et algorithmes » et tous les sigles de notre civilisation branchée : fmi, pib, arn… « L’écran s’est verrouillé / le champ d’étoiles est devenu noir (…) Il fait un temps d’insectes affairés ».
Un monde nouveau, qui n’a pas ses faveurs, émerge donc avec fracas. Mais il ne s’agit pas pour autant, la concernant, de verser dans la nostalgie. Au cœur de ce chambardement en cours, elle nous dit dans un lumineux entretien publié à la fin du recueil que « Écrire de la poésie, c’est habiter cet espace de la perte, creuser dans l’ombre pour en extraire quelque chose de lumineux ».
Mes forêts, Hélène Dorion, éditions Bruno Doucey, 2023, 156 pages, 5,90 euros
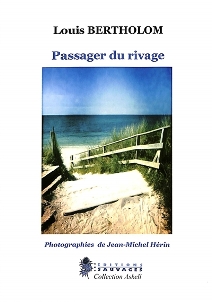 |
Louis Bertholom, |
| Passager du rivage |
|---|
Être né quelque part. Louis Bertholom ne manque pas de nous rappeler, à travers ses différents livres, son profond attachement au pays fouesnantais où il a vu le jour le 24 août 1955, plus précisément du côté de la pointe de Mousterlin. Après nous avoir parlé dans d’autres ouvrages du lieu-dit familial de Cleut Rouz, voici qu’il s’attache à nous parler de la plage et du marais de Kerler. Son récit, qui mélange prose et poésie, est à la fois un journal intime et un bel exercice de Nature writing dans la tradition des plus grands auteurs de ce genre littéraire.
« Kerler me cache ou me révèle ses mythes au gré de mes humeurs et des siennes », confie Louis Bertholom. Kerler, ce sont trois paysages qui s’additionnent : une très longue plage, un cordon dunaire, une zone marécageuse que la mer gagne à marée haute. « C’est ici que je perdure », affirme le poète breton, reprenant ici les mots d’un poème de Xavier Grall. « Mon ADN contient certainement une partie de l’âme de ces lieux ». Et Bertholom de nous embarquer dans ces « lieux amniotiques » de Kerler, dans ses « paysages sensoriels », mais il demeure, de bout en bout, « passager du rivage » car l’homme n’a pas le pied marin. Il se contente – et celui lui agrée largement – de baignades ou de longues marches pour satisfaire un « besoin irrépressible » de recueillement devant la grande bleue. Parfois il se contente de « humer les odeurs de goémons » ou d’inventorier sur la grève ces « idéogrammes / d’algues sèches / traces diverses » que la mer absorbe « deux pages par jour / à l’infini ». Marcher, donc, jusqu’au point d’entrée d’une portion de plage naturiste (ne sommes-nous pas, ici, vraiment loin de tout ?). L’occasion pour le poète de trousser quelques haïkus malicieux sur les occupants des lieux. « Cul nu / dans l’eau / à faire des bulles » (…) « Cul nu /deux figues sèches / au soleil ».
Le vrai morceau de bravoure de son livre est son approche d’entomologiste du marais de Kerler. Oiseau, batraciens, mammifères rongeurs, plantes et fleurs diverses : ce monde grouillant n’échappe pas à on expertise. Il fait corps avec ce milieu naturel, épouse ses fragrances, au point qu’il devienne pour lui « le meilleur remède contre l’ennui et la mélancolie » et d’engendrer chez lui un « genre d’autohypnose ». Louis Bertholom le dit avec ce vocabulaire fleuri (et parfois déroutant) qui le caractérise quand il octroie des sentiments à la nature. Il en est ainsi de ces « souches convulsives » ou de cette « lagune perfide ».
« Kerler est mon bureau solaire », affirme l’auteur. « Ma page blanche ». Le disant, il se rattache à ces écrivains du « dehors profond » qu’il admire, de Jack Kerouac à Jim Harrison en passant par Kenneth White. La géopoétique de Berholom lui fait envisager de se fondre pour l’éternité dans ce paysage. « C’est ici / que j’aimerais rendre / mon dernier souffle / à celui du vent / qui l’emportera / vers l’île aux narcisses blancs ». Allusion aux Glénan, îlots semés sur cette ligne d’horizon qu’il scrute avec passion. Plus loin, il insiste : « Je voudrais m’envoler d’une vision ultime / Nu, abandonné comme une algue à la dérive / Sur la plage à Kerler par une nuit sans frime / Parmi les gravelots sautant sur la déclive ». Rimes riches pour un envolée qui l’est tout autant. Car ce « passager du rivage » qu’est Louis Bertholom nous dit d’abord, dans ce livre très personnel et touchant, qu’il est avant tout un passager sur terre.
Passager du rivage, Louis Bertholom, photographies de Jean-Michel Hérin, Les Éditions Sauvages, collection Askell, 147 pages, 16 euros.
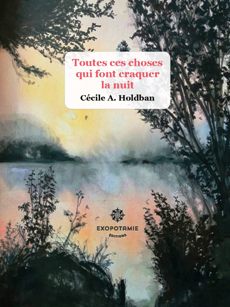 |
Cécile A.Holdban, |
| Toutes ces choses qui font craquer la nuit |
|---|
L’art du bref. Cécile A.Holdban nous le démontre à nouveau en publiant pas moins de 208 haïkus et tercets qu’elle accompagne de ses propres peintures. L’artiste et poète fait état, dans ce nouveau livre, du fruit de ses travaux lors d’une résidence littéraire et artistique en Ardèche.
Cécile A.Holdban a plusieurs cordes à son arc. Poète, peintre, traductrice (hongrois, anglais…), elle « écripeint », comme elle le dit elle-même, dans des livres ou des revues. À propos d’un de ses premiers recueils (Un nid dans les ronces, La Part Commune), on avait noté la tendresse vigilante qu’elle portait aux paysages et à ceux qu’elle porte en elle.
Nous voici, à nouveau, de plain-pied dans cette approche sensorielle du monde. Cécile A. Holdban se coltine au réel avec à la fois l’exigence et la simplicité qui sied aux poètes authentiques. Ce réel, c’est d’abord une nature dans laquelle elle plonge sans retenue. Fidèle en cela aux principes fondateurs du haïku, elle touche du doigt le monde qui vit autour d’elle en jetant son dévolu sur tout ce qui bouge au bord du chemin, souvent le plus insignifiant. « Une joie discrète / savoir nommer /les herbes du sentier », écrit-elle. « Jour après jour / je vois s’arrondir / la pomme reinette ».
Attentive à ces instants de déambulation vécus dans la campagne ardéchoise, elle peut aussi écrire : « Depuis le vieux pont / jusqu’à la chèvrerie / la piste des crottes ». Car Cécile A. Holdban n’écrit pas de n’importe où. Son texte porte la marque du terroir qui l’accueille. Voici, sous sa plume, les châtaigniers, les cèpes et les girolles, le chêne vert ou la marjolaine. « Aube violette / trois prunes blettes / sur le chemin ». Et que dire de tous ces oiseaux qui lui tiennent compagnie, qu’elle nomme ou qu’elle peint avec gourmandise. Pic-épeiche, rouge-queue, sittelle, geai, buse : ils traversent ses pages d’un coup d’aile et ses haïkus en gardent la trace. « Le toc-toc du pivert / m’offre les portes / d’un pays d’arbres »
Du haïku on peut même glisser en douceur vers la pensée ou l’aphorisme. « Prendre ce qui vient / laisser le reste au vent / vivre comme un arbre ». Et sans doute penchée sur ces ruisseaux qui irriguent les collines ardéchoises, elle écrit : « Les souvenirs ricochent / plus longuement que les galets », tandis qu’à la fin d’une journée qu’on imagine riche en cueillettes de toutes sortes, elle écrit ces mots à haute valeur émotionnelle : « Dans un bouquet / l’enfance de ma mère / et celle de mes enfants ». De bout en bout, on sent l’artiste-peintre qu’elle est s’efforcer de rester fidèle à ce que ses yeux ont vu. « Chercher longtemps / la nuance exacte / de l’ombre d’un pétale ». Ce souci de la justesse et de l’exactitude qui la caractérise.
Toutes ces choses qui font craquer la nuit, Cécile A. Holdban, Exopotamie Éditions, 105 pages, 17 euros
 |
Gilles Cervera, |
| Les mourettes |
|---|
En publiant Les mourettes, le Rennais Gilles Cervera nous livre un superbe récit où l’on retrouve toutes les qualités de ses deux beaux précédents livres : L’enfant du monde et Deux frères (éditions Vagamundo, 2016, 2017)). Nous voici à nouveau au cœur de sa parentèle bretonne, l’occasion pour lui de portraits bien sentis et, surtout, de nous dire comment l’on peut s’accommoder à la vie qui va, avec ses hauts et ses bas. Ce qui donne une touche universelle à un livre ancré dans l’intime et le particulier, rédigé dans ce style alerte, vibrant, sans fioritures, qui est la marque de l’auteur.
Pour parler de là d’où l’on vient, on peut écrire un livre d’histoire ou d’ethnologie. On peut aussi avoir recours à la poésie à la manière d’Armand Robin évoquant, à la fois en photos et en poèmes, des figures paysannes et des terroirs de son pays natal de Rostrenen (Le cycle du pays natal, éditions La Part Commune, 2010). Gilles Cervera, lui, a recours au récit. Il fait revivre tout un monde avec ses propres mots et aussi, de-ci, de-là, avec les mots (dont beaucoup en langue bretonne) de toutes celles et ceux qu’il évoque dans son livre. À commencer par le mot «mourettes » qui donne le titre à son livre. « Les mourettes, c’est ce que l’enfant dit », parlant des mouettes qui voltigent autour de lui dans cette ville de la côte où il réside avec sa mère (on reconnaît Saint-Brieuc)
Nous voici, à partir de ce mot mourettes, embarqué dans un récit à trois pôles géographiques : la Bretagne intérieure (dans les Côtes d’Armor), Saint-Denis en région parisienne (là où certains ont émigré) et cette ville de bord de mer (qui signe pour d’autres le retour au pays). C’est l’univers dans lequel s’ébrouent tous ces êtres que l’enfant va apprendre à connaître et à aimer. Nommons-les : Pierre et Jeanne, les grands-parents de l’enfant (côté maternel), Colette (une tante), Isabelle (une cousine), les frères et sœurs de Jeanne (Mathurin, Bernadette, Titine), les frères et sœurs de Pierre (Lucien dit Hien, Eugène dit Bedjan, Élise, François, Ida.) Mais la plus importante de tout, c’est celle que tout le monde appelle « la petite », fille de Pierre et de Jeanne, qui deviendra la mère de l’enfant.
De tous ces êtres, l’auteur dit : « Ils sont rois parce qu’ils sont rien ». Oui, parce que son récit, de bout en bout, est là pour les anoblir, pour saluer leurs vies de paysans, d’ouvriers ou de petits fonctionnaires, mais aussi d’anciens combattants ou de jardiniers, pour certains d’entre eux, à l’heure de la retraite. Pas de résignation chez eux, plutôt une forme de sagesse et de lucidité sur notre condition humaine. Elle est commune à tous ces êtres de chair et d’os évoqués dans ce livre. « Les chênes sont de leur ciel commun et les ronces à leur pied un enfer maîtrisé », note l’auteur. Pour Hien, il y a quand même « l’espoir de refaire le monde ». Pour Élise, « l’évidence d’un autre étage, celui du ciel ».
Leur point d’ancrage, c’est le hameau de Keriolet. Épicentre des retrouvailles, espace d’échanges et de rencontres des générations. On y a vécu, on y vit, on y meurt. « Dans ce pays de Keriolet, la mort est une compagnie. On la laisse parler. On la regarde passer au bras des tempêtes ou dans le giron des sources. Parfois on l’attrape ou on se laisse attraper ».
Tous ces êtres côtoyés, scrutés, aimés par l’enfant, deviennent sous la plume de Gilles Cervera des « importants ». Et il s’explique sur ce mot : « L’importance vient de la lumière de leur regard et par ce qu’il y a de grâce lorsqu’ils arpentent un pré (…) Les importants datent de l’arbre. Ils viennent des arbres, de leur temps long ». Et que dire des « importantes » parce que « tout part d’elles », note l’auteur. « L’importante est généreuse. A peu et le donne ». Pour parler des ces « importants » et de ces » importantes », Gilles Cervera a fait œuvre poétique. Le lisant on pense à ce que disait le poète russe Ivan Bounine dans un poème de 1916 : « La poésie n’est pas, n’est certes pas dans ce que le Monde / Nomme poésie. Elle est dans mon héritage. / Plus j’ai de richesse, plus je suis poète ». Foi de mourettes.
Les mourettes, Gilles Cervera, éditions Un Ange Passe, 157 pages, 16 euros. Sur commande aux éditions Un Ange passe, P.Gaucher, 18, rue Jim Sevellec, 35740 Pacé (4 euros de port). En vente dans deux librairies rennaises : L’encre de Bretagne et Planète Io.
 |
Jean Lavoué, |
| Écrits de l’arbre dans le soleil |
|---|
La poésie du breton Jean Lavoué est volontiers placée sous le signe de l’arbre. Auteur et éditeur ne publie-t-il pas des livres à l’enseigne de L’enfance des arbres ? Son nouveau recueil place une nouvelle fois l’arbre au cœur de sa démarche poétique. « Sous l’écorce des arbres / J’entends triompher la sève », écrit-il.
Dans les poèmes de Jean Lavoué, l’arbre est à la fois le signe tangible de nos fragilités (« Chaque arbre qui brûle / Est le témoins blessé / De nos communes fragilités »), le garant de notre enracinement, le symbole de nos surgissements salvateurs. L’arbre, au fond, dit ce que nous sommes ou ce que nous sommes appelés à devenir : des êtres ardents comme l’est l’arbre à la montée de la sève, des êtres capables de renaître sans cesse à l’image des bourgeons qui éclosent. Sève et bourgeons sont les mots qui reviennent d’ailleurs, le plus souvent, sous la plume du poète.
L’arbre, ici, est un symbole. Il n’y a guère, dans ce recueil, d’arbres particuliers si l’on excepte le châtaignier ou le peuplier. « Quand ton âme sera aussi pauvre / Qu’un peuplier se balançant dans la lumière / Alors tu n’auras plus rien à faire / Qu’à être là / Poreux aux murmures du silence ». L’arbre est une leçon de vie. « L’enfance des arbre, / Ce n’est pas seulement se réjouir qu’un arbre soit jeune, / Encore en devenir et plein de promesse, /Mais c’est envisager que chacun d’entre nous / Nous devenions arbres, / Des pousses pleines d’ardeur et de vie / Dans la forêt humaine… ». Voilà qui éclaire au passage, le sens du nom que le poète a attribué à sa maison d’édition. « Devenir un arbre / Enraciné dans sa nuit // Familier / De l’instant, // Ouvrant l’espace / De la clairière ».
Jean Lavoué ponctue son livre, conçu entre 2018 et 2023, de poèmes évoquant des moments douloureux liés à la disparition d’être chers : la mort d’un beau-père qui était « l’ami des arbres », celle du poète Christian Bobin en 2022 et devenu désormais un « jardinier céleste », celle du chanteur Philippe Forcioli qu’il associe à la grande fratrie des « amis poètes trop tôt en allés ». Parlant d’eux il a ces mots : « Vous êtes nos bâtons de marche / Nos vagabonds protecteurs /Nos étoiles annonciatrices de l’aube / Arbres tombés qui nous ouvrez passage ».
Douleur du poète breton mais une douleur aussitôt transfigurée par une « joie rebelle » qui nous fait penser à la Joie errante de Jean Sulivan (Folio, 1988) écrivant : « Il faut porter en soi un soleil ». Comme le fait l’arbre dans la poésie de Jean Lavoué.
Écrits de l’arbre dans le soleil, Jean Lavoué, illustrations de Isabelle Simon, L’Enfance des arbres, 130 pages, 15 euros.
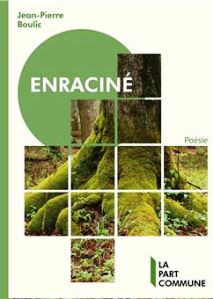 |
Jean-Pierre Boulic, |
| Enraciné |
|---|
Enraciné dans le pays d’Iroise, à la pointe du Finistère. Il n’y a pas de doute là-dessus. Jean-Pierre Boulic nous l’a bien fait mesurer au fil de ses différents livres. Mais l’enracinement dont il est question dans son nouvel opus n’est pas seulement géographique. Il est aussi celui qui témoigne d’un ancrage intérieur, fait d’écoute et d’attention soutenue (notamment aux signes donnés par la nature). Le poète nous le dit en quatre chapitres, comme autant de pièces d’une œuvre musicale.
Les fidèles de l’œuvre de Jean-Pierre Boulic ne seront pas désorientés. Il y a, comme c’est souvent le cas sous sa plume, tous ses points de repères familiers : la dune, la falaise, les chemins, l’estran, les « vents ébouriffés », les oiseaux… Et, nous dit le poète, « ainsi s’esquisse un univers ». Pour en faire état, il recourt ici aux poèmes brefs. Quelques vers seulement. Petits exercices de contemplation et de méditation, graines de sagesse souvent. « Contente-toi de semer tes mots », souligne-t-il.
Il le fait dans une forme de progression « dramatique » en quatre mouvements. Tout commence par l’état de « veille » (chapitre 1) sur une « terre recroquevillée » aux « couleurs meurtries ». C’est l’hiver du monde. « La vie balbutie » et « le vent trébuche sur le dos des falaises ». Les jours eux-mêmes ont « pris des rides » et on s’éveille « les mains vides ». Mais le poète perçoit déjà une lueur. « Le jour est proche / Déjà quelqu’un s’approche ».
Le « matin » (chapitre 2) signe une forme de résurrection. « De sa veille la nuit / Se relève / Et rend grâce ». Un jeune soleil apparaît triomphant, « berger des nuages ». Alors, vite gagner le rivage et guetter « sur l’estran / Au pied de l’océan / Les portes de l’infini ». Ce matin auquel nous convie Jean-Pierre Boulic a des accointances avec celui chanté par le poète suisse Georges Haldas, écrivant que « la douce lumière du matin en dit plus que toutes les philosophies sur les mystères de la vie et l’infinie tendresse de la Source » (Pollen du temps, L’Age d’Homme,1999). Il nous rappelle aussi le matin chanté par Guillevic : « Chaque matin / Est pour l’oiseau / L’anniversaire / De sa naissance » (Possibles futurs, Poésie/Gallimard, 2014). Jean-Pierre Boulic, lui, dit du matin qu’il « n’a rien / Il est tendresse des feuilles / Regard paternel ». Il dit aussi que « La pivoine / Un parfum de vie / Enracine le matin ».
Le surgissement du matin signe « la fête à venir » (chapitre 3). Arrive enfin le moment où « L’océan tricote / Belle chasuble / d’azur profond » et où « L’oiseau effleure de sa clarté / La roche le sable la dune ». Le chant peut donc s’élever pour célébrer « La tendresse du pays / le sublime paysage ». La clarté inondant le monde saisit les hommes. « Et de nos ombres / La lumière s’élève ».
Il reste à traduire ce Magnificat dans un véritable « hymne » (chapitre 4) pour clôturer en apothéose ce recueil. Une vraie tonalité mystique imprègne alors le dernier mouvement de cette pièce poétique en quatre actes. Jean-Pierre Boulic nous parle de « nouvelle genèse » ou « d’instant transfiguré » et de cet « infime instant / Où la création respire ». Appel à « Apprendre le silence / L’oubli de soi ». Cheminant en pays d’Iroise, enraciné et ouvert à la fois, le poète touche du doigt l’univers entier et n’en finit pas, de livre en livre, à se mettre à l’écoute d’une « invisible présence ».
Enraciné, Jean-Pierre Boulic, La Part Commune, 2023, 96 pages, 14 euros.
 |
Pascal Boulanger et Solveig Conrad-Boucher, |
| Ainsi parlait Chateaubriand |
|---|
Ne sait-on pas déjà tout de Chateaubriand ? La publication d’un livre de « dits et maximes de vie », extraits de son œuvre, nous montre peut-être le contraire, révélant la profonde modernité du grand écrivain. Témoin d’un monde en pleine mutation – de la monarchie à la République en passant par l’Empire – Chateaubriand (1768-1848) tient des propos qui valent aussi pour notre époque troublée, à la jointure, elle aussi, de plusieurs mondes.
C’est le miracle de la littérature. Pouvoir lire ou relire des écrivains et se dire qu’à deux siècles de distance, ils peuvent nous aider à comprendre, voire à affronter, des défis contemporains. Celui que Lautréamont appelait le « Mohican mélancolique » fait partie de ces écrivains-là. Chateaubriand avait notamment dévoilé « la répétition mimétique de l’histoire, celle des faits et des foules déchaînées », notent Pascal Boulanger et Solveig Conrad-Boucher dans leur présentation de ces dits et maximes, soulignant combien cette approche aurait pu être signée par René Girard, père de la théorie mimétique, anthropologue de la violence et du religieux. Et que dire aussi de la profonde lucidité de Chateaubriand sur l’origine des guerres et des conflits. « Des nations s’égorgent ordinairement parce qu’un roi s’ennuie, qu’un ambitieux se veut élever, qu’un ministre cherche à supplanter un rival ». Chateaubriand affirmait aussi que « l’anarchie enfante presque toujours le despotisme » et il se désolait d’un monde voulant faire du passé table rase. « Il n’existe plus rien : autorité de l’expérience et de l’âge, naissance ou génie, talent ou vertu, tout est nié ; quelques individus gravissent au sommet des ruines, se proclament géants et roulent en bas pygmées ».
Ces constats accablants sur son époque nous rappellent tant de turpitudes de la nôtre. Chateaubriand ne se faisait guère d’illusion sur la nature humaine. Certaines citations rassemblées dans ce livre nous ramènent volontiers à Montaigne, Joubert ou Chamfort quand Chateaubriand écrit, par exemple, qu’on « aime facilement son ennemi, surtout s’il nous a donné l’occasion de vertu ou de renommée » ou quand il pointe « une idolâtrie redoutable, l’idolâtrie de l’homme envers soi ». Pour autant, Chateaubriand ne niait pas ses propres contradictions en s’affirmant à la fois « Bourboniste par honneur, Royaliste par raison, Républicain par goût ».
L’homme croyait à la beauté car « quiconque est insensible à la beauté pourrait bien méconnaître la vertu ». Spectateur émerveillé de cette beauté dans un monde souvent ensanglanté, il gardait une fidélité sans failles à la « cloche natale » (y compris celle de l’Église). Se revendiquant « enfant de la Bretagne », il pouvait écrire : « Les landes me plaisent, leur fleur d’indigence est la seule qui ne soit pas fanée à ma boutonnière ». Il pouvait aussi rappeler la félicité rattachée au « chant de l’oiseau dans les bois de Combourg ». Élargissant la focale, puisqu’il fut aussi un étonnant voyageur, il s’est fait le chantre de la nature, cette « commune mère » qui « instruit les enfants du monde ». Ne disait-il pas aussi : « Ma vie n’est à l’aise qu’au milieu des nuages et des mers ». Parole de Breton.
Ainsi parlait Chateaubriand, Dits et maximes de vie, présentés par Pascal Boulanger et Solveig Conrad-Boucher, Arfuyen, 170 pages, 14 euros
 |
Jean-Claude Caër, |
| Sur la voie abrupte |
|---|
« L’air se raréfie », nous dit Jean-Claude Caër dans un livre conçu durant le confinement. Quittant Paris, il a trouvé « refuge » dans la maison familiale du Nord-Finistère, à Plounévez-Lochrist. Sur place, il va écrire, marcher, méditer, pour nous livrer aujourd’hui une petite trentaine de textes poétiques, dans un va-et-vient permanent entre l’Extrême-Occident où il séjourne et cet Extrême-Orient qui ne finit pas de le fasciner.
Quand il voyageait au Japon ou en Sibérie En longeant la mer d’Okhotsk (Le Bruit du temps, 2019) Jean-Claude Caër nous parlait volontiers de sa Bretagne natale. Chez une paysanne japonaise penchée sur son lopin de terre, il retrouvait les traits de sa propre mère. Dans un temple bouddhiste, il entendait le son d’une cloche qui lui rappelait un autre son de cloche : celui, matinal, de la chapelle de son lycée. En foulant un rivage, lui revenaient en mémoire les « goémons noirs » de la plage de Keremma où il courait enfant. « Touchant la pointe de l’orient / L’occident me hante », confie-t-il d’ailleurs dans son nouveau livre.
L’inverse est, aussi, tellement vrai. Touchant la pointe de l’occident, l’orient le hante. Installé à la pointe bretonne le temps d’une pandémie, il nous parle volontiers d’Extrême-Orient, citant notamment le Japonais Takuboku Ishikawa. Longeant le rivage, il admire ce rocher familier de Mean Melen qu’il assimile à un « Bouddha géant ». À un autre moment, il pense à ces oies bernaches qui « sont parties vers la péninsule de Taïmyr en Sibérie » après avoir hiberné dans la baie où il marche aujourd’hui. Et quand il écrit « Nous qui foulons l’herbe brillante d’un pas léger et heureux », comment ne pas penser (une nouvelle fois) à ces vers de Kobayashi Issa : « En ce monde / nous marchons sur le toit de l’enfer / et regardons les fleurs ». Car de cet enfer, il en est question quand l’auteur se rend dans la localité voisine de La Martyre où, sur l’ossuaire de l’enclos paroissial, un bandeau sculpté évoque An Infernien, l’Enfer froid des Celtes.
Cette navette entre l’orient et l’occident (avec aussi quelques échappées vers la Russie ou l’Italie) imprègne donc de bout en bout ce recueil. Ce n’est pas seulement, on l’a compris, une question de géographie. C’est avant tout une façon d’appréhender le réel, de saisir l’instant, de s’adonner à la contemplation. « Un nuage noir, immense, sur la baie de Goulven, laisse passer des rayons de gloire », écrit Jean-Claude Caër. « Comme dans des tableaux religieux du XVIIe siècle, des rais de lumière descendent sur nous à travers le nuage sombre. Silhouettes de pèlerins, nos ombres s’allongent, image de nos vies ».
Il y a aussi, à l’occasion de ce retour au pays, une forme de nostalgie qui s’exprime. « Où sont les oiseaux de mon enfance ? Les merles, les grives, les roitelets… ». Mais le poète se rassure, demeurent les oiseaux de mer : goélands, aigrettes, gravelots à collier interrompu… Demeurent aussi les terres inondées, les mousses, les oyats, les sables blancs, les champs de choux-fleurs, les tracteurs qui ronronnent, le son des cloches à Plounévez-Lochrist un dimanche de Pâques. Mais le temps fait son œuvre : la dune recule, elle est devenue « une falaise de sable blanc ».
Jean-Claude Caër peut donc écrire : « Sur la voie abrupte, le monde ne reviendra pas. Il s’éloigne. L’air se raréfie, et bientôt tu étouffes, tu cries ». Ce cri est aussi celui d’un homme qui a perdu sa mère (il en parle à plusieurs reprises dans son livre). « Ma mère me manque / Son enveloppe charnelle / Sous l’œil de ma mère le monde avait des couleurs plus vives ». Il se souvient de la vieille femme qu’elle fut : « Sa voix est cassée, éraillée / N’est pas la voix de ma mère jeune ». Son amour filial explose dans la chambre mortuaire. « Seulement mettre son front dans la paume de ma main ».
Même s’il y a les larmes et même trop plein de larmes, comme il le dit lui-même, Jean-Claude Caër persiste à emprunter, avec une forme de légèreté, sa propre « sente étroite du bout du monde » (Bashô). Le lisant, on pense aussi à ce haïku de Sôseki : « Sans savoir pourquoi / j’aime ce monde / où nous venons pour mourir ».
Sur la voie abrupte, Jean-Claude Caër, Le Bruit du temps, 2023, 72 pages, 17 euros
 |
Jean-Luc Le Cléac’h, |
| Rêver au jardin |
|---|
Nomade mais aussi sédentaire. Attiré par les lointains mais aussi par le plus proche : le Breton Jean-Luc Le Cléac’h (il vit en pays bigouden) nous entraîne aujourd’hui au jardin pour partager avec lui des instants de rêverie que l’on imagine volontiers bien féconds.
Il parcourt l’Europe dont il nous ramène des visions fulgurantes (Fragments d’Europe, La Part Commune, 2019). Mais il sait aussi, chez le même éditeur, s’émerveiller au bord des plus humbles ruisseaux (L’élégance des eaux vives, 2016), arpenter avec allégresse les rivages de Bretagne ou ses chemins creux (Poétique de la marche, 2017). Même les mois noirs ont le don de lui plaire (L’hiver, saison de l’esprit, 2021). D’une soirée d’hiver, il dit ainsi qu’elle est « un espace limité qui contient le monde ». Il suffit souvent, à ses yeux, d’un feu de cheminée, d’une tasse de thé et, surtout, d’un bon livre.
S’il est un autre espace limité qui contient aussi le monde, selon Jean-Luc Le Cléach, c’est bien le jardin. « Le jardin fait naître, dans un espace fini, des rêves infinis ». C’est carrément, ajoute-t-il, un « concentré d’univers ». Il suffit d’avoir sous les yeux un hortensia originaire d’Asie ou d’Amérique, le callistémon de Nouvelle-Zélande, l’échium ou la vipérine rouge qui provient des Canaries. Ajoutez à cela que vivre au jardin, « c’est s’immerger dans un océan de senteurs » et qu’on peut « y ferrer une pensée, une idée, éprouver une sensation inconnue ». Au bout du compte, affirme-t-il, « le jardin s’ouvre sur l’univers, nous ouvre à l’idée d’universalité ».
On l’a compris. Jean-Luc Le Cléac’h n’est pas le jardinier du dimanche (comme on le dirait d’un peintre) mais celui d’un quotidien vécu au jardin en plénitude. Chez le jardinier philosophe qui est aussi poète, on sème des graines de sagesse. Pas d’allées tirées au cordeau. Pas de planches claires et nettes de légumes de saison. Non, plutôt le sentiment d’un aimable désordre, d’un patchwork de sensations neuves recueillies en faisant un simple pas de côté.
L’écriture de ce livre en témoigne. On passe volontiers du coq à l’âne. « Je me dédouane, se rassure l’auteur, en songeant qu’au jardin aussi, il arrive que les rosiers ou les plants de zinias côtoient les radis et les tomates, qu’un hydrangea avoisine les courges ». L’auteur va ainsi, par sauts de puces successifs (ou plutôt d’abeilles ou d’insectes), nous parler du « toucher » stimulé au jardin, du silence qui n’y est jamais absolu, du plaisir des dernières journées d’automne, de la sieste bienfaisante dont on sort « à mi-chemin entre réalité et rêveries ». Et que dire de la lecture au jardin dont le meilleur moment est celui où « nous l’interrompons, levant les yeux, fixant notre regard sur rien de particulier à vrai dire, un simple support car c’est vers notre intériorité, aiguillonnée par ce que nous venons de lire, que notre attention est dirigée ». Côté lecture, Jean-Luc Le Cléac’h a d’ailleurs de belles références : Bachelard, Hopkins, Grosjean, Saint-John Perse, Bergounioux, Erri de Luca… On l’imagine parcourant leurs livres puis levant les yeux, méditatif, vers son figuier ou son ginkgo biloba.
Cet idéal de jardin « engendre une forme raffinée d’apaisement », estime l’auteur. C’est un « support à la recherche de la beauté », entretenant un « sentiment de bien-être, de sérénité ». On le suit volontiers quand il dit ne pas croire à l’existence d’un jardin idéal mais aimer « l’idée d’un idéal de jardin ».
Rêver au jardin, Jean-Luc Le Cléac’h, La Part Commune, 2023, 135 pages, 13 euros
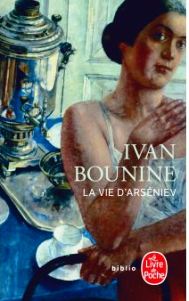 |
Ivan Bounine, |
| La vie d’Arséniev |
|---|
Écrivain et poète, le Russe Ivan Bounine (1870-1953), mort en exil en France il y a 70 ans, est à redécouvrir, notamment à l’aune des événements actuels en Ukraine. Né à Voronej (là où Ossip Mandelstam écrira certains de ses poèmes), au cœur de la steppe russe, à 400 km au sud de Moscou, Ivan Bounine a beaucoup pérégriné en Ukraine, un pays qualifié à son époque de « Petite-Russie » ou de « Russie kiévienne ». Il en parle notamment dans La vie d’Arseniev, un livre autobiographique.
Ivan Bounine est un immense auteur qui n’a pas acquis la notoriété des Tolstoï, Dostoïevski, Tchékhov, Tourgueniev, Pouchkine, Gorki ou Gogol… Il est pourtant le premier Russe à avoir obtenu le prix Nobel de littérature. C’était il y a 90 ans, le 17 novembre 1933. Son œuvre est profondément marquée par ses origines, par cette enfance et cette jeunesse passées dans une famille de hobereaux désargentés au cœur de la steppe russe. « Des champs déserts, un manoir solitaire au milieu… L’hiver, un océan de neige à l’infini, l’été, un océan de blé, d’herbes, de fleurs… Et le perpétuel silence de ces champs, leur étrange mutisme ». C’est en ces termes qu’il le raconte dans La vie d’Arséniev. Dans un poème de 1910, il écrivait pourtant : « La steppe chante. Comme un épi gonflé / L’âme est pleine. La terre appelle : hâtez-vous / D’aimer, de créer, de vous saouler de rêve »
« Je ne connais pas d’œuvres où le monde extérieur soit en contact plus étroit avec l’autre, le monde intime », écrira André Gide dans une lettre qu’il lui adresse pour célébrer son 80e anniversaire. L’écrivain russe réside en France depuis son exil de Russie en 1920 (il vit à Grasse et mourra à Paris le 8 novembre 1953) et c’est en France qu’il écrira son roman autobiographique. « L’art de Bounine, note Jacques Catteau dans la préface de ce livre publié en 2008 dans Le Livre de Poche, est avant tout une poétique de l’existence, centrée sur le moi et le monde, le moi au monde, le monde pour moi ». L’auteur russe écrira d’ailleurs lui-même, dans un poème de 1916 : « La poésie n’est pas, n’est certes pas dans ce que le monde / Nomme poésie. Elle est dans mon héritage. / Plus j’ai de richesse, plus je suis poète // Je me dis, ayant perçu la trace obscure / De ce que ressentit mon aïeul dans son enfance d’autres âges : /Il n’y pas dans le monde différentes âmes et le temps non plus n’est pas » (Mon cœur pris par le tombe, Orphée/La Différence,1992).
Quand Bounine nous parle de l’Ukraine, c’est pour nous dire son émerveillement devant un pays du sud. « J’ai toujours été par nature spécialement sensible à la lumière et à l’air, et j’en ressens les moindres variations. Dès mon arrivée à Kharkov, je fus frappé par la douceur de l’air et par une lumière plus exubérante que chez nous ». Sa vie de poète et d’écrivain en devenir mais aussi sa quête amoureuse le mènent dans des lieux que la triste actualité contemporaine nous a rendus familiers (Nikolaïev, Kherson, Sébastopol et les rives du Dniepr…). Il est sous le charme (« Ce merveilleux pays qui s’ouvre à moi »), il parle d’une « vaste et riche région avec des champs et des steppes magnifiques, des hameaux et villages pimpants », d’un « peuple vigoureux et sensible, beau, attentif aux moindres détails de l’existence, héritier des vrais Slaves, ceux du Danube, des Carpates ». Il fait l’éloge du poète ukrainien Taras Chevtchenko (1814-1861), « un poète qui a du génie », écrit-il, et qui fut, on le sait, à l’origine d’un mouvement autonomiste ukrainien et fait figure aujourd’hui figure de poète national. Bounine évoque même la figure de l’écrivain et homme politique Dragomanov (1841-1895), défenseur du nationalisme ukrainien, dont il a lu les Chants petits-russiens.
Ce que dit Ivan Bounine de cette Petite-Russie est très éloquent et nous fait mesurer la perception qu’un Russe pouvait avoir de l’actuelle Ukraine à la charnière du 19e et du 20e siècle. « Ce qu’il me plaît de savoir, écrit Bounine à propos de cette Petite-Russie, c’est de savoir qu’elle n’a plus d’histoire, son aventure historique est achevée depuis longtemps et pour toujours. Elle n’a plus qu’un passé, qu’elle raconte avec des chansons et des légendes, elle a atteint une espèce d’intemporalité. C’est cela qui me ravit le plus » (L’écrivain fait ici référence au passage de l’Ukraine sous contrôle moscovite en 1654). Mais l’histoire, on le sait, le démentira.
Ces appréciations ne doivent pas nous empêcher de lire ses livres avec intérêt et de s’émerveiller de ses talents d’écriture. Et aussi de mesurer son mode d’appréhension picturale du réel par les mots. Alors qu’il travaille dans une revue littéraire à Orel, Bounine raconte ainsi ses promenades nocturnes. « Je voyais de larges rues recouvertes de neige, des masures noires sur fond de neige, et dans l’une d’elles une petite lumière rouge… Oui, me disais-je avec transport, oui, c’est ainsi qu’il faut écrire, juste trois touches : neige, masures, et lumière rouge dans l’une d’elles ». L’art d’être un artiste et un poète, ce qu’il était.
À lire :
La vie d’Arséniev, Ivan Bounine, roman, Le Livre de poche, 540 pages
Mon cœur pris par la tombe, Ivan Bounine, poèmes, avant-propos de Vladimir Nabokov, bilingue russe-français, Orphée/La Différence, 120 pages.
Les pommes Antonov, Ivan Bounine, nouvelles, Éditions des Syrtes, 160 pages.
 |
Gérard Bessière, |
| De lumière et de vent |
|---|
Des poèmes sur le seuil. Celui du grand passage entrevu par Gérard Bessière aujourd’hui âgé de 95 ans. « Voici demain qui vient / dans l’ombre du mystère », nous dit, depuis sa retraite de Luzech au cœur du Quercy, le poète, ancien journaliste, exégète et prêtre dans les marges. Un émouvant recueil où « l’ombre de la nuit » côtoie « l’obstiné goût de vivre ».
Dans un précédent recueil, Au seuil du silence (Diabase, 2019), il se disait déjà saisi de vertige au cœur du grand âge. Mais s’il résistait à la peur c’était grâce au silence qui montait en lui « comme la crue de la rivière en mars ». Il pouvait donc rester paisible et disponible, accueillant l’inconnu, cultivant « le goût du beau et tant d’autres conduites ou réalisations qui nous élèvent ». Le voici, quatre ans plus tard, après avoir publié Le titre brisé (Diabase, 2020) et L’intime lumière (Diabase, 2021), plus que jamais au seuil du silence.
Pour dire ce qui l’anime aujourd’hui, Gérard Bessière a opté pour un versification « à l’ancienne » : des strophes de quatre vers sagement alignés sur la page, six syllabes par vers. Mais l’important n’est pas là car domine, de bout en bout, ce tremblement qui signe la véritable parole poétique. Tremblement d’émotion, mais aussi une forme de désarroi quand l’homme est gagné par « le vertige du vide ». Alors il appelle au secours « les visages aimés » ou les paysages de l’enfance. Fleurs, herbes, papillons, merles, écureuils et nuages investissent ses poèmes. Dire le beau de ce monde que l’on s’apprête à quitter. Dans L’intime lumière Gérard Bessière montrait déjà sa volonté de continuer à avancer dans l’inconnu à l’exemple du bourgeon qui « ne sait pas / que sa mort dans le noir / fera naître une rose / au soleil de demain ».
Mais aujourd’hui le monde s’est rétréci. Il a quitté sa maison « pour une petite chambre » où la vie va « finir en silence ». Cette fin de vie, nous raconte-t-il, est peuplée « de rêves et de cauchemars » (…) / Pourquoi faut-il souffrir / Dans l’attente inquiète / De l’instant de mourir ? ». Il s’interroge : « Les planches du cercueil /Où je reposerai / Sont-elles déjà sèches ? ».
Mais Gérard Bessière, homme de foi, voit au-delà de sa mort corporelle. « L’infini nous visite », écrit-il. « L’horizon est en nous ». Il aspire à retrouver « D’innombrables aïeux / Eblouis de tendresse ». Et fait un vœu : « À l’heure de mourir / J’aimerais regarder // Un arbre qui frissonne / À la brise du soir ».
De lumière et de vent, Gérard Bessière, Diabase, 2023, 67 pages, 13 euros.
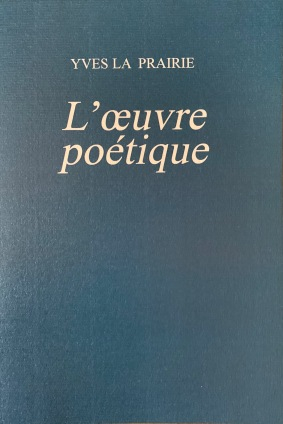 |
Yves La Prairie, |
| L’œuvre poétique |
|---|
Lire ou relire Yves La Prairie. Officier de marine et poète, mais aussi fondateur du CNEXO à Brest (Centre national pour l’exploitation des océans) devenu l’IFREMER, il aurait eu 100 aujourd’hui. Ses enfants rééditent à cette occasion, à Brest, son œuvre poétique constituée de trois livres publiés entre 1983 et 1995.
Yves La Prairie s’est surtout fait un nom dans le domaine maritime et scientifique. Né d’un père brestois et d’une mère bordelaise, il était profondément attaché à ces deux racines familiales. Mais il avait aussi attiré l’attention sur lui par ses talents d’écriture notamment révélés par son roman Comme la vague offerte, couronné en 1980 par l’Académie française. Il avait aussi manifesté son intérêt pour la poésie en publiant une anthologie sur La mer et ses poètes en 1982 aux éditions du Cherche-Midi. Poète lui-même, il avait été reconnu à sa juste valeur par les auteurs qu’il a pu côtoyer dans les dernières années du siècle dernier, à l’image de Henri Queffélec, Pierre- Jakès Hélias, Angèle Vannier, Gérard Le Gouic…
« L’homme était élégant et réservé », souligne l’autrice Nicole Laurent-Catrice dans la courte postface de la réédition de son œuvre poétique. Ceci explique-t-il ce relatif silence qui a longtemps entouré l’œuvre poétique de Yves la Prairie ? On peut le dire mais ce déficit évident de notoriété ne l’avait pas empêché d’être nommé membre d’honneur de la Maison des écrivains de Saint-Malo. Juste reconnaissance par ses pairs d’un auteur de trois livres de poésie : Les margelles du temps et Les solitudes habitées (publiés en 1983 et 1986 aux éditions Saint-Germain-Des-Prés) ainsi que Des lambeaux d’éternité (éditions Le miroir poétique, en 1995). Voici donc ces trois ouvrages réunis aujourd’hui dans un seul et même livre et publiés à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance.
De quoi nous parle Yves La Prairie ? Des thèmes éternels : la vie, la mort, l’amour. Mais aussi de la foi chrétienne qui l’anime. Il le fait dans une poésie très musicale, rythmée, volontiers qualifiée de classique dans son expression, jusqu’à l’usage des rimes riches : « Tu as cambriolé mon cœur / Pour y prendre toute la place ; /Des fantômes dont j’avais peur / Tu as su effacer la trace », écrit-il s’adressant à Chantal, son épouse artiste. Mais on ne vit pas impunément à la pointe du Finistère. Sa poésie est forcément imprégnée des lieux qu’il fréquente. « Abers / Exacts étuis de sable et de vase mêlés / Que la marée montante / lèche, pénètre, fouaille et engrosse ».
La mer, forcément, tient dans ses pages une place éminente à l’image de ces Laudes marines où, dans un bel exercice de métonymie, il chante cette « mer de nos ressacs et de nos houles, / De nos fureurs / Qui roulent / Par toutes les pores de nos peaux ». Familier de l’Île de Batz, où il retrouvait son ami Anthony L’héritier, il dit qu’elle « a ses douceurs / comme elle a ses rudesses / des abris sablonneux, / mais de sournois courants ». Préfaçant en 1983 son premier recueil Les margelles du temps, le poète Jean Orizet se plaisait aussi à souligner que Yves La Prairie était sans doute le premier poète dans l’histoire à évoquer des « plongées aux abysses » et à nous faire entrevoir « la face cachée de la mer ». Ce qu’exprime en effet Yves La Prairie dans une série de poèmes sous le titre Abyssales en parlant de cette « odyssée verticale » à « moins deux mille huit cent mètres » dans « la mer féconde et glauque / au ventre pélagique ».
Son second recueil, notera Jean Orizet, est plutôt construit autour du thème de la solitude. À la fois celle des hommes et celle des contrées que traverse le voyageur. « Les espoirs incisés / les sabliers brisés / Il nous faut tout apprendre ». Le poète brestois a toujours inscrit sa démarche poétique, comme il le dit lui-même dans « une approche non seulement de l’infini et du démesuré, mais de l’éternel ». Il le fait en rêvant aux galaxies ou en contemplant la mer, en comptant les étoiles ou les vagues. C’est cette « quête de lumière », souligne aujourd’hui son fils Patrick, qui signe véritablement l’œuvre poétique de son père. Yves La Prairie s’est éteint en 2015. « Chut ! / Voici l’heure où l’amour / déshabille les mots… », écrivait-il dans son dernier livre.
L’œuvre poétique, Yves La Prairie, 312 pages, 12 euros (et 7 euros de port pour une commande du livre à Patrick La Prairie, 23 rue Jean Macé, 29200 Brest)
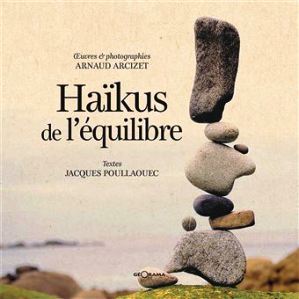 |
Arnaud Arcizet et Jacques Poullaouec, |
| Haïkus de l’équilibre |
|---|
Une rencontre. Celle d’un adepte du land art et d’un auteur de haïkus, par ailleurs artiste lui-même. Le mot « équilibre » les réunit. Pour le premier (Arnaud Arcizet), il s’agit de « superposer naturellement des pierres en jouant avec la gravité », comme il le dit lui-même. Pour le second (Jacques Poullaouec), de peser ses mots « pour faire entrer tout un univers dans le microcosme du poème ». À découvrir.
Arnaud Arcizet et Jacques Poullaouec avaient toutes les raisons de se rencontrer un jour. D’un côté le poseur de pierres, de l’autre le poseur de mots. L’un vit sur la côte nord du Finistère, le second n’y vit plus mais y est né (précisément à Lesneven, « plaque tournante de la Côte des légendes », comme le disait la flamme postale d’autrefois). On retrouve chez le land artist le grain de cette pierre qui signe la rudesse de cette portion de littoral breton. Le haïjin Poullaouec ne pouvait pas ne pas y être sensible lui qui, gamin, a tellement galopé sur ces rochers rugueux. Et pour les réunir encore mieux, il fallait un éditeur au diapason. Ce qui est le cas puisque Géorama est implanté sur la côte découpée – et si envoûtante – de Porspoder. Un pays où « où tout peut basculer / le ciel dans la mer / le passé dans le présent » (Poullaouec)
Mais il y a, ici, plus qu’une question d’espace ou de territoire. Arcizet et Poullaouec partagent une même sensibilité à la pensée extrême-orientale, celle qui induit patience, lenteur, contemplation, détachement... Le rock balancing ou stone balancing que pratique Arnaud Arcizet est, explique-t-il, « une pratique de méditation par les pierres. C’est également un art qui consiste à superposer naturellement des pierres en jouant avec la gravité, le contrepoids et les points de pression ». Le résultat, c’est une sculpture qui tient « comme par miracle ». Un art « très connu et pratiqué au Japon », précise-t-il. Le haïjin Poullaouec, lui, nous renvoie au Tao Te King de Lao Tseu, qu’il cite dans le livre : « Le grave est la racine du léger ; maître du mouvement, le calme ».
Le résultat est surprenant. On pourrait même dire stupéfiant. Créer ce monde en équilibre de pierres superposées constitue un véritable exploit. « J’ai mis parfois plusieurs semaines avant d’arriver à ce qui me semblait perfection et harmonie avec le paysage et moi-même », raconte encore Arnaud Arcizet qui a lui-même photographié ses œuvres, soulignant au passage qu’il laissait « le lieu d’édification aussi vierge qu’au départ ».
Cet art de l’éphémère coïncide avec ce sentiment de l’impermanence et de la fugacité qui signe l’approche de philosophies extrême-orientales. Le haïku (qui flirte dans ce livre avec l’aphorisme) entre dans cette catégorie. « Ne me jetez pas la pierre / j’équilibre le tout / pour rien », écrit Jacques Poullaouec. « Empiler pierre sur pierre / haïku sur haïku / jusqu’où ne pas aller trop loin ». Oui, une question d’équilibre.
Haïkus de l’équilibre, œuvres et photographies d’Arnaud Arcizet, Textes de Jacques Poullaouec, Géorama, 18 euros.
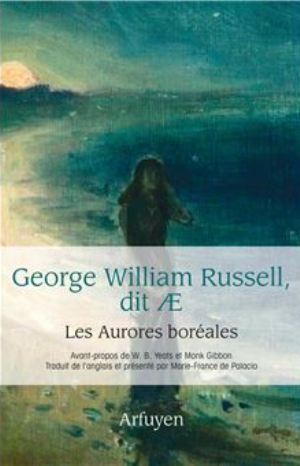 |
George William Russell, |
| Les aurores boréales |
|---|
Écrivain, peintre, visionnaire : l’Irlandais George William Russell (1867-1935), né dans le comté d’Armagh, demeure un auteur à découvrir. Ami du grand poète irlandais Yeats, il n’a pas connu la postérité de celui-ci. Sans doute faut-il l’expliquer par le caractère insolite de sa personnalité. Un livre regroupant ses écrits ou ceux d’auteurs qui l’ont connu permet de mieux comprendre ses ressorts créatifs.
George William Russell faisait des rêves éveillés et ressentait autour de lui la présence d’êtres surnaturels. Cette expérience mystique qui le caractérise a sans doute fait oublier qu’il fut un homme très engagé dans le mouvement nationaliste irlandais (le héros fondateur de l’Irlande, Eamon de Valera, assista à ses obsèques) mais aussi dans le mouvement coopératif agricole. On le voit, une personnalité très éclectique. Sans compter qu’il était végétarien, qu’il prenait le parti des femmes en demandant qu’on leur accorde le droit de vote, qu’il prônait l’action non-violente et qu’il cultivait une forme d’écologie avant l’heure en soulignant dans ses textes que « nous faisons partie de la terre ».
Visionnaire à coup sûr, en avance sur son temps. Mais c’est d’abord un homme qui a cherché à trouver une explication à ses visions. Cette quête l’a conduit vers la théosophie et vers les cercles diffusant cette idéologie en Irlande. Il s’est également passionné pour la pensée hindoue telle qu’elle s’exprime dans les Upanishads ou la Bhagavad Gîta. Il s’est abreuvé aux textes mystiques de toutes les religions. « Je préfère la poésie soufie à toute chose, affirmait-il, parce qu’elle s’enivre de choses divines ».
George William Russell était surnommé AE, initiales du mot AEon, « mot forgé par les gnostiques pour désigner les premiers êtres créés, séparés de la divinité », note Marie-France de Palacio dans la riche introduction à ce livre dont le cœur est constitué de textes de Russell publiés entre 1892 et 1897 dans The Irish Theologist. « Ses écrits sont comme sa peinture : on peut les lire sans posséder la clef de tous les symboles », note Marie-France de Palacio. On y trouve des rêves éveillés ou des transcriptions de promenades oniriques. Dans le texte qui donne le titre à son livre, AE raconte : « Je m’éveillai de mon sommeil en un cri. Je fus précipité hors du grand abîme et chassé de l’obscurité (…) Je me dirigeai à grande vitesse vers le nord, des eaux sombres s’écoulant sous moi et des étoiles accompagnant mon vol. Puis un rayonnement illumina les cieux, les pics et les grottes de glace, et je vis les Aurores Boréales ».
On peut être désarçonné par de tels propos, n’y voir qu’élucubrations et fantasmes. Mais une pensée sous-tend en réalité la démarche de l’auteur irlandais : « Je suis persuadé, écrit-il, que l’âge d’or nous environne et que nous le pouvons, si nous le voulons, dissiper cette opacité et avoir encore une fois la vision de l’antique beauté ». C’est cette quête d’une forme d’âge d’or (Ce paradis dispersé sur terre dont parle le poète Novalis) qui a pu séduire, un moment, le jeune poète Philippe Jaccottet (il le raconte dans son livre La promenade sous les arbres) mais il a pris très vite ses distances avec Russell car AE, écrit-il, « ne questionnait pas réellement le monde mais volait vers un monde « supérieur » et ce monde avait tous les défauts de la sur-nature ».
Ce livre n’est pas seulement un récit de ses visions. Russell pratiquait aussi l’aphorisme, l’une de ses formes littéraires préférées : « Dans la vie, l’homme de cœur et de mérite peut être reçu dans la meilleure société, même s’il ne prend pas soin de sa toilette ou a une apparence négligée. Rien de tel en littérature. Les gardes du palais sont snobs et une pensée de la plus grande valeur ne sera pas reçue avec respect si sa robe ne convient pas ». Russell, lui, était profondément un homme de cœur, désintéressé, altruiste. Tous les gens qui l’ont rencontré l’ont souligné. « Sa gentillesse envers les jeunes écrivains était proverbiale », raconte, dans un texte publié dans ce livre, le poète irlandais Monk Gibbon (1896-1987). Dans une lettre qu’il lui avait adressée, Russel écrivait : « Je ne pense pas qu’il vaille la peine d’écrire de la poésie si l’on ne sent que c’est là la plus haute expression de l’esprit humain ». Des poèmes de Russell lui-même, William Butler Yeats disait qu’ils étaient « des tentatives pour saisir, en un réseau d’images obscures, un état d’âme élevé et impalpable ».
Les aurores boréales, George William Russell, Arfuyen, 216 pages
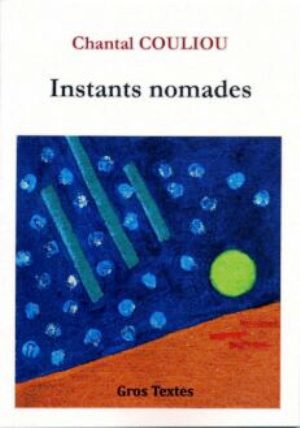 |
Chantal Couliou, |
| Instants nomades |
|---|
Ses recueils sont comme de petits cailloux semés sur un chemin de poésie qui a démarré il y a près de quarante ans, Chantal Couliou, partagée entre les cieux brestois et morbihannais, a la concision comme terrain de jeu. Elle pratique avant tout le poème court et le haïku. Ses textes nous la montrent le plus souvent immergée dans la nature mais toujours à l’écoute des rumeurs de la ville quand elle y réside. Son nouveau petit recueil est là, à nouveau, pour en témoigner.
Ses Instants nomades, titre à la fois du premier chapitre et du recueil lui-même, nous font penser à cette Voie nomade évoquée par Anne Perrier (1922-2017) dans son livre édité en 1986 à La Dogana. « Ne me retenez pas si / Au détour du chemin / Tout à coup / Emportée vers les sources du jour / J’escalade le chant du merle », écrivait la poétesse suisse. Il y a aussi des merles dans le petit livre de Chantal Couliou. Elle raconte ainsi, dans un de ses instants nomades, avoir eu « pour toute compagnie / le chant d’un merle solitaire ». Si ce n’est pas un merle, c’est un rouge-gorge qui la suit « pas à pas ».
Vivre ces instants nomades, dit-elle, « c’est se délester de ce trop-plein de gris entre terre et mer ». C’est « résister au vent et effacer ses traces ». Car ce n’est pas le « bleu du vent » dont parle Anne Perrier. Le vent, ici, est obsédant et Chantal Couliou l’évoque dans d’autres chapitres de son recueil. C’est une « voix », un « souffle ». Et ce vent peut être « glacial ». Il « nous convie /à une longue traversée de la nuit ». De toute façon (et l’on pense à Brest), il « gouverne l’horizon ».
À l’écoute du vent sur sa propre voie nomade, Chantal Couliou nous révèle la sensibilité qui est la sienne à tout ce qui vit puis disparaît (cette notion d’impermanence chère à la sensibilité extrême-orientale). Ainsi évoque-t-elle, dans ses courts poèmes, aussi bien les pas qui disparaissent dans la neige que la mémoire qui s’effiloche ou encore, en empruntant un trottoir, ce dessin à la craie que la pluie efface. Pour Chantal Couliou il importe avant tout de « rester à l’écoute », savoir que l’on peut « marcher sans fin / et ne jamais arriver / à bon port ». Elle prône la lenteur, une forme de vie « à l’écart du monde » (qui n’est pas une fuite). « Prendre temps, dit-elle, de se pencher / sur la primevère sauvage / qui court sur le talus ». Et elle cite la grande poétesse russe Marina Tsvetaïeva (…) pour qui « la plus belle victoire » était de « passer sans laisser d’ombre ». Ce que fait, à sa manière, la poétesse bretonne.
Instants nomades, Chantal Couliou, images de Yves Barré. Gros textes, 70 pages, 8 euros
 |
Jean-Claude Albert Coiffard, |
| Le ciel était immense |
|---|
Le ciel immense ne peut être que celui de l’enfance. C’est ce que nous raconte le poète nantais Jean-Claude Albert Coiffard (90 ans) dans un livre à la fois pétri de nostalgie et de gratitude pour ce temps vécu dans un pays au « visage d’aurore ». Et toujours dans la fidélité à René Guy Cadou.
Sous le ciel immense de Jean-Claude Albert Coiffard, un ciel qui « brasille sous le soleil de mai », il y a un fleuve (la Loire), des roseaux, des oiseaux et, dans le jardin du poète, « l’odeur des lilas », un puits, un figuier, des abeilles et des roses à foison. C’est à ce pays-là qu’il s’adosse, univers parcouru de « nuages au long cours » et toujours, la nuit venue, illuminé d’étoiles.
C’est la voix de René Guy Cadou qui résonne, de bout en bout, dans ce livre. Jean-Claude Albert Coiffard nous dit qu’il peut aujourd’hui écrire « son nom en lettres d’or / dans le granit du temps ». Car le monde, dit-il, « s’ordonnait sous les pas » de l’instituteur-poète de Louisfert dont le chemin de l’école était « pavé d’hortensias ». Hommage à Cadou, donc, mais aussi, au fil des pages, à Apollinaire, Marie-Noël ou Nerval, qui furent ses compagnons de route.
Mais le poète, l’âge venu, n’en finit pas malgré tout de s’interroger. « Le mot que je cherche / qui me le donnera ? ». Car comment témoigner au plus près de cette vie donnée en abondance ? « J’ai tant et tant / remonté d’eau / de mon vieux puits / j’ai tant et tant / puisé de lettres / que maintenant / je vois le fond ».
Saisi d’une forme de vertige, le poète évoque ce « vieux puits / rempli d’ombres » où « délaissant le ciel / le soleil s’est noyé ». Pourtant il se ressaisit bien vite. Sans doute faut-il se résoudre à partir, « mais les roses toujours », se rassure-t-il, « parleront aux abeilles ». Et loin de pouvoir prétendre tout dire de ce ciel immense avec les mots du quotidien, il affirme arriver « à l’heure / où le silence / pourra tout dire ». Et, plein de confiance, quand « la porte s’ouvrira », accéder au « pays mystérieux ».
Le ciel était immense, Jean-Claude Albert Coiffard, postface de Marie-Laure Jeanne Herlédan, cinq dessins de Eugénie Couteau, Des Sources et des Livres, 2023, 139 pages, 17 euros
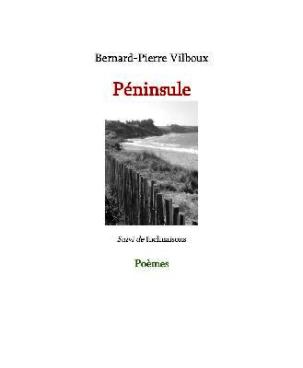 |
Bernard-Pierre Vilboux, |
| Péninsule |
|---|
Péninsule. « La contrée celte de mon cœur », écrit Bernard-Pierre Vilboux. Péninsule armoricaine. Et plus précisément, la Bretagne. « Pays vert et bleu ». Le poète, né à Rennes en 1961, nous raconte poétiquement ses pérégrinations au cœur d’un pays qui n’en finit pas de l’éblouir.
Bernard-Pierre Vilboux aborde son pays natal par la face lumineuse, « dans le secret des villages granitiques » et « sous le chapitre des légendes vives ». Il est à la fois d’Armor et d’Argoat. Car pour citer au passage Lennon, Scrignac ou Cléden-Poher, il faut avoir appris à faire l’école buissonnière. Ce qui l’attire avant tout dans cette péninsule : une aurore, un couchant, les chapelles, les bistrots, un fest-noz, tous ces « chants fiévreux des contrées de la tourbe ». Il marche dans les pas de ceux qui ont dit et chanté ce pays (de Grall à Cadou en passant par Robin, Duval, Gwernig, Segalen, Kemener et tant d’autres). Comme eux, il chante ses « Bretagnes enfouies comme feu sous la cendre ». Évoquant un village familier il a ces mots simples : « Une fontaine au milieu où des anges se prélassent / Un chemin de ronde et bien des noisetiers ». De Brocéliande, il dit que « chaque matin / Les ruisseaux sont à la fête / Ils exhalent une brume évanescente ».
Car Bernard-Pierre Vilboux est aussi allé où tout le monde va : la baie des Trépassés, la presqu’île de Crozon, Bréhat, le pays bigouden… Mais s’il parle de ces lieux emblématiques, il le fait en changeant de focale. À Crozon, il évoque ce « versant sur l’infini / Parsemé de bruyères roses ». À Loctudy, il entre dans un café « où d’heureux habitués aiment / À boire et à saluer la compagnie ». Sa traversée de la Bretagne le mène aussi bien sur le sentier des douaniers que le long du Canal de Nantes à Brest où il s’extasie sur « les volutes des chaumières d’écluse » ou sur « le mystère des eaux aimantées ».
Le poète n’hésite pas, par ailleurs, à clamer qu’au cœur de cette péninsule qu’il exalte vit « une communauté insoupçonnée / Pour la plupart des Jacobins ». Ajoutant : « Tu es né en Bretagne et non en France ». Des accents qui nous ramènent à la fièvre poétique des années de braise post soixante-huitardes en Bretagne au moment où ont émergé les voix enflammées de Keineg, Keginer, Moazan, Kalvez et de tant d’autres. « Peuple équinoxial, tu bâtiras / Ta péninsule à la source des vents », clamait Kristian Keginer (Terra incognita, éditions Bretagnes, 1979, réédition Hauts-fonds, 2020). La péninsule de Bernard-Pierre Vilboux est aussi cette « Terre promise » que chantait Tugdual Kalvez (Sevel e vouez, Kendalc’h, 1977). Sous sa plume elle demeure une « Armorique éternelle ». Il s’y abreuve inlassablement. Mais, comme ses prédécesseurs, il ne s’y enferme pas, scrutant d’autres horizons en étant à l’écoute De Rilke, Gibran, Keats, Pessoa, Séferis, Neruda, Césaire… « Voici une once de jours / Un poète a du passer par ici // Les arbres semblent plus feuillus / L’herbe plus tendre », note Bernard-Pierre Vilboux.
Péninsule suivi de Inclinaisons, Bernard-Pierre Vilboux, photos de Lucile Davy, éditions L’enfance des arbres, 2023, 130 pages, 15 euros
 |
Abbas Kiarostami, |
| Quelques gouttes de pluies sur la terre |
|---|
Il est cinéaste et photographe. Mais aussi poète. L’iranien Abbas Kiarostami est surtout connu pour ses films, comme Le goût de la cerise (Palme d’or à Cannes en 1997) ou Le vent vous emportera (1999). On a dit de lui – le compliment n’est pas mince – qu’il est l’équivalent iranien du Russe Andreï Tarkovski et du Français Robert Bresson. Mais son œuvre poétique restait à découvrir. En 2002, son recueil Avec le vent avait été publié chez P.O.L, puis, en 2008, Un loup aux aguets à La Table ronde. L’essentiel de son œuvre poétique a enfin paru sous le titre Des milliers d’arbres solitaires (éditions Erès, 2014). Aujourd’hui, la publication de Quelques gouttes de pluie sur la terre, à destination des enfants et des plus grands enfants, est l’occasion de renouer avec la poésie d’un artiste complet.
La poésie de Kiarostami émerveille par sa simplicité, son naturel, sa sensibilité à la beauté des paysages. Elle traite de l’enfance et de la nature, de l’amitié et de la solitude, de ce qui passe et de ce qui demeure. Le poète iranien, dans ses très courts poèmes, mêle à la fois des notations prises sur le vif à des considérations philosophiques ou morales où affleure, dans la bonne tradition littéraire iranienne, une spiritualité discrète. Il interroge toujours notre présence sur terre, comme dans ces simples mots contenus dans le petit livre qui vient de paraître. « Pour la lune la question est : / ceux qui la contemplent / sont-ils les mêmes / qu’il y a mille ans ? »
Préfaçant Pluie et vent, un livre de photographies signé de l’auteur iranien (Gallimard 2008), Christian Boltanski notait que Kiarostami « refusait tout détail anecdotique, tout orientalisme de pacotille » et qu’il n’y avait « jamais chez lui de pittoresque facile ». On pourrait tenir les mêmes propos pour sa poésie qui se rapproche, à bien des égards, du haïku japonais. Les mots de saison sont là. La nature souvent. « Il nous décrit un monde universel reconnaissable par chacun », soulignait encore Christian Boltanski. « Il nous montre ce que nous savons tous, mais que nous avons oublié, des visions enfouies au fond de nous-mêmes ».
Sa parenté spirituelle avec son compatriote poète Sohrab Sepehri (1928-1980) saute, plusieurs fois, aux yeux. « Il est midi de l’été / et les ombres savent de quelle saison il s’agit », écrivait ce dernier dans L’Espace vert (1967). « Un ruisseau court / dans un désert sans herbe / à la recherche / de quelqu’un qui a soif », écrit Kiarostami. Lisons le poète iranien. Il nous conduit très loin.
Quelques gouttes de pluies sur la terre, Abbas Kiarostami, avec sept images de Hoda Hadadi, Rue du monde, 2023, 36 pages, 9,50 euros
 |
Hervé Carn, |
| Georges Perros, la vie est partout |
|---|
Georges Perros aurait eu 100 ans cette année. Né le 23 août à Paris, il avait choisi à partir de 1959 de vivre à Douarnenez au bout du bout de la Bretagne. Pour marquer cet anniversaire, le poète Hervé Carn rend hommage à l’auteur des Poèmes bleus, de La Vie ordinaire ou des Papiers collés (Gallimard). En 54 séquences poétiques, il nous raconte leurs années d’amitié entre 1973 et 1978, date du décès de Perros.
Hervé Carn a 24 ans quand il arrive à Quimper. Né dans les Ardennes dans une famille originaire du Finistère, il vient y occuper un poste de professeur de lettres. Il a lu Georges Perros, aime ses livres et entreprend de le rencontrer à Douarnenez « sur la cale désencombrée des touristes » (…) « Pas de présentation, la présence suffit » et cette relation fut un engagement « à le suivre dans d’autres contrées ».
Perros et Carn ont déjà au moins un point commun. Ils sont fils uniques. « Nous vivions avec le vide de l’autre » (pour Perros, un frère jumeau mort à la naissance). Mais cela, on s’en doute, ne suffit pas pour nourrir une amitié durable, pas plus que l’intérêt qu’ils cultivent tous les deux pour le football (Perros chroniquait sous un pseudo les matches du club local de La Stella Maris). Hervé Carn n’est pas là non plus pour entretenir, à petits frais, la mythologie perrosienne : ses virées en moto, sa pipe légendaire, sa bourlingue des comptoirs, son exigu appartement HLM sous les toits. Carn n’est pas là, non plus, pour nous faire la recension des livres qui ont fait la renommée de Perros. Il est d’abord là pour nous parler de l’homme Perros, de son être au monde et de sa relation aux autres.
Ce qui le frappe avant tout chez Georges Perros, c’est « l’authenticité ». Pas de faux-semblant, pas d’esbroufe. Il était « Ferme. Généreux. Réfléchi. Cultivé. Courageux. » Comme tant d’autres jeunes de son âge qui ont aimé le grand écrivain, Hervé Carn est sensible à « L’homme ordinaire qu’il avait choisi d’être par amour / Pour une femme qu’il adorait qu’il admirait / Pour ses enfants qu’il chérissait inquiet / Toujours de leur devenir dans un monde / De plus en plus inculte et voué au vulgaire ». Il ajoute même : « Il avait peu de péchés capitaux et l’envie / Lui était tout à fait étrangère ce qui faisait / De lui dans son époque une anomalie. » L’éloge n’est pas mince. Hervé Carn sait ce qu’il doit à cet homme-là. « Il m’a aussi permis de m’éloigner / De moi-même et de vivre l’espace / D’une découverte du monde / Qui ne serait pas asservie / Aux intérêts du petit moi ».
En même temps, c’est toute une époque d’effervescence littéraire qui revit ici sous sa plume, faite de rencontres multiples. On voit ainsi émerger au fil de ces séquences poétiques les silhouettes de Michel Butor, Jean Bazaine, Paol Keineg, Marc Le Gros, Michel Quesnel, Jean Roudaut… Il a aussi, dans les parages, Sevy Valver, alias Yves Landrein, fondateur des éditions Ubacs et plus tard de La Part commune, à qui l’on doit la publication des correspondances de Georges Perros avec Jean Grenier, Lorand Gaspar, Vera Feyder et Carle-Gustav Bjurstrôm. Tout ce beau monde peut se retrouver autour d’une table de bistrot ou de restaurant à Quimper et d’autres convives peuvent aussi être de la partie (Jacques Guéguen, Jean-Yves Boudéhen …)
Hervé Carn garde un souvenir ému de tout cela, mais aussi de ses échappées avec Perros dans son terroir familial du côté de Plonévez-du-Faou et « vers tous les lieux qu’il chérissait » (Locronan, Sainte-Anne-La-Palud, l’île de Sein…) avec, à la clé, un déjeuner « Sur le pouce arrosé de vin rouge / Dans un routiers ou une gargote ». Quand la maladie s’est abattue sur Perros, il se souvient d’un homme qui la combattait « avec toutes les formes de l’humour » (il mourra le 24 janvier1978 et sera enterré au cimetière marin de Tréboul). « Curieuse époque que celle de vos cent ans », note aujourd’hui Hervé Carn, « Où lire n’est plus qu’un loisir d’ouvroir / Où les livres ne touchent plus / Que les étudiants dans leurs soupentes / Et les vieux messieurs chancelants / Que nous sommes devenus ». D’où l’urgence, nous dit-il entre les lignes, de lire ou de relire Georges Perros et d’apprivoiser, pour notre plus grand bien, son « triomphant désespoir ».
Georges Perros, la vie est partout, Hervé Carn, La Part Commune, 2023, 82 pages, 13 euros
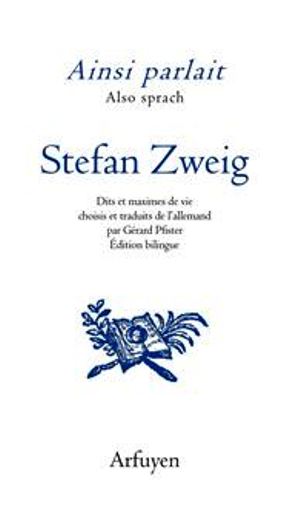 |
Gérard Pfister, |
| Ainsi parlait Stefan Zweig |
|---|
Lire et relire Stefan Zweig. Pas seulement l’écrivain, l’auteur de Vingt-quatre heures de la vie d’une femme. Lire également le penseur dont les « dits et maximes de vie » sont réunis dans un livre par Gérard Pfister. Ce que Stefan Zweig (1881-1942) nous dit de l’existence et du monde se révèle riche d’enseignements pour les temps sombres que nous vivons. Miracle de l’écriture, quand les propos d’un auteur deviennent intemporels.
« Mon but serait de devenir un jour non un grand critique, une célébrité littéraire, mais une autorité morale », affirmait Stefan Zweig dans une lettre à Romain Rolland du 21 avril 1918. Qu’il se rassure ! Il est bien devenu cette autorité morale, cet homme capable de distiller des graines de sagesse « dans la vision de l’homme et du monde qu’il s’est forgée tout au long de sa réflexion », note Gérard Pfister. Les fragments reproduits dans ce livre sont là pour en témoigner. Ils révèlent aussi l’influence qu’ont pu exercer sur lui certains « grands esprits » dans leur lutte contre les nationalismes, les fanatismes religieux ou les dogmatismes de tout poil.
Les nationalismes ? Stefan Zweig s’est mis à l’écoute de Romain Rolland qui devint véritablement son mentor lorsque l’écrivain français entreprit de dénoncer les nationalismes à l’origine de la Grande Guerre. Le contre-exemple fut pour lui le poète Émile Verhaeren dont les positions lui renvoient comme un miroir grossissant la bêtise et la haine de la propagande nationaliste. Stefan Zweig et Romain Rolland seront pour un dépassement des nationalismes en plaidant pour l’éclosion d’une Europe unie. On notera, en outre, que le rejet du nationalisme par Stefan Zweig le conduira même à « dénoncer le nationalisme juif comme une dangereuse illusion », note encore Gérard Pfister.
Pour dénoncer les fanatismes religieux, Zweig se tourne vers Érasme mais encore plus vers le théologien Sébastien Casteillon (1515-1563), l’adversaire inflexible du fanatisme de Calvin et de ses émules genevois (ils avaient mis à mort Michel Servet, le savant humaniste, brûlé pour hérésie). « On ne prouve pas sa foi en brûlant un homme, mais en brûlant pour elle », s’indigne Stefan Zweig. Mais il pose aussi cette question dont on mesure l’actualité tout aussi brûlante : « Comment les hommes peuvent-ils arriver à vivre ensemble en paix sur la terre, malgré toutes les différences de races, de classes, de couleurs, de religions et de convictions ? » C’est dans ce questionnement que l’on trouve aussi les liens qui peuvent s’instaurer entre fanatisme et nationalisme.
Contre les dogmatismes de toute nature (son troisième combat), la référence de Stefan Zweig est incontestablement Montaigne. Il n’a pourtant découvert les Essais qu’en 1941 mais il s’en empare rapidement. « Il ne veut pas de dogme, pas de précepte et craint en permanence les affirmations définitives », note Zweig. « Peu d’homme se sont battus avec plus de loyauté et d’acharnement pour préserver leur moi le plus intime ». Et c’est là que sa dénonciation du dogmatisme peut rejoindre celle du fanatisme.
Tout se tient dans les graines de sagesse de Stefan Zweig. On est frappé par leur vibrante actualité dans notre époque de résurgence des fanatismes (Daech et consorts), des nationalismes (Poutine et consorts), et aussi de toutes ces formes de dogmatisme qui polluent le débat démocratique, font régner l’intolérance et entravent l’art de la nuance. « Pourquoi les hommes ne veulent-ils pas la vérité, écrivait Stefan Zweig, c’est qu’il est difficile de vivre avec elle, plus coûteux, plus fatiguant, que de vivre dans la chaleur d’un mensonge ».
Ainsi parlait Stefan Zweig, dits et maximes de vie choisis et traduits de l’allemand par Gérard Pfister, édition bilingue, Arfuyen, 190 pages, 14 euros
 |
Philippe Jaccottet, |
| La promenade sous les arbres |
|---|
Voici réédité un livre de Philippe Jaccottet publié en 1957 par l’éditeur suisse Mermod. Le poète a alors 32 ans et c’est son premier livre en prose, un véritable traité de l’expérience poétique ou, comme l’exprime l’éditeur actuel (Le Bruit du temps), « un petit livre des commencements »
La promenade sous les arbres est le titre d’un des sept textes publiés par Jaccottet dans ce livre pour, en quelque sorte, illustrer sa propre démarche poétique. Dans les six autres textes, il nous parle de Grignan (cette ville de la Drôme où il vient de s’installer), des montagnes, de la « rivière échappée » ou des nuits éclairées par la lune. Ce sont, dit-il, des « exemples » de ce qu’il entend exprimer dans l’écriture. « Ces textes ne sont pas des poèmes, mais des tâtonnements, ou parfois de simples promenades, ou même des bonds et des envolées, dans le domaine fiévreux où la poésie, parfois, plus forte que toute réflexion ou hésitation, fleurit vraiment à la manière d’une fleur ».
Tout commence, selon lui, par les émotions que peut susciter le monde extérieur. À commencer par la nature et, notamment, des « lieux les plus pauvres ». Pour le poète, il s’agit de « comprendre ces émotions » et d’analyser « les rapports qui les lient à la poésie ». Mission accomplie dans les sept exemples qu’il propose. Ce qui fait dire à Jean-Marc Sourdillon, dans la préface de cette réédition qu’on « y perçoit presque à tout moment la présence d’une discrète jubilation, l’eurêka modeste du poète qui découvre la cohérence de sa propre manière ».
Cette cohérence doit se nourrir, selon Jaccottet, de « simplicité », « d’impressions fugaces », « d’intensité de l’expérience ». Il le dit en faisant notamment référence à ce qu’il admire dans la poésie de l’Irlandais George William Russel (1867-1935), tout en prenant certaines distances avec lui. Il y a aussi, parallèlement, chez Jaccottet, « le pressentiment que l’âge d’or est encore au monde ». Référence à la fameuse phrase de Novalis : « Le Paradis est dispersé sur toute la terre, c’est pourquoi nous ne le reconnaissons plus. Il faut réunir ses traits épars ».
Pour réunir ces traits épars, Jaccottet affiche son désir de « dépassement des images (…) ce moment où la poésie, sans en avoir l’air puisqu’elle s’est dépouillée de tout brillant, atteint à mon sens le point le plus haut ». C’est ce qu’il admire chez Leopardi, Hölderlin ou Verlaine. D’où l’intérêt qu’il accorde déjà, à l’époque, au haïku après la lecture de l’ouvrage de R.H. Blyth consacré à ce genre littéraire. Philippe Jaccottet parle à son propos de « transparence » et « d’effacement absolu du poète ». C’est cette « transparence » qui dominera dans la majorité de ses écrits à venir, notamment dans ses proses poétiques.
La promenade sous les arbres, Philippe Jaccottet, préface de Jean-Marc Sourdillon, Le Bruit du temps, 120 pages, 9,50 euros
 |
Tao Yuanming, |
| Œuvres complètes |
|---|
Pourquoi l’ancienne poésie chinoise suscite-t-elle aujourd’hui un regain d’intérêt ? Jean-Marie Gustave Le Clézio avait déjà attiré notre attention sur les grands poètes de la dynastie Tang (618-907) dans son ouvrage Le flot de la poésie continuera de couler (Philippe Rey, 2020). Voici, aujourd’hui que Les Belles Lettres publient les Œuvres complètes du poète Tao Yuanming (352-427). Chez cet auteur comme chez beaucoup de ceux de la dynastie Tang – on pense en particulier à Li Baï – il y a cette même prise de distance avec le monde et ce retour à la nature qui n’est pas sans rappeler certains penchants contemporains.
Tao Yuanming (né dans une famille de lettrés) a, un jour, quitté son emploi de fonctionnaire pour venir s’installer au pays natal, à la campagne, loin des fracas du monde. « Jeune, déjà mon tempérament ne s’adaptait guère au monde / ma nature originelle aimait les montagnes / par mégarde, j’ai été pris dans les filets du monde de poussières ». Pour autant, il ne vivra pas en ermite car il continuera, sur place, à entretenir de nombreuses relations. « Les voisins viennent souvent me rendre visite / notre discussion animée évoque les choses du passé / ensemble nous apprécions la belle littérature / les passages difficiles ensemble nous élucidons ».
Nous sommes à l’époque de la dynastie des Song du sud, à une moment troublé de l’histoire de la Chine, à un moment aussi où le confucianisme commence à être délaissé au profit du taoïsme tandis que le bouddhisme accroît son influence. Tao Yuanming s’inscrit dans la tradition taoïste qui célèbre la vie pleinement vécue et la jouissance de l’instant présent. Deux mots-clés pour Tao Yuanming: la contemplation et l’ivresse, sur un fond de liberté philosophique et existentielle (Épicure n’est pas loin).
Le poète chinois raconte qu’il habite « une humble hutte (…) Il suffit qu’elle abrite juste un lit et des sièges ». Il s’est fait jardinier : « J’avais semé des pois au pied des monts du sud / l’herbe folle est prospère mais les pousses sont rares / levé de grand matin, je raisonne ma friche / et la houe sur l’épaule m’en retourne au soir ». Il contemple le monde, il vit au rythme des saisons. « C’est le début de l’été, herbes et arbres sont luxuriants / les arbres feuillus entourant la maison déploient leur ombrage ». Puis vient l’automne et ses chrysanthèmes aux « couleurs ravissantes » (c’était sa fleur fétiche).
Pour Tao Yuanming, l’ivresse lui permet aussi de s’accorder au cours naturel des choses. « La coupe se vide, le pichet s’épuise / le soleil se couche / l’agitation cesse / de retour dans la forêt les oiseaux chantent / à l’aise je siffle dans la véranda de l’est / content de jouir du plaisir de la vie ». Avec de telles intonations, il rejoint celles de Li Baï (701-761), le poète de l’ivresse affirmant : « Seul importe le plaisir du vin / mais à quoi bon parler de cela à quelqu’un de sobre ».
Tao Yuanming cultivera l’ivresse mais vivra dans la pauvreté. Il connaîtra même la faim. Son œuvre (poésie et prose) ne sera vraiment reconnue qu’à partir du 10e siècle. Celui que l’on appelait le Maître des Cinq-Saules était notamment l’auteur de La source aux fleurs de pêcher où il décrivait un village dans une vallée cachée à l’écart du monde et aussi du Chant du retour où il évoquait son retour à la campagne au pied des Monts Lu. On lui attribue ces courtes proses ainsi qu’environ 130 poèmes.
Œuvres complètes, Tao Yuanming, Les Belles Lettres, 2022, 416 pages, 29,50 euros. Édition bilingue et critique sous la direction de Philippe Uguen-Lyon.
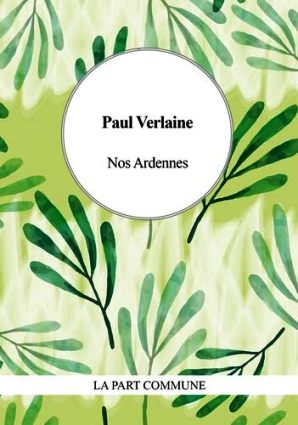 |
Paul Verlaine, |
| Nos Ardennes |
|---|
Voici un Verlaine inédit dans la peau d’un « excursionniste » comme il le dit lui-même et qui ressemble fort, pour l’occasion, à un guide de tourisme. Le poète nous dit son amour des Ardennes qui, à ses yeux, « présentent à l’observateur ou même au simple touriste toutes les qualités et toutes les richesses de la terre et de l’âme françaises ». Il l’affirme dans une série de six articles publiés en 1882 et 1883 dans Le Courrier des Ardennes et aujourd’hui réédités.
On sait ce qui lie le Lorrain Paul Verlaine (né à Metz en 1844) au massif des Ardennes. Il y a, avant tout, son aventure orageuse avec l’ardennais Rimbaud originaire de Charleville. Mais on sait moins que son père était originaire des Ardennes belges. C’est là que le jeune Verlaine passa souvent, chez une tante, des vacances d’été. Puis il y eut son emploi de répétiteur dans un collège de Rethel où il se prit d’affection pour un élève originaire de Juniville. C’est dans cette commune qu’il résida de 1880 à 1882 et entreprit la rédaction d’articles pour Le Courrier des Ardennes.
Verlaine nous entraîne dans les pays de Rethel et de Vouziers. Et, bien sûr, il nous parle longuement de Juniville « avec sa rivière bien nommée (La Retourne) qui l’enveloppe de ses mille replis et son bois de peupliers pleins de ruisselets, d’air pur et de doux ramages ». Il le reconnaît : « Je me suis étendu un peu sans doute sur Juniville mais j’y ai longtemps vécu, y laissant les bribes de ma destinée, et j’éprouve un mélancolique plaisir à en parler trop ».
Le poète excursionniste nous raconte ses Ardennes par monts et par vaux. Des localités qui fleurent bon le terroir s’illuminent sous sa plume : Tagnon, Neuflize, Alincourt, Bignicourt, le Mesnil-Annelle, Perthes, Sorbon… Il a un mot pour chacune. Ici une « église de craie », là un « village de pure culture », Ailleurs « des toits rouges et noirs », plus loin « un clocher illustre et des cheminées pittoresques »… Parfois (rarement), il se désole en parcourant, dans le Vouzinois, une campagne « bien plate, bien laide, disons-le, quoi ? Pas un arbre ». Verlaine est à l’affût. Il peut se désoler mais il contemple avant tout. Les sens en éveil. La vue, mais aussi l’ouïe. Ainsi est-il particulièrement sensible aux parlers locaux. « Au Châtelet et à Juniville, par exemple, le français, suffisamment correct, traîne à la normande (…) Et dès Coulommes commencent les patois, légers encore, pour se renforcer de lieue en lieue vers le Nord et l’Ouest ». Rejoignant Attigny, il note « la joliesse de parler paysan de ce coin des Ardennes ».
Ainsi va Verlaine, devenu apprenti linguiste ou ethnologue, nous racontant le pèlerinage de saint Méen dans la même commune d’Attigny ou encore « le petit chemin de fer de Vouziers ». Les stigmates de la guerre de 1870 – il le note – sont encore présents sur place. Le voici à Voncq, un « village pillé par les Prussiens », puis à Chestres « brûlé, lui, terriblement (…) par ces féroces Bavarois ». Plus loin, il parle même de ces « laides têtes carrées où n’entraient ni le respect des vaincus, ni celui d’eux-mêmes ». Honte, donc, à ceux qui ont voulu défigurer ses Ardennes, « microcosme français », « heureux résumé de la patrie ». C’est ce pays que chantera aussi plus tard, dans son livre Lointaines Ardennes (éditions Arthaud), l’écrivain et poète André Dhôtel, né dans cette commune d’Attigny où s’était attardé Paul Verlaine.
Nos Ardennes, Paul Verlaine, La Part Commune, collection La Petite Part, 50 pages, 6,50 euros
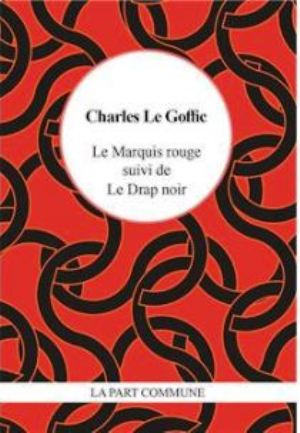 |
Charles Le Goffic, |
| Le Marquis rouge |
|---|
Le Lannionnais Charles Le Goffic (1863-1932) nous revient à travers la réédition de deux de ses nouvelles publiées en 1908 dans son livre Passions celtes. Le poète et écrivain breton enveloppe ses deux récits d’une atmosphère de tragique où « l’atroce côtoie le sublime », souligne Vincent Gogibu dans la présentation de ces nouvelles. L’ancrage breton ne se dément jamais, aussi bien dans le premier texte dont l’action se déroule à l’intérieur des terres que dans le second situé en pleine mer.
Parlant de Charles Le Goffic, son ami Auguste Dupouy disait : « Trop Breton pour patronner certaines bretonneries, trop convaincu que son pays est beau pour éprouver la tentation de l’embellir ». Plusieurs fois couronné par l’Académie française, Le Goffic en deviendra l’un des membres en 1930 et fut accueilli par l’écrivain Henry Bordeaux en ces termes : « Toute la Bretagne veut entrer ici avec vous ». Breton, donc, par toutes les fibres de son corps et qui entreprit (après avoir enseigné) de devenir écrivain, à la fois prosateur et poète. On notera que Charles Le Quintrec dans son livre Littératures de Bretagne (édtions Ouest-France) portait un regard très critique sur son œuvre poétique qu’il disait « faite de banalités sonores » et de « minces strophes ». Il reconnaissait par contre, volontiers, que « c’est en prose plus qu’en vers qu’il donnait la mesure de son talent ».
On peut effectivement le constater dans ces deux nouvelles rééditées aujourd’hui. La première sous le titre Le Marquis rouge évoque la figure d’un petit potentat d’Ancien régime ancré au cœur de la Bretagne. Ce Markiz-Rû « menait, en plein XVIIIe siècle, la vie d’un féodal du XIII, raconte Charles Le Goffic, courant les auberges et les mauvais lieux ». Il tirait son nom d’une « broussaille de poils roux mais d’un rouge si vif qu’il en fulgurait ». Un jour, c’est un valet « jarrets d’acier et poigne de fer » qui le fera tomber de son piédestal. Le lieu de l’empoignade entre les deux hommes, avec ses « schistes verticaux, taillés en lames de rasoir », sera au diapason de la haine réciproque qui les habite. Pour un dénouement inattendu…
La deuxième nouvelle raconte l’aventure des deux gardiens du phare de Men-Rû, François Labat et Yves Marie Kerguénou, « au cœur des flottantes mousselines de la brume » où se perdent tant d’embarcations. Depuis leur vigie, les deux hommes (dont leurs femmes sont sœurs) peuvent apercevoir, quand la brume se disperse, la maison où ils résident avec leurs épouses. Mais un jour ils voient, avec effroi, que l’on dresse un drap noir autour de la porte. Quelqu’un serait-il mort ?
Dans ces deux nouvelles, Charles Le Goffic a l’art de maintenir une tension dramatique, s’appuyant sur tous ces traits saillants de L’âme bretonne, titre des quatre tomes d’un ouvrage qu’il publiera entre 1902 et 1923. Sensibilité à la nature, force des éléments naturels, sentiment de la mort, proximité des vivants et des disparus : tout est fait pour retrouver dans ces deux textes, à l’écriture qui peut paraître parfois datée, un condensé de ce que Charles Le Goffic entendait exprimer sur cette Bretagne du début du XXe siècle.
Le Marquis rouge, suivi de Le Drap noir, Charles Le Goffic, La Part Commune, collection La Petite Part, 63 pages, 6,50 euros.
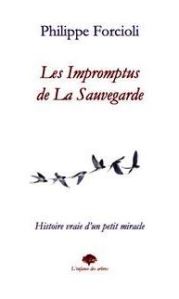 |
Philippe Forcioli, |
| Les impromptus de la Sauvegarde |
|---|
Le chanteur et poète Philippe Forcioli a rédigé sur son lit d’hôpital avant sa mort le 16 février dernier, à l’âge de 70 ans, un livre-témoignage sur l’expérience vécue sur place mais encore plus sur certains moments-clés de sa vie. Un livre de gratitude et de ferveur de la part d’un homme qui a « troqué sa guitare contre un clavier de paradis / pour célébrer la vie en toutes ses octaves », comme l’écrit son ami poète et éditeur, Jean Lavoué, qui publie aujourd’hui en Bretagne le livre du chanteur.
Les impromptus de la Sauvegarde. Un titre de livre qui mérite explication. Impromptu, nous dit Philippe Forcioli, parce qu’il s’agit d’un manuscrit « improvisé », « sans préparation ». La Sauvegarde, c’est la clinique lyonnaise où il sera soigné au cours de cet hiver 2022-2023. « J’aime bien ce titre, note-t-il, je le verrais bien inscrit sur un bon et honnête bouquin doux au toucher, je l’emporterais dans mon panier, impatient d’entrer dans ce titre un peu mystérieux mais attirant ». Jean Lavoué a comblé ses vœux.
Le déclic pour engager ce travail d’écriture a été, pour lui, l’annonce de la mort du poète Christian Bobin, le 23 novembre dernier. À peine huit jours après, Philippe Forcioli entamait son livre en commençant par un hommage appuyé au poète et penseur du Creusot dont il se sentait si proche. Et il le termine par une anecdote relative à Bobin (« histoire vraie d’un petit miracle ») puisqu’une dame de service de l’hôpital lui raconte, un jour, avoir bien connu le poète et surtout son amie Ghislaine dont celui-ci gardait les enfants (Ghislaine, La plus que vive, du récit fameux de Bobin). La boucle était bouclée. Comme un signe du destin.
En une série de poèmes ou textes courts, Philippe Forcioli évoque sa vie d’hôpital en commençant par un hommage appuyé et profondément touchant aux infirmières, « veilleuses sans cesse allumées de l’intérieur ». Le lisant on pense ici au livre de Lydie Dattas, qui fut la compagne de Christian Bobin (décidément, on ne le quitte pas), racontant dans L’expérience de bonté (éditions Arfuyen) l’attention soutenue que lui accorda une religieuse infirmière lors d’un séjour à l’hôpital, alors qu’elle était enfant. Les infirmières, donc, « aux gestes les plus délicats ». Mais aussi la chimio ou l’anesthésie locale, « allongé sur un lit à roulettes sous une toile bleu-vert » quand le chirurgien demande à l’infirmière : « Chantal, assurez-vous que M. Forcioli est à plat ».
Philippe Forcioli rêve, médite, interprète le passage des nuages (« ce don gratuit du ciel »), ces nuages dont Christian Bobin disait qu’ils étaient de « merveilleux infirmiers ». Il rembobine sa vie, celle d’un enfant « dans le ciel d’Algérie l’Oranie la forêt de M’Sila où mes grands-parents s’occupent d’une ferme viticole ». Celle d’un gamin qui assiste, émerveillé, au match Algérie-Brésil (avec Pelé) le 17 juin 1965 dans un stade d’Oran. Mais, surtout, voici sa mère, dont il dresse un portait touchant et dont il rapporte des confidences qu’elle lui a faites. « Elle m’a dit / chaque fois que j’entends que l’on frappe un enfant / j’ai envie de hurler j’ai envie de griffer » (…) « Elle m’a dit / à sept ans j’ai remporté le premier prix de chant au conservatoire de la cathédrale ».
Tenait-il de sa mère ce don pour le chant ? Pourquoi ne pas le penser. Philippe Forcioli, en tout cas, en a fait son métier. Il a bourlingué dans toute la France, surtout dans le sud, chansons « à textes » en bouche (façon Jacques Bertin, Julos Beaucarne ou Félix Leclerc), guitare en bandoulière. Il le raconte ici. Un bail de 40 ans. « Me suis rarement vendu. Partagé, loué, donné pour rien souventes fois, telle fut ma vie ». Vie de poète aimant les poètes. Bobin, bien sûr. Mais aussi René Guy Cadou, le poète « solaire et fraternel » qu’il a mis en chansons, comme l’a fait Manu Lann Huhel en Bretagne.
Philippe Forcioli aimait Cadou. Il a chanté en Loire-Atlantique dans le pays de Cadou. Il aimait la Bretagne où il avait un réseau de fidèles. C’est en Bretagne que son livre-testament est aujourd’hui publié. Un livre qui répondait à une exigence, à une nécessité intérieure. « Un jour nous comprendrons que la poésie n’était pas un genre littéraire mal vieilli mais une affaire vitale, la dernière chance de respirer dans le bloc du réel », écrivait Christian Bobin dans Un assassin blanc comme neige (éditions Gallimard). Philippe Forcioli nous le démontre s’il en était besoin.
Les impromptus de La Sauvegarde, Philippe Forcioli, éditions L’Enfance des arbres, 132 pages, 15 euros (frais de port, 4,50 euros). L’Enfance des arbres, 3, place vieille ville, 56 700 Hennebont.
Philippe Forcioli a chanté à Assérac, invité par Des Sources et des Livres. Il aimait la Bretagne où, du Bois de la Roche, à Hennebont en passant par Redon et autres lieux, il a offert ses poèmes, ses chansons et sa grande amitié. Et comme il l'a écrit dans une dernière dédicace, désormais, c'est " pour toujours ".
 |
Claude Serreau, |
| Réviser pour après |
|---|
En publiant ce nouveau recueil, il dit « mettre un point final » à ses « prétentions d’écrire ». Le Nantais Claude Serreau (dont on connaît aussi l’attachement au pays fouesnantais) est un poète fécond. « Face au grand âge devenu », il annonce vouloir tourner la page. Mais peut-on se passer vraiment du « démon » de l’écriture ? Le concernant, plutôt que de « démon », il faudrait parler de « Bonheur » de l’écriture. Son nouveau et dernier livre le démontre une fois de plus.
« J’engrange de l’amour / tout ce qui se partage / un soleil habité / de ces rires majeurs / où le matin s’invente ». Claude Serreau est du côté du « oui » à la vie. Il l’exprime notamment dans une série de « Dix poèmes à C… ». Mais ce chant d’amour, que l’on suppose adressé à l’être aimé, embrasse tout ce qui palpite « dans l’instance des jours ». Les accents fraternels du poète rejoignent une nouvelle fois les intonations de René Guy Cadou à qui il fait allusion dans l’un de ses textes (« Son corps avait gardé / d’enfance sous la guerre / une haine du froid / de l’ombre et de la nuit… ») Claude Serreau, lui aussi, opte pour la lumière « égarée quelque part / vers l’ouest ». Il entend, comme il l’a toujours fait, poursuivre « un chemin de ferveur / sans failles ni hasards ».
Claude Serreau ne cultive pas la nostalgie, ne ressasse pas des regrets. Il cultive plutôt l’art du détachement. « Mon âge a ses musées / solitaires et vains ». Il nous parle de sa « vie maraudée » et livre « au soir du saut dans l’inconnu » une forme de testament littéraire pour « échapper au pouvoir des ombres ». Plus encore, il nous indique un chemin que ne renieraient pas les plus grands sages. « Chaque instant sera bien à prendre / au foyer du cœur loin du bruit ». Et si ce sont vraiment les derniers mots du poète, accueillons-les avec joie et gravité, manuscrites à la dernière page de son livre : « Écoute les violons du monde descendre / au grave de leurs harmonies / quand c’est l’heure et que tout est dit ».
Réviser pour après, Claude Serreau, postface de Gérard Cléry, Des Sources et des Livres, 90 pages, 15 euros
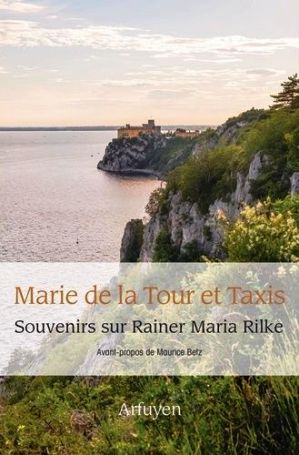 |
Marie de la Tour et Taxis, |
| Souvenirs sur Rainer Maria Rilke |
|---|
Les élégies de Duino, une des œuvres majeures de Rainer Maria Rilke (1875-1926), doivent leur nom au château où elles ont été écrites la première fois. Un livre vient aujourd’hui éclairer le contexte de cette création poétique. L’auteur en est la femme qui a accueilli Rilke dans son château de Duino. Elle devint sa protectrice et son amie. C’était une princesse d’origine vénitienne par sa mère, autrichienne par son mariage. Son nom : Marie de la Tour et Taxis (1855-1934)
Une princesse qui évoque ses souvenirs. Nous ne sommes pas ici dans un récit glamour ni dans la chronique mondaine des têtes couronnées. Avec Marie de la Tour et Taxis nous avons affaire à une femme profondément cultivée, naviguant de Venise à Berlin en passant par Munich, Vienne, Paris ou Londres, fréquentant les plus grands auteurs ou artistes de l’époque. Devant nous défile un monde culturel à cheval sur le 19e et le 20e siècle (d’où émergent les noms de Rodin, Valéry, Vaerhaeren, Nijinski…), un monde où la notion de frontière ne semble pas exister, au cœur d’une Europe où le mécénat se donne libre cours.
Rainer Marie Rilke baigne dans ce milieu-là. Il rencontre pour la première fois la princesse à Paris, en 1910, chez Mme de Noailles. Le poète a 35 ans. Celle qui deviendra sa protectrice en a 55. Elle l’invite en avril 1910 à venir résider dans son château de Duino près de Trieste, sur une falaise dominant l’Adriatique, dans « une chambre claire et gaie avec à gauche la pleine mer, Trieste et l’Istrie ; à droite le golfe qui s’avance jusque vers Aquileia et les lagunes de Grado », raconte Marie de la Tour et Taxis. Le poète séjournera même seul dans ce château au cours de l’hiver de l’année suivante.
C’est un beau matin de janvier 1912, alors qu’il se promenait dans cette propriété, que lui est « donnée » la première élégie. « Il entendit une voix qui l’appelait, raconte la princesse, une voix très proche qui disait ces mots à son oreille : Qui donc parmi les légions des anges, / qui donc entendrait mon cri… Il resta immobile, écoutant. Qu’est-ce ? murmura-t-il à mi voix… Qu’est-ce qui vient ?... Il prit son petit livret qu’il portait toujours avec lui, écrivit ces lignes et puis tout de suite, encore quelques vers qui se formaient comme involontairement... ». Marie de la Tour et Taxis avait appelé Rilke le Seraphico. « Quelle intuition extraordinaire, aussi juste qu’étrange, raconte-t-elle, et combien je le compris au plus profond de mon cœur quand l’heure fut enfin arrivée, l’heure de la seconde Elégie, l’élégie des anges, cette merveille ».
Le livre, à partir de là, évoque toute une série d’événements liés à des rencontres ou des découvertes de toute nature dont les deux protagonistes sont les témoins ou les acteurs. On les retrouve dans les grandes villes européennes, visitant des musées, des édifices religieux, s’arrêtant devant des monuments (la tombe de Pétrarque, par exemple, en Vénétie). La princesse s’inquiète pour la santé de son protégé (fragile des nerfs), note son « exaltation étrange et son regard égaré et plein d’angoisse ». Elle le reçoit aussi dans sa résidence de Lautschin en Bohême (comme un retour aux sources pour le poète né à Prague) mais aussi dans son « entresol » de Venise.
On voit ainsi, au fil des pages, le rôle essentiel joué par cette femme (nous faisant presque oublier l’autre femme de Rilke : Lou Andréas Salomé). « L’amour, le grand amour qu’il admirait tant dans les autres, écrit néanmoins la princesse, il se croyait incapable de jamais le ressentir d’un façon constante et sûre. Un moment de joie, d’enthousiasme, d’ardeur, et puis le désillusion complète, le dégoût, la fuite… ». Mais elle ajoute aussitôt : « Et pourtant il ne peut pas vivre sans avoir autour de soi l’atmosphère de la femme. Oui, j’ai été frappée souvent de l’attraction extraordinaire de la femme sur lui et de ce qu’il m’a dit souvent, qu’il ne pouvait parler qu’avec des femmes, qu’il ne croyait comprendre que les femmes et ne se plaisait vraiment qu’avec elles… »
Marie de la Tour et Taxis se trouvait à Rome au moment de la mort du poète en 1926, en Suisse. Elle écrira en français ses Souvenirs sur Rainer Maria Rilke mais le livre sera publié pour la première fois en 1933 dans une traduction allemande, puis en français en 1936 pour le 10e anniversaire de la disparition de Rilke. Voilà à nouveau ce livre entre nos mains. Il approfondit notre connaissance de l’homme Rilke (et bien sûr, aussi, du créateur). Il nous révèle également la profonde effervescence culturelle cette époque « si attirante si curieuse » comme le dit Maurice Betz dans l’avant-propos, et, à ce titre, ce livre constitue une indéniable contribution à la connaissance de l’histoire littéraire de l’Europe, sans oublier toutes les informations que les amoureux de l’œuvre de Rilke pourront y glaner.
Souvenirs sur Rainer Maria Rilke, Marie de la Tour et Taxis, Arfuyen, 185 pages, 17 euros
 |
Alexis Gloaguen, |
| Surgies |
|---|
Sous le titre laconique et énigmatique Surgies, l’auteur breton Alexis Gloaguen raconte trois expériences de vie inédites, menées pour deux d’entre elles en résidence d’écrivain : auprès de comédiens et d’artistes dans le pays de Dinan et auprès des occupants des Jardins Solidaires de Morlaix. Le troisième texte du livre évoque un lieu de mémoire, celui de la Résistance bretonne à Langoëlan dans le centre-Bretagne. Trois espaces, trois expériences que l’écriture poétique d’Alexis Gloaguen transfigure. Sous sa plume, ils deviennent des lieux de révélation. Des « surgies » en quelque sorte.
Alexis Gloaguen s’emploie, comme il le dit lui-même, à noter « les surgies provenant d’un monde qui, dans certains cas, se passerait bien de nous ». Il parle aussi de « la surgie des évidences hors du terreau des jours » ou encore de la « surgie des plantes » quand « à travers les phrases nées du jardin, on redevient habitant ». Dans ces Jardins Solidaires de Morlaix, l’écrivain va, en effet, se mettre en quête de « surgies », de ce que le poète suisse Gustave Roud appelait des « signes » et qui, à ses yeux, fondaient la poésie, « au cœur d’un monde qui ne demande qu’à répondre, interrogé, il est vrai, selon une certaine intonation de voix » (Air de la solitude, éditions L’Âge d’homme). Il y a chez Gloaguen comme chez Roud cette quête inlassable de signes.
Le lieu de résidence de l’auteur breton à Morlaix sera un vieux camion d’où il regardera avec tendresse un peuple s’ébrouer au milieu des planches de légumes, des massifs de fleurs ou des arbres fruitiers. « Ainsi on vit des signes que l’on arrange autour de soi, des recherches de chaleur qui nous redressent dans la douleur du froid ». Car, ajoute-t-il, « le jardin est un atterrissage pour ceux qui ont perdu les images-radar de leur vie ». Il et elles s’appellent Brigitte (« qui coupe l’herbe au couteau »), Nicole, Jean-Paul, Alain (« le pourvoyeur d’eau »), Esma et Ujesin, Régis… Alexis, parfois, met lui-même la main à la pâte. Ainsi aide-t-il Brigitte « à lier des fèves autour d’un grillage pour ménager une ascension vers la course du soleil ». L’écrivain en tire des leçons de sagesse. « C’est en chérissant le futile qu’on découvre l’essentiel ». Il cite Épicure pour qui « le jardin n’était pas une fuite, mais un lieu d’où revoir les choses ».
Dans le pays de Dinan, la résidence d’écrivain donnait moins l’occasion de toucher terre. C’est avant tout, pour Alexis Gloaguen, une découverte du monde du théâtre (« une révélation et un virage décisif ») et, sur les pas d’un photographe, l’opportunité de rencontres et de « moments forts du quotidien ». Il avoue même que ce fut là « une formidable leçon d’humilité » qui lui a permis de « sortir du splendide isolement de l’écrivain » et même d’affronter « un moment de déconstruction » qui le « fragilisera » un temps. « Je mesure, avoue-t-il, mon inadaptation à la vie en groupe et à la baisse de sollicitude que cela entraîne ». Bel exercice d’introspection sur la place et le rôle de l’écrivain, y compris au sein même du monde artistique.
Le troisième texte de ce livre est d’une autre nature dans son évocation du Maquis Breton et du combat de Kergoët, le 1er juillet 1944. Alexis Gloaguen parle ici d’un lieu emblématique de la Résistance bretonne situé à proximité de son propre lieu de résidence. L’auteur place l’évocation de ce lieu sous le signe du célèbre hymne Bella Ciao des Partisans italiens. « Il y a, dans l’alliance de la jeunesse et des situations désespérées, une raison d’idéaliser l’amour », écrit-il sans imaginer que, quelques mois après avoir écrit ces mots, Bella Ciao deviendrait le chant de ralliement des femmes iraniennes en lutte pour leur émancipation et leur liberté.
Surgies, Alexis Gloaguen, Diabase, 2022, 122 pages, 16 euros
 |
Christian Doumet, |
| Segalen |
|---|
Segalen. Ce simple mot pour le titre d’un livre. Segalen, autrement dit Victor Segalen, né à Brest en 1878 et décédé mystérieusement dans la forêt du Huelgoat en 1919. Christian Doumet, qui a dirigé l’édition de Œuvres de Segalen à La Pléiade, évoque dans un bel essai à la fois érudit et poétique, la destinée de ce médecin de la marine qui fut aussi le voyageur, l’archéologue et l’écrivain que l’on connaît.
Voyager avec Segalen, c’est sans doute d’abord confronter le réel à l’imaginaire. Son premier voyage date de 1902 quand il embarque au Havre pour l’Océanie (il a 24 ans). Les immémoriaux, son ouvrage de la période polynésienne, est issu de cette découverte. Mais son œuvre prendra véritablement son sens dans la rencontre avec la Chine. Il y fait trois voyages, en 1909, 1914 et 1917 (le premier interrompu par un retour-éclair en Europe en 1913).
Le livre de Christian Doumet commence par ces mots : « Victor Segalen. Marseille, 25 avril 1909, paquebot Sydney, 11 heures (…) On ne sait pas ce qui pousse un homme vers son extrême orient ». Segalen engage cette première expédition en Chine avec Gilbert de Voisins. Il rencontre sur place Paul Claudel en poste à Tien Tsin. Puis le voici à Pékin, à Chensi, sur le fleuve Yang Tseu, à Shangaï… Il écrit René Leys (intrigue aux allures policières de la vie à Pékin). Il séjourne à la frontière entre la Mandchourie et la Chine. En 1912, c’est la publication de Stèles. « On voit bien quel entêtement l’anime : celui des paysages sans doute, mais par-dessus tout celui des mots », écrit Christian Doumet.
Segalen et de Voisins, l’auteur de cet essai les voit « impuissants à rien sauver de ce qui sombre : effigies sans attribution, piliers, stèles, plus tard, chimères, temples entiers, jusqu’au tombeau que certains prennent de loin pour une simple colline ». Il tente de comprendre leur appétit de découverte. « Aimantés par quelle raisonnable curiosité ? Statuaire, archéologie, sinologie… ce sont évidemment les mots qu’ils auraient à la bouche si on leur demandait pourquoi ils marchent ». Mais Christian Doumet saisit aussi où est la faille. Segalen, en effet, n’est pas seul à cette époque à errer dans cette Chine-là jusqu’à « éprouver les tourments de la déréliction ». Or, dit-il, « Segalen s’identifie parfois à cette compagnie d’exaltés. Ne voyant pas l’obscurité dont elle l’envelopperait ».
Est-ce cette « obscurité » qui peut expliquer la fin tragique de l’écrivain breton ? À l’hôpital maritime de Brest (dont il est devenu le directeur adjoint), « le diagnostic parle une langue nébuleuse : lente neurasthénie, mélancolie d’abord chronique, enfin constante ». En forêt du Huelgoat on découvrira un homme qui « gisait sur la mousse, plongé dans un sommeil sans frayeur (…) Ce sera le dernier lieu. Lieu d’arbustes, de fondrières, de souches. Partout circulent les eaux éclairées dans le repli des roches ».
Segalen, Christian Doumet, Arléa, 2022, 100 pages, 9 euros
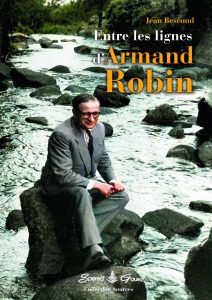 |
Jean Bescond, |
| Armand Robin entre les lignes |
|---|
Le poète et écrivain breton Armand Robin (1912 - 1961) est toujours demeuré une forme d’énigme. Écrivain inclassable, suscitant de-ci de-là des polémiques autour de sa personnalité et de son œuvre, il est reconnu aujourd’hui comme un auteur majeur. Il a fallu pour cela l’acharnement de passionnés à même d’éclairer la portée d’une œuvre protéiforme (poèmes, romans, chroniques radiophoniques...). Parmi ces passionnés, il y a le Finistérien et ancien enseignant Jean Bescond. Il témoigne de ses découvertes dans un livre regroupant des inédits et différents articles qu’il a publiés dans la revue Spered Gouez (L’Esprit Sauvage) animée par Marie-Josée Christien.
Né en 1912 à Plouguernevel, au cœur de l’Argoat, dans une modeste famille paysanne où l’on ne parle que breton, Armand Robin va brûler les étapes. Repéré comme un élève doué, il fera sa scolarité au fameux lycée de Campostal à Rostrenen où il sera, de bout en bout, « tête de classe ». Après son bac, grâce à une bourse, il intègre Khâgne au lycée Lakanal à Paris, « mais il échouera aussi bien à Normale sup' qu’à l’agrégation », raconte Jean Bescond. Il faut dire que Armand Robin n’y a pas mis du sien. Le professorat ne l’intéresse pas. Il rêve déjà d’écrire et s’intéresse aux langues étrangères.
En 1933, une bourse du Gouvernement lui permet de se rendre en Pologne puis en URSS. Maîtrisant déjà la langue russe, « il découvre non le paradis escompté, mais la réalité sordide et cachée derrière les paravents montrés aux touristes naïfs et bien encadrés de l’agence Intourist : la misère des paysans dépouillés de leurs terres, les massacres de Kiev de l’année précédente, la vie opulente et insolente des apparatchiks », note Jean Bescond. « Il revient donc de là définitivement anti-communiste ».
1935. Ce sont ses débuts littéraires à la revue Europe, à laquelle il collabore grâce à Jean Guéhenno, son ancien professeur de Khâgne. Il collabore aussi à la NRF, aux Cahiers du Sud… et entame une œuvre littéraire avec son roman Le temps qu’il fait. La période de la guerre le verra « embauché » par le ministère de l’Information et son travail consistera à rédiger un travail d’écoute des radios au gouvernement de Vichy. Mais sa situation privilégiée lui permettra de livrer en secret des informations à la Résistance. Cela ne l’empêchera pas, à la Libération, d’être inscrit sur la liste noire du Comité National des Écrivains (CNE) animé, entre autres, par le poète communiste Aragon. Toute cette période controversée de la vie d’Armand Robin est finement analysée par Jean Bescond.
Robin se situe dans la mouvance anarchiste (donc anti-communiste), ce que les poètes et écrivains installés de l’époque ne lui pardonneront pas non plus. Il collabore à la revue Libertaire où il côtoiera un certains Georges Brassens. On lira ici avec intérêt tout le travail accompli par Jean Bescond pour décrire la relation entre les deux hommes. Mais « Robin échappe à tout, note l’auteur, c’est un solitaire absolu et d’une indépendance totale et même suspicieuse ». Depuis 1945, il s’est mis à l’écoute des radios étrangères émanant surtout des pays de l’Est. Il traduit ces écoutes et les vend. « C’était son gagne-pain et il en était très fier ».
L’œuvre poétique et littéraire d’Armand Robin se mène en parallèle. On la connaît mais Jean Bescond apporte son éclairage grâce à des documents inédits. Il nous parle aussi du Robin intime, de l’amoureux, de celui qui restera fidèle à ses terres d’origine, mais aussi de l’homme colérique, passionné, intransigeant. Dans une lettre du 25 mai 1948 à son ami Roger Toussenot, Georges Brassens parlait en ces termes d’Armand Robin : « Je crois que sa position philosophique est une sorte de stoïcisme à la Camus mais en moins positif. Oui, il me semble qu’il est très au courant de l’œuvre de Kafka. D’ailleurs, il lit et écrit plus d’une douzaine de langues ». Brassens avait bien analysé l’homme Armand Robin.
Entre les lignes d’Armand Robin, Jean Bescond, avant-propos de Marie-Josée Christien, Spered Gouez, collection Sources, 2022, 110 pages, 15 euros.
 |
Gustave Roud, |
| Œuvres complètes |
|---|
Un coffret de 4 volumes, 5120 pages, 88 photos couleurs et de très nombreuses illustrations noir et blanc (car Gustave Roud était aussi photographe). Les œuvres complètes du grand poète suisse sont publiées par les éditions Zoé. Une heureuse initiative permettant de regrouper ses œuvres poétiques (dix recueils de poésie entre 1927 et 1972), ses traductions (notamment de Novalis, Hölderlin, Rilke, Trakl…), son Journal (1916-1976) ainsi que les articles ou études critiques que Roud a consacrés, tout au long de sa vie, à des poètes, écrivains et peintres et qui ont été publiés par des journaux ou revues suisses
« Gustave Roud regarde la nature à l’œil nu et la nature ne le distrait pas », disait de lui Jean Paulhan en 1957. Ce marcheur impénitent qu’était Gustave Roud, parcourant sans relâche les champs et les collines du Haut-Jorat, est l’auteur d’une prose lyrique envoûtante qui témoignera, de bout en bout, de sa relation intime avec le vivant et l’élémentaire : les fleurs, les arbres, les oiseaux, les étangs, les rivières… au cœur d’un monde rural que la modernité n’a pas épargné : « Des vergers aux forêts, tout un cloisonnement de haies, jadis, donnait refuge aux oiseaux. Où trouvent-ils retraite, maintenant qu’un immense espace nu rayé de jeune blé, taché d’orge laineuse unit les villages épars ? », écrivait-il le 18 décembre 1941 dans la revue L’illustré.
Le poète allie deux perceptions de la vie et du monde. D’une part un sentiment aigu de la précarité de nos existences, de la mort, de la disparition (à l’image de cette civilisation paysanne qui brille de ses derniers feux). D’autre part, le sentiment de la beauté du monde et de la présence, autour de nous, de miettes de paradis. Gustave Roud avait, en effet, repris à son compte la fameuse injonction de Novalis : « Le paradis est dispersé sur toute la terre et nous ne le reconnaissons plus, il faut en réunir les traits épars ». Au cœur de son entreprise poétique, il y a, fondamentalement, cette quête de signes et de messages qui lui donnent la certitude d’un accès au paradis. « À la fois chant du monde et méditation sur la fin de la ruralité traditionnelle, la poésie de Roud apparaît aujourd’hui comme précurseur des écritures contemporaines qui tentent de renouer le lien défait entre l’humain, son habitat terrestre et les vies qui le peuplent », n’hésitent pas affirmer les instigateurs de la publication de ses œuvres complètes.
Ce regard « familier » sur les disparus, mais aussi cet appétit pour le « dehors », pour la nature dans ses expressions les plus diverses, on les trouve en permanence chez Roud. « Merveille de pureté cette matinée où j’avance à travers les prairies multicolores, les ombres fraîches, les feuillages (…) les fleurs se tendent vers moi comme des corps affamés de tendresse » (Essai pour un paradis). Dans un livre où il évoque la mort de sa mère et le deuil, le poète écrit : « Je pose un pas toujours plus lent dans le sentier des signes qu’un seul frémissement de feuilles effarouche. J’apprivoise les plus furtives présences ».
S’il a vécu solitaire, Gustave Roud a su multiplier les rencontres en allant à la découverte des œuvres des autres. Qu’il s’agisse d’auteurs dont il cultivait l’amitié (Jaccottet, Chessex…) ou d’artistes dont il a parlé avec bonheur. « En cherchant à cerner le rapport particulier que les artistes abordés entretiennent avec le monde, l’auteur questionne sa propre position et, à travers ces cas spécifiques, il médite sur le processus créatif en général. Rendre compte d’expériences esthétiques nourrit la démarche du poète et l’exercice de la poésie infléchit en retour son regard sur les œuvres d’autrui », note Bruno Pellegrino dans la présentation des hommages, articles et études critiques que Roud a consacrés à des poètes écrivains et peintres.
Plus de 45 ans après la mort du poète, ce coffret des œuvres complètes (dans une édition critique) est là pour nous rappeler la place majeure tenue par Gustave Roud dans la vie culturelle de son époque et rendre justice à un œuvre lyrique majeure dans la poésie francophone du XXe siècle.
Œuvres complètes, Gustave Roud, éditions Zoé, 5120 pages, 85 euros, 90 CHF
 |
Liza Kerivel, |
| Nos |
|---|
Trois lettres pour un titre de livre de poésie. Ce « Nos » un peu énigmatique nous renvoie au quotidien de nos existences. Liza Kerivel a pris le parti de la « jouer collectif ». En parlant d’elle, elle parle de nous tous (mais sans doute un peu plus des femmes), truffant son texte d’expressions bien connues de la conversation courante. On y entre, en tout cas, de plain-pied.
Si l’on convient que « la forme dit le fond », alors on peut l’affirmer sans conteste pour ce livre. Les 65 poèmes présentés ici sont comme des blocs compacts, composés chacun de 8 lignes et demi très précisément. Pas de ponctuation, pas de blanc pour retrouver sa respiration. Manière sans doute pour Liza Kerivel (elle vit dans la région nantaise) de souligner la façon dont la vie nous happe et de pointer du doigt « le vertige de nos existences » comme le dit si justement Albane Gellé dans la préface de ce livre. Voici donc « nos semaines par-dessus la tête plus vite plus vite » ou « nos instants volés nos actes manqués ». Dans les mini-tableaux poétiques de Liza Kerivel (« précipités de réel », note encore Albane Gellé) il y a toujours une forme d’urgence et cette conscience aiguë du parcours chaotique de nos vies : « Nos dédales de tournants décisifs pas encore décidés nos situations de plus en plus complexes à force de bifurquer nos labyrinthes de mini-torts… », raconte Liza Kerivel.
Ce qui fait profondément l’originalité de ce livre, c’est le recours par l’autrice à des formules bien connues de nos bavardages quotidiens. Indiquées en italique au cœur du poème, elles en sont en quelque sorte le pivot. Leur surgissement dans le texte donne finalement cette respiration et ce recul qui permettent de prendre une forme de distance (parfois mâtinée d’humour) avec nos existences pressées. « Nos entorses à la règle nos lésions faute de mieux nos corps meurtris mais peut mieux faire nos services de grands brûlés elle prend tout au premier degré de toutes façons nos vexations nos fractures ouvertes ». Ou encore ceci, filant la métaphore apicole : « Nos tailles de guêpes nos bourdonnements d’oreilles elle a été piquée au vif nos reines d’un soir nos ouvrières en trois-huit… »
On pourrait ainsi faire un « inventaire à la Prévert » de toutes ces phrases (en italique) qui ponctuent nos vies et qui en disent long : « C’était une simple visite de routine », « vous cherchez un modèle en particulier », « mais ils se prennent pour qui ? », « j’ai coupé court à la conversation », « C’est moi ou il fait froid », « le pauvre avait totalement perdu le nord », « enchanté de faire votre connaissance », « tu vas me parler autrement »… Avec parfois en toile de fond, une critique acerbe de nos « sociétés de l’indécence » et de nos « réseaux antisociaux ».
Cet inventaire des bruits de fond de la vie (après son Inventaire des silences publié en 2010 aux éditions MLD) n’est pas sans rappeler certaines intonations des poèmes de François de Cornière, ponctuant lui aussi d’expressions courantes certains poèmes de son recueil ça tient à quoi (Le Castor astral, 2019). « Cette nuit tu as parlé en dormant », « J’ai pas été trop longue », « Il y a combien d’années déjà ? »… Mais la tonalité n’est pas la même chez les deux poètes. Il y a chez Liza Kerivel une forme douce de désenchantement. Beaucoup de « bagages trop lourds » de « trop pleins » de « fortes tensions ». Mais elle nous dit aussi, au passage, « Y a pas de quoi en faire tout un foin ».
Nos, Liza Kerivel, éditions Diabase, 2022, 80 pages, 12 euros.
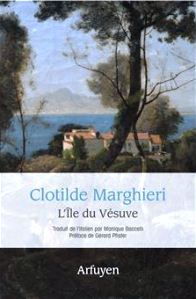 |
Clotilde Marghieri, |
| L’île du Vésuve |
|---|
C’est son premier livre traduit en français. L’écrivaine italienne Clotilde Marghieri (1897-1981) y raconte son séjour dans une propriété adossée au Vésuve, face « au superbe décor du golfe » de Naples. Un exil volontaire qui durera six ans, loin des convenances de la haute société bourgeoise dont elle est issue, au contact d’un milieu rural qui ne manquera pas à la fois de la surprendre, de l’émerveiller mais aussi de la décevoir.
1933. Clotilde Marghieri (elle a 36 ans et elle est mariée depuis 13 ans à un avocat) quitte Naples pour vivre dans la villa de son père sur les flancs du Vésuve, à Santa Maria la Bruna, villa à laquelle elle donne le nom de son ancien collège La Quiete. « Choix audacieux que cet exil campagnard qui choque aussi bien la bonne société napolitaine que sa propre famille », note l’éditeur et auteur Gérard Pfister en préfaçant ce livre. Clotilde Marghieri est une jeune femme cultivée qui a étudié le latin et le russe et qui dévore les auteurs français. Parmi ses références, il y a Colette et Madame de Sévigné. Elle va raconter cet épisode particulier de sa vie dans 28 courts chapitres regroupés sous le titre Vita in villa, ce qui sera son premier livre simplement publié en 1960 en Italie (et aujourd’hui en France sous le titre L’île du Vésuve).
« J’ai découvert la merveilleuse et simple vie des champs », raconte-t-elle dans le premier chapitre de ce livre. Elle vit entre pinèdes et vignes dans le voisinage de la Villa della genestre (la villa des genêts) où le poète Leopardi trouva refuge à la fin de sa vie. Clotilde Marghieri, qui reçoit sur place beaucoup d’amis italiens ou étrangers, mesure vite la difficulté de s’intégrer dans ce monde qui « regarde, écoute, épie ». Elle est facilement désarçonnée par certaines réactions d’hostilité (quand on clôture, par exemple, une pinède proche de chez elle) mais, en même temps, elle aborde avec une certaine empathie les coutumes locales, qu’il s’agisse de l’utilisation de l’eau, des rites funéraires, ou du « cadeau de la mariée ».
Elle se dit aussi sensible à l’expression locale du langage, à sa « rigueur contrôlée ». Ce monde campagnard, qu’elle côtoie, affiche à ses yeux une « peur presque révérentielle des mots, aujourd’hui où le carnaval journalistique en a déclenché l’inflation en les jetant, à tort et à travers, comme des confettis de toutes les couleurs ». C’est l’un des aspects les plus intéressants de ce livre. « C’est comme si l’on redécouvrait, sous l’écorce de l’usage, l’éclat originel du verbe », écrit Clotilde Marghieri, livrant ici un regard original et pertinent sur « l’imparable valeur des mots » au sein d’un monde volontiers qualifié de frustre. Tout cela est bienvenu et sûrement utile pour l’écrivaine en devenir qu’elle est.
Mais il est un autre regard sur son époque que révèle cette Île du Vésuve. Clotilde Marghieri découvre en effet le gâchis (on dirait aujourd’hui « environnemental ») lié à l’occupation de l’espace et aux nouvelles constructions aux pied du Vésuve. « Dans mon enfance, note-t-elle, cette région était exactement comme au temps de Leopardi, quand le poète marchait dans ses sentiers (…) De ma maison à la sienne coulait alors un fleuve de pins, au milieu de vignes riantes, de vergers dorés de chrysomèles et du frémissement de quelques peupliers ». Aujourd’hui, se désole-t-elle, « la terre, cette belle et merveilleuse terre, s’appauvrit en arbres, en nids, en ombres fraîches ». Et que dire de toutes ces maisons neuves où, devant chacune d’entre elles, on trouve de « minuscules jardins, emprisonnés dans des grillages, comme dans les petits pavillons des faubourgs de Londres ».
On croit entendre ici la voix de Hermann Hesse, dans sa thébaïde de Montagnola, au cœur du Tessin. « À la place des fleurs des champs, des vignes et des figuiers, s’élèvent des clôtures en fil de fer protégeant des petites maisons de banlieue aux couleurs criardes. C’est un mal rampant qui monte vers nous sans relâche de la ville et de la vallée », écrivait le grand auteur suisse d’origine allemande peu de temps avant sa mort en 1961. Avait-il lu Clotilde Marghieri ? Leur sensibilité commune à la nature saute en tout cas aux yeux.
L’île du Vésuve, Clotilde Marghieri, traduit de l’italien par Monique Baccelli, préface de Gérard Pfister, Arfuyen, 2022, 192 pages, 17 euros
Lectures de 2022
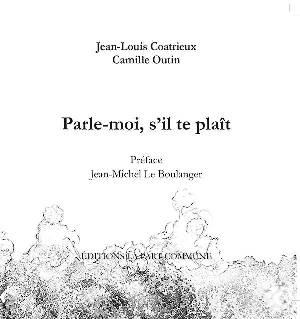 |
Jean-Louis Coatrieux et Camille Outin, |
| Parle-moi, s’il te plaît |
|---|
Il peut arriver que l’actualité accorde un relief particulier à un ouvrage de poésie. C’est le cas avec le livre du Rennais Jean-Louis Coatrieux et de la plasticienne Camille Outin. À l’heure des péripéties liées aux phénomènes migratoires en Méditerranée, à l’heure aussi des exils forcés liés à la guerre en Ukraine ou de la barbarie qui s’impose en Syrie ou en Afghanistan, voici des textes et des peintures qui prennent le parti de l’empathie pour tous les exilés de la terre. Le produit de la vente du livre est destiné à soutenir Utopia 56, une association de mobilisation citoyenne qui vient en aide aux personnes exilées ou sans-abri.
Jean-Louis Coatrieux avait déjà manifesté l’intérêt particulier qu’il accorde aux réfugiés et demandeurs d’asile dans un recueil paru en 2018 aux éditions Riveneuve sous le titre Cours Mounia, sauve-toi. Il évoquait le sort d’une fillette condamnée à l’exil. Elle s’appelait Mounia et c’est la guerre en Syrie qui constituait la toile de fond de son récit poétique. L’auteur rennais prenait le parti de l’ellipse et de l’épure pour parler des exilés et de la triste destinée de certains d’entre eux. Quelques vers, des poèmes courts de cinq à six lignes pour dire l’insupportable.
Il renouvelle cette pratique d’écriture dans son nouveau livre en se plaçant, de nouveau, dans le sillage d’une petite fille qui a quitté son pays d’origine. « Une enfant sans regard (…) Les mots / Les mots mouraient en silence / sur ses lèvres », écrit le poète. « À quoi bon un destin / S’il faut toujours / Se cacher ». Comme dans son précédent livre sur les réfugiés, Jean-Louis Coatrieux évoque les jours heureux, ceux d’avant l’exil. « Hier encore / Je voyais / Des champs de blé / À perte de vue / Mes rêves alors / avaient aussi besoin des jours ». Ces champs de blé pourraient bien être ceux de l’Ukraine, mais « Où aller / Dans quel pays / Si demain / N’est plus rien / Une poignée de terre ».
La jeune artiste plasticienne rennaise Camille Outin accompagne de ses aquarelles les poèmes de Coatrieux. Les silhouettes évanescentes, fantomatiques, qu’elle nous laisse entrevoir dans ses tableaux, sont une merveilleuse illustration de ces destins plongés dans l’incertitude, sous des cieux forcément incertains. « L’artiste façonne avec délicatesse des bulles d’espoir dans une histoire qui continue de s’écrire », pouvait-on lire dans la récente exposition de ses travaux à la Conciergerie d’art de Rennes. « Dans ses aquarelles, délicates, qui parlent de la douleur, qui évoquent et ne soulignent rien, on entend le silence, on voit l’absence », écrit pour part Jean-Michel Le Boulanger dans la préface de ce très bel album.
Parle-moi, s’il te plaît Jean-Louis Coatrieux,Camille Outin, Éditions La Part Commune, 81 pages, 25 euros
Ce livre n'est pas diffusé en librairie. Pour se le procurer, il suffit de faire un don de 100 euros au nom d'Utopia 56 et d’envoyer le chèque à l'adresse de l’auteur : Jean-Louis Coatrieux, 12, allée Kerguelen, 35200 Rennes. Avec coordonnées complètes et e-mail pour recevoir un reçu fiscal permettant de déduire 75 euros au titre des impôts.
 |
Gérard Le Gouic, |
| Lettres de Bretagne et d’ultimes chagrins |
|---|
80 poèmes de sept vers chacun, écrits entre le 21 octobre et le 28 novembre 2021, empreints de nostalgie, de regrets, de chagrins, voire même de désespoir. Faut-il voir dans ce nouveau recueil de Gérard Le Gouic (86 ans) une forme de testament ? Le poète s’adresse ici à la femme aimée (« la Grande Disparue »). Il lui dit son amour. Il nous montre à quel point il demeure imprégné de sa présence. Le disant, il fait défiler diverses séquences de sa vie, depuis l’Afrique où il a vécu jusqu’à sa demeure cornouaillaise de Kermadeoua dans l’arrière-pays de Pont-Aven.
Devenu « dernier veilleur / de la maison douloureuse », comme il le disait déjà en 2016 dans son livre Je voudrais que quelqu’un (Telenn Arvor), Gérard Le Gouic prend ici le parti d’introduire chacun de ses poèmes par les mots « je t’écris » : anaphore qui rythme son propos et révèle, par ricochets, le côté obsessionnel de sa quête. Ainsi défilent les « Je t’écris de l’érable », « du chemin creux », « de la cécité des choses », « de la nuit bretonne », « du pays où je te rejoindrai », « de mon dernier jour »… Chaque amorce de poème est déjà tout un poème.
Xavier Grall dans Solo, son livre testament, s’adressait à son Seigneur en lui disant qu’il venait de « Petite Bretagne ». Gérard Le Gouic, lui, nous dit qu’il vient de « Bretagne basse / si basse que les champs s’abreuvent à la mer / que ses talus ondulent suivant les vagues… ». Cette Bretagne, « un pays qui fut toujours le tien / que tu ne quittas pas », dit-il à la disparue. « Je t’écris de la Bretagne / je t’écris de mon chagrin, / de la maison vide comme le ciel (…) Je t’écris comme on égrène / le chapelet du temps aux grains usés ». Plus loin, il dit : « Je t’écris de ma peine / de ma tristesse qui se dilue ».
Comment ne pas penser, le lisant, à ce dialogue que Hélène Cadou avait engagé avec René Guy, son grand disparu. « Ici j’écris / En ce temps / En ce lieu / Mais c’est une autre chambre que j’habite / À l’étage du dernier froid » (J’ai le soleil à vivre, éditions Bruno Doucey). Derrière le chagrin, il y a chez les deux poètes ce souvenir d’une « patrie commune » (Le Gouic) et d’une « mémoire où tout s’apaise » (Cadou). Le ciment de cette « patrie » et de cette « mémoire » est bien l’amour. « Je t’écris de l’amour » écrit le poète breton. « Je t’écris de la poésie », dit-il aussi. Car l’un ne va pas sans l’autre. Chez Cadou comme chez Le Gouic.
Lettres de Bretagne et d’ultimes chagrins, Gérard Le Gouic, Diabase, 2022, 93 pages, 13 euros
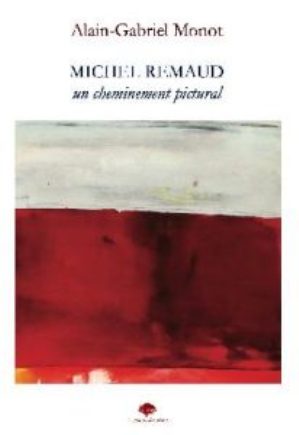 |
Alain-Gabriel Monot, |
| Michel Remaud, un cheminement pictural |
|---|
Comment devient-on un artiste-peintre ? À chacun, sans aucun doute, son cheminement propre. L’écrivain et universitaire Alain-Gabriel Monot nous raconte celui du Cornouaillais Michel Remaud dont l’œuvre, nous dit-il, « n’a cessé de s’étoffer et de s’affirmer », passant par petites touches du figuratif à un non-figuratif où s’affirme « une forme de géographie intérieure ».
Il a mené une carrière de professeur d’anglais au lycée du Likès de Quimper. Michel Remaud attire aujourd’hui l’attention sur lui pour d’autres raisons : la qualité de son œuvre picturale. Mais que de chemin parcouru depuis Rennes (où il est né en 1948) ! Alain-Gabriel Monot évoque avec précision et empathie tous ces moments-clés qui vont forger, à bas bruit, un tempérament d’artiste. Les voyages et la découverte y sont pour beaucoup avec une inclinaison particulière pour les États-Unis où le jeune Michel accomplira un road-movie en compagnie de son amoureuse Christiane. Il y a aura aussi la coopération militaire en Algérie et la séduction des formes épurées du désert.
À cette époque Michel Remaud photographie plus qu’il ne peint (le livre publie plusieurs de ses clichés) même si son tempérament d’artiste, repéré très jeune, le fait pencher vers la peinture, surtout depuis la découverte de l’œuvre de Bonnard qui demeurera sa référence. « De 1982 à 1992, Michel cherche sa peinture et son langage », raconte Alain-Gabriel Monot. Il fait se gammes. Mais il doute. Jusqu’à cette forme de révélation : « La voie figurative est pour lui une impasse ». Un galeriste quimpérois, Patrick Gaultier, accueille ses premiers tableaux non-figuratifs. Parallèlement, il retrouve « le pays blanc » de la région de Guérande (où il passa, jeune, des vacances), « lieux abstraits, géométriques, fruit du travail des paludiers ». Et Michel Remaud « s’engouffre dans ce quelque chose qui pourrait nourrir ce qu’il cherchait en peinture et intègre dans ses motifs la géographie des marais ».
Le voilà propulsé, trouvant appui et nourriture dans la musique baroque (dont il apprécie « l’énergie », « le mysticisme » et « l’abstraction ») mais aussi dans l’œuvre d’Edmond Jabès dont « l’écriture fragmentaire » et « les mises en abîme des récits le fascinent ». D’où son penchant progressif pour des travaux associant peinture et littérature. C’est la voie royale pour ce qui sera désormais sa principale « marque de fabrique » : le livre d’artiste. L’occasion de rencontres avec des auteurs, le plus souvent poètes, aussi prestigieux que Guy Goffette, Jean-Michel Maulpoix, Dominique Sampiero, Philippe Le Guillou, Pierre Bergounioux… (sans oublier des auteurs bretons qui lui confient aussi certains de leurs poèmes). La qualité de ses très nombreux livres d’artistes lui vaut d’ailleurs, aujourd’hui, la création d’un fonds Michel Remaud à la médiathèque de la ville de Quimper.
Mais « l’histoire n’est pas finie », note avec justesse Alain-Gabriel Monot qui ne manque pas « d’observer avec le recul des années une évolution dans le travail du peintre et on regard sur le monde ». Selon lui, « sa peinture a eu tendance à délaisser la géométrie initiale pour aller vers un traitement plus “atmosphérique” de ses champs colorés (…) Son cœur et sa peinture se sont largement imprégnés de l’environnement breton, de ses couleurs, de ses ciels inouïs, de sa littérature… » À découvrir dans ce très beau livre, magnifiquement réalisé, où l’on retrouve de nombreuses peintures de l’artiste breton.
Michel Remaud, un cheminement pictural, Alain-Gabriel Monot, L’enfance des arbres, 2022, 138 pages, 22 euros
 |
Bernard Berrou, |
| Frontières d’Irlande |
|---|
Le Breton Bernard Berrou sait l’Irlande sur le bout des doigts. Il parcourt ce pays depuis des années et le dit dans des livres qui font référence. Mais jamais il n’avait abordé son sujet avec autant de regard critique. Il faut dire que l’actualité du Brexit lui a fourni un menu de choix en le conduisant à la frontière des deux Irlande. Son témoignage prend alors l’allure d’un reportage à haute valeur journalistique, doublé de cet art consommé du récit qu’on lui connaît.
Profondément enraciné dans son Pays bigouden, Bernard Berrou a aussi rêvé de vivre en Irlande. « Un mirage qu’auraient agrémenté de belles histoires amoureuses avec des Irlandaises rousses au teint de pêche », raconte-t-il, avec malice, dans son nouveau livre. Le mirage est resté un mirage car « La verte Erin » n’est pas forcément un pays de cocagne. La faute à la météo d’abord mais aussi, et surtout, à toutes ces dérives que l’écrivain pointe du doigt, à commencer par celles d’une société imprégnée d’un catholicisme rétrograde. On le voit ainsi, dans son périple, faire un détour par Tuam, à 50 km au nord de Galway, là où furent découverts les squelettes de 796 enfants (nés de viols ou de relations hors-mariage), morts de maladie dans un orphelinat tenu par des religieuses. Rejoignant Galway, Bernard Berrou n’a pas de mots assez durs pour décrire cette ville emblématique de l’Irlande qui ressemble aujourd’hui à ces « milliers de villes dans le monde qui ont subi une uniformisation déshumanisée sous le rouleau compresseur de l’économie de marché ».
Car l’Irlande (« le tigre celtique ») a bien changé. Ce n’est plus seulement le pays des prés verdoyants tombant dans la mer, des parties de pêche dans des rivières cascadant sur les rochers, de pubs où l’on s’enivre de musiques du pays. Aujourd’hui les jeunes générations préfèrent acheter des cannettes de bière dans les supermarchés plutôt que de déguster une bonne Guinness au comptoir d’un pub (question de pouvoir d’achat).
De nouvelles frontières se créent donc qui fracturent la société irlandaise. Entre vieux et jeunes notamment. Entre ceux qui s’accrochent à la préservation de l’identité d’un pays et ceux qui adhèrent à cette uniformisation à marche forcée que l’aide massive de l’Europe a permis d’instaurer. Alors l’auteur persiste à gamberger sur « les douces collines oblongues du comté de Clare » tout en assistant, résigné, à l’émergence de ces temples « du réconfort et de la convivialité, palais du sucre d’orge, du coca-cola et de la frite saucisse ». L’Irlande n’est plus tout à fait dans l’Irlande et Bernard Berrou le dit aujourd’hui sans ambages, regrettant ce lent effritement culturel d’un pays chanté par William Butler Yeats, Seamus Heaney, John Mac Gahern, sans oublier le Français Michel Déon dont l’auteur rappelle ici la figure.
C’est dans ce nouveau paysage économique et culturel que surgit la question, liée au Brexit, de la frontière entre les deux Irlande (310 points de passage sur 500 km). Bernard Berrou est donc allé sonder les cœurs des deux côtés de la frontière. « A Belleek, écrit-il, je franchis une frontière sans barrières, sans douanes, située quelque part au milieu du pont sur la rivière Erne ». Puis son road movie (de pub en chambres d’hôtes, par les chemins buissonniers et les petites routes boueuses) le conduit à Pettigo, une ville située à moitié dans le Donegal et l’autre moitié dans le comté de Fermanagh (Ulster). Son hôtesse du jour, Michelle Lavin, se confie : « Si la frontière se referme, vous savez ce qui arrivera ? Il me faudra un passeport pour aller cueillir mes haricots » (son potager est en Ulster). « Retrouver un checkpoint, c’est inimaginable, c’est juste impossible », s’exclame Clara, « une jolie blonde au sourire énorme, employée au Doherty’s » dans le village-rue de Bridgend.
Autre son de cloche, celui de Billy Smith, l’étrange prédicateur orangiste que l’auteur rencontre chez lui. « L’heure est venue de nous protéger contre tous ceux qui souhaitent la disparition de l’Irlande du Nord ». L’homme affirme être celui qui « perpétue le mieux la pensée de Ian Paisley ». Mais lassé de ses « déclamations exaltées », Bernard Berrou prend congé et « laisse un grand vent balayer les miasmes proférés » par son interlocuteur. Il ajoute : « En ce point ultime, tout m’arrache au fanatisme des Orangistes, au concept de frontières, aux déchirures, aux passions tristes des colonisations et des conflits religieux ». L’auteur nous rappelle en tout cas, dans son livre, que « le Brexit se joue dorénavant autour de la seule frontière terrestre dont le Royaume-Uni dispose avec l’Union européenne ». Son passage à Derry (« cité sainte de l’Ulster protestant ») lui fera mesurer l’ampleur du problème même si le message de fond, perçu sur place, est celui d’une « population qui ne souhaite plus que de vivre en paix ».
Frontières d’Irlande, Bernard Berrou, éditions Le Mot et le Reste, 2022, 186 pages, 19 euros
 |
François Cassingena-Trévedy, |
| Propos d’altitude |
|---|
Il est moine bénédictin, théologien, spécialiste de la tradition liturgique et des Pères de l’Église. Il vit aujourd’hui une forme d’érémitisme dans les hautes terres du Cantal, au contact de la nature et d’un monde paysan dont il partage l’existence. François Cassingena-Trévedy est aussi écrivain. Depuis des années il distille, dans des livres, des graines de sagesse qu’il appelle « Étincelles ». En voici le 5e tome, sous le titre Propos d’altitude (2016-2020) où l’on voit se succéder, dans le déroulement de l’année liturgique, aphorismes, pensées, maximes, proses poétiques, méditations… Le tout dans une fidélité sans failles à la parole du Christ, mais avec l’art de bousculer toutes les certitudes.
L’altitude dont il est question ici fait référence, sans aucun doute, à ces montagnes auvergnates depuis lesquelles frère François s’exprime. Mais il ne faut surtout pas y voir, de sa part, l’opportunité d’exprimer un point de vue en surplomb. Cette altitude « elle est toute géographique et simplement terrestre », souligne l’auteur. Apprécier l’altitude, parce qu’elle est le lieu « d’épanouissement du regard » et de « dilatation du souffle », sans oublier « la raréfaction du bruit ». Plus fondamentalement, ajoute frère François, c’est le lieu où « le soi se transcende » mais, précise-t-il, « ce qui est difficile, ce n’est point de monter, mais de redescendre. Redescendre en traitant chaque degré inférieur – plus bas, toujours plus bas – comme une altitude ». Vivre l’incarnation.
Vivre en altitude, c’est aussi « vivre dans l’interrogation ». Car c’est bien une interrogation foncière qui parcourt ce livre. Comme affronter « l’événement majeur » que constitue « l’effondrement de tout un paysage religieux » ? François Cassingena-Trévedy n’y va pas par quatre chemins pour défricher le terrain. Il parle « d’état d’urgence » face à « la grande déroute de nos repères familiers, des institutions séculières, des idéologies concurrentes, des systèmes religieux inertes et, plus menaçante encore que tout cela, de la destinée planétaire elle-même ». Frère François n’est pas là pour établir un programme d’action (fût-il catholique). Il interpelle, il chemine (comme il l’avait fait dans cette traversée du Cézallier racontée dans Cantique de L’infinisterre, éditions Desclée de Brouwer). Il chemine et nous propose de cheminer avec lui. De commencer par se poser les bonnes questions, lui qui n’a jamais quitté l’Église car il pense qu’on ne vit pas sa foi tout seul et qu’on a besoin de frères et de sœurs. Mais c’est le même homme qui nous dit que « l’heure est venue de reconnaître, sans honte ni horreur, l’agnostique qui nous habite, l’agnostique que nous sommes bel et bien devenus sous la nécessité d’un crépuscule universel qui nous environne et qui nous envahit ».
Pour sortir de ce crépuscule, il faut des étincelles. « Toute étincelle est célébration », dit-il, et il s’explique. « Partout où il y a célébration (…) il y a une étincelle possible. Aussi est-ce l’instinct de célébrer – de découvrir, partout et en tout, matière à célébration – qui est à entretenir sans cesse en nous ». Célébration, on l’a compris, de ce que la vie nous offre de plus beau, en commençant par le plus élémentaire, le plus insignifiant, le plus humble qui soit (« remplacer l’exploitation de la nature par l’admiration de la nature »). Oui, honorer le très-bas. François Cassingena-Trévedy s’en fait lui-même l’apôtre, de-ci de-là, dans les intonations poétiques qui ponctuent son livre : « À travers le feuillage noir des frênes, amis de l’humide, monte, vibrante et muette, la grande rose trémière de la lune ; son averse laisse un givre d’argent sur l’herbe, contre les troncs ».
Ce que nous propose au fond le frère François (dans le sillage d’un autre François, d’Assise celui-là) c’est « le réenchantement d’un monde qui a passé un seuil irréversible de désenchantement ». Il parle de « tâche personnelle et collective » à engager d’urgence loin des crispations religieuses identitaires, loin des « routines somnolentes » ou des « fanfaronnades réactionnaires ». Et son diagnostic est implacable : « Le décor du christianisme est mort : le cœur du christianisme commence seulement de battre ».
Propos d’altitude, François Cassingena-Trévedy, Albin Michel, 2022, 245 pages, 21,90 euros
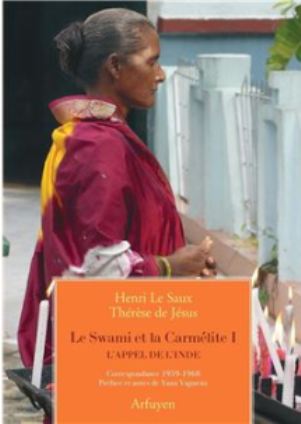 |
Yann Vagneux, |
| Le swami et la carmélite, L’appel de l’Inde |
|---|
Le « swami » (guide spirituel en Inde), c’est le Breton Henri Le Saux, moine au cœur de l’hindouisme. La carmélite, c’est la Mayennaise Thérèse Lemoine, sœur Thérèse de Jésus en religion, qui décida de rejoindre le moine breton en Inde. Leur correspondance – plus de 700 pages de lettres – vient d’être retrouvée par Yann Vagneux, prêtre des Missions étrangères. Elle est riche d’enseignements sur le regard que pouvaient porter le bénédictin et la carmélite sur le rôle de l’Église et plus généralement sur celui de la foi chrétienne dans les terres dites de mission. Elle nous montre l’approche qu’avaient ces deux religieux catholiques d’un dialogue interreligieux approfondi qui aille au-delà des discours convenus pour faire converger les grandes voies spirituelles de l’humanité.
Henri Le Saux était né à Saint-Briac en 1920. Moine de l’abbaye morbihannaise de Kergonan, après des études au séminaire de Rennes, il avait quitté la Bretagne en 1948 et épousé la spiritualité hindoue (tout en continuant à dire la messe) en fondant un ashram (ermitage) avec l’abbé Montchanin qu’il avait rejoint en Inde. Revêtu d’étoffes safran, il vécut ermite et connut aussi des années d’errance. Il est mort en Inde en 1973. « L’Inde est une maîtresse merveilleuse de contemplation », écrivait Henri Le Saux dans une lettre du 23 novembre 1959. Et il ajoutait : « Le Carmel, du moins tel que je le comprends, est certainement un des points de rencontre possibles entre l’Inde et l’Église, pourvu qu’il soit très ouvert, non une petite chapelle ». Le religieux breton le disait dans sa première lettre à sœur Thérèse de Jésus, carmélite à Lisieux, qui n’arrivait pas à satisfaire une vraie soif d’absolu au sein de son institution et rêvait de pouvoir, un jour, s’investir en Inde.
La carmélite Thérèse Lemoine, née en 1925, était une fille de paysans de la Mayenne. Entrée au carmel de Lisieux en 1947 sous le nom de Thérèse de Jésus, elle allait connaître l’existence et l’itinéraire spirituel de Henri Le Saux grâce à la supérieure de son carmel. Une correspondance s’est engagée entre le Swami et la carmélite, révélant une femme d’une grande maturité à la fois intellectuelle et spirituelle, profondément consciente des enjeux de l’Église de son temps.
L’un comme l’autre souhaitaient une Église qui soit plus attentive à l’approche mystique (celle de maître Eckhart, de Tauler, et, donc aussi, celle de l’hindouisme) et aussi plus soucieuse d’épouser la spiritualité des peuples dans lesquels elle était amenée à vivre. Thérèse de Jésus ne verra ses vœux de rejoindre l’Inde exaucés qu’en 1967 : elle intégrera le carmel de Pondichéry avant de retrouver Henri Le Saux et de vivre elle-même en ermite. « Je ne voudrais pas venir en Inde pour enseigner mais d’abord pour être enseignée et me faire toute réceptive », écrivait la jeune carmélite dans une lettre au swami Henri Le Saux le 25 mars 1962. Avec, en écho, les mots de ce dernier dans une lettre du 24 octobre 1966 : « Il ne s’agit pas d’adapter à l’Inde telle ou telle forme chrétienne, bénédictine, carmélite, dominicaine… mais d’ouvrir toute grande la porte de l’Église au vent de l’Esprit qui souffle dans et par l’Inde ».
Henri Le saux, qui prendra le nom de Abhishiktananda dans sa vie d’errance, ira très loin dans cette démarche. Il deviendra une forme d’hindou chrétien et son expérience mystique impressionnera de nombreux prêtres et religieux, à commencer par le prêtre et écrivain breton Jean Sulivan (né à Montauban-de-Bretagne en 1913) qui lui rendra visite dans son ashram. Thérèse de Jésus, elle, disparaîtra sur les bords du Gange en 1976 sans laisser de trace, noyée ou assassinée.
Le swami et la carmélite, L’appel de l’Inde (tome 1, correspondance 1959-1968), Henri Le saux, Thérèse de Jésus, préface et notes de Yann Vagneux, Arfuyen, 2022, 260 pages, 19,50 euros. 2ème tome à paraître sous le titre L’appel
 |
Pierre Adrian, |
| Que reviennent ceux qui sont loin |
|---|
Un été en Bretagne sur la côte des abers du nord-Finistère. Pierre Adrian raconte la grande maison de famille qui accueillait chaque année sa parentèle, depuis la grand-mère jusqu’au tout dernier-né. Il signe ici un roman sur l’esprit de famille et aussi sur le passage de l’enfance à l’âge adulte. Avec toujours, en toile de fond, les odeurs et les saveurs du pays de Léon.
Pierre Adrian est un jeune auteur de 31 ans qui a notamment écrit Les âmes simples (publié aujourd’hui en Folio) ainsi qu’un livre remarqué sur Pasolini (La piste Pasolini, Les Équateurs). C’est déjà un écrivain fécond dont l’intérêt pour la Bretagne ne se dément pas. On le sait notamment sensible à la poésie de Xavier Grall puisqu’il a préfacé une réédition de L’inconnu me dévore aux éditions Les Équateurs. Le voici aujourd’hui, de nouveau, de plain-pied en Bretagne avec ce nouveau roman publié dans « la blanche » de Gallimard.
L’auteur nous fait pénétrer dans l’intimité d’une famille qu’un jeune homme rejoint pour passer le mois d’août. Il débarque dans cette grande maison qui réunit tout le monde, chaque année, le temps d’un été. Gamin, il y passait ses vacances avec ses parents. Puis, le temps passant, il a eu la tête ailleurs et vécu d’autres aventures. Mais il a voulu revenir sur ces lieux qui l’ont marqué pour toujours. « Tiens, te voilà toi », lui dit une tante. Pourquoi ce retour ? Pourquoi au mois d’août ? « Parce que août était le mois qui ressemblait le plus à la vie », écrit Pierre Adrian. Et il veut l’éprouver à nouveau, rameuter des souvenirs, entretenir une filiation.
Mais tout ce beau monde a bien changé. Cousins et cousines sont, pour certains, devenus parents. Le grand-père est mort mais la grand-mère, bien que diminuée physiquement, demeure la figure tutélaire du lieu. Les enfants, eux, sont les rois. « Ils régnaient sur la grande maison. Leurs repas, leur réveil, leurs devoirs de vacances, les jeux de plage… On vivait à leur service. Petit, je pensais être tributaire des adultes, de leurs horaires, des déjeuners à rallonge, de la messe du dimanche. Mais je me rendais compte maintenant que les enfants étaient les véritables rois ».
Cette grande famille s’ébroue dans un terroir qui n’est pas anodin. Il est à la fois rude et accueillant avec plages de sable fin, ses rochers massifs, ses hortensias et ses haies de troènes. C’est la côte du Léon qui transpire dans les pages de ce livre, un « pays d’averses et de brumes, de matinées mouillées ». Mais l’enfant qu’il fut conserve « la mémoire du beau temps » car « le ciel était toujours bleu dans nos histoires d’enfants ». En journée tout le monde s’active : les jeux, la plage, la voile, les courses effrénées. « Personne, dans cette famille, n’était du soir. Nous tombions tous de fatigue après dix heures ». Mais ce n’est plus tout à fait le cas pour le jeune homme qui revient sur place quelques années après. C’est l’heure des sorties nocturnes avec des cousins ou des amis dans les bistrots du port. Pierre Adrian évoque tout cela dans une écriture vive, faite de phrases courtes happant son lecteur.
Quand ce lecteur est breton, il y trouve aussi son compte car l’atmosphère des lieux est bien restituée, depuis les champs de maïs (qui ont proliféré) jusqu’aux églises qui, elles, se sont vidées sans oublier les bribes de langue bretonne entendues ici ou là ou le culte des morts toujours prégnant sur place. « Mes morts étaient ici sur la terre qu’ils avaient élue. Ils avaient choisi d’être enterrés là où ils avaient connu leurs plus beaux soleils et où ils finirent leurs jours. Ils reposaient dans une allée nouvelle du cimetière, après les lotissements, à l’ombre d’un château d’eau ». La vie, nous dit au fond Pierre Adrian, est une succession de « petites morts » à l’image de celle de la 2e quinzaine d’août quand le temps bascule, par petites touches, dans une atmosphère chargée de nostalgie. Et, dans le cas de ce livre, annonciatrice d’un drame qui ébranlera le jeune homme.
Adrian-Quereviennent ceux qui sont loin, Pierre Adrian, Gallimard, 2022, 181 pages, 21 euros
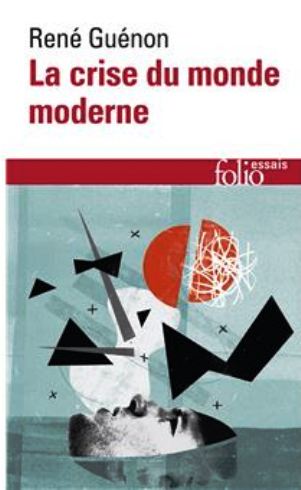 |
René Guénon, |
| La crise du monde moderne |
|---|
Plusieurs fois réédité, le fameux livre du philosophe et érudit René Guénon (1886 - 1951) sur La crise du monde moderne fait l’objet d’une nouvelle réédition chez Allia. Elle est sans doute liée à l’actualité brûlante d’un tel thème au regard des défis majeurs que doit précisément affronter le monde d’aujourd’hui. Si l’ouvrage de Guénon, paru en 1927, date donc de près d’un siècle, il garde valeur d’avertissement.
« Certains entrevoient plus ou moins vaguement, plus ou moins confusément, que la civilisation occidentale, au lieu d’aller toujours en continuant à se développer dans le même sens, pourrait bien arriver un jour à un point d’arrêt, ou même sombrer entièrement dans quelque cataclysme », affirme René Guénon, alors qu’à son époque on ne parlait pas encore de désastre écologique ou de péril nucléaire. Ce qui signe le ton quasi prophétique de ses propos, à l’aune des réelles menaces qui pèsent aujourd’hui sur la planète.
Guénon met en cause la croyance en un progrès indéfini et souligne le chaos régnant déjà, selon lui, dans le monde qui est le sien. Ce qu’il dénonce c’est le matérialisme et l’individualisme, à même de conduire le monde à sa perte. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que le monde occidental a rompu avec ce qu’il appelle « la tradition », autrement dit le noyau commun à toutes les religions. Issu lui-même du milieu catholique, séduit malgré tout par la franc-maçonnerie (son côté ésotérique), Guénon adhère notamment à l’approche du monde contenue dans les religions orientales, en particulier l’hindouisme (même s’il terminera sa vie au Caire, au cœur du soufisme). Dans son livre il prédit l’entrée du 20e siècle dans ce que, dans l’hindouisme, on appelle le Kali Yuga (« l’âge sombre »). On assisterait ainsi à la période ultime d’une civilisation.
Dans ce contexte, son livre se veut avant tout un plaidoyer pour le retour de la spiritualité, à, l’image de ce qui se pratique encore, à son époque, dans un Orient pas encore gangrené par la civilisation matérielle et l’individualisme. Il croit à un possible sursaut au cœur du catholicisme lui-même. « Il existe maintenant en Occident, estime-t-il, un nombre plus grand qu’on ne croit d’hommes qui commencent à prendre conscience de ce qui manque à leur civilisation ». Et il ajoute : « Devant l’aggravation d’un désordre qui se généralise de plus en plus, il y a lieu de faire appel à l’union de toutes les forces spirituelles qui exercent encore une action dans le monde extérieur, en Occident aussi bien qu’en Orient ; et, du côté occidental, nous n’avons pas d’autres que l’Église catholique ».
Guénon espère pour cela l’émergence d’une « élite » intellectuelle et spirituelle capable d’impulser un tel mouvement. Parallèlement, il pressent déjà que l’Orient spirituel pourrait être contaminé par l’Occident matérialiste. Mais sans doute n’aurait-il pas imaginé que ce matérialisme aurait pu s’imposer sans coup férir dans le monde entier. Y compris en Inde, en Chine ou au Japon, ces pays où il puisait ses références spirituelles.
La crise du monde moderne, René Guénon, Allia, 2022, 173 pages, 9 euros
 |
Daniel Morvan, |
| La main de la reine |
|---|
Un journaliste se rend en Finis Terrae pour enquêter sur des légendes de la mer et notamment celle relative à la fée Morgane. Il débarque sur l’île de Holly où la Morgane qu’il découvrira n’est pas celle qu’il pouvait imaginer. Daniel Morvan, né natif de Plougasnou et résidant aujourd’hui à Paimboeuf, signe ici un roman foisonnant aux fulgurances poétiques, riche de références à des lieux ou à des écrivains qui lui sont chers, à commencer par Jean-Pierre Abraham, l’auteur du célèbre ArMen, récit de sa vie de gardien de phare à l’extrémité de la chaussée de Sein.
L’intrigue de ce roman tourne autour de deux lieux situés sur l’île de Holly : le phare d’Awen Bell (dont Lucien est le gardien) et l’hôtel/pub de Bell Rock (tenu par Odette). Le journaliste Lewis Boyce, reporter aux Britton news, à la Cornish Review et à Paris Normandie va orienter son enquête sur ces deux lieux et ses deux occupants principaux. Le fil conducteur de son enquête sera le journal de bord (retrouvé dans le phare) d’une certaine Saskia Meyer, adolescente hollandaise qui tint compagnie au gardien de phare durant cinq années. Mais que venait-elle donc faire là ? Quelle était la raison de venue sur l’île ? Le roman creuse l’énigme tandis que gravitent autour de ces trois personnages des figures locales hautes en couleur, à l’image du carrier Vanka ou de Titus, comédien de passage à Holly et force de la nature. Quant à « La main de la reine », qui donne son titre au roman, il fait allusion à Marguerite de Savoie, reine d’Italie, qui vient à Holly en 1881 et plongea « sa main baguée dans la fontaine de Shoreham qu’on appelle en son honneur La main de la reine ».
Le décor ainsi planté (cette « micro-nation de célibataires au sang corrompu par l’alcool »), Daniel Morvan fait gambader notre imagination mais il le fait toujours dans un souci prégnant de réalisme. C’est le côté paradoxal de ce roman qui titille une forme de fantastique mais garde, de bout en bout, les pieds sur terre (et sur mer) dans un luxe de détails et de notations qui révèlent la profonde connaissance des lieux par le romancier. Car dans ce Finis Terrae qui évoque des lieux emblématiques de Cornouaille, l’île de Holly rime volontiers avec les îles Scilly et le phare d’Awen Bell avec celui d’Ar Men. Dans ce phare on retrouve ainsi un gardien qui fait penser à Jean-Pierre Abraham, amoureux comme lui du peintre Vermeer et de ses modèles comme « La jeune fille au turban ». De ces gardiens de phare, Daniel Morvan dit qu’ils étaient « des moines lumineux, vagabonds azuréens, pâtres de déferlantes pointant un nez entre deux pans de mer céruléenne. Ils étaient des monuments, des veilleurs de l’infini, ils éclairaient le monde quand celui-ci prenait sa dominante béton ! ».
En lisant ce roman, on pense aussi à un autre Finis Terrae, celui de film de Jean Epstein (1929). Du noir et du blanc qui sied à ces terres frustres du bout du monde et qui nous fait penser que La main de la reine ferait aussi un bon scénario de film en noir et blanc. Avec de prodigieux flash-back sur le journal de bord d’une jeune fille, le fil conducteur d’un scénario à rebondissements.
La main de la reine, Daniel Morvan, avec en couverture « Sans-titre », acrylique sur papier de François Dilasser, Le temps qu’il fait, 2022, 135 pages, 18 euros
 |
Ghislaine Lejard, |
| Dans la lumière de la fragilité |
|---|
La fragilité. Le thème est aujourd’hui volontiers décliné dans des livres par des philosophes, des théologiens ou des poètes. La Nantaise Ghislaine Lejard fait partie de ces derniers. Son court recueil Dans la lumière de la fragilité nous entraîne au cœur du mystère de notre être au monde.
La fragilité est aujourd’hui regardée d’un œil neuf dans un monde gagné par la brutalité des rapports humains au point de devenir, sinon un atout dans la vie, du moins une forme de vertu. « Si vous voulez « réussir » dans la vie, n’hésitez-pas à montrer vos failles ! Dieu lui-même est fragile, c’est là sa grandeur », écrivait Gabriel Ringlet dans son Éloge de la fragilité (Albin Michel). Plus récemment, sous le même titre, plusieurs auteurs dont la psychanalyste Cynthia Fleury et le généticien Axel Kahn ont souligné, eux aussi, cette force paradoxale de la fragilité. Chez les poètes, on n’est pas en reste, à l’image de Jean-Pierre Boulic, auteur de L’instant si fragile (Le Nouvel Athanor).
La collagiste et poète Ghislaine Lejard fait partie de cette fratrie d’auteurs que la fragilité « interpelle ». Préfaçant un récent livre de Jean Lavoué (René Guy Cadou, La fraternité au cœur, L’enfance des arbres), elle parlait, à propos du poète de Louisfert, d’une œuvre qui « s’inscrit dans la fragilité, celle des disparus : le frère, la mère et le père, celle de la maladie et la capacité que le poète a de s’effacer devant l’amour, celui d’Hélène, celui des amis, mais surtout de s’effacer devant le poème ».
Les poèmes de Ghislaine Lejard, eux, sont truffés de mots qui donnent une coloration pour le moins spirituelle (sinon religieuse) à cette notion de fragilité. Citons-en quelques uns dans la désordre, égrenés au fil des pages : « Louange », « promesse », « plénitude », « révélation », « confiance », « dépouillement », « don », « clarté », « souffle », « allégresse », « ravissement », « bienveillance », « silence », « mystère »… Ne parle-t-elle pas aussi du « sacré de la fragilité » ?
Face à la précarité de nos existences, signe de notre fragilité foncière, Ghislaine Lejard renouvelle son étonnement d’être au monde et accueille la vie dans l’ordinaire des jours. Au « drame de l’univers », elle oppose un « sourire d’enfant ». Elle le fait en connivence avec une nature fragile par essence, à l’image de ces arbres que le « désert blanc » de l’hiver dépouille mais avec la certitude de retrouver « le temps immobile de l’été » dans ses fragrances de lavandes, de foins et de tilleuls. Il y a, sous-jacentes, cette « merveille de la Présence » et cette « parole première », inaugurale, celle des premiers temps de la Création.
Pour accompagner ces poèmes, il fallait des gravures cultivant le mystère et une forme d’énigme, celles de Marie-Françoise Hachet - de Salins qui font galoper allègrement notre imaginaire. S’agit-il ici de fruits, de feuilles, de pierres ou, plus simplement d’empreintes laissées par le temps à moins qu’il ne s’agisse d’un ailleurs indéchiffrable, à la fois proche et lointain. Fragile, quoi qu’il en soit.
Dans la lumière de la fragilité, Ghislaine Lejard, Marie-Françoise Hachet – de Salins, Des Sources et des Livres, 2022, 30 pages, 14 euros.
 |
Abdellatif Laâbi, |
| La poésie est invincible |
|---|
Force de la poésie. Celle qui parle à l’oreille et au cœur. Celle qui se tient « à côté de tous les crucifiés » comme le dit Abdellatif Laâbi. Le poète marocain, né à Fez en 1942, revient inlassablement sur le métier pour dire le pouvoir des mots face à la barbarie et au chaos. « De l’homme à son humanité / la poésie est le chemin le plus court / le plus sûr ».
Abdellatif Laâbi a passé huit ans et demi dans les geôles marocaines entre 1972 et 1980. C’est presque de l’histoire ancienne mais cette épreuve, qui l’a particulièrement marqué, l’amène à porter une attention particulière à tous les réprouvés de la terre comme « cet ami aujourd’hui en prison », réfugié palestinien en Arabie Saoudite.
Dans un chronique d’avril 1980 publié par la revue Croissance des jeunes nations, Xavier Grall avait déjà attiré notre attention sur cet auteur marocain aux « poèmes tumultueux, rageurs, accusateurs » contenus dans son livre Le règne de barbarie (Seuil). Enthousiasmé par son écriture, le poète breton ajoutait : « L’œuvre de Laâbi, si moderne soit-elle dans sa forme, relève de l’oralité. Elle trouve toute sa puissance d’être dite. Et, plutôt que d’être dite, d’être hurlée dans les derbs sauvages du Maroc prolérarien. Hurlée à la face des princes qui, la djellaba dans le placard, s’en vont en Rolls-Royce, festoyer en leurs palais d’Azrou ou de Marrakech ».
Le verbe du poète marocain s’est assagi. Il y a toujours cette dénonciation de « la suprématie tonitruante du chaos ». Mais on ne peut réduire Abdellatif Laâbi à un poète engagé ou militant, car il y a aussi chez lui, profondément, ses interrogations sur le temps et l’expression de ses propres doutes. De la poésie, il dit notamment qu’elle est un peu sa religion, mais « une religion / qui cultive le doute / plutôt que la foi ».
Dans un série de Robaiyates (mot arabe pour désigner les quatrains), il distille ainsi quelques sages vérités. « Couvrez-vous de soie grège et de laine écrue / marchez au rythme des plus lents d’entre vous ». Ou encore ceci : « Vous ôterez vêtements, couvre-chefs et resterez pieds nus / vous exposerez vos peaux au chaudron renversé des étoiles ». Éloge de la lenteur, au diapason de penchants contemporains en faveur de la sobriété et du respect de la nature. Dans le Abdellatif Laâbi de 80 ans, on croit parfois entendre Omar Khayyam nous disant : « Ne renonce jamais aux chants d’amour, aux prairies, aux baisers, / Jusqu’à ce que ton argile se fonde dans une plus ancienne » (Les Quatrains, Albin Michel)
Établissant à la fin du livre « la carte d’identité poétique » de l’auteur marocain, Jacques Alessandra parle d’une « esthétique de la dissidence doublée d’une éthique et d’une foi en l’homme jubilatoire ». Il faut dire que Abdellatif Laâbi se laisse d’autant mieux approcher que son propos se tient à distance du jargon et de l’hermétisme. Face à « l’insolence de la vieillesse », il salue « la manne des matins ». Et comment ne pas s’émerveiller à la lecture de ces deux vers : « Entre les vivants et les morts / la poésie n’a pas de préférence ».
La poésie est invincible, Abdellatif Laâbi, Le Castor Astral, Poche/Poésie, 2022, 150 pages, 9 euros
 |
Éric Holder, |
| L’Anachronique |
|---|
De 1996 à 2012, l’écrivain Éric Holder (décédé à 59 ans en 2019) a publié tous les deux mois des chroniques (qu’il appelait des « anachroniques ») dans la revue littéraire Le Matricule des anges. Installé dans le Médoc, il racontait le temps qui passe et le monde qui va, ou ne va pas. Avec une mission confiée par la revue : parler de tout sauf des livres qui paraissent. La publication en livre de l’ensemble de ces chroniques est un vrai ravissement de lecture.
On sort en effet ébloui de la lecture de ce livre. Les qualités d’écriture et la justesse de ton de l’auteur nous mènent très loin. Avec le sentiment d’aller encore plus loin que dans ses romans, pourtant de qualité (on pense à Mademoiselle Chambon). Ici la vie s’expose à nous sans « l’emballage » que requiert parfois la fiction. Le caractère poétique des textes de Éric Holder saute même aux yeux. « Au matin brille le fretin des araignées pêcheuses de brouillard, par myriades dans leurs filets. Le couinement incertain d’un vélo – on dirait que tout se tait pour le laisser s’exprimer – révèle l’existence d’un chemin grimpant sous les mélèzes », écrit l’auteur dans une de ses dernières chroniques en janvier 2012.
Il suffit aussi de relever le titre de certaines de ses chroniques (on les imaginerait volontiers dans un livre de poésie) : « Langue des arbres », « l’automne, les amants », « la cueillette des eupatoires », « Planter son mai », « Miettes d’été », « La part des anges »… À un lecteur contestant l’intérêt de ses textes, Eric Holder avoue même les concevoir comme des sortes de haïku car ils débutent, dit-il, par « une évocation, serait-elle lointaine, de la saison ». Parlant du Médoc, dans sa version littorale du côté de Soulac et de Montalivet, il note : « Le vent rançonne les platanes-mûriers tandis que dans le ciel avancent les montagnes prodigieuses de cumulonimbus. Nous signons dès l’automne le pacte de la menace, de l’inconfort et de l’inquiétude métaphysique ».
Sur cette terre vivent des gens simples dont il dresse le portrait avec amour. Elles sont nombreuses les femmes que sa plume anoblit : deux sœurs boulangères, une vendeuse de vélos, une quincaillière derrière son comptoir… Il y a aussi Michel. « Comment expliquer à Michel, amoureux de sa terre, que je l’ai déjà croisé dans Zola, Giono ou Pagnol ? ». Bien intégré dans son terroir, Holder participe bien sûr aux vendanges : « Je n’avais pas besoin d’argent, je les ai faites pour rien : un litre de pineau, des cèpes, un pochon de châtaignes, un bon repas à midi ».
Éric Holder ne cache pas, au passage, ses faiblesses. Il n’est pas là pour parader, pour jouer à l’écrivain à qui on ne la fait pas. Son penchant pour l’alcool le plombe et il sait raconter comment se passe la cure de désintoxication. Dans une introduction à la publication des ces « anachroniques », Thierry Guichard, le directeur du Matricule des anges, peut écrire : « Éric Holder mettait dans la plupart de ses textes une lumière qu’il ne trouvait pas toujours dans la vie. Sinon, pourquoi écrire ? ».
On ne peut pas mieux caractériser ce livre que l’on peut butiner à loisir et sans modération. Lire ici un hommage au poète François de Cornière, là un texte sur sa compagne (« Femme de ma vie est éditeur »), plus loin une chronique sur le départ du dernier touriste : « Il était retraité et allemand. Quelques uns, qui possèdent ces deux qualités, forment ici une petite colonie d’arrière-garde ». Oui, magnifique livre.
L’Anachronique, Éric Holder, Le Dilettante, 2022, 283 pages, 22 euros
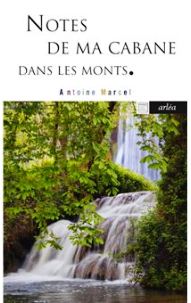 |
Antoine Marcel, |
| Notes de ma cabane dans les monts |
|---|
Il a vécu en Afrique, en Chine, au Moyen-Orient, mais il vit aujourd’hui retiré en France dans une petite région montagnarde adossée au sud du Massif central. Antoine Marcel fut un baroudeur qui a aujourd’hui posé son sac dans la Xaintrie noire, un terroir aux frontières de la Corrèze et du Lot. Il y a fait son nid (avec sa compagne chinoise), établissant un contact étroit avec la nature sans pour autant négliger certaines commodités. Antoine Marcel n’est pas David Henry Thoreau, l’auteur de Walden ou la vie dans les bois, même s’il cite à plusieurs reprises le grand auteur américain. Sa nouvelle vie, il nous la raconte dans un livre bien troussé, loin du tapage médiatique, avec une approche du monde inspirée par le Zen auquel il se réfère souvent, mais sans dogmatisme.
Sur la planète des écrivains retirés du monde ou prêts à expérimenter des séquences aventureuses de solitude prolongée, Antoine Marcel n’est pas le plus connu. Il n’est pas Sylvain Tesson et, d’ailleurs il ne cherche pas à l’être. On le voit même fustiger « les aventuriers médiatiques, qui partent avec une caméra, un contrat signé pour un bouquin à livrer au retour, et si possible un film en vue ». Antoine Marcel, lui, a choisi de vivre dans un lieu aussi peu médiatique qui soit. Qui pourrait vraiment situer la Xaintrie noire sur une carte de France ? C’est pourtant là qu’il vit, dans la commune d’Altillac où résidait aussi un autre sage, le philosophe Marcel Conche, auquel l’auteur fait allusion dans son livre, établissant comme une parenté intellectuelle et spirituelle avec cet homme à l’écart, comme lui, des fracas du monde.
Antoine Marcel a acheté sur place un vieux moulin cerné de bois et de taillis. Il y a sur place une rivière qui charrie des branches et toutes sortes de débris. L’auteur s’emploie à honorer ce lieu, défrichant, débroussaillant, semant, coupant du bois… Et toujours à l’écoute de la nature. Il a une tronçonneuse, il se déplace en moto et a chez lui un ordinateur. Il vit, comme il le dit lui-même, « dans l’horizon d’une sobriété heureuse qui n’exclut pas les panneaux solaires ». Antoine Marcel n’est pas un intégriste. Ni de l’écologie, ni du zen. Esprit ouvert, il s’en prend même aux moines « en robe safran » expliquant que le monde ici bas est illusion et que la vérité est ailleurs. Non, dit l’auteur, « le vrai monde est au-delà du monde, certes, mais il réside mystérieusement en ce monde même ».
L’auteur entend vivre dans « le concret, le factuel, le réel ». Il aspire à rejoindre « cet essentiel émerveillement de l’enfant devant le monde » et témoigner de « la valeur poétique des lieux ». Mais il sait relativiser et, surtout, n’adopte pas de posture. « La véritable dimension poétique, écrit-il, réside dans le vivre. L’œuvre n’est que subsidiaire ». Parole de vrai sage qui peut aussi affirmer : « Si vous entendez vivre de première main, et non selon la dernière mode, le silence, et même peut-être la pensée de la mort, sont indispensables ».
L’intérêt de ce livre est d’allier avec bonheur la trivialité des travaux et des jours à une profonde méditation sur notre vraie présence au monde. Dans « un monde qui s’organise pour éjecter l’humain », Antoine Marcel prend appui sur la nature pour donner libre cours à son profond humanisme.
Notes de ma cabane dans les monts, Antoine Marcel, Arléa-Poche, 2022, 239 pages, 11 euros
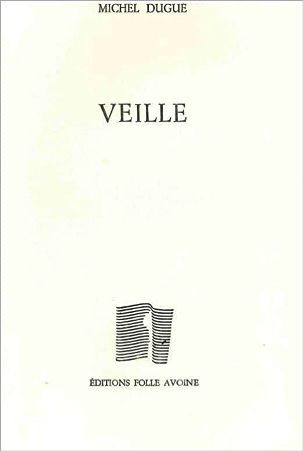 |
Michel Dugué, |
| Veille |
|---|
État de veille. Michel Dugué regarde la nature qui l’habite, revisite des pans de son enfance, nous dit ce qu’il y a « ici » et maintenant quand il scrute le monde. Son territoire est aussi, d’une certaine manière, celui de beaucoup d’entre nous. Comment ne pourrait-il pas nous toucher profondément avec son nouveau recueil ?
On connaît les attaches de Michel Dugué (il vit dans la région rennaise) avec les lieux qui lui sont familiers en Bretagne. Il en a notamment fait état dans un livre en prose poétique (Mais il y a la mer, Le Réalgar, 2018) où il évoquait son Trégor-Goëlo intime du côté de Plougrescant. On retrouve ici des couleurs et des intonations qui nous ramènent à cette terre d’élection : le cordon de galets, l’estran, les oiseaux criards, les « mouvements musculeux des vagues », les « éclats d’eau brillante / que se disputent les pies », les « entailles de bleu », « la mer – sa présence le soir / flaque brève aperçue / par le carreau de la chambre ». Michel Dugué ne joue jamais « couleur locale ». Surtout pas ! Ce qu’il veut, à travers toutes ces notations fugitives, c’est élargir la focale, creuser le mystère de ces grèves ou de ces sentiers qu’il arpente sans répit. « Chaque chose travaille à son éternité », écrit-il, lui « installé ici / à demeure, dirait-on ».
Toutes les manifestations de la nature que son œil recueille sont, le plus souvent, pétries de questionnements. « Croire à la rumeur de l’eau / mais non ! Ce serait plutôt / le bruit lointain d’une machine ». On croit entendre Philippe Jaccottet s’interrogeant sur la signification d’un son lointain de cloche (La clarté Notre-Dame, Gallimard, 2020) ou, à la lumière de septembre, se posant la question : « Dans ce nid brumeux de lumière / qu’est-ce qui est couvé, / quel œuf ? (La seconde semaison, Gallimard, 2004). Loin de la Drôme chère à Jaccottet voyant le brouillard gagner les flancs du Ventoux, Michel Dugué, pérégrinant sur les rivages costarmoricains, peut écrire : « Il y a dans l’air / des écharpes de brume. / On dirait des fumées / après le feu éteint ».
Il y a un autre feu qui couve dans les pages de ce livre, c’est celui de l’enfance. Michel Dugué en rameute des « parcelles ». Visions fugitives, d’abord, comme sorties d’un rêve : « une mare d’eau », « le lavoir », « un vieil outil laissé dans l’herbe », une vieille femme « de noir vêtue avec une coiffe blanche »… Le poète ne cultive pas pour autant une quelconque nostalgie. « Monde d’hier / ce n’était pas un royaume ». Mais dans ce monde d’hier triomphait, malgré tout, une forme d’innocence. « Est-il possible que cela fut / d’être aussi légers ? », note-t-il. « Nous mêlions tout / éclats de rires et de larmes ». Michel Dugué (il est né en 1946) voit la vie qui défile. « C’était il y a longtemps / sans les mots pour dire / l’étonnement d’être là ».
Veille, Michel Dugué, Folle avoine, 2021, 62 pages, 12 euros
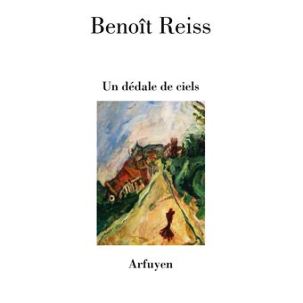 |
Benoît Reiss, |
| Un dédale de ciels |
|---|
Les aïeuls de Benoît Reiss ont vécu sous un « dédale de ciels ». L’auteur raconte ici poétiquement leurs vies, celles d’hommes et de femmes qui ont vu poindre « les incendies à l’horizon ». Saga d’une communauté juive abordée, ici, dans une série de tableaux où le réalisme côtoie volontiers l’imaginaire et même une forme de fantastique.
Dans le très beau livre de Benoît Reiss, il est question de père et de mère, de grand-père et de grand-mère, mais aussi de mère de la grand-mère ou du grand-père… Le poète remonte allègrement les branches de l’arbre généalogique. Il parle de ses « aïeuls taiseux », de « corps légers couverts de rides enfantines », d’ancêtres « absorbés de sagesse » qui « nomment une à une les étoile », des « ombres longues / dans l’été blet et immobile », des « femmes victorieuses » (ses arrière-grands-mères), de « mains couronnées de veines » (les grandes-tantes)…
Benoît Reiss dit avec des mots de poète (et quels mots si merveilleusement empreints de tendresse !) ce que Aaron Appelfeld a dit si magnifiquement dans Mon père et ma mère (éditions l’Olivier, 2020). Chez les deux auteurs, le même amour de la lignée, de l’ancrage dans les traditions ou dans l’histoire que des mots en hébreu ou yiddish perpétuent ici comme autant de balises sur des destinées rudement mises à l’épreuve. Voici les « Shomrim » (veilleurs). Voici les « Schlemazel » (malchanceux). Des lieux sont aussi évoqués furtivement où des aïeux ont vécu ou passé : Buxières-les-Mines, le cimetière central de Vienne, le camp de Gurs, les bords du Danube…
Car ce monde que Benoît Reiss restitue avec tant de bonheur, après duquel il a tant appris, voit des nuages noirs s’amonceler à l’horizon. « Nous marchons près des baraques sous les poings du soleil ». Le poète (né en 1976) s’imagine aux côtés de ce grand-père qui ne lui répond pas mais qui d’un geste « congédie dieu ». Destin tragique d’hommes et de femmes condamnés à porter « des valises fatiguées / à moitié vides au bout de leurs bras » et qui « fuient les aboiements ». Car, « par décret », ces ancêtres « n’ont plus de biens ». Ainsi, écrit-il, l’on ne compte plus toutes ces « familles envolées dans le courant du ciel ».
Mais il y aura les Justes à qui Benoît Reiss dédie son livre, eux qui on sauvé ses grands-parents. Et puis, il restera ces images fortes qui marqueront à jamais le jeune Benoît : la leçon de vie apprise d’une grand-mère près de laquelle il est accroupi et qu’il découvre, une autre fois, « adossée au silence », lavant « son linge de corps ». Et que dire de cet aïeul dont le travail « consiste à couper des ongles des morts » mais qui raconte que « bien sûr les ongles des morts continuent de pousser ». Merveilleux ! Oui, un livre merveilleux !
Un dédale de ciels, Benoît Reiss, Arfuyen, 2022, 118 pages, 13 euros
 |
Jacques Rouil, |
| Pierre et son merle |
|---|
Ce livre aurait pu s’intituler (façon fable de La Fontaine) « le merle et le retraité ». Car son auteur, Jacques Rouil, nous propose ici une belle brochette de petites histoires pour parler de notre époque. Voilà, en réalité, de bons coups de bec sur la politique et les mœurs d’aujourd’hui.
Profondément Normand de cœur (la Normandie du Cotentin), mais « Rennais dans un pavillon de banlieue avec un lourd paquet d’angoisse sur le dos », ancien journaliste d’Ouest-France, fin connaisseur du monde rural et des mœurs politiques, Jacques Rouil avoue d’emblée qu’il tourne un peu en rond. Plutôt que d’aller voir un psy, il a opté pour une forme de thérapie revigorante en dialoguant avec un merle. Le volatile a ses habitudes dans le jardin de poche de notre retraité. Mais un jour il est venu cogner à sa vitre. Alors s’est engagé un dialogue sur tout et sur le presque rien. Le retraité-narrateur, dénommé Pierre pour les besoins de la fable, avait trouvé un interlocuteur aussi finaud que lui (nommé Charlie) capable de lui apporter la contradiction. Au fond, un alter ego, très doué dans la dialectique et à même de nuancer des pensées parfois abruptes. Ou, au contraire, d’appuyer là où ça fait mal.
Comment ne pas penser ici, par moments, à l’écrivain espagnol Juan Ramon Jimenez dialoguant avec son âne (Platero et moi, Seghers, 2009) dans un petit village d’Andalousie. Nous nous entendons à merveille. Je le laisse aller à sa guise, et il me conduit toujours où je veux », écrit l’auteur espagnol parlant de son âne. Jacques Rouil n’écrirait pourtant pas tout à fait la même chose. Car son merle est en réalité bien plus têtu qu’un âne. Il résiste, il conteste… Il ricane aussi, s’adressant à Pierre : « Tu n’es jamais content de ton sort mon vieux. Voilà que tu voudrais voler comme un oiseau maintenant. Je te signale quand même que vous les hommes, vous êtes les maîtres de la nature. Et cela ne te suffit pas ! ».
Pierre et le merle Charlie vont débattre d’écologie, de politique, de religion, de questions « sociétales ». Nous recevons ainsi des échos de la vie à Blaireau-Cité et surgit, au fil des pages, un bestiaire fabuleux digne de La Fontaine : voici Beria (le rat qui lit Marx), le furet facteur (qui distribue des tracts de la Ligue révolutionnaire des Cocos pendant sa tournée), voici Adolf l’extrême bouledogue, Ségoline la tourterelle ambitieuse, Thibaut le fameux cygne technocrate qui sait tout, Manu le lévrier candidat… Tout y passe : les manifs, le Covid, les élites, le communautarisme… L’époque que l’on vit chagrine beaucoup l’auteur de ces fables. Il le dit à travers tous ces personnages qu’il épingle avec justesse. « Tu sais Charlie, dit-il à son merle, si les gens au pouvoir écoutaient un peu plus le peuple, les Adolf n’existeraient pas. Démocratie rime avec modestie, mais les grands fauves qui gouvernent l’ont oublié ».
Pierre et le merle, Jacques Rouil, éditions Feuillage, 2022, 230 pages, 17 euros
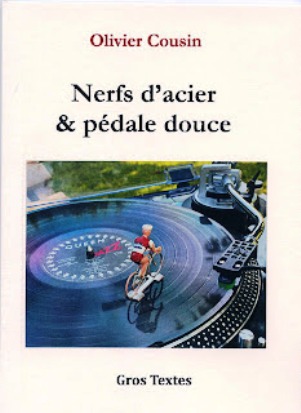 |
Olivier Cousin, |
| Nerfs d’acier et pédale douce |
|---|
Décidément, Olivier Cousin a l’humeur vélocipédique. Il se met une nouvelle fois en selle pour distiller quelques bonnes vérités sur l’air du temps. Sans jamais oublier cette part d’autodérision qui est la marque de fabrique de plusieurs de ses recueils. Car l’enseignant et poète lesnevien pratique volontiers le tête-à-queue et le dérapage contrôlé. Il sait aussi, quand il le faut, « ronger son frein ».
Dans Les riches heures du cycliste ordinaire (Gros Textes, 2017), Olivier Cousin nous avait déjà donné un bel aperçu de son compagnonnage quotidien avec le vélo (il dit « vélo » et non pas « bicyclette ») pour se rendre chaque matin sur son lieu de travail. Rien à voir avec quelque posture de militant écolo bon teint. Son recueil n’est pas là pour dire qu’il faut « décarbonner » ses déplacements quotidiens. Non, il est plutôt là pour regarder malicieusement ce « poète à pédales » qui serait à même « d’écrire des poèmes valables / en équilibre sur deux rondelles / de caoutchouc remplies d’air ». Poète sûrement, malgré l’air goguenard de ses contemporains avec leurs « insinuations utilitaristes » et qui posent la question : « Est-ce ainsi être poète ? »
Mais le poète sait se faire moraliste et épingler tous ceux qui « perdent les pédales / sans jamais faire de vélo » et aussi tous ceux qui font du vélo comme lui en doublant par la droite ou en roulant du mauvais côté de la route. Olivier Cousin n’embellit jamais le tableau. Il faut savoir « pactiser avec les éléments », nous dit-il. Et, surtout, pactiser avec soi-même. « J’ai mes recettes pour éviter de tourner en rond », affirme-t-il, le sourire en coin. Au slogan « Métro Boulot Dodo », il substitue le sien propre : « Vélo Boulot Disco Dodo ». Car le poète pédalant a chez lui un bureau / discothèque. « La musique y tourne à la chaîne ». Mais surtout pas de casque pour écouter la musique en vélo. Non, être à l’écoute de ce monde qu’il fend chaque jour sur sa bécane. Pouvoir ainsi parler de ces vélos d’enfants qu’il aperçoit dans le jardin en friche d’une maison neuve ou encore de cette dame à la fenêtre, sa « spectatrice la plus fidèle ». Rester disponible en toutes circonstances, notamment « pour les belles marcheuses / ou les jolies automobilistes qui pourraient me siffler ».
Oliver Cousin sait aussi se payer quelques « extra ». Il quitte parfois l’itinéraire obligé du boulot-dodo pour quelques escapades dans des lieux qui fleurent bon le terroir léonard du côté du pays Pagan quand « en direction de la mer / on descend à toute berzingue / la fameuse entre toutes / côte du Salut ». Ou, encore, quand sur une autre route de campagne, un tracteur et sa remorque Rolland Pencran (du nom d’un fabricant de matériel agricole) bouchent le passage. Le poète pédalant connaît bien son monde.
Nerfs d’acier et pédale douce, Olivier Cousin, Gros Textes, 2022, 50 pages, 6 euros
 |
Jean Lavoué, |
| Le Poème à venir |
|---|
Quel est donc ce Poème dont Jean Lavoué nous annonce la venue prochaine ? En sous-titrant son nouveau livre Pour une spiritualité des lisières, l’auteur breton oriente en réalité notre regard vers la figure « christique » de Jésus qui fut « habité comme nul autre par le Poème ». Un Poème que Jean Lavoué entreprend ici de décliner en approfondissant tous les thèmes qui charpentent son œuvre et sa recherche : l’intériorité, le silence, l’exode, les marges…
Poème. Du grec « Poiêsis » qui signifie « création », du verbe « poiêin » : faire, créer. Ses petits rappels étymologiques ne sont pas superflus quand il s’agit de parler du Poème. Et Jean Lavoué se fait encore plus précis : « C’est en fait le dynamisme créateur de cette Vie partout à l’œuvre dans l’univers que nous avons voulu traduire dans ce récit méditatif par le mot Poème (…) Son origine, nous les nommons Source et Vie, indifféremment, pour tenter de mettre des mots sur une réalité que l’on se saurait saisir ».
L’auteur parle de « récit méditatif » car il ne prétend pas faire, ici, œuvre de théologien. Il s’est nourri de nombreux auteurs (de Jean Sulivan à Maurice Bellet en passant par Joseph Moingt, Jacques Pohier et tant d’autres). Son livre, nous dit-il, « est plutôt le fruit d’intuitions, nourries par des lectures et vendangées dans les celliers du cœur ». Lectures d’ouvrages essentiellement issus du terreau judéo-chrétien qui est le sien.
La dimension « Christ » de Jésus est, à ses yeux, une traduction dans cette culture judéo-chrétienne « de ce que nous appelons Poème ». Mais il ajoute aussitôt : « Le dynamisme créateur de la Vie dont ce mot est le signe ne saurait se réduire à cette culture ». Il importe donc « d’accueillir chaque expression de l’aspiration humaine comme étant une réponse au mystère de ce Souffle créateur et cette Vie qui ne cesse de la travailler ». Autant dire, concevoir que, « dans d’autres traditions et d’autres cultures, cette vision de la Source originaire fut traduite par d’autres mots : Allah pour les uns, Atman pour les autres, Terre-Mère ou Gaia encore pour d’autres ». Pour Jean Lavoué, « L’universalité du Poème ne fait aucun doute ».
Arc-bouté sur ces convictions, l’auteur va pouvoir expliciter au fil des chapitres l’apport du Poème dans toutes ces manifestations d’ordre spirituel qui lui sont chères : l’espérance, la tendresse, l’hospitalité, la « terre intérieure », le pardon la rencontre, la fraternité, la confiance, l’espérance… Au détour des pages, redécouvrons sous sa plume son ardente admiration pour les grands témoins du Poème. Ils ou elles s’appellent Etty Hillesum, Teilhard de Chardin, Christiane Singer, les dominicains Chenu et Congar… Et comment ne pas y trouver ces poètes du Poème dont Jean Lavoué salue une nouvelle fois les écrits visionnaires : René Guy Cadou, Jean Grosjean, Christian Bobin… Oui, « voie royale de la poésie » quand, comme René Guy, « elle respire de ce dialogue direct entre l’autre inconnu et lui-même qui ne cesse jamais de creuser avec lui les limons de la beauté ».
Le Poème à venir, préface de François Cassingena-Trévedy, Médiaspaul, 2022, 143 pages, 15 euros
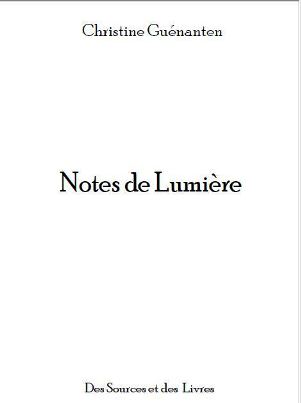 |
Christine Guénanten, |
| Notes de lumière |
|---|
Ne pas abuser de mots pour parler d’un recueil minuscule. Christine Guénanten nous livre aujourd’hui des petites Notes de lumière. Écoutons-les vibrer au son de la harpe avec qui le poète dialogue.
De la bretonne Christine Guénanten (elle vit dans le bassin rennais), on a déjà dit qu’elle sait se tenir à l’écart de la mièvrerie même si elle en prend souvent le risque tant son écriture est placée sous le signe d’une simplicité élémentaire. Ne pas chercher, en effet, sous sa plume, l’esbroufe des poètes qui se rengorgent. Elle vit au plus près de la vague ou du rocher, « entre fontaine et océan ». Son verbe a pris un abonnement avec les anges qui circulent en liberté dans les pages de son petit recueil. Ces anges sont le plus souvent musiciens, comme ceux que l’on trouve sur les retables, les sablières ou dans les porches de nos sanctuaires bretons : ange à la harpe, ange à la clarinette… « L’ange toujours se penche / À petits pas de pluies / Sur l’herbe des chemins », écrit Christine Guénanten.
Mais l’ange se fait rare dans un monde où peut sévir « la cruauté morbide ». Manque aujourd’hui aux hommes le don de « Contempler, recevoir / Les célestes silences / Des chapelles bretonnes ». Pour autant, le poète ne s’évade pas dans un monde éthéré. Si Christine Guénanten clame la louange – dans des intonations qu’on pourrait qualifier de franciscaines – cela n’empêche pas un regard lucide sur la détresse humaine et les drames contemporains. « Ils étaient tous partis / Pour fuir la famine et les guerres / Mais la misère / Ne voyage jamais / En bateau de croisière ».
L’ange musicien, malgré tout, « nous dit d’embarquer ». Il suffit, en effet, de deux coquillages posés sur une table pour partir en voyage. « Les mots des coquillages / Inscrits dans le cahier / Voudraient sauver, guérir, soulager la souffrance ».
Notes de lumière, Des Sources et des Livres, 2022, 40 pages, 10 euros
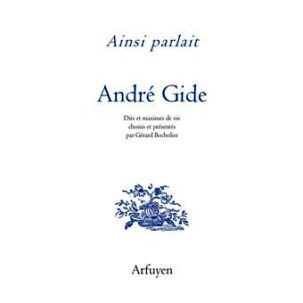 |
Gérard Bocholier, |
| Ainsi parlait André Gide |
|---|
Nous amener à lire André Gide (1869-1951) sous un jour nouveau, avec un œil neuf. C’est la réussite de cet ouvrage de « dits et maximes » du grand écrivain français sélectionnés par le poète Gérard Bocholier dans l’ensemble de son œuvre (romans, journaux…). Mieux nous rendre compte de la « sagesse » de Gide, c’est-à-dire de la vision de l’homme et du monde qu’il s’est forgée tout au long de sa réflexion.
« Je ne suis qu’un petit garçon qui s’amuse, doublé d’un pasteur protestant qui l’ennuie ». André Gide était, à sa manière, un homme des paradoxes. Mais ce qui sous-tend toute son œuvre, c’est son souci permanent de sincérité, une vertu qu’il qualifiait de cardinale parce qu’ « à la racine de toute morale authentique », note Gérard Bocholier.
Cette sincérité on la trouve avant tout dans une œuvre placée sous le signe du naturel et de la vie authentique. « La chose la plus difficile, quand on a commencé d’écrire, c’est d’être sincère », notait Gide dans son journal. « La poésie, cesse de la transférer dans le rêve ; sache la voir dans la réalité, et si elle n’y est pas encore, mets-l’y », écrivait-il encore dans Les Nouvelles Nourritures en 1935. Des propos qui détonaient en pleine période symboliste. Mais cette quête du naturel et de la réalité sous-tend chez lui de fortes ambitions. « Ne prendre chacun de mes livres que pour ce qu’il est : une œuvre d’art », affirmait-il tout net.
Cette sincérité concerne aussi, bien sûr son homosexualité affichée. À l’heure de MeeToo, les opinions de « l’immoraliste » Gide prennent – il faut le dire – un relief particulier. « Songez que dans notre société, dans nos mœurs, écrit Gide, tout prédestine un sexe à l’autre ; tout enseigne l’hétérosexualité, tout y invite, tout y provoque » (…) La vérité est que cet instinct, que vous appelez contre nature, a toujours existé, à peu près aussi fort, dans tous les temps et toujours et partout – comme tous les appétits naturels ». Ce qui fait dire à Gérard Bocholier que « Gide prophétisait les révolutions des mœurs qui agitèrent la 2e moitié du XXe siècle et qui continuent dans notre XXIe siècle ». Pour autant il ne manque pas de relever que la « pédérastie » revendiquée par Gide (on dirait aujourd’hui pédophilie) entraînerait aujourd’hui des conséquences judiciaires.
De l’œuvre de Gide, ici découpée au scalpel, émerge aussi une vision particulière et plus que décapante de la religion. Né dans un milieu protestant, Gide avait pris ses distances avec ses racines (comme il le fera, plus tard, avec le communisme). « Le catholicisme est inadmissible. Le protestantisme est intolérable. Et je me sens profondément chrétien », écrivait-il. Et c’est sur ce thème que la modernité et la sincérité de Gide éclatent aussi au grand jour.
Gérard Bocholier (poète à la fibre chrétienne) n’a donc pas manqué de retenir toutes ces graines de sagesse que pourraient pendre à leur compte, aujourd’hui, les chrétiens en recherche ou dans les marges. « Ah ! Que tout irait bien si l’on avait affaire au Christ ! Mais la religion, ce n’est pas le Christ, c’est le prêtre (…) Mon christianisme ne relève que du Christ. Entre lui et moi, je tiens Calvin ou Saint Paul comme deux écrans également néfastes ». Et, pour revenir à la sagesse, il y a ces mots : « Le commencement de la sagesse est dans ces mots : Ne jugez point »
Ainsi parlait André Gide, dits et maximes de vie choisis et présentés par Gérard Bocholier, Arfuyen, 170 pages, 14 euros
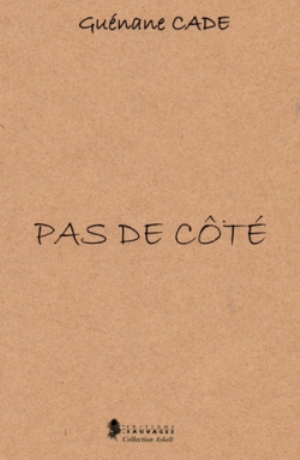 |
Guénane, |
| Pas de côté |
|---|
La Lorientaise Guénane poursuit avec ferveur une œuvre engagée en 1969, le cœur toujours partagé entre sa Bretagne natale et la Patagonie, autre terre d’élection. Le Pas de côté qu’elle publie aujourd’hui lui fait emprunter, à nouveau, des chemins buissonniers. Guénane parle d’elle mais toujours plongée dans une nature qui l’exalte. C’est la marque particulière de son écriture.
Faire un pas de côté, c’est d’abord aller vers ce qui ne saute pas d’emblée aux yeux. C’est faire le choix de s’intéresser aux choses « de peu », par exemple à ces fleurs ou à ces plantes dont on ne connaît pas forcément le nom. « Simples / vous êtes ma seule sagesse / je plante vos noms en terres incultes / avec la dynamique du chiendent », note Guénane. Éloge de toutes ces mauvaises herbes qui n’en sont pas « pour qui les perce à cœur ». Le pas est vite fait, alors, du côté des « herbiers de l’enfance », avec ses « fleurs séchées décolorées / entre nos pages préférées ».
Les herbes, mais aussi les arbres car « se confier à l’arbre est vertueux », affirme Guénane. Mais également les oiseaux comme ce moineau à « la gaîté d’un moinillon pépiant ». Ou encore le papillon, cette « petite ponctuation turbulente ».
Si les chemins de Guénane sont faits de terre, ils sont aussi faits de sable. Son pas de côté l’entraîne sur des estrans où s’ébrouent des « escadrilles » d’oiseaux de mer qui « vocifèrent ». Place aux bernaches ou à l’aigrette, « silhouette familière de l’estuaire ». Élargissant les perspectives, elle embrasse l’océan qui « rabâche des histoires » mais « seul le silence les élucide ». Attentive aux « buffles de la marée montante », elle médite sur le temps qui passe et le monde qui ne tourne pas rond (« qui fait le plus d’écume / l’océan ou l’humanité ? »)
« Vivre est dangereux se retourner aussi / allées dérobées sentes secrètes / la vie nous joue des tours / sur nos chemins de ronde (…) Si en toi un nouveau souffle naît / arrange-toi pour bien virer / au vent de ta bouée », affirme Guénane. La rencontre avec la nature a toujours été pour elle une rencontre avec elle-même (souvenons-nous de sa Rencontre avec la dune, Rougerie). Heureusement, écrit-elle, « la poésie parfois cimente les affres ». Et, sans faiblir, il s’agit de persévérer face au temps qui passe, « chercher en soi ce qui ne se voit pas / un reste d’ardeur / remettre du sel dans sa vie / il n’a pas de prix ».
Pas de côté, Les Éditions sauvages, collection Askell, 2022, 60 pages, 11,50 euros
 |
Taras Chevtchenko, |
| Notre âme ne peut pas mourir |
|---|
C’est au poète breton Eugène Guillevic que l’on doit la découverte du poète national ukrainien Taras Chevtchenko (1814-1861). En 1964, en effet, les éditions Seghers publient dans leur collection « Poètes d’aujourd’hui », une anthologie des œuvres poétiques de Chevtchenko. Guillevic en est le traducteur. C’est lui aussi qui assure la préface du livre. Près de soixante ans après, voici l’ouvrage opportunément réédité, dans le contexte dramatique que l’on sait.
Le poète-héros de l’Ukraine est actuellement sur toutes les lèvres quand on parle de la littérature de ce pays aujourd’hui sous les bombes russes. « Notre âme ne peut pas mourir, / La liberté ne meurt jamais. / Même l’insatiable ne peut / Pas labourer le fond des mers, / Pas enchaîner l’âme vivante, / Non plus la parole vivante… ». Ces vers de Taras Chevtchenko résonnent avec force en ces temps de déréliction. Écrits en 1845, ils font partie de son poème intitulé Caucase. « Quand je serai mort, mettez-moi / Dans le tertre qui sert de tombe / Au milieu de la plaine immense, /Dans mon Ukraine bien-aimée », écrivait le poète, la même année, dans son poème Testament.
Chevtchenko était peintre et poète. Né près de Kiev, fils d’un paysan serf, libéré du servage en 1840 en étant racheté à son propriétaire par deux artistes russes, il mourra d’épuisement à Saint-Pétersbourg après des années de harcèlement et de persécution de la part du pouvoir russe. Mais les ennemis de l’Ukraine, à l’époque, sont aussi les sultans de Turquie et les rois de Pologne. Guillevic, qui connaît le russe, s’approche de l’œuvre de Chevtchenko avec l’aide d’un traducteur d’ukrainien. Le poète breton est, à l’époque, membre du Parti communiste et un lien s’établit avec le gouvernement de la République socialiste soviétique d’Ukraine pour faciliter la publication d’une anthologie. En 1964, Chevtchenko est « récupérable » car, selon le pouvoir communiste ukrainien, il vise dans ses poèmes le régime tsariste russe, comme l’explique André Marcowicz dans un avant-propos à cette réédition.
Guillevic voit avant tout dans Chevtchenko un grand poète au service du patriotisme ukrainien. « Son lyrisme personnel rejoint un souffle d’épopée », écrit-il. « Il s’est servi des récits historiques, des contes populaires, des légendes de son pays ». Guillevic met aussi en valeur sa « simplicité », son langage « frais et neuf ». Voilà, en effet, une poésie abordable par tous. Son esthétique est « celle de son temps » même si le poète breton note dans certains poèmes/récits « cette espèce d’incohérence qui tient des rêves, des cauchemars (…) où se manifeste quelque chose que la poésie moderne cherche à faire apparaître ».
Prenant en compte ces divers paramètres, Guillevic s’est efforcé de conserver dans sa traduction « le caractère primitif, naïf, des poèmes » et aussi le « mouvement » qui les anime. « J’ai retenu le vers syllabique sans rime », explique-t-il.
Aujourd’hui c’est avec un œil neuf que l’on lit les œuvres de Chevtchenko. La barbarie saignant son pays et frappant à nos portes, ses mots prennent notamment une nouvelle coloration quand il évoque les forces telluriques de sa terre natale. « Il mugit et gémit le large Dniepr. / Au-dessus de lui hurle un vent puissant / Qui courbe jusqu’à terre les grands saules, / Soulève les flots, on dirait des monts ».
Notre âme ne peut pas mourir, Taras Chevtchenko, traduit et préface par Guillevic, Avant-propos d’André Markowicz, Éditions Seghers, 2022, 120 pages, 14 euros
Les bénéfices de la vente de l’ouvrage seront reversés intégralement à l’AMC France-Ukraine (association médicale et caritative) pour soutenir son action humanitaire.
 |
Alain Vircondelet, |
| Des choses qui ne font que passer |
|---|
Ces choses qui ne font que passer sont celles qu’Alain Vircondelet aperçoit derrière la vitre d’un train. Le matin comme le soir. En toutes saisons. Visions fugitives qui rassérènent le poète après « les saisons lourdes / de l’épreuve ». La nature est là pour pouvoir continuer à vivre « Sur les crêtes d’abondance / Où survivent les mots ».
En citant en exergue Shei Shonagon, dame de la cour japonaise du 11e siècle et auteure des célèbres Notes de chevet, Alain Vircondelet se place d’une certaine manière sous le signe de l’impermanence, chère aux philosophies extrême-orientales, qui trouve sa traduction dans le passage des saisons. « Le chant perdu des choses qui passent jamais perdues cependant, reprises au vol, juste avant qu’elles ne s’effacent », note Vircondelet.
Après l’hiver, le printemps. Tout meurt, tout revit. L’appréhension du monde depuis un train ajoute ce grain de fugacité. Et aussi d’instantané. Car il importe de saisir au vol, tel un photographe, la chose entrevue. Ici « les coulis d’or des colzas », plus loin « l’éolienne dans sa blancheur de lait cru » ou « le vert velours des champs »… Le poète l’affirme : c’est « chaque petit matin / cette même célébration ».
Alain Vircondelet vit au diapason des saisons. Il y a le « plain-chant des vergers en fleurs » (printemps), « les chants cloutés de meules » (été), « la clarté dorée des heures quotidiennes (automne) », « l’impatiente ardeur des graines » (hiver). Mais cette capacité renouvelée d’émerveillement ne masque pas une forme de désarroi. « Le poème est salut et consolation », affirme-t-il, « dans l’aplomb incertain de nos vies ». Car il s’agit de faire face à « l’immobile silence du mal », à « la lancinante usure » et de « croire / à l’imprévisible courage des mots ».
La nature, entrevue, lui sert de modèle et l’invite même à une forme de résilience avec ses « herbes têtues » ses « forêts impassibles », ses « haies tenaces et fidèles ». Et quand les vignes ont subi des grêles dévastatrices, « leur silence est plus fort que leurs cris ». Le dehors dit le dedans. Le cœur chiffonné d’Alain Vircondelet, poète de la métonymie, trouve dans la « gloire / du vivant renaissant » et dans « l’allure vive et verte / De l’espérance » de quoi « se prémunir de l’obscure clarté / des puits à venir ».
Des choses qui ne font que passer, Alain Vircondelet, L’enfance des arbres, 2022, 120 pages, 16 euros
 |
Carles Diaz, |
| L’arbre face au monde |
|---|
Poète et historien de l’art, le franco-chilien Carles Diaz nous entraîne sur les pas d’un peintre allemand exilé au Chili en 1850. Nous voici plongés, par le truchement d’un journal de bord imaginaire, dans l’aventure de Carl Alexander Simon disparu dans les forêts de Patagonie deux ans après son arrivée dans le pays. Voyage initiatique, faisant alterner textes en prose et poèmes, dans lequel Carles Diaz confie – à travers son héros – ses vues sur les rapports de l’homme et de la nature, mais aussi sur la liberté à conquérir, essentielle à tout artiste pour trouver sa propre voie.
Se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre. Imaginer ses émois, ses sensations, ses pensées. Vivre, au fond, par procuration. L’entreprise est hasardeuse mais des auteurs ne rechignent pas à recourir à cette méthode. On pense à Hubert Haddad épousant la vie d’un artiste japonais dans ses Haïkus du maître d’éventail (Zulma, 2013). Carles Diaz, lui, a jeté son dévolu sur un « petit maître » oublié des anthologies d’histoire de l’art mais qui, avant son exil au Chili, mena à la fois une vie de peintre et de militant de ce socialisme utopique qui a fait florès au 19e siècle. « Quand il s’exile au Chili, il obéit davantage à un romantisme exacerbé qu’à une fin utilitaire », note l’auteur.
Sur place, en effet, Carl Alexander Simon surfera sur des valeurs qui lui tiennent à cœur : le respect de la nature, la contemplation, l’empathie pour les peuples autochtones… « Je dessine ce que ma nature profonde a toujours et inlassablement aimé par-dessus tout : les forêts froides, impénétrables, les sommets déchiquetés, surgis comme des titans dans les récits des navigateurs ». Ce sentiment de la puissance du monde naturel se double d’une attention particulière aux « choses les plus précaires, infimes, insignifiantes ». Car « c’est dans la grandeur de l’infime que le Très-Haut se manifeste. Et c’est dans ce bain de lumière sylvestre que mon regard cherche à se perdre des heures entières. J’en tombe à genoux, je me sens rajeunir dans cette volupté silencieuse, loin de siècle et de la turpitude des hommes avec leurs pierres précieuses, leurs sceaux de commerce, leurs brevets en blanc ». On croit entendre les imprécations de son contemporain Henry-David Thoreau (1817-1862) contre la société industrielle en gestation en Amérique du nord. Même approche des tribus indigènes, même admiration de « l’incessant labeur de la nature ».
« Qu’est-ce qui pourrait nous sauver », écrit Carl Alexander Simon dans son journal imaginaire, lorsque nous glissons dans une vie sans but, lorsque nous trébuchons dans l’amertume de la réalité, le courage usé, l’intelligence, la pensée et la poésie condamnées à la brutale indifférence d’autrui, voire à l’inconscience ? Carles Diaz se met de plain-pied dans la peau de son héros pour parler du temps présent. Depuis la Patagonie pour parler de notre monde occidental et de « l’indigence de notre époque ».
Il assigne alors une mission à l’artiste : « croiser le fer avec la médiocrité, l’imposture, l’abandon et l’égoïsme ». Carles Diaz nous dit, à travers l’évocation de son « petit maître », que « face à la pauvreté spirituelle grandissante », il faut continuer à « vibrer sans jamais oublier notre condition tragique ». Le désespoir ou l’amertume ne doivent pas nous aveugler. Il faut « réclamer la jubilation de l’instant ancien et renoncer à l’impatience, à la faim insensée de l’orgueil et de la suffisance, de l’hypocrisie et de la commodité ». Sans oublier de « porter dans son chant sa blessure intérieure ». Au bout du compte, c’est un véritable programme de vie que nous propose ici Carles Diaz : habiter poétiquement le monde, selon les aspirations mêmes de la maison d’édition qui le publie.
L’arbre face au monde, vie et destin de Carl Alexander Simon, Carles Diaz, POESIS 2022, 203 pages, 18 euros
 |
Henry David Thoreau, |
| Myrtilles, la beauté des petites choses |
|---|
Homme de la désobéissance civile, adepte de la vie au plus près de la nature (comme il l’a raconté dans son Walden ou la vie dans les bois), l’américain Henry David Thoreau (1817-1862) est aujourd’hui considéré comme l’un des précurseurs du mouvement écologiste. Son petit livre sur les myrtilles, sujet minuscule s’il en est, ouvre de larges perspectives sur les bienfaits d’une plongée dans la nature et plus précisément dans la cueillette quand celle-ci nous rattache à des valeurs sûres : la simplicité, la lenteur, l’attention soutenue aux petites choses.
En Amérique, la myrtille a une importance et une charge symbolique qu’on ne lui connaît pas en Europe. Fruit de la nature, la myrtille s’y décline en de multiples variétés dont Thoreau – botaniste confirmé – se plaît à détailler la richesse, depuis les myrtilles bleues (qualifiées de « bleuets ») jusqu’aux myrtilles d’un noir profond. Ce fruit que la nature donne en abondance s’inscrit, en outre, dans une histoire : celle des premiers occupants de certains États américains, à commencer par les Algonquins : « Les Indiens faisaient naturellement plus de cas que nous des fruits sauvages et parmi les plus importants figuraient les myrtilles (…) Ce ne sont pas les Blancs qui ont appris aux Indiens quel usage faire de ces baies », note l’écrivain américain. Ceux-ci, en effet, ont perpétué l’art de sécher le fruit, d’en faire des gâteaux aux myrtilles faits de farine indienne et de myrtilles.
Mais Thoreau élargit très vite la focale. Ce qu’il veut nous dire en parlant des myrtilles (comme on pourrait le faire, chez nous, en parlant des mûres) c’est qu’un simple fruit peut par ses « saveurs délicates et innocentes » nous relier à la nature (« l’autre nom de la santé », dit Thoreau) et nous conduire aussi vers la contemplation. Quand mûrissent les myrtilles, écrit-il, « champs et collines sont une table constamment dressée ». Cultivant même la veine biblique, Thoreau parle « d’Éden rural » et d’une terre « où le lait et les myrtilles abondent ».
Dans ces conditions, « le véritable fruit de la nature ne peut être cueilli que d’une main délicate, d’un cœur léger ». Les enfants doivent y avoir toute leur part car la cueillette est une voie d’initiation aux champs et aux forêts jusqu’à devenir « la véritable université où l’on peut apprendre les lois éternelles ».
Malheureusement, les hommes (« ces stupides démons ») demeurent les hommes. Ils compromettent de si belles opportunités. David Henry Thoreau est vent debout contre le mercantilisme et en profite pour pointer « le malheur de notre civilisation : donner à toute chose une valeur vénale ». Et il enfonce le clou : « Quel genre de pays est-ce donc, où les champs de myrtilles sont une propriété privée ? » Des ces fruits minuscules, il en fait l’étendard d’un « déconditionnement de la civilisation », comme le note avec justesse Thierry Gillyboeuf dans une éclairante préface. Selon lui, il s’agira toujours, pour Thoreau, de « renouer avec cette part sauvage, primitive de l’homme qu’est l’enfance ». Ce que permet notamment la cueillette des myrtilles.
Myrtilles, la beauté des petites choses, Henry-David Thoreau, Rivages poche, 2022, 107 pages, 7,20 euros
 |
Jean-Louis Coatrieux, |
| Tu seras une femme, ma fille |
|---|
Chercheur et écrivain, le rennais Jean-Louis Coatrieux nous entraîne ici dans un palpitant récit de vie, celui d’une jeune juive autrichienne fuyant en France pour échapper au nazisme. Il fit sa connaissance au Venezuela où elle s’était finalement installée. Son livre se veut un « témoignage d’amitié » pour cette femme et entend répondre à un « devoir de mémoire ».
Jean-Louis Coatrieux a des accointances avec l’Amérique latine. Ce continent, où il s’est plusieurs fois rendu, est la toile de fond de quelques-uns de ses livres. On pense notamment au travail qu’il a effectué autour de la figure du grand écrivain Alejo Carpentier. Il se trouve qu’un séjour au Venezuela lui a permis de rencontrer Erika Reiss, juive viennoise ayant échappé à la persécution nazie grâce à la chaîne de solidarité mise en place en France pour accueillir des personnes comme elle. Le récit que Jean-Louis Coatrieux nous propose s’inspire librement de l’histoire d’Erika et des divers éléments d’information qu’il a pu recueillir sur cette période (journal, lettres, photos…)
Tout commence pour l’adolescente Erika Reiss, née le 21 mai 1927 à Vienne, par un changement de nom. Elle devient Eliane Richou et quitte sa famille en avril 1939 au moment où la peur s’installe en Autriche après la nuit de Cristal. Ses parents restent à Vienne et son frère va tenter de rejoindre la Palestine. Erika, elle, prend le train pour Paris. Un convoi de filles et garçons de 7 à 14 ans.
Première escale à Saint-Ouen l’Aumône dans un pensionnat juif puis transfert au château de la Guette à Villeneuve-Saint-Denis (géré par l’œuvre du secours national), dirigé par une certaine Germaine Le Hénaff, originaire de Crozon et qui recevra la médaille des Justes en 1986 pour avoir accueilli et ainsi sauvé des enfants juifs. « La Guette était une maison laïque et la mixité la norme à tous les niveaux », raconte Erika dans ce récit écrit à la première personne.
Printemps 1940. C’est l’Exode et le départ pour La Bourboule à l’Hôtel des Anglais « où nous avons connu le froid et la faim ». Erika est inscrite à l’école hôtelière féminine de Clermont-Ferrand. Puis, à la fin de l’été 1941, c’est un séjour bienvenu à l’école de Beauvallon, à Dieulefit dans le Drôme, d’où émerge la personnalité de Marguerite Soubeyran. Mais c’est bientôt le retour à La Bourboule (« Nous avions tous le moral en berne ») avec, pour elle, des stages pratiques de cuisine au Grand hôtel de Clermont-Ferrand.
L’itinérance ne s’arrêtera pas là. Il y aura aussi, au printemps 1942, Le Courret « dans les collines à une trentaine de kilomètres à l’est de Limoges » où Erika renoue avec les traditions juives (« Rien à voir avec La Guette et Beauvallon, les laïques »). Erika lit beaucoup à l’époque, recopie des poèmes dont celui de Rudyard Kipling. « Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie / et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir (…) Tu seras un homme, mon fils ! ». Cette phrase, pour Erika, claque comme un cri. « Je tenais là ma vie d’enfant et mon rêve. Il suffisait de remplacer cette phrase par « Tu seras une femme, ma fille ».
La vie d’Erika Reiss connaîtra bien d’autres soubresauts que l’on découvrira. Jean-Louis Coatrieux nous happe dans ce récit/roman où il fait parler son héroïne. Un récit à lire à l’aulne de certains débats actuels sur la période de l’Occupation et où règne en maître, chez certains, cette « fausse parole » que dénonçait si vigoureusement le poète breton Armand Robin.
Tu seras une femme, ma fille, Jean-Louis Coatrieux, Riveneuve, 2022, 170 pages, 18 euros.
 |
Milan Kundera, |
| Un occident kidnappé |
|---|
La tragédie ukrainienne nous amène aujourd’hui à regarder d’un œil neuf le texte de l’écrivain tchèque Milan Kundera (exilé à l’époque à Paris après un séjour à Rennes entre 1975 et 1979), texte publié en 1983 dans la revue Le débat et aujourd’hui réédité en livre. Il y est question de cette Europe centrale (Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne), historiquement et culturellement européenne, placée à l’époque sous la botte russe. Le drame de ces « petites nations », explique Kundera, c’est que l’Europe ne s’était même pas aperçue de leur disparition en les rangeant dans ce qu’on appelait « le bloc de l’est ». Son texte devient alors un vibrant à la liberté et à la culture, dont cette Europe centrale fut le flambeau pendant des décennies.
Un simple bout de phrase a profondément alerté Kundera en 1956 quand les chars russes investissent Budapest. Il émane du directeur de l’agence de presse de Hongrie : « Nous mourrons pour la Hongrie et pour l’Europe ». Soudain, souligne Kundera, « le destin de l’Europe centrale apparaît comme l’anticipation du destin européen en général et sa culture prend d’emblée une énorme actualité ». La Russie, elle, dans sa version soviétique, devient ainsi un monde extérieur qui a kidnappé l’occident.
Milan Kundera insiste : les révoltes centre-européennes (Hongrie 1956, Tchécoslovaquie 1968, Pologne 1956, 1968, 1970) « émanent du monde de la culture ». En face, « la civilisation du totalitarisme russe est la négation radicale de l’occident tel qu’il était né à l’aube des temps modernes ». Cet occident – version mittle europa – est celui qui a donné Bartok, Musil, Kafka et tant d’autres. L’Europe d’un Tchèque, d’un Polonais ou d’un Hongrois, insiste Kundera, n’est pas un simple phénomène géographique, « mais une notion spirituelle qui est synonyme du mot occident ». C’est une Europe « enracinée dans la chrétienté romaine ». En face, les Russes apparaissent « des barbares contre qui on guerroyait sur des frontières lointaines » soulignait pour sa part Czeslaw Miloscz dans son livre Une autre Europe que mentionne Kundera. C’est cette Russie « uniforme, uniformisante, centralisatrice » qui a transformé « avec une détermination redoutable toutes les nations de son empire (Ukrainiens, Biélorusses, Arméniens, Lettons, Lituaniens, etc) en un seul peuple russe », rappelle Kundera.
L’écrivain tchèque fait un autre constat. L’Europe centrale a lapidé – c’est le poids de l’histoire – les chances qu’elle avait de se fédérer et de peser ainsi entre la Russie et l’Allemagne. L’empire des Habsbourg (devenu l’empire austro-hongrois) a fait long feu. Il n’y a rien eu pour le remplacer.
Mais Kundera va plus loin en parlant d’un drame plus profond qui touche cette fois toute l’Europe. Ce drame est celui du déclin de la culture, élément fédérateur s’il en est à ses yeux. « De même que Dieu céda, jadis, sa place à la culture, la culture cède la place. Mais à quoi et à qui ? », interroge l’écrivain. « Quel est le domaine où se réaliseront les valeurs suprêmes susceptibles d’unir l’Europe ? Les exploits techniques ? Le marché ? Les médias ? (le grand poète sera-t-il remplacé par le grand journaliste ?) Ou bien la politique ? Celle de droite ou celle de gauche ? Existe-t-il encore, au-dessus de ce manichéisme aussi bête qu’insurmontable, un idéal commun perceptible ? »
C’est un questionnement que Kundera avait déjà formulé en 1967 dans un discours au congrès des écrivains tchécoslovaques sur la littérature et les petites nations. « Les hommes qui ne vivent que leur présent non contextualisé, qui ignorent la continuité historique et qui manquent de culture sont capables de transformer leur patrie en un désert sans histoire, sans mémoire, sans échos et exempt de toute beauté ».
Des intonations que l’on retrouvera plus tard sous la plume de Vaclav Havel dans son livre Il est permis d’espérer (Calmann-Lévy, 1997). L’homme de la Charte 77, qui deviendra le président de son pays, soulignera notamment « la crise générale de la spiritualité dont souffre notre monde contemporain ».
Un occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale, Milan Kundera, Le débat/Gallimard, 2022, 77 pages, 9 euros
 |
Oliver Risser, |
| Etty Hillesum, un chant de vie par-delà les barbelés |
|---|
Encore et toujours Etty Hillesum. La figure de cette jeune Juive néerlandaise (1914-1943), déportée puis assassinée à Auschwitz, n’en finit pas d’interroger les écrivains, les philosophes, les théologiens, les poètes et tous ceux qu’interpelle la question du mal. Olivier Risser, jeune enseignant breton, est de ceux-là.
Après La fée de Westerbork (L’enfance des arbres, 2020), où il évoquait sous la forme d’une narration contée, la vie « solidaire » d’Etty Hillesum au camp de transit de Westerbork, Olivier Risser aborde ici la jeune Juive sous un angle plus philosophique ou – disons-le – plus métaphysique autour de la question lancinante du mal (et nous revient ici en tête la fameuse question d’Adorno sur « comment penser le monde après Auschwitz ».) Voici donc sous la plume de l’enseignant breton un essai structuré sur le sujet. S’appuyant essentiellement sur le Journal et la Correspondance d’Etty Hillesum, il constate d’abord « le formidable élan vital » de la jeune femme et le démontre au fil des pages. Puis il entend démontrer comment Etty a « agi et pensé en conformité avec sa foi et son amour du prochain ». Olivier en tire des leçons pour lui-même et pour l’humanité entière, truffant son essai d’exhortations à faire le bien, à enraciner sa foi dans l’humanité.
Pour « questionner la présence du mal dans ce monde », l’auteur trouve une « âme-sœur » à Etty. Elle s’appelle Simone Weil (1909-1943), « peut-être un peu moins chaleureuse, certainement plus impressionnante de prime abord, plus cérébrale sans doute, mais tellement inspirante » et qui travailla en usine de décembre 1934 à août 1935 pour partager la condition ouvrière.
Comment penser le mal ? Etty Hillesum apporte une possible réponse, « sans doute la meilleure, sans doute la plus courageuse : panser le mal », estime Olivier Risser. Oui « Panser le mal », une volonté qu’exprimera aussi sans relâche Simone Weil. Le mal, par ailleurs, incline l’homme « à remettre en cause l’existence de Dieu ». Etty renverse le problème. Il s’agit de se tourner vers ce « Dieu fragile qui a besoin de nous » et qui pose la question à l’homme : « Que fais-tu de la liberté que je t’ai offerte ? ».
Cet essai d’Oliver Risser est riche de notations qui nous révèlent une Etty Hillesum profondément incarnée. Cette jeune femme, qui se donne corps et âme aux autres, a de forts appétits sexuels. Elle prit même un jour la décision d’interrompre une grossesse et parlera de « l’enfant non-né » à qui elle veut « épargner d’entrer dans cette vallée de larmes ». C’est la même femme qui pouvait ailleurs écrire que « la vie est grande, bonne, passionnante, éternelle », révélant ainsi, comme tout un chacun, ses propres contradictions. Olivier Risser en profite pour rappeler ces mots de Simone Weil dans La Pesanteur et la grâce : « La contradiction est l’épreuve de la réalité ».
Etty Hillesum, un chant de vie par-delà les barbelés, Olivier Risser, suivi de Notes sur la poésie d’Etty Hillesum, L’Enfance des arbres, 2022, 250 pages, 17 euros
 |
Anne-Lise Blanchard, |
| L’horizon patient |
|---|
L’horizon patient, Anne-Lise Blanchard, préface de Colette Nys-Mazure, Ad Solem, 2022, 107 pages, 17 euros
 |
Philippe Le Guillou, |
| Le testament breton |
|---|
Philippe Le Guillou affiche son amour de la Bretagne dans un récit où l’on retrouve sa géographie intime et ses lieux fondateurs. Place, avant tout, à l’imaginaire. Car si l’auteur affirme une « conscience bretonne », elle n’est pas celle de l’engagement ou du militantisme mais plutôt celle qui trouve sa source dans un héritage à la fois historique et poétique.
Ce testament breton, Philippe Le Guillou raconte l’avoir écrit au Faou, sa ville natale, « dans une solitude et une réclusion totales ». Nous sommes, comme il le dit, au cours de « cet étrange printemps de 2020 » quand sévit la pandémie. L’écrivain en profite pour condenser dans un récit tout ce qu’il a déjà un peu dit (ou pas encore dit) sur cette Bretagne qui s’enracine, pour lui, « du côté de l’imaginaire et du fantasme, de la nostalgie et du désir ». Revoici, sous sa plume, « ces endroits qui sont un peu comme les aimants d’un cadastre sélectif ». Voici Le Faou et son « église des marées », voici la forêt du Cranou et ses liserés de jonquilles ou de primevères, voici le sanctuaire de Rumengol et son étonnant vitrail, et, plus loin, Le Menez-Hom, Saint-Anne-la-palud, l’abbaye de Landévennec, Les Monts d’Arrée… Philippe Le Guillou aime la géographie. Il aime les cartes (comme celle de Bretagne qu’il avait en face de lui à l’école). Il aime, lui-même, dessiner « les côtes, les baies, les pointes et les reliefs de l’Armorique ».
Pour décrire ce pays, il prend appui sur les quatre éléments. L’eau, d’abord, celle des rivières (à commencer par celle du Faou) mais aussi celle des marées montantes, avec « la conscience d’habiter un territoire menacé, déchiré par l’irruption des flots » ; L’air, ensuite, avec ses « tempêtes de novembre » et ses « grands souffles féroces » (comment ne pas penser aux « vents hurleurs » de Xavier Grall) ; la terre, avec « ses champs labourés, des pacages et des prairies, un bocage harmonieux quadrillé de talus et de haies » ; Le feu, enfin, « tout aussi fascinant, mais plus lointain, plus intermittent » quand il frappe les landes des monts avoisinants.
Mais les quatre éléments, ainsi déclinés, ne sont que la partie émergée d’un pays aux « fondations mystérieuses et vitales ». Car l’auteur nous entraîne, par petites touches, dans sa définition de la « matière de Bretagne » où il fait se côtoyer l’approche spécifique de la mort chez Les Bretons, la quête inassouvie du saint Graal, « la belle et vivante unité du grand royaume celtique ». Et toujours, en toile de fond, cette quête spirituelle, ce sens du sacré et cet « imaginaire des confins » qui résiste envers et contre tout (alors que « la langue des confins », elle, « s’est perdue »).
Cet imaginaire est entretenu par les paysages mais aussi par les peintres (aussi bien Mathurin Méheut que Yves Tanguy), par ces éminents écrivains que Philippe Le Guillou a placés dans son panthéon littéraire : Anatole Le Braz (et sa Légende de la mort), Yves Elléouët, Julien Gracq (celui du château d’Argol), Saint-Pol-Roux (le mage de Camaret), mais aussi Xavier Grall, « un grand écrivain dont les songes et les lignes entraient en véritable résonance avec mon univers le plus intime ».
Philippe Le Guillou en est convaincu. « Il ne suffit pas de naître sur une terre pour l’adopter et pour l’aimer : tout un travail enfoui, une progression titubante, intime, est nécessaire. Il faut savoir déchiffrer les signes, les échos et les résonances, et la littérature, quand elle possède ce haut pouvoir d’enchantement, se révèle salvatrice ». Laissons-nous enchanter, pour notre part, par ce récit de haute volée, écrit dans cette prose élégante qui porte la marque d’un grand écrivain.
Le testament breton,Philippe Le Guillou, Gallimard, 2022, 153 pages, 16 euros
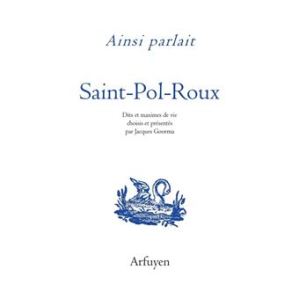 |
Jacques Goorma, |
| Ainsi parlait Saint-Pol-Roux |
|---|
On l’appelait « le mage de Camaret ». Voici un livre qui permet de découvrir de manière synthétique une œuvre majeure. Celle d’un poète, d’un écrivain, d’un homme de théâtre qui avait élu domicile dans la Presqu’île de Crozon et dont on connaît la fin tragique. « La vie c’est le courage universel », disait Saint-Pol-Roux.
Les Dits et maximes de vie de Saint-Pol-Roux (1861-1940) présentés dans ce livre le sont par l’écrivain et poète Jacques Goorma, exécuteur testamentaire de Divine, la fille de Saint-Pol-Roux. Ces fragments renvoient à l’ensemble de son œuvre. « Ils visent à rendre compte de la « sagesse » de leur auteur, c’est-à-dire de la vision du monde et de l’homme qu’il s’est forgée tout au long de sa réflexion », explique Jacques Goorma. « La vanité de l’homme est en rapport avec sa pesanteur », écrivait Saint-Pol-Roux. « Glorifier la mort, c’est offenser la vie ».
Né dans la banlieue de Marseille, Saint-Pol-Roux (de son vrai nom Paul Roux) était monté à Paris pour faire du droit. Il se mêle vite à la vie littéraire de l’époque, fonde une revue (La Pléiade), rencontre Villiers de l’Isle-Adam, Mallarmé et se fait remarquer par les qualités de ses écrits (Théâtre, recueils…). En 1895 il quitte Paris pour vivre à Bruxelles, dans les Ardennes, puis à Roscanvel avant de s’installer à Camaret en 1905 où il fait construire un manoir à huit tourelles autour d’une ancienne ferme. Le voici face à l’Océan, tout près de l’alignement de menhirs de Lagatjar. « Les personnages de Camaret, le monde familier des animaux (…), les rochers qui l’entourent et que le poète contemple depuis son rêvoir (une étroite plate-forme encastrée dans les rochers et recouverte d’herbe rase et d’où, bravant le vertige, Saint-Pol-Roux contemplait l’immensité écumante autour des Tas de Pois), tous ces éléments sont revalorisés dans son monde, recréés dans le poème de sa vie… », raconte Jacques Goorma.
C’est là, à Camaret, que le premier drame arrivera. Dans la nuit du 23 au 24 juin 1940, un soldat allemand investit le manoir, tue la gouvernante, blesse la fille de l’écrivain et tente de la violer (Saint-Pol-Roux avait enterré en juin, dans son jardin, le manuscrit d’un grand poème contre Hitler). Trois mois après, le manoir est pillé et de nombreux manuscrits sont déchirés ou brûlés. Des pages seront recueillies par des gens du pays et conservées précieusement par Divine. Saint-Pol-Roux mourra les 18 octobre 1940 à l’hôpital de Brest.
Le voici qui nous revient à travers ses dits et maximes. « Une parole juste et libératrice », écrit Jacques Goorma qui souligne « la distance de son humour, le don de son amour, la conscience aiguë de la solidarité qui le lie à ses frères humains et la force de son silence ». Saint-Pol-Roux était celui qui pouvait écrire : « À la condition d’être lui-même, chaque homme, si humble soit-il, peut nous offrir un enfant de lumière ». Ou encore ceci : « Un peuple sans beauté commence de mourir ».
Ainsi parlait Saint-Pol-Roux, dits et maximes de vie choisis et présentés par Jacques Goorma, Arfuyen, 2022, 170 pages, 14 euros
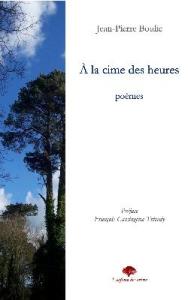 |
Jean-Pierre Boulic, |
| À la cime des heures |
|---|
Les fidèles lecteurs des poèmes de Jean-Pierre Boulic ne seront pas désarçonnés à la lecture de son nouveau recueil. On y retrouve à la fois les lieux familiers de l’auteur breton (entre terre et mer, « à l’orée de l’océan », en pays d’Iroise) et les méditations qui sont les siennes sur cette vie éternelle vécue dans l’instant présent.
Le poème est-il est un exercice spirituel ? C’est le poète Gérard Bocholier qui le dit. On est disposé à le croire à la lecture des textes de Jean-Pierre Boulic. C’est dans cette veine-là, en effet, qu’il creuse son sillon depuis de nombreuses années. Mais cet exercice spirituel n’a rien d’éthéré. Il s’enracine toujours dans des lieux, « lieux de patience », « Univers de galets / De vagues » où « la brume couve les tourterelles », où « l’aube déverrouille les roses ». Il y a le chemin côtier tout proche, l’appel de la grande bleue mais aussi ces ribinnou à l’intérieur des terres d’où surgissent « les flocons bleus des campanules », ce « pommier nimbé de rose » ou encore « la bergeronnette en brassière blanche ».
De bout en bout, c’est la contemplation et l’attention soutenue au monde. « Un rien enlumine les heures pour celui qui a le cœur ouvert à la reconnaissance et à l’émerveillement », note le frère François Cassingna-Trévedy dans la préface de ce livre. « Tu es ici / De ton humble présence / Tirant de rien petites choses », écrit le poète breton. « Tu confies ton goût de vivre / À la cime des heures ». Instants de plénitude, mais dans la fidélité à un lieu de mémoire. Enracinement et filiation assumés. « Voilà plus de soixante-cinq ans / Que tu as sans le savoir / Reconnu ce lieu où l’herbe rase / Est couverte de menues bruyères / Que ta mère contemplait étonnée ».
Sensible à « l’étincelle d’un rien », Jean-Pierre Boulic peut élargir la focale – jusqu’à manier le grand angle – pour voir à l’œuvre, « au verger des heures », la Bonne Nouvelle de l’Évangile. Voici « l’homme fatigué », « la femme qui vient », « le puits séculaire », trilogie du récit de la Samaritaine (Jean 4, 1-42). Voici « Un drôle d’oiseau / Mal aimé » qui « S’abrite dans le sycomore /Un peu plus haut que les badauds ». Bonjour Zachée ! (Luc 19, 1-10). Voici la foule qui « avait faim » et qui « fut rassasiée » (Matthieu 14, 14-21). La vie de Jean-Pierre Boulic, poète chrétien « à la cime des heures », le ramène inlassablement à ces tranches de vie pleinement évangéliques qui n’en finissent pas de l’inspirer. À ce propos, François Cassingena-Trévedy note avec justesse sa parenté d’inspiration avec la poétesse Marie Noël, celle qui pouvait écrire : « L’aube a couché mes cils et je me suis levé / J’ai trempé mon cœur lourd dans la brumes divine / J’ai bu dans la fontaine et je m’y suis lavé ». Une manière aussi, comme le poète breton aujourd’hui, de savoir parler à voix basse à la cime des heures.
À la cime des heures, Jean-Pierre Boulic, préface de frère François Cassingena-Trévedy, L’enfance des arbres, 2021, 100 pages, 15 euros
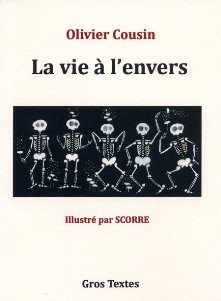 |
Olivier Cousin, |
| La vie à l’envers |
|---|
Quand un poète se jauge et jauge son époque, cela peut donner La vie à l’envers, un recueil d’humour noir sur la vie d’un défunt dans sa tombe. Le Breton Olivier Cousin nous avait déjà habitués à ce genre de regard oblique, comme ce fut le cas dans Les riches heures du cycliste ordinaire où il racontait le monde depuis la selle de son vélo. Le voici aujourd’hui dans la « tentative fragmentaire de compter sur soi jusqu’à l’infini », sous-titre de son nouveau petit livre.
« Depuis que ma mort est effective, je suis soulagé d’un poids : je n’ai plus peur de mourir ». Les aphorismes et autres pensées de ce recueil sont souvent de cet acabit-là. « Mourir de rire n’est plus du tout dans mes cordes », fait dire Olivier Cousin à son « héros » dans la tombe. « Passant / La vie est courte / L’éternité aussi / Les miennes se sont achevées », écrivait un autre poète breton, Gérard Le Gouic, dans un livre où il faisait aussi parler les défunts (Passant, précédé de L’enclos, suivi de Éloge, éditions Telen Arvor, 2017). Il y a aussi le Rennais Jacques Josse et son Comptoir des ombres (Les hauts-Fonds, 2017) qui nous montrait des copains défunts prenant l’apéro sous terre. « Le bar central se situe dans un caveau assez spacieux pour recevoir ceux et celles qui ont encore quelque souvenir à faire valoir ». Olivier Cousin, lui, épouse volontiers la même veine du macabre… désopilant. Ses séquences courtes font mouche à chaque fois. « La question de l’angle mort reste un mystère dans le caveau ». « Je vis ma mort en ermite », « Ici j’ai intégré une chose : le futur n’a pas d’avenir. Le passé est enterré pour de bon. Le présent ne pèse rien ».
Le plus croustillant dans ce livre, c’est la référence à nos existences et à nos modes de vie. Faire parler un mort, c’est d’abord faire parler des vivants (mais à l’envers) dans des passages qui ne manquent pas de piquant. « En troquant la voiture contre la tombe, j’ai juste changé de concessionnaire ». Ou encore, ceci : « Orange n’a pas donné suite : je serai sans fibre jusqu’à l’éternité ». Le débat (si contemporain) sur la crise de l’énergie arrive même sur le tapis. « Question énergie, nous dit le mort, je suis devenu irréprochable. Plus aucun gaspillage, eau, électricité etc. Je pousse l’éco-responsabilité jusqu’à produire moi-même du gaz que je ne consommerai pas. Je passerais pour un vantard si je vous parlais de mon compost ». Et ceci, plus loin : « Seule la pensée de l’épuisement de ma matière première requiert encore mon attention ».
Les bruits du monde arrivent par bouffées à l’intérieur de la tombe (comme ils arriveraient à l’intérieur d’un appartement). Voici ces « bien-portants » que l’on entend « trébucher » dans les allées du cimetière. Voici les « préados » qui font du skate pas loin. « Je perçois les trépidations jusque dans les jointures de mon caveau ». Voici le crissement des freins du vélo d’un gamin « faisant des dérapages dans la poussière ». Et ce crissement rappelle au mort « les derniers tours de vis » pour « river » son cercueil.
Olivier Cousin a eu, en outre, la bonne idée d’associer quelques belles plumes à ces évocations : des poètes du Moyen-Age (ceux des grandes mortalités), le poète Michel Deguy parlant du cimetière où le présent est « cassé en mille morceaux », Samuel Beckett affirmant que « la mort doit me prendre pour un autre », ou encore Henry de Montherlant à qui l’on prête cette phrase : « Vérifier bien méticuleusement que je suis bien mort ». Il y a même, pour la bonne bouche, ce dicton breton : « Un danjer eo bezan bev d’an deiz a hiriv », « C’est un danger d’être en vie de nos jours ».
La vie à l’envers, Olivier Cousin, illustré par Scorre, Gros textes, 2021, 69 pages, 7 euros
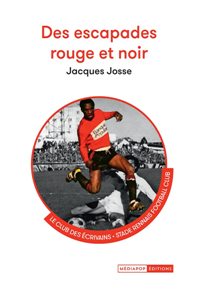 |
Jacques Josse, |
| Des escapades rouge et noir |
|---|
Jacques Josse raconte son Stade Rennais à lui. Une passion héritée de son père, fervent supporter des Rouge et Noir. Le poète rennais nous fait entrer dans l’imaginaire d’un club et de ses supporters. Mais il le fait dans « les marges », comme il l’a toujours fait dans ses livres en parlant des gens, de ce qui les fait vivre et vibrer.
« Il allumait le transistor à des heures précises ». Jacques Josse se souvient de son père à l’écoute des matches du multiplex football. « Il haussait le son quand des nouvelles arrivaient du Stade de la route de Lorient ». Les Josse vivent dans les Côtes d’Armor, près de Paimpol, et le Stade Rennais est à l’époque le club-phare de toute la Bretagne. Il le restera longtemps, même après la montée en gamme du Stade Brestois, de l’En-Avant de Guingamp ou du Football-Club de Lorient. « Une semaine avant de s’en aller, en février 2008, il écoutait encore le multiplex endiablé du samedi soir à la radio », ajoute l’auteur parlant de son père.
Racontant tout cela, Jacques Josse nous dit ce que l’on doit à nos pères. Quelque chose, dans le cas présent, qui peut relever du futile, mais qui ne l’est pas du tout en réalité. Le poète et philosophe suisse Georges Haldas a ainsi raconté dans un livre touchant (La légende du football, éditions L’Age d’homme) ce qu’il devait à son père, supporter du Servette de Genève, qui l’attirait avec lui au stade, lui faisant ainsi découvrir des horizons insoupçonnés. Jacques Josse, aussi, a vécu aussi une telle expérience, mais par procuration (car le match n’était vécu qu’à distance). Mais il a vite saisi ce qui pouvait agiter les hommes, ce que pouvaient signifier les passions humaines.
Jacques Josse regardera toujours le Stade Rennais en pensant à son père. Mais sans jamais aller dans les tribunes, s’enflammant plutôt à distance, se contentant de rester sur les bords de la Vilaine (qui jouxte le stade) pour écouter, par exemple la rumeur du Roazhon Park lors d’un match de Ligue Europa contre le Celtic de Glasgow. L’auteur rennais raconte avoir toujours aimé « vrôder autour des stades ». Il l’a même fait à Prague autour de celui de Dukla de Prague, mais en pensant au poète tchèque Jiri Kolar qui, lui, soutenait le Slavia de Prague.
Le Stade Rennais, Jacques Josse le voit à la télé, comme lors de la mémorable finale de Coupe de France, le 27 avril 2019. Certes, il est allé humer l’ambiance sur l’esplanade de la ville où le match était retransmis sur écran géant, mais il a préféré suive cela à la télé dans son appartement. « L’effervescence qui règne en ville m’a titillé les neurones, raconte-t-il, je le sens aux tremblements qui s’emparent de ma main droite ». Après la victoire, c’est le coup d’œil sur le bistrot d’en bas, Le Bardac, où « les gens sont aux anges, crient et applaudissent chaque fois que passent les bagnoles ». Son récit est ainsi truffé de scènes particulièrement bien senties. Toujours à l’affût, Jacques Josse a, par exemple, repéré ces supporters inconditionnels des Rouge et Noir, Régis et Vladimir, dont il aime suivre « le manège » dans un bar du centre-ville de Rennes.
Les fins connaisseurs de l’histoire du Stade Rennais retrouveront aussi les figures de ceux qui ont fait les grandes heures du club : le « virevoltant » Ivoirien Laurent Pokou, l’entraîneur emblématique Jean Prouff dont une statue a été installée « dans la tribune Super U » du stade. Et déjà se profilent de nouvelles gloires, comme ce jeune Eduardo Cavaminga qui joua son premier match chez les pros à l’âge de 16 ans. Puis Jacques Josse, pour conclure, revient au père et à son héritage. « Je marche pas à pas sur la route vagabonde où se sont jadis posés ses semelles rêveuses en bifurquant fréquemment vers des chemins de traverse qui me mènent sur les traces de son ancien club fétiche ». Et que vivent à jamais les Rouge et Noir !
Des escapades rouge et noir, Jacques Josse, Médiapop éditions, 2022, 65 pages, 9 euros
 |
René Guy Cadou, |
| Et le ciel m’est rendu |
|---|
Des inédits de René Guy Cadou ! Quel bonheur, mais aussi comment ne pas s’étonner que des textes du poète de Louisfert aient pu rester si longtemps dans un tiroir. 70 ans après sa disparition, les voici accessibles grâce à la diligence des éditions Bruno Doucey. Une quarantaine de poèmes sont publiés ici, où l’on retrouve les thèmes favoris de René Guy : l’amour de Hélène, la sensibilité à la nature, le quotidien dans sa banalité et sa simplicité, les émois de l’enfance… Nous sommes vraiment en pays de connaissance.
Comment ne pas aborder ces inédits de Cadou sans une certaine émotion ? Mais, aussi, comment ne pas se sentir, d’emblée, de plain-pied avec cette « harmonique » qui signe tous ses poèmes : un accord tacite avec le monde, dans ce qu’il a à la fois de plus joyeux et de plus tragique, le tout exprimé dans un langage au lyrisme tempéré.
Ces poèmes inédits, accessibles aujourd’hui au grand public, se trouvaient (grâce à la diligence de Hélène Cadou) au fonds Cadou de la bibliothèque municipale de Nantes. Ils sont presque tous datés, en majorité de 1944, mais il y en a aussi allant de 1947 à 1950. Certains d’entre eux ne sont pas de purs inédits, ayant été publiés en revue ou sous forme de courte plaquette comme Cantate de la forêt (Éditions du Petit Véhicule, 2006). Dans une note sur la présente édition, Jean-François Jacques explique que « un texte non retenu pour la publication par son auteur peut signifier plusieurs choses : soit une “mise en réserve” pour une publication intérieure, soit une insatisfaction de l’auteur qui se réserve la possibilité de revenir ultérieurement sur son écriture. Mais comme René Guy n’a jamais mentionné “Ne pas publier”, ou n’a pas détruit ces textes, nous nous autorisons à les donner à lire, comme un complément utile à la connaissance que nous avons de son écriture poétique ».
Cet éclairage apporté, plongeons-nous dans ces inédits où transpire notamment avec force l’amour de René Guy pour Hélène. Il faut dire que nombre de poèmes publiés ici datent de 1944, année qui a suivi leur première rencontre à Clisson. « Sa main sur mon visage / Et le ciel m’est rendu », écrit René Guy dans un poème pour les 22 ans de Hélène. « En 1922 à Mesquer / Il y avait des tas de lanterne sur la mer / Et des oiseaux de sel dans la cour de l’école ». Dans un autre poème datant du 3 mai 1944 qu’il dédicace à sa « petite Lène chérie », il dit : « Je prends ses mains / Je n’ai plus mal ». Cinq ans plus tard, le 24 juin 1949, c’est toujours la même déclaration d’amour : « Tu es debout devant ma vie avec ton ventre / Pareil à un pays d’après la fenaison / Il me vient de ta chair comme une odeur de plantes / Piétinées un lendemain de procession ».
Ces « envolées » qui parcourent le recueil n’empêchent pas de garder cette conscience aiguë de « la douleur humaine » (comme le dira Xavier Grall dans Genèse) et de la noirceur du monde. Voici évoqué à nouveau, dans un poème, les fusillés de Chateaubriant que Cadou avait croisés sur le chemin de leur exécution en 1941. Voici un drame raconté dans sa « complainte de l’enfant au bois », où l’on croit retrouver les accents d’une gwerz bretonne. « Elle gît comme un nid dans l’herbe / Et toute entière découverte / Elle a des yeux tout de travers / Un tablier à carreaux verts ». Alors, oui, se tourner vers Dieu. Non pas pour parler de son absence, mais pour faire une « demande d’audience » (titre de l’un des poèmes). « Mon Dieu apprenez-moi à prier / Comme l’enfant s’appuie à des châteaux de sable ». Ailleurs il écrira : « Mon Dieu accepte-moi / Comme un ami facile / Toujours prêt à t’aider / au transport de la croix ».
Ainsi allait René Guy sous les cieux de Brière. On le retrouve intact dans ces inédits et nous voici, à nouveau, en communion avec lui. Comme nous le sommes, à nouveau, avec Hélène dont des inédits paraissent aussi au même moment sous le titre J’ai le soleil à vivre, toujours aux éditions Bruno Doucey. Réjouissons-nous.
Et le ciel m’en rendu, René Guy Cadou, préface de Bruno Doucey, éditions Bruno Doucey, 2022, 100 pages, 14 euros.
 |
Hélène Cadou, |
| J’ai le soleil à vivre |
|---|
Hélène Cadou nous revient. Huit ans après sa mort elle nous éblouit à nouveau, elle qui a brandi si haut le flambeau de l’œuvre de René Guy tout en poursuivant sa propre œuvre poétique. Pourquoi nous touche-t-elle toujours autant ? « Parce que Hélène écrit sans fard, sans artifices ni effets de manche, au plus près de ses ressentis », affirme avec justesse Muriel Szac dans la préface de ces inédits publiés par Bruno Doucey.
Comme celui qui fut l’homme de sa vie, disparu il y a soixante-dix ans, Hélène Cadou avait donc des poèmes « restés dans les tiroirs ». Les voici mis au jour, exhumés en quelque sorte du fonds Cadou de la bibliothèque municipale de Nantes. Il s’agit d’un ensemble relativement disparate de poèmes jamais datés mais qui, par leur tonalité, se révèlent avoir été écrits – pour beaucoup d’entre eux – dans les années 2006 à 2008 avant que la maladie ne rattrape Hélène et ne l’empêche à tout jamais d’écrire (elle décédera en 2014).
À la lecture des deux précédents recueils d’Hélène Cadou (Le bonheur du jour et Cantate des nuits intérieures, Bruno Doucey, 2014) on avait eu la troublante sensation qu’ils avaient été soufflés à l’oreille de la femme aimée par le disparu lui-même. Chez les deux poètes, la même faculté à se mouvoir dans un monde empli de signes et la même capacité à envisager une vie emplie de « fontaines familières », de « sommeil limpide sous les arbres », de « paroles ensoleillées comme des abeilles ». Le Paradis en somme ? Qui sait…
C’est cette même connivence avec René Guy que l’on retrouve dans ce recueil d’inédits d’Hélène. « Adieu à toi qui me fis don / De ton absence en viager ». Le veuvage de Hélène durera – faut-il le rappeler – plus de soixante ans. Elle nous parle donc ici depuis « ces hauts plateaux / de la mémoire », ajoutant, comme pour mieux inscrire son propos dans le terroir qui fut celui de leur amour : « Ce n’est pas d’un homme que je parle / C’est un pays en moi / Qui a visage d’homme ».
Ce pays à hauteur d’homme, elle en parle dans ce langage épuré qui signe son écriture. « Bonheur des prés / Noce d’un arbre / Et d’un nuage ». Gorgée d’espérance malgré l’absence, elle peut écrire : « J’ai le soleil à vivre / La pluie / Les nébuleuses de la plaine // À vivre l’herbe et les fleurs / Le goût des rues / Et des matins ». Acquiescement au monde qui démarre très tôt avec cette « Enfance légère / Qui déjoue les embuscades / Et gravit le ciel », avec ses « chemins creux / où se perdre ».
Mais le temps fait son œuvre. Il entretient la nostalgie (« qui se souvient de cette chambre / Où je te vis pour la première fois »). Mais, plus encore, il suscite l’effroi. « L’obscur me gagne / J’assiste à la montée sévère / De la nuit / Alerte à ceux que j’aime / Il s’agit d’eux ». Veillant sur l’œuvre de René Guy, Hélène veillait aussi sur nous ses lecteurs. Parole d’adieu mais aussi appel à changer notre regard, à inventer des chemins nouveaux. « Pour mettre le monde à neuf / Il faut poncer jusqu’à l’os / Dégager le juste appareil / de la ronce et de l’illusoire ».
J’ai le soleil à vivre, Hélène Cadou, éditions Bruno Doucey, 2022, 134 pages, 15 euros.
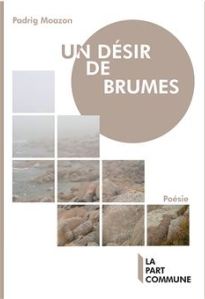 |
Patrig Moazon, |
| Un désir de brumes |
|---|
« Une écriture de l’imaginaire, parfumée de réalité ». C’est ainsi que se définit le nouveau recueil de Patrig Moazon. La réalité dont il est question ici emprunte le visage des rivages bretons, ceux de la côte nord, plutôt du côté des îles. Sans oublier le Pays pagan où l’auteur a de sérieuses attaches. Quant à l’imaginaire, il galope facilement dans un territoire largement habité par les brumes et les brouillards.
Patrig Moazon n’est pas né de la dernière pluie. En 1973 (à 19 ans), il publiait une forme de brûlot poétique, sous le titre Celte présence, au cœur du remue-ménage culturel et social de la Bretagne post-68. Les éditions P.-J.Oswald, où était publié ce livre, accueillaient à l’époque des poètes bretons à la plume acérée dénonçant à la fois les méfaits du capitalisme ou le sort (colonial) réservé à la Bretagne. On pense à Paol Keineg, Kristian Keginer ou encore Yann-Ber Piriou. Dans Celte présence, Patrig Moazon parlait des « hommes effilochés sur le macadam de l’émigration ». À l’écoute des ouvriers du Joint français à Saint-Brieuc, il pouvait écrire : « Avec l’haleine de nos mots / souffler notre colère dans le granit des silences ». Il dédiait son livre aux « indigènes du Parc armoricain ». Il évoquait la « colère paysanne » (« Dans la rue poussent des artichauts en forme de grenades »). Cri de fureur d’un jeune Breton, originaire de Saint-Méen-le-grand, étudiant à la fac de droit de Rennes.
Près de cinquante ans après, voici Patrig Moazon sur un tout autre registre. Car le monde a bien changé, la Bretagne aussi et le jeune homme de 19 ans aura 68 ans cette année. Mais ce qui n’a pas changé, c’est cet amour – cette fois transfiguré – pour un pays où « les abeilles et les verdiers / partagent la rouille des bruyères », où « le ciel a pris ses habitudes / établi un compromis avec le vent ». Ce qui n’empêche pas le jeune militant qu’il fut (et qui pointe, de-ci de-là sous le poète) d’épingler aujourd’hui l’emprise technologique sur nos vies et sur notre imaginaire (« le phare réduit au chômage partiel / par le radar et le GPS ») ou encore de souligner les insultes faites à l’histoire ou au patrimoine breton (« l’ossuaire est devenu garage à vélos de location ».
L’essentiel du recueil est là pour nous proposer une approche toujours émerveillée de la nature en Bretagne. Avec une préférence marquée pour ces îles qui collectionnent « les brumes et les ombres ». Ici on reconnaît Ouessant entre les lignes car « derrière le mur de pierres / les moutons hésitent entre les frelons du trèfle / et les bourgeons du roncier ». On pense à Roscoff quand « le ferry / transporteur de rêves / quitte le port ». Plus loin, nous voici en plein Pays pagan, celui des « Pilleurs d’épaves / Trafiquants d’illusions // Ramasseurs de goémon / Inventeurs de légendes ». Nous sommes sur la Côte des légendes où le poète rennais a ses habitudes du côté de Plounéour-Trez. « Monde flottant » (comme dirait Kenneth White) partagé entre brumes tenaces, « nuages lourds » et éclaircies joyeuses bondissant sur le chaos des rochers.
Patrig Moazon le dit en maniant le poème court, l’aphorisme, parfois la sentence, sans oublier le haïku. « À l’ombre d’un rocher / pas à pas / le fracas des vagues ». Alignant ses poèmes comme on le ferait d’une belle collection de coquillages (ici, de préférence, des brennig), il nous propose de véritable « brèves de grève » dans une écriture en « mode basse-consommation », pour nous mener très au large et faire galoper notre imaginaire.
Un désir de brumes, Patrig Moazon, La Part Commune, 2022, 100 pages, 13 euros
 |
Yvon Le Men, |
| Les Épiphaniques |
|---|
On connaissait Les Épiphanies aux accents libertaires d’Henri Pichette. Voici Les Épiphaniques d’Yvon Le Men, un livre qui nous renvoie, plus qu’à la fête religieuse bien connue, à la racine grecque du mot. Épiphanie, autrement dit révélation, apparition. Voici, en effet des hommes et des femmes « invisibles » sortis de l’ombre, mis sous la lumière par la grâce d’une écriture poétique qui se met au service de leurs récits de vie. Ils et elles vivent dans la marge, cassés voire broyés par la vie. Le poète breton les a écoutés et il raconte à la fois leurs itinéraires et leurs espoirs.
Pour Yvon Le Men tout démarre par une résidence d’auteur à Rennes. Comme il l’avait fait pour Les rumeurs de Babel (Dialogues, 2016 ) dans le cadre d’une autre résidence, cette fois au cœur du quartier populaire de Maurepas, le poète va rencontrer des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, « de souche » ou immigrés (récents ou non). Ils s’appellent Mickaël, Louna, Thomas, Tiago, Myriam… La vie les a secoués. Ils sont tous dans la marge, parfois après des enfances de misère (« La goutte de gnole dans le biberon pour m’endormir », raconte l’un) ou l’expérience de lourds drames familiaux (le suicide d’une mère, confie un autre). Anne-Laure, elle, raconte : « Mes ancêtres étaient des tueurs de loups / du Loup / mes arrière-grands-parents / des tueurs d’Arabes ». Pour Asma, la Somalienne, c’est de l’emprise du père qu’il faut se libérer. « Il faut que l’on soit comme mon père / veut qu’on soit ».
Le poète écoute, met en vers leurs récits, ennoblit leurs destins de déclassés. Mais il établit aussi des correspondances avec sa propre vie. Quand cette fille-mère de 40 ans évoque sa vie dans une yourte, Yvon Le Men ne peut pas manquer de penser à son « amie qui est morte au bord de ses quarante ans » ou encore à sa mère « qui a perdu son amour le jour de ses quarante ans ». Quand tel ou tel évoque sa révolte, Yvon Le Men rappelle qu’il fut aussi, à un moment de sa vie, ce « jeune révolutionnaire ». Mais un révolté qui estime que « la fin ne justifie jamais les moyens ». C’est le Le Men de En espoir de cause (éditions P.-J. Oswald, 1975) et de Vie (L’Harmattan, 1977) qui resurgit au détour d’un vers. C’est le jeune homme épris de justice et de fraternité qui regarde aujourd’hui avec sympathie ceux qui « marchent vers les ronds-points / main sur l’épaule », ceux qui « partagent sur les ronds-points / nuit et jour leurs nuits et leurs jours ».
C’est aussi son itinéraire personnel de poète qui refait surface lors d’une rencontre avec ce jeune qui fut orphelin très tôt et qui rêve aussi de devenir poète. Alors ce jeune lui pose la question : « Tu crois / que l’on peut vivre / en poésie / de poésie ? ». La réponse est lumineuse : « En poésie / oui / il suffit d’y travailler / de poésie / c’est autre chose ». Et alors reviennent sous sa plume, comme une évidence, ces affirmations toutes simples qui ont fondé sa propre aventure poétique. « Le bruit court qu’on peut être heureux » et « Il fait un temps de poème ». Les mots sont Jean Malrieu, un poète qui a tant compté pour Le Men. Et l’on se pose la question : Le Men pourrait-il devenir le Malrieu de ce jeune qui se dit « pressé » et « déjà plus vieux que Rimbaud / quand il a commencé » ? Le poète répond en tout cas à ce jeune qui rêve de poésie : « C’est possible / pour toi / car ce le fut pour moi // il suffit de croire en ceux qui étaient sur la route avant toi / et t’attendent ». C’est ce qu’on appelle sans doute une épiphanie.
Les Épiphaniques, Yvon Le Men, avec des œuvres de Richard Louvet, Éditions Bruno Doucey, 2022, 160 pages, 16 euros.
Le texte de ce livre sera porté sur la scène du Théâtre national de Bretagne à Rennes, dès mars 2022, par le metteur en scène Massimo Dean, sous le titre « La Rance n’est pas un fleuve ».
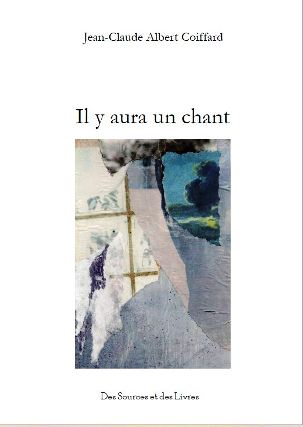 |
Jean-Claude Albert Coiffard, |
| Il y aura un chant |
|---|
Avec Jean-Claude Albert Coiffard, on est dans cette poésie « élémentaire » qui nous ramène, inlassablement, au comment et au pourquoi de notre vie sur terre, dans ce qu’elle a, à la fois, de terriblement angoissant et d’émerveillant. Car la mort est là, en point de mire. Mais le poète sait nous dire qu’« il y aura un chant / envoûtant le silence / des oiseaux arrivant de plus loin que le ciel ».
Jean-Claude Albert Coiffard (né en 1933) a l’âge, comme l’on dit, de regarder dans le rétroviseur. Ce que ne manque pas de faire le poète en égrenant avec bonheur des souvenirs d’enfance entre terre et mer, du côté de la Loire, du marais, de l’estuaire. Nous sommes dans le pays nantais (« Que ma ville était belle / les paupières bleuies / par le lait de la lune ») et l’on retrouve forcément ici les intonations de René Guy Cadou. « Mes souvenirs s’endorment / dans une vieille armoire / dont j’ai perdu la clef », écrit Jean-Claude Albert Coiffard. « On ne parlait pas / on écoutait la nuit / on regardait les ombres », ajoute-t-il.
Francis Jammes rôde aussi dans ces pages, celui qui écrivait : « Chanter de joie, mon Dieu, comme une pluie d’orage », tandis que le poète nantais s’émerveille à la vue d’Eugénie et de ses 3 ans. « Tu cours / dans l’allée verte et bleue / tu cours / Eugénie // et tu es belle / la lumière en frémit ».Ce recueil est ainsi pétri de notations lumineuses, revigorantes. Il fait aussi l’éloge du silence, « un éternel silence / qui nous parle de Dieu (…) quand on entend vibrer / la corde de son âme ».
Mais la mort fait son œuvre fracassant les élans du poète. « Il y eut cette nuit / plus noire que la nuit // il y eut ce silence / plus grand que le silence ». C’est la perte d’êtres chers, évoquée en mots retenus. Et le poète lui-même anticipe son grand départ par une dédicace au monde qu’il quittera un jour. Il l’adresse « aux fleurs et océans / à l’herbe et à l’insecte / aux orties et aux ronces (…) à la bruyère longue / qui embrasse la lande (…) à la harpe, aux saxo ». On croit entendre Xavier Grall faisant l’inventaire du monde dans Genèse, son livre posthume, ou entonnant un chant à son créateur dans Solo.
Jean-Claude Albert Coiffard, lui, écrit : « Je partirai / une légende au cœur / et le sable des roses / dans le creux de la main // Je prendrai le chemin qui conduit aux mystères ». L’éternité existe. Le poète nantais l’a déjà rencontré. « Elle est cette lumière / qui parlait à l’enfant / en langage d’abeille ».
Il y aura un chant, Jean-Claude Albert Coiffard, collages de Ghislaine Lejard, Des sources et des livres, 2021, 70 pages, 15 euros.
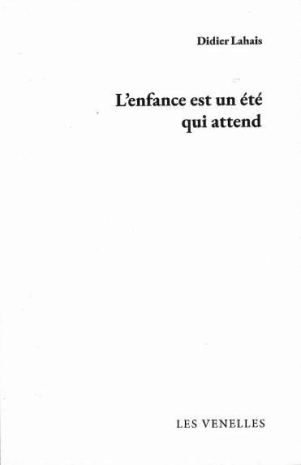 |
Didier Lahais, |
| L’enfance est un été qui attend |
|---|
Récit d’enfance et d’adolescence, chronique d’une génération et d’un milieu social dans le Rennes des années 60 et 70, le livre de Didier Lahais est tout cela à la fois. Mais il est bien plus que cela. Il nous parle de « l’envie de voler et de la peur de l’envol » mais aussi, et surtout, du « tri sélectif » que la mémoire peut opérer au fil d’une existence. Avec, dans le cas de l’auteur, une prégnance du récit de la guerre.
Né en 1958 « dans ce qui serait bientôt une époque ancienne », né « à la frontière de deux mondes », Didier Lahais a en effet baigné dans le récit, fait par ses parents, de la Seconde guerre mondiale et de la libération de Rennes. La paix retrouvée, ses parents – de milieu modeste – s’installent dans le bonheur simple et la routine des jours, mais toujours à l’écoute des rumeurs du monde rapportées par le poste de radio.
Pour le petit Didier, « il n’y a que la lumière et les couleurs mouvantes des choses, l’odeur du bois, les bras qui protègent, une voix sans doute, celle de papa, qui nous dit de sourire pour la photo. Il faudra que nous grandissions un peu pour que le récit commence ». Didier apprend donc les codes en vigueur dans son milieu : « Rester à sa place plus que tenir son rang. Faire allégeance ». Il est l’élève de l’école catholique tenue par « les frères de Ploërmel ». Il a deux grandes sœurs, un petit frère, puis, plus tard, un autre petit frère. Chez les Lahais, on va à la messe. On fait sa Première communion. Les parents se sont connus aux « Cadets de Bretagne ».
« Que reste-t-il d’une enfance ? », interroge aujourd’hui l’auteur. « Un désordre d’images, répond-il, de saisons, de couleurs. Des traces d’émotion qu’une porte poussée sur une odeur d’humide, un jardin, une rue empruntée par hasard font ressurgir. C’est avec ce désordre et ces absences que nous vivons ». Plus loin il parle de ce « brouillon d’un monde qu’on ne mettra jamais au propre, qu’on n’ordonnera jamais, qui passe, coule en moi, m’envahit et devient moi comme je deviens lui ». Bel aveu pour parler de ce passé qu’on ne peut jamais rejoindre et dont il n’existe que des pages raturées remplies de blancs. « Les faits et les mots peinent à trouver leur exact emplacement dans cette fresque ».
Le monde, bientôt, vient frapper à ses tempes d’enfant. Il faudra savoir trouver sa place entre « la France des jardins » et celle des « injonctions nouvelles ». Mai 68 surgit. Didier a 10 ans. « Trop de lumière, trop de foule », écrit-il. Voici le temps des « transgressions libératrices », des « horizons à dépasser ». Faut-il s’accorder, comme tout un chacun, aux « icônes modernes » ? L’auteur fait alors ce constat implacable. « Nous arrivions sur le quai de leurs gares avec nos petits sacs en skaï du centre aéré des faubourgs, qui sentaient la banane et le renfermé ». Choc des cultures : celle du monde des employés (portée par ses parents), celle du monde nouveau assourdissant et péremptoire.
Le jeune Didier s’émancipera loin des codes convenus. Mais il sait être à l’écoute du monde. Coups de feu à la radio (la mort d’Allende), la révolte des Lip, Giscard qui singe le peuple. Des convictions se forgent, à bas bruit, chez l’ado à la mobylette grise. Il entrevoit « la beauté comme un poison contre l’ordre injuste ». Plutôt que les Pink Floyd, il écoute Brel, Barbara, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Jacques Bertin et Joan Baez. Il voit, grâce à son lycée, Les Justes de Camus à la Maison de la culture de Rennes et découvre René Guy Cadou à la devanture de la librairie de la place du Parlement. « Si l’enfance est un été qui attend, l’adolescence fut l’automne qui le suit, impatient d’un Noël qui tarde à venir, consolant ses premiers frimas de chansons et de livres ».
Arrivé au bout de ce récit, l’auteur donne le plus bel hommage qui soit à ses parents. Comme pour boucler la boucle, lui l’homme de 63 ans peut aujourd’hui écrire. « Leur récit m’aura appris que les belles histoires doivent être prises pour ce qu’elles sont : une trace de ce qui fut et une invite à ne pas désespérer d’un idéal que figure la beauté des choses ».
L’enfance est un été qui attend, Didier Lahais, Les Venelles, 87 pages, 12 euros (contact : didier.lahais@gmail.com)
 |
Louis Bertholom, |
| La lyre du silence |
|---|
Un livre-fleuve pour temps de Covid. Louis Bertholom, on le sait, n’a jamais été avare de mots et le montre ici « puissance 10 » en publiant plus de 300 pages de poèmes. Sa Lyre du silence, aux textes sagement alignés et rimés, nous parle de tout ce qui fait l’univers du poète breton. Sa méditation s’adresse à une myriade d’amis ou de connaissances nommément désignés au départ de chaque poème. Vite, prenons notre souffle pour aborder cet Himalaya de quatrains.
Si quelques poèmes datent de 2020 – début de la pandémie – la majorité d’entre eux ont été écrits l’an dernier. « Finis les traits blancs dans le ciel / tout est redevenu si calme / même les oiseaux s’en étonnent, / les nuages se font la fête ». Pris entre la colère pour cause de confinement et l’émerveillement quand il se tourne vers une nature retrouvée, le poète se fait philosophe : « Le rêve compense / toute frustration / tant que sa réserve / ne se tarit pas ».
Ce rêve, chez Louis Bertholom, est inséparable de son tropisme nord-américain. Le voici, à l’occasion de ses 66 ans, prêt à fantasmer sur la fameuse Route 66 qui traverse d’est en ouest les États-Unis et qu’il rêve un jour d’emprunter. « Réinventer le chant des hyènes / sous la lune en lisant Kerouac / aux sources des plaines cheyennes, / un bourbon au feu d’un bivouac ». Kerouac, bien sûr, mais aussi Thoreau ou Whitman dont les fantômes rôdent dans ce livre. Méditant le 14 juin 2021 « vers vingt-trois heures » sur la plage de Kerler en Fouesnant, il peut écrire : « Pensif sur le rivage en feu / d’un soir qui flambe encore au loin / sous les jets des pinceaux célestes / le monde se tait peu à peu ».
Difficile de rendre compte d’un tel livre qui va à hue et à dia, où l’auteur mêle « hommages » et « pensées », évoque « l’enfance » ou encore des « endroits » emblématiques, puis s’attarde sur des faits de « société » avant de nous entretenir sur « le temps qui passe » ou sur « le temps qu’il fait », sur l’acte « d’écrire ou lire » sans oublier de nous rappeler ses insomnies ou d’évoquer tel ou tel jour de pluie passé dans son camping-car.
Il y a enfin ses poèmes aux nouveaux « amis envolés » dont Bertholom, familier de cet exercice (À mes amis envolés, éditions Vivre tout simplement), salue ici la mémoire : le journaliste Jean-Charles Perazzi, le chanteur Serge Cabon, le guitariste Jacques Pellen (mort du Covid)… Le poète en arrive lui-même à envisager sa propre disparition dans un des poèmes les plus touchants de ce livre : « Je voudrais m’envoler d’une vision ultime / nu, abandonné comme une algue à la dérive / sur la plage de Kerler par une nuit sans frime / parmi les gravelots sautant sur la déclive ». Comment ne pas penser ici à Xavier Grall écrivant dans La sône des pluies et des tombes : « J’aimerais partir le jour premier du printemps /dans les doux plis de la mort primevère ».
Mais la vie reprend vite le dessus. Ailleurs, en effet, le poète pense avant tout à sa longévité. Il le dit, dans une forme d’auto dérision, en évoquant le principe de précaution. « Je m’inflige un bon mois de cure / afin que mes gamma GT / retrouvent la virginité / d’une prise de sang bien pure ».
Ainsi va Louis Bertholom sous nos cieux bretons si incertains. Mais, pour la bonne bouche, attardons-nous sur ce poème qu’il dédie à son… fournisseur d’énergie ENGIE. « Lorsque j’interromps le chauffage / au printemps qui vient me sourire, / je lâche enfin un grand soupir / comme une sorte de revanche ». Les rimes sont riches, très riches. Pour dire le renouveau et l’espoir qui gît, « quoi qu’il en coûte », au cœur de l’homme en ces temps chaotiques.
La lyre du silence, Louis Bertholom, Les Éditions Sauvages, collection Askell, 2021, 304 pages, 18,50 euros
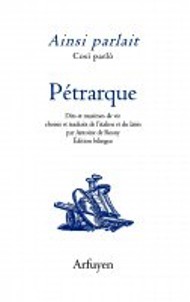 |
Antoine de Rosny, |
| Ainsi parlait Pétrarque |
|---|
Poète amoureux éperdu de Laure et « vainqueur » du Ventoux, Pétrarque a des « étiquettes » qui lui collent à la peau. Cet immense auteur de la Renaissance, Français et Italien à la fois, gagne à être mieux connu. Un florilège de ses écrits – traités, pamphlets, dialogues, poèmes, lettres – est aujourd’hui rassemblé par Arfuyen sous le titre Ainsi parlait Pétrarque.
Né en 1304 et décédé à Padoue à l’aube de son 70e anniversaire, Francesco Petrarca, dit Pétrarque, est une personnalité encore auréolée d’une forme de mystère. Il faut dire que l’éclectisme de ses engagements a permis de créer une sorte de mythe autour de sa personne. On le voit un jour à Avignon auprès de la cour pontificale, un autre jour à Bologne, à Vérone, à Padoue, à Montpellier ou sur les bords de la Sorgue. Auteur « transfontalier », il avait fait en 1330 le choix de la carrière ecclésiastique et reçu les ordres mineurs (tonsure, célibat, lecture quotidienne du Bréviaire).
Pourquoi s’intéresser à Pétrarque aujourd’hui ? Et, surtout, pourquoi capte-t-il notre attention ? Sans doute parce qu’il est, avant l’heure, un saute-frontières pratiquant une forme d’errance à la fois intellectuelle et spirituelle. Il est autant de France que d’Italie. Il revendique l’héritage des Anciens et demeure profondément habité par les auteurs latins, comme l’explique Antoine de Rosny dans la préface de ce livre. « L’éternel pèlerin » qu’était Pétrarque avait « une pensée mue par le désir de donner un sens à la vie ». Son idéal était « l’humanisme chrétien » dont de nombreux dits et maximes regroupés dans ce livre nous donnent l’exacte mesure. « Que les hommes soient bons et les temps le seront aussi », écrivait Pétrarque. « J’affirme qu’aucune vie n’est brève si elle a vraiment rempli son devoir de vertu ».
S’exprimant aussi bien en latin qu’en italien, Pétrarque « savait l’inquiétude de l’homme affairé, la présence familière de la mort et l’insatisfaction où nous laisse l’horizon fermé des biens de ce monde », souligne Antoine de Rosny. Un diagnostic qui s’accorde aux temps troublés qui sont les nôtres. « Le monde est plein de fausses opinions qui, si on ne leur résiste pas, poussent à une extrême misère », écrivait Pétrarque 700 ans avant les « réseaux sociaux ».
Ainsi parlait Pétrarque, dits et maximes de vie, choisis et traduits de l’italien et du latin par Antoine de Rosny, édition bilingue, Arfuyen, 2021, 167 pages, 14 euros.
 |
Rachel, |
| Sur les rives de Tibériade |
|---|
Qui connaît vraiment Rachel Blaustein – dont le nom d’auteur fut simplement Rachel – née en 1890 en Russie et décédée en Israël en 1931 ? Il faut donc saluer ici la volonté des éditions Arfuyen de faire sortir d’une forme d’anonymat cette poétesse au lexique « essentiellement biblique », comme l’affirme son traducteur Bernard Grasset, et profondément marquée par le tragique de la condition humaine.En suivant Rachel sur les rives du lac de Tibériade, nous entrons au cœur d’un univers « parcouru d’un souffle fervent », comme l’affirme encore Bernard Grasset.
Sa vie fut courte. Elle fut aussi chaotique. Fascinée par la Terre sainte où elle se rend en voyage à 19 ans, Rachel y apprend l’hébreu, s’initie au travail agricole puis gagne la France en 1913 pour y entreprendre – à Toulouse – des études universitaires d’agronomie. Elle est contrainte, en raison de la guerre, de regagner la Russie en 1916 où elle se met au service d’enfants pauvres de réfugiés. Mais elle contracte la tuberculose et, avec la maladie, naît l’écriture. En 1919, elle rejoint un kibboutz israélien et écrit ses premiers poèmes. Contrainte de quitter son travail à cause de sa maladie, elle rejoint Tel-Aviv en 1925 où elle décède six ans plus tard. Elle sera inhumée dans un cimetière des rives du lac de Tibériade, un lieu qui l’émerveillait et où des amis créeront « le jardin de Rachel ».
Le livre intitulé Sur les rives de Tibériade rassemble des poèmes épars de Rachel, un choix de lettres ainsi que des articles rédigés entre 1926 et 1930 et publiés dans différents journaux ou revues littéraires. Dans ces articles, Rachel parle beaucoup de poésie et de littérature. Elle dit, par exemple, son admiration pour les œuvres de Francis Jammes ou son attachement à l’œuvre de François d’Assise (dont la custodie franciscaine de Terre sainte, estime-t-elle, a trahi l’esprit du moine italien). On retiendra aussi l’article où elle définit son art propre poétique qu’elle place sous le signe de la simplicité de l’expression : « Expression des premiers tremblements de l’émotion lyrique (…), dépouillée d’artifices littéraires, qui touche le cœur par sa vérité humaine ».
C’est cette simplicité que l’on avait déjà trouvée dans les précédentes œuvres de Rachel éditées par Arfuyen (Regain en 2006, De loin suivi de Nébo en 2013) et que l’on retrouve ici dans 30 poèmes épars écrits entre 1920 et 1930. Ainsi de ce poème dédié à Anne Meizel : « Toi, sous l’arbre, tu te tiens / Et moi sur une branche, comme un oiseau ; / À la cime argentée d’un olivier / Nous taillons les branches noircies ».
Bernard Grasset ne manque donc pas de souligner chez elle sa « fascination pour la nature », son écriture « familière du silence » et placée sous le signe de la « sobriété » ou de « l’expérience de la souffrance » (ainsi de ce poème écrit à l’hôpital). Une invitation à lire Rachel, considérée aujourd’hui comme une fondatrice de la littérature hébraïque moderne.
Sur les rives de Tibériade, Rachel, traduit de l’hébreu et présenté par Bernard Grasset, Arfuyen, 185 pages, 17 euros
 |
John Keats, |
| La poésie de la terre ne meurt jamais |
|---|
Contemporain de Byron, Wordsworth et Coleridge, poètes majeurs de son époque, le Britannique John Keats (1795-1821) n’a pas eu le temps de déployer tout son talent. Décédé à l’âge de 26 ans, il est l’auteur de longs poèmes narratifs et surtout d’odes qui ont assis sa réputation. À l’occasion du bicentenaire de sa disparition, les éditions POESIS nous proposent des extraits de sa correspondance ainsi qu’un choix de poèmes (traductions de Thierry Gillyboeuf et Cécile A.Holdban)la plupart axés sur une forme de célébration de la nature.
« La poésie de la nature ne meurt jamais ». C’est le premier vers d’un poème intitulé « La sauterelle et le grillon » que John Keats écrit en 1816. Il y parle de « pré frais fauché » où se repose la sauterelle, du grillon dont le chant « par une soirée d’hiver solitaire » monte du poêle. Tout l’art de Keats s’exprime dans de poème de quatorze vers à la gloire de la nature et de ses habitants les plus minuscules.
Ce qui ne l’empêche pas, parallèlement, de s’émerveiller d’une nature « majuscule » quand, par exemple, il se rend à Windermere dans le Lake district ou dans les Highlands d’Écosse. En juillet 1818, il écrit ainsi à son ami Benjamin Bailey. « Je ne me serais pas consenti ces quatre mois de randonnée dans les Highlands, si je n’avais pas pensé que cela me fournirait davantage d’expérience, me débarrasserait de davantage de préjugés, m’habituerait à davantage d’épreuves, identifierait de plus beaux paysages, me chargerait de montagnes plus majestueuses et renforcerait davantage la portée de ma poésie, qu’en restant chez moi au milieu des livres, quand bien même j’aurais Homère à portée de main ».
Le jeune Keats avait mis la poésie au cœur de son existence. Et il dit comment il la conçoit dans une autre lettre à son ami Bailey. « La poésie devrait être quelque chose de grand et discret, qui pénètre dans votre âme, et la surprend ou l’émerveille non par elle-même, mais par son sujet. Quelles sont belles, les fleurs qui restent en retrait ! Elles perdraient toute leur beauté si elles prenaient la grand-route d’assaut en s’écriant : « Admirez-moi, je suis une violette ! Adorez-moi, je suis une primevère ! ». Des propos qui signent véritablement son art poétique et sa manière d’habiter poétiquement le monde.
Si Keats dit son amour de la nature, il le dit moins quand il s’agit de parler des hommes. Il a pour eux peu de considération, « tout en affirmant, malgré tout, qu’il aime la nature humaine ». note Frédéric Brun dans l’avant-propos de ce livre. Keats était, avant tout, en proie au doute et les jugements sévères portés sur ses textes par les journalistes de l’époque l’atteignaient donc profondément. Mais on connaît la notoriété posthume dont bénéficiera le poète britannique, aujourd’hui traduit dans le monde entier.
La poésie de la terre ne meurt jamais, John Keats, correspondance traduite par Thierry Gillyboeuf, poèmes traduits par Cécile A.Holdban, choix des textes et avant-propos par Frédéric Brun, éditions POESIS, 2021, 125 pages, 16 euros
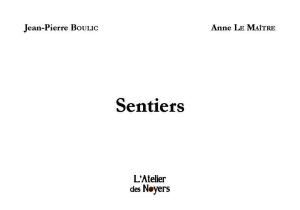 |
Jean-Pierre Boulic, |
| Sentiers |
|---|
Jean-Pierre Boulic nous revient. Fidèle à lui-même. Après L’offrande des lieux (La Part Commune, 2021) où il évoquait certains épisodes fondateurs de sa vie, le voici à nouveau de plain-pied dans les sentiers de son Pays d’Iroise. Pas de surprise, car sous sa plume, on le sait, « les couleurs trémulent » et les « brouillards sont cousus de fil noir »
C’est un tout petit recueil. Format à l’italienne, rehaussé des peintures d’Anne Le Maître. Il est le fruit d’une rencontre au salon du livre insulaire d’Ouessant : celle de Jean-Pierre Boulic avec l’Atelier des Noyers, un éditeur portant « une attention particulière aux expressions de la beauté de la nature ». Le manuscrit Sentiers du poète breton a très naturellement trouvé un lieu d’accueil dans une maison affichant une telle ligne éditoriale. Nous voilà, donc, plongés à nouveau dans ce qui fait le quotidien de Jean-Pierre Boulic. À sa suite nous empruntons les sentiers bien connus (aux fortes senteurs iodées) de son pays d’Iroise, avec quelques embardées du côté de la grande île voisine. Voici « le sarrau des landes », « la dentelle de la brume » et « la tulle de la dune ». Voici « les épaules tassées de l’île » et les « bras ballants du cormoran ».
Les fidèles lecteurs du poète breton reconnaîtront bien ici le style de l’auteur (pas avare de métaphores), son aptitude à saisir l’instant dans toute sa plénitude. Car nous ne sommes pas ici dans le « chromo » facile ou dans la simple couleur locale. Jean-Pierre Boulic nous a toujours amenés à percer le rideau des apparences pour nous faire, poétiquement, « passer sur l’autre rive » (Marc, 4, 35-41) : celle de l’émerveillement et de la contemplation. Ce qu’il appelle ici « les folles avoines de l’âme ».
Tout peut alors devenir signe ou message, comme si le mystère du monde venait soudain frapper à notre porte. Il faut pour cela des messagers privilégiés. Ce sont le plus souvent les oiseaux dans ses livres. Et c’est encore le cas dans ce nouveau petit recueil quand l’auteur évoque « grives et mésanges / passacaille du bocage, voix venues des aulnes ». Voix venues d’ailleurs, pourrait-on dire, pour saluer une « terre abreuvée » qui « respire », pour aider aussi « l’homme fragile » au « frêle cœur de chair » à accueillir cet « instant de clarté » qui « approche à pas légers ».
Sentiers, Jean-Pierre Boulic, peintures d’Anne Le Maître, L’Atelier des Noyers 2021, collection Carnets de nature, 10 euros
 |
Elisée Reclus, |
| L’homme et la nature |
|---|
Comment un texte publié en 1864 peut-il encore résonner aujourd’hui à ce point ? C’est pourtant ce qu’il se passe à la lecture de L’homme et la nature du géographe Elisée Reclus (1830-1905). Tout y est déjà dit – ou presque – sur le nécessaire respect de la nature et sur les atteintes portées par l’homme à son environnement. Ce qu’évoque Elisée Reclus se passe aujourd’hui, sous nos yeux, à une plus grande échelle.
En 1864, Elisée Reclus découvre le livre de George Perkins Marsh (1801-1882), philologue et diplomate américain qui vient de publierMan and nature, physical geography as modified by human action. Reclus y découvre l’essentiel de ses intuitions sur les rapports de l’homme et de la nature. Il décide alors de publier une longue analyse de cet ouvrage dans la célèbre Revue des deux mondes à laquelle il collabore. Son analyse, très fouillée, fait aujourd’hui l’objet d’un petit livre aux éditions La Part Commune.
Marsh, souligne Elisée Reclus, part d’un constat implacable : « Les peuples ont transformé de diverses manières la surface des continents, changé l’économie des eaux courantes, modifié les climats eux-mêmes ». C’est écrit au milieu du 19e siècle. Marsh ajoute : « Le barbare pille la terre » tandis que « l’homme vraiment civilisé répare les dégâts (…) et aide la terre ». La déforestation à grande échelle (qui nous rappelle quelque chose se passant aujourd’hui sous nos yeux) est notamment pointée du doigt. Sont évoquées les conséquences de cette déforestation sur la Perse, la Mésopotamie, les Carolines ou l’Alabama, mais aussi sur les Alpes françaises. « Des propriétaires trop avides ont abattu presque toutes les forêts qui recouvraient les flancs des montagnes, note Elisée Reclus à la suite de Marsh, et par la suite l’eau, que retenaient autrefois les racines et qui pénétrait lentement la terre, a cessé son œuvre de fertilisation pour ne plus servir qu’à dévaster ».
Et que dire des perturbations constatées au niveau du climat et du déroulement des saisons. Par son action dévastatrice, l’homme « change le réseau des lignes de température ». Que dire, enfin, des conséquences sur la flore et la faune où des espèces sont en voie de disparition à cause de « l’intervention insensée de l’homme ». On croit lire un texte du 21e siècle.
On comprend qu’Elisée Reclus – porteur d’idées anarchistes et communautaires – ait pu séduire de larges pans du mouvement écologiste dans le monde, faisant figure de précurseur (presque de prophète) comme le fut aussi, à sa manière, Henry-David Thoreau aux États-Unis. Mais Reclus note aussi, à la suite de Marsh, que l’homme peut parfois agir en bien sur la nature. Il salue, par exemple, les entreprises d’assainissement engagées pour se dégager des « miasmes paludiens ». Il se félicite des efforts engagés pour embellir la nature en Irlande ou en Écosse où l’on commence par respecter le biotope naturel et où l’on favorise le reboisement. Mais ces cas sont plutôt exceptionnels. « Les peuples préfèrent la force à la beauté ».
Mais que se passera-t-il « quand la science fournira d’autres moyens d’action sur la nature ». Elisée Reclus termine en envisageant l’usage par l’homme de la force du vent ou des marées. C’est dire sa puissance de visionnaire.
L’homme et la nature suivi de À mon frère le paysan, La Part commune, collection La Petite Part, 65 pages, 6,50 euros
Lectures de 2021
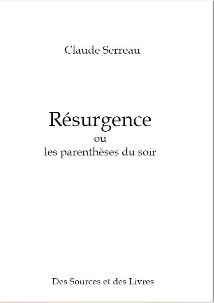 |
Claude Serreau, |
| Résurgence, ou les parenthèses du soir |
|---|
Résurgence : « réapparition à l’air libre, sous forme de grosse source, d’eaux infiltrées dans un massif calcaire » (Dictionnaire Larousse). La poésie de Claude Serreau est de cet acabit-là : elle fait surgir à la surface des pages des émotions enfouies parfois frappées du sceau de la douleur et du chagrin, pour en faire un bouquet où transpire un inaltérable appétit de vivre et de dire le monde dans sa beauté. Le poète n’avait-il pas parlé dans un précédent recueil de « l’humus fertile de nos deuils » (Racines et fragments, Des Sources et des Livres, 2018). Il réédite aujourd’hui cette approche dans un recueil plus secret que le précédent, comme auréolé d’un halo de mystère.
Il commence le titre de tous ces livres par la lettre R. Ce n’est pas un hasard. Claude Serreau vit et écrit dans la fidélité à René Guy Cadou. Et il sème dans ses livres des petits cailloux qui nous ramènent au poète de Louisfert. « Maintenant les trains en partance, écrit Claude Serreau, n’assurant qu’au rythme du cœur / René Guy dirait à Hélène /au moment d’ouvrir ses cahiers / que les horloges n’ont qu’un sens / pour imprimer le fil des heures / sur les murs blancs de l’espérance (…) J’ai certitude d’avenir / quelques saisons peut-être pas », poursuit-il. Le temps file, en effet, pour Claude Serreau (né en 1932). Il file dans la douleur d’une absence : « Chaque nuit / retrouver / le vide bien présent / l’inquiète solitude ».
Dans une préface éclairante, Marie-Laure Jeanne Herlédan nous dit que Claude Serreau « déplie son long poème à la vie, l’amour, la mie, la mort ». Poème à « celle qu’il a accompagnée et veillée ». Le poète parle à l’absente, pousse son chant : « Je voudrais te crier / autant qu’il se pourra / t’envelopper te dire /je t’aime et t’ai aimée // puisqu’enfin avec toi / l’éternité s’étire / une fois recréée ».
Cette toile de fond de la séparation n’estompe pas la « marée de vie » ni l’espoir « qui renaît des souterraines eaux ». Car dans l’univers de Claude Serreau (fait de résurgences et de nappes phréatiques) la nature est toujours prête à « dévider sa toile ». Sous sa plume on découvre « un rideau coloré /cent arbres et mille fleurs /comme la mer à l’ouest /sans cesse élaborée /sous d’obscures étoiles ». Et quand le printemps est là, « on voit au mois de mai /Vénus et son parterre /d’étoiles revenues /au ciel donner le change ».
| Résurgence ou les parenthèses du soir, Claude Serreau, Des Sources et des Livres, 2021, 106 pages, 15 euros | |
| Retrouvez les publications Des Sources et des Livres | |
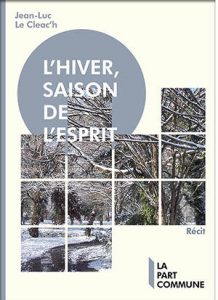 |
Jean-Luc Le Cléac’h, |
| L’hiver, saison de l’esprit |
|---|
Il n’est pas surprenant que Jean-Luc Le Cléac’h aime l’hiver. Il nous a appris dans des précédents livres édités à La Part Commune l’intérêt qu’il portait aux joies élémentaires, loin des paillettes et des artifices, loin des impératifs de la consommation, « de l’immédiateté et du flux tendu » comme il le dit lui-même. Il aime la marche et la halte (Poétique de la marche, 2017). Il aime la course lente et musicale des ruisseaux et des rivières (L’élégance des eaux vives, 2016). Il est capable de voyager dans sa tête en se penchant sur des cartes de l’IGN (Parcourir l’atlas, 2013). Il aime sortir des sentiers battus quand il voyage, jetant son dévolu sur l’Europe centrale ou septentrionale (Fragments d’Europe, 2019).
Voici qu’il nous entraîne dans sa passion de l’hiver, une saison, qui, pour lui, « commence fin octobre et s’achève en avril ». L’hiver dont il nous parle est celui qu’il traverse sur le littoral bigouden quand « le vent entêté s’acharne sur la maison », quand la pluie insistante vient « s’épuiser sur les vitres ». La neige, par contre, est bien un « fantasme breton », raconte-t-il dans un des chapitres du livre. Alors, il va chercher cette neige ailleurs, par exemple par moins de 15 degrés en Lituanie, où on le voit marcher sur un lac glacé pour aller en ligne droite vers un château à visiter. Voyager l’hiver ? Pourquoi pas, nous dit l’auteur. On évite embouteillages et queues à l’entrée des musées. L’air est plus respirable.
Mais là où Jean Luc Le Cléac’h nous fait le plus saliver, c’est quand il nous raconte sa façon d’envisager (d’apprivoiser) l’hiver au creux de son logis. « Délesté de l’accessoire », il lui suffit pour cela de quatre principaux ingrédients : un feu de bois, un livre, une théière et une lampe pour délimiter un espace. « Un espace limité qui contient le monde, c’est peut-être la meilleure définition d’une soirée d’hiver ». Ce monde est peuplé d’écrivains qu’il aime et qu’il cite dans son livre à plusieurs reprises : Lucrèce, Bachelard, Blanchot, Bonnefoy, Ponge, Corbin… Dans cet « espace-temps » qu’est l’hiver, il faut aussi savoir laisser libre cours à « la puissance de la rêverie » et rendre « hommage aux forces de l’imaginaire ». En clair, nous dit-il, en hiver « nous nous appartenons ». Ce n’est pas rien. Nous avons la possibilité de repousser « les limites de l’obscurité ». Obscurité des mois noirs de Bretagne (Miz du) mais aussi obscurité de notre époque qui aime si peu cette capacité d’intériorité à laquelle nous convie l’auteur. Cet hymne à l’hiver, « saison de l’esprit », peut prendre alors les allures – quand le thé infuse près d’un foyer – d’un « minuscule acte de de rébellion » ou d’un « geste subversif ».
L’hiver, saison de l’esprit, Jean-Luc Le Cléac’h, La Part Commune, 111 pages, 13 euros.
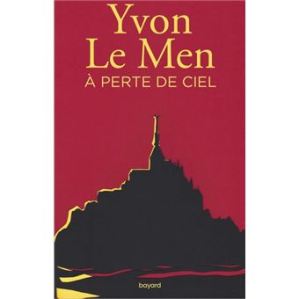 |
Yvon Le Men, |
| À perte de ciel |
|---|
L’épopée du Mont Saint-Michel sous la plume d’un poète : la démarche ne manque pas d’originalité. Mais Yvon Le Men va, ici, bien au-delà de son propre émerveillement devant la Merveille. C’est à un véritable pèlerinage spirituel qu’il nous convie, dont il est le principal acteur.
On ne compte plus dans ce livre le nombre de portes d’entrée au Mont Saint-Michel. Yvon Le Men les multiplie à souhait nous invitant à la fois à méditer sur ce lieu exceptionnel et à parcourir, dans son sillage, divers épisodes de sa propre vie. Lui qui est passé de la « foi du charbonnier » (celle de son enfance trégoroise) aux interrogations d’ordre métaphysique qui sont les siennes aujourd’hui. « Il faudrait que chacun vide sa propre abbaye / pour la remplir de ses chants et de ses rêves d’abbaye », écrit-il. « Il faudrait / que tout monte en nous / quand on monte vers le Mont ».
Yvon Le Men gagné par la foi ? Après les Exercices d’incroyance de Gérard Le Gouic (Gallimard) assisterait-on ici à une forme « d’Exercices de croyance » de la part du poète breton (publié pour l’occasion par un éditeur catholique) ? Ce n’est pas si simple, même si Yvon Le Men n’a jamais caché sa quête d’une forme de transcendance. On connaît notamment les liens qui l’attachaient au poète juif Claude Vigée (qu’il évoque d’ailleurs dans ce livre) ou encore à Xavier Grall, à propos duquel il écrit : « Ensemble nous cherchions / lui Dieu / moi eux / les hommes et les femmes filles et fils de Dieu ». N’a-t-il pas aussi parmi ses amis le poète Gilles Baudry, « frère en l’abbaye de Landévennec / où je me rends une fois par an » ?
Yvon Le Men tourne donc autour du Mont – au risque de le perdre, parfois, un peu de vue – pour revisiter ses propres croyances (au sens large du terme) et introduire dans son livre des textes venus d’éminentes personnalités de l’Église. Il en est ainsi des prières à l’archange saint Michel, reprises fidèlement, écrites par Saint Bonaventure, saint Louis de Gonzague, Léon XII et même le pape François. L’occasion aussi d’évoquer les figures de saint Colomban ou de saint Yves que l’on célèbre à Tréguier dans son Trégor natal. Évoquant les moines copistes comme ceux qui vécurent au Mont, il écrit : « Si j’avais été moine (…) j’aurais recopié / cet hymne sur le paradis de saint Ephrem de Syrie : « Personne n’y travaille / car chacun n’y a faim / personne n’y vieillit / car personne n’y meurt ».
On le voit, ce livre est un patchwork de confessions, de réminiscences, de tranches d’histoire personnelle. N’évoque-t-il pas, à nouveau, les doigts des cantonniers (comme l’était son père) ou les yeux des couturières (comme l’était sa mère) ? Le Mont, dans sa magnificence surplombe le récit poétique en miettes de sa propre existence et devient le lieu d’une quête inassouvie, d’un vrai pèlerinage ascensionnel.
Le Men parle d’une « possibilité d’éternité » à propos d’un lieu qui lui était apparu pour la première fois, quand il était gamin, sur le calendrier des Postes et qu’il revisite cette fois par l’imagination « parce que je pouvais plus m’y rendre en vrai, avec le corps, entouré qu’il était, comme nous tous, de la pandémie, de la maladie, de la mort peut-être ». Et s’il fallait « s’inventer une seconde demeure », le poète breton fait même cet aveu : « Elle est / elle serait le Mont-Saint-Michel / comme un escalier que je prendrais pour le ciel ».
À perte de ciel, Yvon Le Men, Bayard 2021, 196 pages, 16,90 euros.
 |
Jean Lavoué, |
| Carnets de l’enfance des arbres |
|---|
« L’enfance des arbres » est un blog poétique dédié à l’aventure intérieure. Conçu il y a déjà plusieurs années par le poète, écrivain et éditeur Jean Lavoué, ce site fait de l’arbre le symbole à la fois de l’enracinement et de l’élévation. « Il faut reboiser l’âme humaine », disait le chanteur Julos Beaucarne, cité par l’auteur. « Reboiser » : c’est la noble entreprise à laquelle Jean Lavoué s’est attelé. Il nous le rappelle dans un livre contenant les brefs poèmes qui ont accompagné la naissance de son blog.
« Déjà je parle aux arbres / et mes doigts me suffisent », écrivait René Guy Cadou dans Les bruits du cœur (1941). Jean Lavoué demeure dans le sillage du grand poète disparu auquel il a consacré un fervent livre-hommage en 2020 (René Guy Cadou, la fraternité au cœur). « Avec l’arbre, // ce que tu écris / Semble avoir trouvé son axe », note pour sa part Jean Lavoué. Et, plus loin, il écrit : « Parler à hauteur d’arbre / Sans forcer la voix / Dans la croix des saisons / Et le ciel grand ouvert ».
Le poète, en effet, ne force pas la voix. Il nous dit fréquenter les mots simples : « Soleil, silence, lumière, absence, présence ».
Soleil ? « Ah ! si le chemin / N’était que tronc tendu / Vers le soleil »
Silence ? « Dès que tu fais silence / La forêt se redresse / Les mots s’ordonnent un à un / La clairière s’illumine, //Tu sens que tu es là ».
Lumière ? « Arbre, pesante lumière / Étrange gravité / Donnant des ailes / À ta voix ».
Jean Lavoué ne se paie pas de mots. Il veut sa poésie orientée vers plus vaste que nous. « J’ai découvert un jour / Qu’écrire était une forme de prière ». Et s’il nous parle – fugitivement – de l’enfant qu’il a été (« Comment rester à hauteur de l’enfant /que tu as été »), c’est d’abord pour nous inviter à retrouver l’enfant qui est en nous, retrouver notre innocence et notre capacité d’émerveillement. « La foi ne n’apprend pas / Elle s’enracine », écrit Jean Lavoué. Oui, s’enracine comme un arbre.
Le poète évoque tout aussi fugitivement des poètes bretons qui lui tiennent à cœur. Georges Perros à qui il dédie un poème. Xavier Grall, cet homme qui « chantait la Bretagne / Ressuscitait ses pardons », sans parler des vents qu’il chérissait dans sa paroisse de Nizon. Avec, comme en écho, ces vers de Jean Lavoué qui nous ramènent invariablement à l’arbre. « C’est le vent bien sûr / Qui parle le mieux / La langue de l’arbre ».
Carnets de l’Enfance de l’arbre, Jean Lavoué, avec des linogravures et monotypes de Isabelle Simon, éditions L’Enfance des arbres, 2021, 202 pages, 15 euros
 |
Jacques Josse, |
| Le manège des oubliés |
|---|
Le Rennais Jacques Josse a de la constance. Ne lui faites pas parler, dans ses livres, d’autre chose que des oubliés, des cabossés, des invisibles ou des marginaux de tout poil. Il ronge son os comme l’affirmait Henry David Thoreau s’adressant aux artistes et aux écrivains : « Connais ton os personnel : ronge-le, enfouis-le, déterre-le et ronge-le encore ». Oui, Jacques Josse remet sans cesse son os sur le métier. Il cultive une veine et un style qui lui sont propres. C’est le cas encore dans son nouveau livre où il dresse le portrait d’oubliés dans des textes de trois pages aux allures, parfois, de courtes nouvelles.
Les « oubliés » ont quelque chose en eux de fracassé, qu’il s’agisse de drame familial, de souffrances héritées de l’enfance, d’exploitation au travail… Ils vivent sous des cieux bretons, mais pas seulement. Prenons François Labia qui eut à subir, encore adolescent, l’éprouvante vie de pêcheur à Terre Neuve. Nous sommes au début du siècle dernier. « Il était âgé de quatorze ans. À son retour, il avait le nez brisé, le visage balafré et le dos lardé de blessures consécutives aux coups de gaffe, d’épissoir et de martinet que lui assénait quotidiennement le frère du patron ». Aujourd’hui le carré de sa tombe s’affaisse dans un petit cimetière.
Prenons cette femme – anonyme – qui « a aidé une vieille à se mettre au lit » et « coupé les ongles de pied d’une nonagénaire ». La voilà aujourd’hui qui procède à la toilette d’un mort. Prenons cette autre femme qui, un samedi soir de déprime, « sort une boîte de cachets de sa poche » et s’effondre dans une tourbière « tandis qu’au café du bourg, son homme, le roi des chasseurs et des boulodromes, vide verre sur verre, consulte sa montre et déclare, hébété, que ce soir encore, sa femme va devoir manger sans lui ».
Voici Tony, l’ancien crieur, cueilleur d’ormeaux, dont on jette les cendres dans la mer (près de trous d’ormeaux). Voici ce chauffeur-routier « usé par des kilomètres de bitume » qui transporte des animaux destinés à l’abattoir. Tout est à l’avenant. Jacques Josse, œil aux aguets, multiplie les scènes saisies sur le vif. Il les découpe au scalpel. La vie est rude sous sa plume, comme elle l’est dans tous ses précédents livres. La mort y est omniprésente. On célèbre des proches, des amis disparus (souvent tragiquement). Mais il y a toujours, où que l’on aille, ce bistrot salvateur (celui de Bob, par exemple) où des hommes « arrivent avec des mines défaites et repartent, deux heures plus tard, revigorés ». Il y a aussi ces musiques, ces chansons (Les Doors, Big Joe Turner, Le Jefferson Air Plaine..) qui pimentent la vie et tous ces écrivains dont les livres sont des viatiques (Jim Harrison, Franck Venaille, Danièle Collobert, Franck O’Hara…)
De toutes les vies « de peu » qu’il évoque dans son livre, Jacques Josse tire des récits poignants en forme d’hommage à tous les oubliés de la terre. Avec un art consommé du pointillisme – pour mieux élargir le tableau – il nous donne l’exacte mesure de la souffrance humaine.
Le manège des oubliés, Jacques Josse, Quidam éditeur, 124 pages, 14 euros
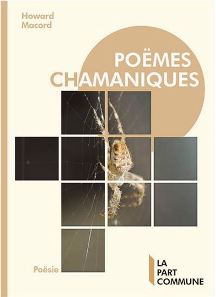 |
Howard Mc Cord, |
| Poèmes chamaniques |
|---|
Il faut accepter de se laisser dérouter, envoûter, voire interloquer, avant de s’engager dans la lecture des Poèmes chamaniques d’Howard Mc Cord. Voilà un grand écrivain américain (né en 1932 dans le Texas) qui n’en finit pas de laisser son lecteur à la fois perplexe et ému dans son approche « chamanique » de la nature et de l’humanité. C’est à Gary Snyder ou à Robinson Jeffers que l’on pense en le lisant. Nous sommes ici dans la veine du « Nature writing ».
« Réfléchis aux petites choses : boutons, feuilles, balles de tissus ouaté (…) Sois sage autant que le permet ta fragilité (…) et contente-toi de moins ». Mc Cord n’est pas avare de conseils pour qui prétend être poète (et il commence par se les appliquer à lui-même). S’il écrit des poèmes, lui, c’est pour « rester saint d’esprit » et pour faire entendre des langues en lui « qui n’ont pas de nom et qui ne sont pas parlées, mais ressenties ». On est très proche de la poésie chinoise dans sa façon de capter le réel et de se tenir face au monde. Howard Mc Cord ne fait-t-il d’ailleurs pas cet aveu : « Su Tung Po est assis à côté de moi dans l’ombre ». C’est parce qu’il est situé sur ce penchant de la vie qu’il peut écrire : « J’attrape la lune dans le bol d’eau ». Et l’on croit entendre, dans ces vers, le moine japonais Ryokan faisant l’éloge de la sobriété : « Mes plaisirs / sont dans la solitude, un feu / mon repas simple, / la prière du vent ».
Mc Cord n’est pas Chinois ou Japonais. Il est Américain. Mais il n’y a chez lui « aucun régionalisme américain », soulignent Thierry Gillyboeuf et Cécile A. Holdban dans la présentation de ce livre. « Son Amérique n’a pas de frontière. Elle n’est qu’un espace géographique. Elle a les dimensions du monde ». L’écrivain a beaucoup voyagé, de l’Ohio à l’Himalaya en passant par l’Islande, « des lieux privilégiés où l’homme peut entrer en résonance avec le cosmos et avec lui-même », ajoutent-ils. C’est cette approche chamanique du monde qui conduit Mac Cord à évoquer les Indiens d’Amérique, tant Apaches que Comanches, à se souvenir de la triste bataille de Wounded Knee mais aussi de Mỹ Lai au Vietnam… Car c’est aussi l’impérialisme guerrier de son pays qu’il pourfend ici. « Il n’y a pas de retour en arrière, écrit-il, rien que la maladie de notre histoire / la mutilation des terres, / le meurtre ». Il oppose à cette folie des massacres le chant de cigales détournant « le crépuscule avec leurs oracles ». Il bénit « les chemins bloqués par la neige », « les cheveux blanchissant », « l’épouse et les enfants ». Il fait un poème de tout.
Poèmes chamaniques, Howard Mc Cord, La Part Commune, 2021, édition établie et présentée par Cécile A. Holdban et Thierry Gillyboeuf, illustrations de couverture et d’intérieur de Cécile A. Holdban, 223 pages, 15 euros
 |
Gérard Pfister, |
| Hautes Huttes |
|---|
Pas moins de 1000 poèmes de quatre vers (deux distiques chacun). Gérard Pfister a du souffle. Il nous parle depuis ses Hautes Huttes, à Orbey, dans les Hautes-Vosges alsaciennes. Il y a ses racines. Mais ce n’est pas pour faire couleur locale ou revendiquer une quelconque veine régionaliste. Depuis ses Hautes Huttes, il nous montre en réalité comment il embrasse le monde, et nous invite aussi à le faire, de préférence en empruntant le chemin des arts et des lettres.
« Entends / le chœur des femmes // mêlant aux cigales / sa longue déploration ». Ce poème, pris isolément (comme peuvent l’être aussi tous les poèmes de ce livre) ne pourrait-il pas être entendu partout dans l’univers (et a fortiori, aujourd’hui, dans Kaboul livré aux Talibans) ? Ce poème n’exprime-t-il pas une immuable vérité ? Mais ce poème est aussi là parce qu’il entre en résonance avec une œuvre littéraire lue par l’auteur. Il s’agit ici des Trachiniennes de Sophocle. Et tout, ou presque, est à l’avenant dans le livre de Gérard Pfister. Voici Lucrèce en écho : « – Rires / et doux éclats de joie // tout est nouveau / tout est merveille ». Voici le chinois Li Po : « – chevauchant / le long vent // je flotte à mon gré / hors du ciel ». Voici Etty Hillesum : « Sous les châlits de fer / gobelets gamelles // le linge sale /du pain moisi ».
L’art de faire résonner une œuvre ne s’arrête pas, chez Gérard Pfister, à la littérature. Il explore la peinture, la musique, le cinéma (comme le révèlent les notes situées à la fin de l’ouvrage). Il nous révèle par le fait même ses goûts, ses penchants, ses inclinations… Tout ce vers quoi il se penche avec déférence et considération. En peinture, citons pêle-mêle Gaspard-David Friedrich, Rembrandt, Le Caravage… En résonance avec Georges Rouault, il écrit : « Des bruns / des bistres des ocres // pas de regards / c’est un pays de mort ». Les musiciens qu’il aime s’appellent Purcell ou Dvorak. À l’écoute d’un chœur grégorien dans la cathédrale de Strasbourg, il écrit : « Le temps / devenu chant // tremble / dans nos gorges ». Et il nous dit aussi la dette qu’il doit au cinéma. L’éternel Chaplin (ici celui du film Le dictateur) lui fait écrire : « Il danse / animé de quelle étrange // jubilation / le monde au bout des doigts ».
C’est le miracle de ce livre de nous dire le monde par les voies artistiques en extrayant des fragments frappés du sceau de l’éternité. Et même les Hautes Huttes familières à l’auteur n’échappent pas, par le truchement de la poésie, à ce passage du particulier à l’universel quand l’auteur se met à l’écoute de la musique des clarines : « Vide cette plénitude / merveilleusement // libre cette harmonie ».
Mais on se doute bien que cette approche poétique originale n’est pas gratuite. C’est une expérience intérieure que nous invite à partager Gérard Pfister en interrogeant, par le fait même, nos propres existences. Dans une langue épurée, il pointe à la fois tous nos drames intimes et ceux de notre époque. « Qu’est-il arrivé /à cette vie // qu’on ne sache plus / l’aimer ».
Hautes Huttes, Gérard Pfister, Arfuyen, 382 pages, 19,50 euros
 |
François de Cornière, |
| Quelque chose de ce qui se passe |
|---|
François de Cornière nous revient. Fidèle à lui-même. Capteur d’émotions, de sensations vraies et vécues. Au fond, un Doisneau qui serait écrivain mais qui, contrairement au célèbre photographe ne modifierait rien au décor pour se concentrer sur l’irruption de la vie dans sa vérité et sa simplicité. Pour nous dire, mine de rien, tout ce qui fait la saveur de nos existences dans l’ordinaire des jours. « Est-ce que c’est possible d’écrire un poème / avec rien que des images / et aucun sentiment ? »
Dans un précédent livre (Ça tient à quoi ? Le Castor astral, 2019), François de Cornière évoquait les propos d’une femme après la lecture de ses textes lors d’une soirée du Printemps des poètes : « Pendant que vous lisiez vos textes / je me suis plusieurs fois demandé / si c’étaient des poèmes / ou de très courtes nouvelles / vous voyez ce que je veux dire ». Oui, le poète voyait très bien ce qu’elle voulait dire car François de Cornière ne s’encombre pas de lourdeurs ou d’images poétiques qui « feraient poésie ». Il fuit l’hermétisme et raconte dans son dernier livre qu’il s’imaginait créer un jour, par dérision, un « Festival de la poésie opaque » pour mieux la dénoncer. Car il est, lui, du côté de la limpidité. Du plus banal et dans l’écriture la plus « prosaïque » qui soit, il extrait, lui, un parfum à haute valeur poétique.
Parfum. Le mot, pourtant, est faible car on se doute bien que le poète va bien au-delà d’un simple plaisir sensoriel ou esthétique. Si le poème est là, c’est parce qu’il creuse une inquiétude foncière. « Et je nage / Et j’essaie d’écrire. / Pour ressortir plus loin ». Car telle est bien la démarche de François de Cornière : aller au-delà de la douleur (liée notamment à la perte d’un être aimé), rencontrer d’autres souffrances et, en dépit de tout, dire oui à la vie. Être un nageur du petit matin (dans ce pays de Guérande où il vit) à qui une petite fille en classe de découverte lui avait un jour demandé : « À part nager, vous faites quoi ? ». Et François de Cornière lui avait répondu qu’il essayait de « vivre le mieux possible » et qu’ici « ce n’était pas mal ». Il avait même rangé la question de la fillette dans sa « boîte à questions positives ». Il dit l’ouvrir de temps en temps pour écrire ses poèmes. « Je commence souvent mes poèmes/par des questions invisibles ».
Car dans son nouveau livre, l’auteur interroge beaucoup la poésie elle-même, se pose la question du pourquoi et du comment de l’écriture. « J’ai tenté d’écrire quelque chose / avec ce que j’ai fait ce matin », confie-t-il. Il suffit en fait, pour cela, qu’il ouvre « un petit sac d’émotions mal fermé ». Un rien suffit alors pour le mener ailleurs et nous avec lui : un enfant ramassant des coquillages, un « vieux Errol Garner » écouté en conduisant, le chant d’un grillon, une marche sur la falaise quand le vent souffle fort, le bruit du sécateur de la voisine, deux femmes attendant l’happy hour pour « prendre un cocktail et six huîtres chacune ». Ainsi la vie. Pour François de Cornière, c’est « l’envie d’être à ma place simplement / avec dans mon creux d’épaule / la belle parenthèse de ma vie / que j’écoute respirer dans la nuit ».
Quelque chose de ce qui se passe, François de Cornière, Le Castor astral, 2021, 157 pages, 14 euros.
 |
Mérédith Le Dez, |
| Un libraire |
|---|
Hommage à la librairie, commerce « essentiel ». Hommage aux libraires, dont Mérédith Le Dez tresse le portrait de l’un d’entre eux dans son nouveau livre. Jacques Allano était libraire à Saint-Brieuc, à l’enseigne « Le pain des rêves ». Au-delà de cet homme tragiquement disparu, c’est un vibrant hommage à la littérature qu’elle dresse ici.
Poète, romancière, éditrice éphémère sous le sigle MLD, Mérédith Le Dez aborde dans ce livre un moment à la fois joyeux et tragique de sa vie, celui d’avoir exercé pendant près de neuf mois le métier de libraire. Nous sommes en octobre 2019 et la voilà « collaboratrice » (comme il l’aimait à l’appeler) de Jacques Allano qui avait repris, à l’âge de 70 ans, une librairie quittée dix ans plus tôt à sa retraite mais dont il redoutait désormais une fermeture définitive. Mérédith Le Dez va travailler avec enthousiasme à ses côtés jusqu’au 16 mai 2020, date de suicide du libraire, quelques jours seulement après la réouverture post-confinement de son magasin.
Car la toile de fond de cet événement tragique (mais aussi de tous les mois qui l’ont précédé) est, bien entendu, la terrible secousse provoquée par la pandémie. Jacques Allano a sans doute été l’une des victimes « collatérales » de cette terrible période condamnant les commerces dit « non essentiels » à l’obscurité. « Comme nous avons été heurtés, blessés, l’un et l’autre à l’instar de tous les libraires », confie Mérédith Le Dez, même si elle ne manque pas d’évoquer, avec beaucoup de délicatesse, des raisons plus personnelles qui ont pu conduire au suicide un libraire « ravagé par le chagrin » et qu’elle vénérait véritablement.
Écrire un livre pour témoigner de son engagement à ses côtés : Mérédith Le Dez a longtemps hésité. « Comment faire sans trahir sa pudeur ? ». Celle d’un homme dévoré par son métier de libraire et sa passion de la littérature, un mot qu’il plaçait « au-dessus de rayonnages ».
Pour raconter cette période de sa vie, l’écrivaine a pris le parti de la lettre qu’elle adresse au disparu. Trente lettres entre le 22 novembre 2020 et le 21 décembre de la même année. La lettre comme une nécessité, comme une forme d’exigence absolue, lui faisant laisser sur le feu « un roman qui avait séché comme une peau de lait dans la casserole refroidie ». Par la voie épistolaire, Mérédith Le Dez reprend une conversation brutalement interrompue, pour continuer à parler de ses coups de cœur littéraires (avec de larges extraits de livres qu’elle a aimés), pour évoquer la figure d’autres libraires ou d’auteurs (Christian Prigent, Hervé Carn, Tanguy Dohollau, Yves Prié…), autant de personnalités qui ont illuminé les quelques mois passés avec Jacques Allano, sans oublier les échanges avec les clients fidèles de la librairie.
C’est, par le fait même, tout un pan de la vie littéraire bretonne qui défile sous nos yeux avec comme point d’ancrage Saint-Brieuc, cette « ville d’écrivains » comme aiment à le rappeler les édiles locaux. Pour Mérédith Le Dez, évoquer tout ce compagnonnage raffermit le cœur, tempère progressivement un chagrin tenace. Son hymne aux mots qui parlent juste, son ode à la passion partagée, tout cela nous touche profondément. « Femme à éclipses », comme elle se qualifie elle-même, on la voit rebondir dans la compagnie des livres. Question de survie dans un monde qui la désole si souvent.
Un libraire, Mérédith Le Dez, éditions Philippe Rey 2021, 140 pages, 16 euros
 |
Louis Grall, |
| Le nageur d’Aral |
|---|
De l’art de faire d’un court roman un petit bijou à haute valeur poétique. Le Finistérien Louis Grall raconte la désertion d’un membre de commando d’élite des services secrets soviétiques chargé d’un sabotage en rade de Brest. Dans sa fuite, il échoue à l’abbaye de Landévennec où il sera hébergé par les moines pendant des dizaines d’années.
Il faut cultiver un véritable amour de l’abbaye de Landévennec, à la pointe du Finistère, pour envisager un tel roman. Louis Grall, par la voix de son narrateur, nous dit combien, en effet, il est subjugué par les lieux (« l’entrée à pied sous la voûte des arbres, le silence lumineux à l’intérieur de l’abbaye »). C’est son amitié avec le frère Luc du roman (alter ego du vrai moine-poète frère Gilles Baudry) qui le conduira à découvrir l’histoire rocambolesque de ce Russe déserteur accueilli à l’abbaye au nom du traditionnel droit d’asile.
De cette histoire « secrète », il tire un récit d’une grande limpidité pour transcrire « l’histoire d’un homme qui ne fut pas un saint, mais qui vécut ici une vie exemplaire ». Pour s’imprégner le plus possible des lieux et des événements, le narrateur s’est immergé lui-même dans l’abbaye. « Je suis devenu cénobite. Pour écrire une vie comme le faisaient autrefois les moines chroniqueurs ».
Tout commence « à cinq milles au nord-est d’Ouessant ». Nous sommes le 12 novembre 1961. « Dès que le bateau rompit le lien qui le tenait à son pays, Anton comprit qu’il n’accomplirait pas la mission qui lui avait été prescrite ». Anton, l’agent russe, prend le large. « Il s’éloigna au sud, vers la longue falaise boisée qui encerclait la mer. Ce fut à ce moment précis qu’il devint un déserteur et son cœur, qui n’avait pas bronché dans la tourmente de l’océan, changea de rythme un court moment ».
Louis Grall entame alors le récit d’une désertion en lui donnant une vraie dimension poétique par l’évocation de la nature que découvre le déserteur dans son avancée à la nage à l’intérieur des terres. « Le voici qui franchit le cap de deux rivières. Noroît et galerne lui portant par rafales les parfums humides de la terre. Ce sont des odeurs inconnues pour lui. Elles disent l’herbe, le champ clos et la boue du chemin. Elles s’en vont sur les vagues, odeurs douces de la terre, aussitôt retissées à peine déchirées. Proche de lui, c’est un parfum de pommes et de litières fraîches. En écho lointain sur les crêtes, il entend le cantique des pins ».
Ce nageur-déserteur au fond de la rade de Brest, là où la rivière Aulne rencontre la mer, vient des bords de la mer d’Aral où il est né. Il sera recueilli, hébergé par les moines. Le livre raconte aussi sa vie à leurs côtés. Anton ne les quittera que pour aller vivre de l’autre côté de l’Aulne où il créera avec sa famille une école de yole traditionnelle, avant de mourir noyé à l’âge de 77 ans.
Le nageur d’Aral, Louis Grall, éditions La Manufacture des livres, 2021, 127 pages, 12,90 euros
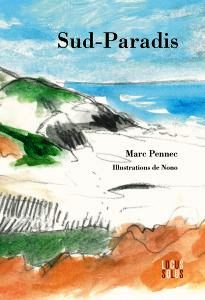 |
Marc Pennec, |
| Sud-Paradis |
|---|
À chacun son Sud. Pour un Nord-Finistérien c’est d’abord le sud de son département, cette Cornouaille riante et forcément ensoleillée. Oui, « aller dans le sud » veut dire quelque chose : c’est ce que nous raconte Marc Pennec, lui qui a ses racines dans le pays brestois, en évoquant ce Sud-Paradis dont il nous ouvre les portes dans un livre en vraie prose poétique.
« Je suis là pour les quelques minutes quotidiennes où le monde nous foudroie de sa beauté. Je suis là pour la lumière et les amis (…) Je suis là, je suis du littoral, des rivages, des bordures, des frontières, des lisières, des seuils, des commencements et des rêves ». Ce pays béni va de Concarneau à Pont-Aven en passant par Port-Manech et, au-delà, trois criques après Doëlan vers l’ouest ». On est au cœur de cette Cornouaille maritime aux proues avancées dans la mer (Trévignon), aux anses où le cœur s’apaise (Rospico, Poulgwin, Kerrochet…), aux étangs demi-sel où s’ébroue un peuple d’oiseaux rares, aux petites jetées où l’on attelle des barques chargées de casiers… C’est dans ce pays-là (où règne l’ombre tutélaire du poète Xavier Grall) que Marc Pennec a posé son sac. Curieux de la nature sauvage qui l’entoure, on le découvre souvent à l’affût comme l’était Rick Bass dans sa tanière du Montana.
Déjà remarqué par un bel ouvrage où il affichait une autre passion, celle des Monts d’Arrée (En Arrée, éditions Dialogues, 2017), voici l’ancien grand reporter d’Ouest-France buvant au goulot l’air tonique d’un Sud-Paradis. Il y laisse ses empreintes sur le sable après de fiévreuses cueillettes d’épaves dont il sait faire son miel.
Mais venir dans le Sud n’est pas renier le Nord. Et encore moins renier Brest et ses bistrots où l’on se serre les coudes, où une fraternité au ras du comptoir aide à « » apprivoiser la Ville, blanche, grise ou couleur de pluie au gré des humeurs ». C’est au Tonkin qu’ils se retrouvent pour refaire le monde, pour « vivre » et « se quereller » en écoutant les airs de rock les plus tonitruants ou en commentant les meilleurs morceaux de la Beat Generation. Ils s’appellent Pops, Paulo ou Ti-Guy… Ils sont, eux, du Sud « aux odeurs de moisson et de pêche, aux promesses de fêtes et d’insouciance ». Ils aiment Brest, profondément, mais le Sud demeure « une formidable zone de repli. Une bouée de sauvetage ». Pourtant, confie l’auteur, « c’est une jeune femme rencontrée dans une Micheline rouge et crème dont la porte s’ouvrait difficilement qui m’a initié au Sud ».
L’amour et l’amitié, on l’a compris, sont au cœur de ce livre. On n’y trouve aucune escale pittoresque, aucun cliché vendeur. C’est l’homme Marc Pennec qui éprouve la beauté du monde dans ce Sud-Paradis. Il peut d’autant plus le sentir et l’affirmer haut et fort qu’il y a toujours les autres, parfois à distance, parfois très proches : la femme, les amis, un « phalanstère » toujours en éveil et prêt à toutes les « ripailles ». Seule une écriture profondément poétique pouvait témoigner de cet émerveillement. « Être là / grandi de solitude / bivouaquant près de l’étonnement ».
Sud-Paradis, Marc Pennec, illustrations de Nono, Locus Solus, 2021, 135 pages, 14 euros
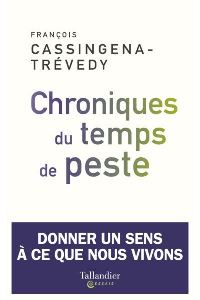 |
François Cassingena-Trévedy, |
| Chroniques du temps de peste |
|---|
Que peut nous dire un moine sur le confinement ? N’est-il pas par nature confiné dans son monastère ? Et le confinement lié à la pandémie ne serait-il pas, pour lui, un confinement dans le confinement ? Avec François Cassingena-Trévedy on ne peut pas avoir ce type d’interrogation. Moine de l’abbaye de Ligugé, il est une forme « d’électron libre » de sa congrégation bénédictine. Ses Chroniques du temps de peste posent aujourd’hui un regard décapant sur notre présence au monde en ces temps de Covid. Elles n’hésitent pas non plus à interpeller avec vigueur l’Église catholique.
Breton par sa mère, Italien par son père, François Cassingena-Trévedy, né en 1959, a bien des cordes à son arc. Il est théologien, enseignant, spécialiste des Pères de l’Église, écrivain, randonneur au long cours, expert en chants liturgiques, fabricant d’émaux, amateur de motos… Il a même été membre de la Mission de la mer au port de pêche du Croisic. Le voici aujourd’hui – après quelques mois de confinement vécus dans son abbaye – moine « détaché » au cœur de l’Auvergne.
C’est de ce monastère à ciel ouvert qu’il adresse à ses amis des lettres de réflexion et d’exhortation regroupées aujourd’hui dans un livre, bien conscient que sa liberté de parole lui vaudra des inimitiés. À commencer au sein même de son Église (dont il pourfend les scandales sexuels qui la visent). François Cassingena-Trévedy a aussi très mal vécu les revendications pour le maintien des messes en pleine pandémie. Il ne mâche pas ses mots. « On attendait un lever de visionnaires et de prophètes, et c’est une cacophonie de gamins capricieux. Tout cela est petit, dérisoirement petit, lamentablement petit ». Et il enfonce le clou « Pourquoi toujours ce catholicisme de l’entre-soi, du pour soi, qui hésite à embrasser le monde, à s’avouer pauvre, balbutiant, désemparé, comme tout le monde, devant le mystère énorme de la vie ». Il aspirait vraiment à autre chose : saisir ces instants particuliers qui bouleversent et interrogent nos vies pour gagner en maturité, en intériorité, inventer d’autres formes de communion. Il constate amèrement que cela n’a pas été le cas.
Mais François Cassingena-Trévedy n’interpelle pas que ce catholicisme de « l’entre-soi ». Il souligne que la pandémie est « la sanction naturelle et quasi-automatique de nos maltraitances invétérées à l’égard des écosystèmes et des aberrations de notre commerce planétaire ». Plus fondamentalement, il met en exergue « les désillusions croissantes d’un progrès global et universel de l’humanité ». Aussi espère-t-il, du fond du cœur, que tout ne reprenne pas comme avant et que nous sachions « donner un sens à ce que nous vivons ». Il interpelle sur ce sujet aussi bien les athées, les agnostiques que les croyants. Avec ce constat – en toile de fond – de ce « désenchantement généralisé qui frappe nos sociétés ».
Le chrétien qu’il est et qu’il demeure, y compris dans sa fidélité à l’Église (parce qu’il faut, dit-il, une institution), lance des pistes pour faire face à « l’effondrement des pans entiers de notre édifice intérieur » (et cela ne date pas de la pandémie). Il propose à tout un chacun le choix d’un « vivre poétiquement le monde », c’est-à-dire « consentir des épousailles avec le réel, dans l’attention, la gratitude, la frugalité, la véhémence, la liberté » (et il suggère au passage de ne pas faire des fameuses « caricatures » l’alpha et l’oméga de la liberté d’expression en France). Aux chrétiens, il suggère de s’en tenir à une foi qu’il qualifie de « modeste » (mais qui gagnerait ainsi en profondeur) plutôt que de « chercher à conserver pignon sur rue ». Loin d’une mythologie chrétienne inaudible pour les hommes d’aujourd’hui, François Cassingena-Trévedy croit nécessaire un sursaut d’ordre spirituel au cœur de nos sociétés de la vitesse et du consumérisme.
Chroniques du temps de peste, François Cassingena-Trévedy, Tallandier, 2021, 170 pages, 18 euros
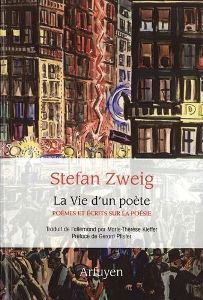 |
Stefan Zweig, |
| La vie d’un poète |
|---|
Stefan Zweig poète ? Voilà une bonne nouvelle car cet aspect de l’œuvre du grand écrivain autrichien est largement méconnu. Son œuvre poétique (trois livres) n’a jamais été publiée en français et l’on doit aujourd’hui aux éditions Arfuyen la publication de plusieurs de ses poèmes. Ils sont accompagnés d’écrits que Zweig (1881-1942) a lui-même consacrés à la poésie.
Stefan Zweig se faisait une idée éminente de la poésie. Il lui attribuait un caractère quasi sacré, faisait des poètes « les serviteurs et gardiens de la langue », les assimilant à « un ordre presque monastique au milieu du tapage de nos jours ». Il avait une admiration sans bornes pour Rainer Marie Rilke qui, selon lui, dans son Livre d’heures, « explique inlassablement Dieu à travers les symboles ». Il vouait aussi un véritable culte à Émile Verhaeren, qu’il a fréquenté personnellement. « Il m’a appris à chaque heure de mon existence que seul un homme accompli peut être un grand poète ».
Mais Stefan Zweig se pose la question : « Des poètes de l’envergure de Rilke ou de quelques maîtres, de tels poètes si purs, si totalement voués à leur art, seront-ils encore possibles dans les turbulences et le désordre universel de notre temps ? » Question qui traverse toutes les époques, mais que Zweig ressent très profondément dans le contexte de la Grande Guerre. Il en arrive même à se poser la question de la possibilité d’écrire de la poésie face à la boucherie de 14-18 (comme si l’on entendait, de façon prémonitoire, le questionnement d’Adorno sur la possibilité de la poésie après Auschwitz).
Quoi qu’il en soit, il apparaît que Zweig n’a pas eu de vrai destin poétique personnel. Il est connu avant tout pour ses essais, ses nouvelles, ses romans. En présentant les rapports que l’écrivain a entretenus avec la poésie, Gérard Pfister souligne que « la dispersion de ses activités » a sans doute nui à sa création poétique. Il souligne aussi que Zweig était plus un « observateur et analyste » qu’un « lyrique et métaphysique ». Ses livres de poésie publiés en 1902, 1906 et 1926, n’ont donc pas connu l’écho que pouvait espérer leur auteur.
Dans ses poèmes, de facture souvent classique (avec rimes), Zweig nous parle de ses rêves mais aussi beaucoup de lieux, de voyages qu’il a pu effectuer en Italie ou ailleurs : Venise, lacs de Côme, de Constance, de Zurich... mais aussi le Taj Mahal ou une « île silencieuse » en Bretagne. « Du rivage j’entends les cloches / par-dessus les landes sonner / et déjà je ne peux plus voir / les contours arrondis des tours »
Gérard Pfister parle de Zweig comme d’un « chasseur végétarien », au fond quelqu’un « qui n’a cessé de poursuive le succès dans des formes littéraires qui n’étaient pas son genre ». Car l’écrivain autrichien entendait répondre à un appel intérieur. Et la poésie répondait selon lui à « l’inquiétude primordiale et inhérente à tout homme ». Ce qu’il soulignait, à la fin de sa vie, dans l’un de ses derniers poèmes : « Le pressentiment de la nuit qui s’approche / n’a rien d’effrayant – il soulage ! / Le pur plaisir de contempler le monde, / seul le connaît celui qui ne désire plus rien ».
La vie d’un poète, poèmes et écrits sur la poésie, Stefan Zweig, traduit de l’allemand par Marie-Thérèse Kieffer, préface de Gérard Pfister, Arfuyen, 2021, 189 Pages, 17 euros
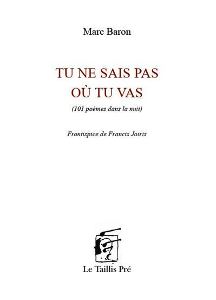 |
Marc Baron, |
| Tu ne sais pas où tu vas |
|---|
101 poèmes écrits dans la nuit entre le 28 octobre 2017 et le 6 février 2018, tous introduits par les mêmes mots « Tu ne sais pas où tu vas » : Marc Baron est un familier de l’anaphore et, comme il le dit lui-même, de cette « poésie ininterrompue pour ne pas rompre le fil ».
En 2011 le poète breton avait introduit chacun de ses poèmes par les mots « ma page blanche » dans son recueil Ma page blanche, mon amour (éditions La Part Commune). En 2018 il avait récidivé avec O ma vie (éditions Vagamundo) Trois mots pour inaugurer chacun de ses poèmes. Marc Baron, en effet, est un poète au long cours, genre marathonien des mots, mais sans démesure, plutôt adepte de l’art de gérer son souffle dans un monde qui a tendance à vous asphyxier. « Courir une heure nous rapproche déjà de la ligne blanche / où tout bascule de l’autre côté ».
Voici donc « 101 poèmes dans la nuit » comme pour mieux souligner l’état de veille assigné au poète, « entre la mort à marée basse et la vie qui déborde ». En inaugurant chacun de ses poèmes par les mots « tu ne sais pas où tu vas », Marc Baron nous signifie bien l’interrogation qui le taraude : C’est quoi vivre ? C’est quoi aimer ? « L’incertitude te désoriente / tu ne sais pas où tu vas ».
Mais il y a des balises sur le chemin. Ce qu’il appelle des « points culminants ». Cela peut être tout simplement le silence, la méditation, l’amour (« une respiration de haute montagne »), « la lueur d’une rose » ou la solitude fertile. « Cherche ta route dans la solitude / où personne ne viendra t’éparpiller ». Plus encore, il y a les territoires d’enfance, ce que le poète appelle la « valise de naissance ». Devant le Rhône au bord duquel il est né, avant de venir vivre en Bretagne à Fougères, il écrit : « que jamais ne soit tari le fleuve de ton enfance ». Lui revient en mémoire « l’esprit des moissons » qui l’ont élevé et il s’adresse à lui-même cette injonction : « N’abandonne jamais le champ qui t’a vu naître ».
Il faut des mots pour le dire et l’écriture demeure son viatique. « C’est ton devoir intime / pour comprendre comment échapper au péril » car « le monde est sombre pour tant de raisons ». Place donc à la poésie, cette poésie « ininterrompue » qu’il pratique et qualifie de « long psaume de supplication ». Car le poète sait aussi se tourner vers son Dieu quand le doute s’installe. « Où me conduis-tu Seigneur ? / chemin n’est pas toujours le mien / et pour un rien je tombe dans les pièges de l’obscurité ».
Tu ne sais pas où tu vas (101 poèmes dans la nuit), Marc Baron, Le Taillis Pré, 2021, 115 pages.
 |
Alexandre Vigot, |
| Sous le masque sacré |
|---|
Loin des clichés de safaris-photos ou des images saisissantes des reporters de guerre, le photographe Alexandre Vigot nous donne à voir une Afrique à hauteur d’homme, à la fois dans sa nudité et sa pauvreté, mais aussi dans sa dignité. Fin connaisseur du continent noir grâce à des missions humanitaires dont il prépare les projets sur place, il a bourlingué du Sénégal au Rwanda : une dizaine de pays parcourus au total sur une période de cinq années.
« Je m’invente des chemins de traverse, faits de rencontres », confie-t-il modestement.
Pourquoi les photographies d’Alexandre Vigot nous touchent-elles ? Parce qu’elles font sortir de l’ombre (parfois de la nuit) des silhouettes d’hommes et de femmes dont les regards nous atteignent profondément. « Ce qui est invisible dans la journée aux non-initiés peut se révéler dans la nuit », affirme l’artiste. Sans doute parfois saisi par l’émotion et dans l’urgence de saisir l’instant, le photographe a la main qui tremble. Faut-il expliquer ainsi le flou qui domine dans de très nombreux clichés ? Ou bien faut-il y voir, plutôt, la manifestation d’une réalité par définition insaisissable ?
Que peuvent nous révéler, en effet, ces photographies d’hommes et de femmes saisis dans les gestes les plus élémentaires et, le plus souvent, dans leur profonde précarité ? Un profond mystère les entoure en tout cas. « Autre chose perce à travers le réel, comme une douce étrangeté », souligne le photographe qui s’attarde sur une main, un cou, un front… Ici un lit défait, là une corde ou un volet d’où perce la lumière. Avec, autour, des figures errantes de chien, d’âne ou de mouton. Alexandre Vigot n’enjolive rien. Il saisit l’homme dans l’ordinaire des jours. Voici un petit enfant endormi sur une banquette de fortune, un homme au retour d’un lourd labeur (ses mains calleuses parlent pour lui), des femmes saisies dans leur modeste intérieur. « Je traverse la campagne africaine. J’écoute battre son cœur ».
Pour saisir une telle réalité, il fallait un homme venu d’un pays rude. Né dans le Livradois, au cœur d’une Auvergne si peu pittoresque mais tellement attachante quand on traverse ses forêts de sapins ou ses clairières bruissant d’abeilles. Pour parler de ce pays-là, Alexandre Vigot a déjà réalisé une histoire photographique sous le titre Je ne me souviens pas de mon enfance. Aujourd’hui, il peut nous dire quand il part en Afrique : « J’emmène mon territoire natal, que je retrouve dans cet ailleurs ».
Sous le masque sacré, Alexandre Vigot, Arnaud Bizalion éditeur, 27 euros
 |
Guénanten Christine, |
| Féerique fougère |
|---|
Fidèle à elle-même. Fidèle à une écriture qui dit le monde dans sa simplicité et sa beauté. La Bretonne Christine Guénanten célèbre les fleurs, les nuages et les papillons. Et beaucoup d’autres choses. Sans oublier cette « féerique fougère » qui donne le titre à son nouveau recueil. De bout en bout, c’est un don d’émerveillement que sa plume rend contagieux.
« Grandes prairies traversées de ruisseaux, / Je vous aime ». Christine Guénanten sait faire feu de tout (petit) bois. Le plus minuscule, le plus anodin, a droit de cité dans ses livres. Elle anoblit les gens, les choses, la nature. Francis Jammes n’est jamais loin, celui qui écrivait « Écoute dans le jardin qui sent le cerfeuil, chanter, sur le pêcher, le bouvreuil ». François d’Assise rôde aussi dans ses textes. Voici donc, dans nos mains, un nouveau Cantique des créatures où la poète convoque aussi bien le « chien châtaigne » que la féerique fougère. « S’enraciner à sa vie / Par son odeur forestière. /Osmonde royale ». Elle convoque aussi « la petite neige », « les petites rivières » et les myosotis dont « les yeux s’émerveillent ». Cette approche sensorielle du monde, que sa plume restitue par une juste musique, n’est possible que par cette « attention soutenue » dont parlait le poète Czeslaw Milosz. Lisant Christine Guénanten, on pense aussi à ce qu’écrivait Henry-David Thoreau : « Poète serait celui dont les mots sont aussi frais que les bourgeons à l’entrée du printemps ».
Cette fraîcheur, ce regard lavé, cette aptitude à la contemplation ne concernent pas que la nature. Christine Guénanten nous parle des « gens modestes » avec la même empathie. À commencer par sa mère (« Tout s’éclairait en or / Grâce à ses mains »). Ailleurs, elle loue « le brave charbonnier », « le prince apiculteur » et « les élégantes modistes ». Mots « pauvres » pour mieux dénoncer « un monde bruyant » et pour « encercler la peur ». Pour faire aussi le constat du désastre écologique. « Terre, / Tu ne peux plus te taire, / Qu’avons-nous fait / de tes forêts, / tes ruisseaux, / tes animaux ? ».
Car Christine Guénanten n’est pas dupe. Il y a « Tant de pièges posés / De-ci, de-là à l’humanité ». Il convient, écrit-elle, de « s‘opposer aux modes / D’un monde numérique » et faire front à « la bêtise programmée », notamment sur les écrans. Elle n’hésite pas à noircir le tableau en parlant de nos « maux misérables », de nos « vies assombries ». Inlassablement, elle appelle la nature à l’aide. « Si les voix des humains / Se changent en couteaux, / Au cercle des jonquilles / Tout se métamorphose / En dialogue amoureux. // Mots-lilas, mimosas, Giroflées / jour et nuit au jardin / Le bonheur nous attend ». On est prêt à la croire et à la suivre.
| Féerique fougère, Christine Guénanten, illustrations de Jean Jagline, Des Sources et des Livres, 2021, 98 pages, 14 euros | |
| Retrouvez les publications Des Sources et des Livres | |
 |
Jean Lavoué, |
| Des clairières en attente |
|---|
Poète, écrivain, éditeur. Le Breton Jean Lavoué creuse son sillon. Dans un récit-témoignage sur son itinéraire de vie, il propose une nouvelle approche du christianisme, en faveur du « poème évangélique », dans la fidélité à des auteurs qui ont choisi « l’exode » et « les marges », à commencer par Jean Sulivan. Que l’on soit chrétien ou non, que l’on croit en Dieu ou non, son témoignage mérite d’être entendu.
S’il y a des mots que Jean Lavoué abhorre, ce sont bien les mots « jugements » et « condamnations » (ceux d’un catholicisme de la culpabilité). Il leur préfère les mots « espérance », « désirs », « confiance ». Car il nous estime « assoiffés de puits », prêts à répondre à « l’appel de l’oasis ». S’il donne l’impression de parler ici en paraboles, il est surtout là pour tisser devant nous le fil conducteur d’une vie qui l’a mené de ses responsabilités dans l’action sociale à un engagement définitif dans l’écriture (inauguré par son blog « L’enfance des arbres »). Des événements fondateurs, des rencontres décisives jalonnent son parcours. Qu’il s’agisse de Maurice Bellet, Bernard Feillet, Etty Hillesum, Dietrich Bonhoeffer, Marcel Légaut, Maurice Zundel, Joseph Moingt, François Cassingena-Trévedy… jusqu’à la découverte essentielle de l’œuvre de Jean Sulivan. Sans oublier les textes poétiques de Gilles Baudry, Christian Bobin, René Guy Cadou, Xavier Grall…
Jean Lavoué se rend vite compte que ses aspirations à une nouvelle approche du christianisme ne sont pas isolées. Le voici engagé dans des « nouveaux réseaux de l’hospitalité et de la générosité » autour de « lignes de fuite permettant d’arracher le souffle évangélique à cette culture qui l’a séquestré » (la culture gréco-romaine). On le retrouve ainsi dans des rencontres « Bible et poésie », dans des journées alliant spiritualité et culture… Le voici, surtout, qui devient auteur. Il publie des livres sur Sulivan, Lamennais, Grall, Perros… Il cherche de nouvelles voies à emprunter pour faire vivre le souffle évangélique. « Loin du cléricalisme » comme le dit, dans un de ses livres, Loïc de Kerimel.
Aujourd’hui un néologisme retient l’attention de Jean Lavoué, celui de « christité » qu’il voit utilisé par le théologien Jean-Marie Martin. « Cette christité, telle que je la ressens, écrit-il, je dirais d’abord qu’elle déplace complètement le divin, Dieu, le Christ, de cette place d’exception au sommet d’une pyramide verticale où il se tient séparé des humains. Plus de Dieu extérieur, plus de conception théiste ». Qui, alors, est Dieu ? « Une puissance de Vie, répond Jean Lavoué, qui appelle l’homme en avant de lui-même, qui lui ouvre tous les possibles ». Avec comme conséquence, celle « d’assumer la conception d’un Dieu faible, pauvre, incarné en l’homme ».
Pour faire vivre cette christité, l’auteur croit plus que jamais aux petits groupes cultivant la fraternité évangélique, à la méditation pour se relier à la « diaspora », à la pratique quotidienne de la marche associée à l’écriture poétique… Il va aussi jusqu’à souhaiter un « œcuménisme radical à élargir au judaïsme » pour rejoindre cette « identification profonde de Dieu avec la souffrance de l’homme ». Il note que les périodes de confinement que l’on vient de vivre furent, à ses yeux, « un grand révélateur de tels déplacements qu’il faudrait apprendre à lire comme un signe des temps ». En clair, ne pas revendiquer « à cor et à cri le retour des messes dominicales » mais plutôt faire de nouvelles expérimentations, loin d’une « église autocentrée », autour de « véritables oasis chercheuses de chemins inédits ». Ce que Jean Lavoué appelle des « clairières en attente ».
Des clairières en attente, Jean Lavoué, Mediaspaul, collection Grands Témoins, 2021, 130 pages, 15 euros.
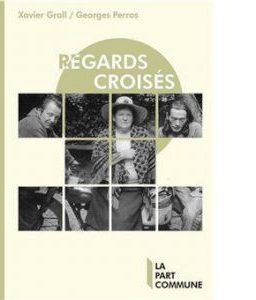 |
Ronan Nédélec, |
| Regards croisés, Xavier Grall – Georges Perros |
|---|
Ils étaient faits pour se rencontrer. Xavier Grall (1930-1981) et Georges Perros (1923-1978), pourtant si différents dans leur approche du monde et de la vie, ont très vite eu des atomes crochus. L’amour de la Bretagne les réunissait mais encore plus leur « claudication commune » comme le dit si justement Ronan Nédélec dans un livre où il rend compte des liens qui unissaient ces deux poètes. Livre publié à l’occasion des quarante ans de la disparition de Xavier Grall.
Ces liens se sont tissés par une correspondance et des rencontres. La première de ces rencontres date du 20 juillet 1969 à Tréhubert en Trégunc où Georges Perros s’est déplacé depuis Douarnenez (sur sa mythique moto) pour rencontrer Xavier Grall. D’autres rencontres suivront, parfois sous le regard de Nicole Correlleau, hôtelière et restauratrice à Pont-Aven (une fameuse photographie de Michel Thersiquel les immortalise tous les trois). Grall se rendra aussi à Douarnenez.
Leur correspondance n’est pas très fournie. Rien à voir, par exemple, avec la correspondance que Perros a entretenue avec Lorand Gaspar. Simplement 20 lettres (13 de Grall, 7 de Perros) écrites entre 1969 et 1978. Grall écrit pour la première fois à Perros parce qu’il prépare un article sur les écrivains de Bretagne pour la revue Le Cri du monde. La dernière lettre est de Perros, le 18 janvier 1978, soit 5 jours avant sa 2e opération à l’hôpital Laënnec à Paris (il décède le 24 janvier).
Dans leur correspondance, les deux hommes parlent de leurs livres, évoquent des articles de journaux, parlent du temps qu’il fait et du temps qui passe. Pas de grandes considérations. Plutôt des signes d’amitié ou de connivence, des « coucous » chaleureux. Une fraternité entre les lignes en somme. « J’ai été très heureux de te revoir ici. Raid un peu bref toutefois. Faut revenir nizonner » (lettre de Grall du 26 décembre 1974 dans sa campagne de Nizon). « Merci de ta carte signe de tendresse. Mais je ne suis plus capable de faire de signes. Justement puisqu’on m’a coupé de sifflet » (lettre de Perros, laryngectomisé, de fin avril 1976). Ronan Nédélec, qui réunit aujourd’hui toutes ces lettres qu’il a pu retrouver, le note avec justesse : « Ils avaient tous les deux un sens aigu de la chose littéraire et c’est aussi cette acuité qui les faisait boiter parfois à la même fréquence ».
Quand Georges Perros mourra, Xavier Grall (qui s’était déplacé à ses obsèques par une journée venteuse et pluvieuse au cimetière marin de Tréboul) lui rendra un hommage vibrant dans un long poème publié pour la première fois dans la revue Le Fou parle. « Je me souviens de Georges Perros / Je ne fus pas de ses intimes / C’était entre nous les rimes / De deux poètes dingues / De rencontres et de frairies / Humains trop humains / Il nous suffisait de l’être / Nous avions rompu avec Paris / Les mêmes rives nous étaient familières / Nous étions de ces frères pudiques / Qui ne sont graves / Que dans les lettres et cartes postales ». Grall publiera aussi deux chroniques dans Le Monde où il évoquera avec chaleur celui qu’il appelait « le moineau de la grève-aux-dames » (par allusion à l’appartement de Perros à Douarnenez qui dominait cette grève).
Les regards croisés de ces deux poètes ne s’arrêtent pas là. Ronan Nédélec réunit ici les appréciations qu’ils portaient, l’un comme l’autre, sur les œuvres d’Armand Robin et de Yves Elléouet. Il y ajoute cette passion commune des îles (Irlande, Sein…) que Grall ou Perros ont exprimée dans des articles ou des poèmes dispersés dans leurs œuvres respectives. Ronan Nédélec entend proposer, comme il le dit lui-même, « une approche sensible aux écrits et aux thèmes qui les auront fait boiter ensemble ». C’est le grand mérite de ce livre qui a nécessité une belle investigation pour rendre ainsi accessible des textes peu connus, ou pas connus du tout, de ces deux grands auteurs de Bretagne.
Regards croisés, Xavier Grall – Georges Perros, édition établie, préfacée et annotée par Ronan Nédélec, La Part Commune, 2021, 242 pages, 15 euros.
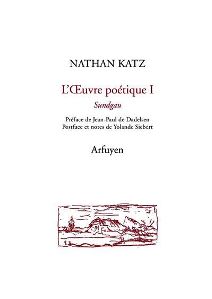 |
Nathan Katz, |
| L’œuvre poétique I, Sundgäu |
|---|
Poète en Alsace comme Anjela Duval l’était en Bretagne. Tous les deux enracinés mais tout autant universels. Nathan Katz (1892-1981), comme la paysanne-poète du Trégor, a chanté son pays natal dans une œuvre poétique que rééditent opportunément les éditions Arfuyen. Katz était originaire du Sundgäu, dans le sud de l’Alsace, un territoire dont il nous parle en dialecte alémanique. « Mon cher pays, je t’aime tant. Tu n’es tout entier que jardins ». En voyageant il entraînait avec lui son pays. « J’en désaltère mon âme, / je l’emporte avec moi par le monde ».
En plus de l’intérêt de découvrir une belle œuvre poétique, les lecteurs bretons ont au moins deux bonnes raisons de lire l’Alsacien Nathan Katz. D’abord il y a donc cette parenté d’écriture et d’approche du monde avec celle d’Anjela Duval (1902-1981). Tous les deux adoraient leur pays natal (avec une ardeur militante, en plus, chez la Bretonne) et vécurent au plus près de la nature. Ensuite parce que Katz fut le « grand frère » en poésie de Guillevic. Les deux hommes s’étaient connus à Altkirch dans le Sundgäu suite à la mutation du père de Guillevic, gendarme, dans le sud de l’Alsace. Le poète breton apprit l’alémanique (qu’il connaissait mieux que la langue bretonne) et traduisit en français des poèmes de Katz. On retrouve aujourd’hui certaines de ses traductions dans ce premier tome de l’œuvre poétique de Katz. Aux yeux de Guillevic, selon l’éditeur Gérard Pfister, l’auteur alsacien, « humble et généreux, naïf et profond, demeurait (…) la figure même du poète ».
La poésie de Nathan Katz se singularise par sa profonde simplicité, flirtant parfois avec le chant ou la comptine (ce qui la rattache, aussi, à des formes de la poésie orale bretonne). Elle parle de la guerre qui a meurtri son pays (« Ma terre natale, que de sang répandu sur les labours »). Elle parle de la mort et des morts (« les morts qui n’ont pas de repos dans la terre »). Elle parle de la nature, des « petites poires du fruitier », du « brouillard d’automne », de « la nuit d’hiver retentissante », du « chant des pommes qui cuisent dans le four ». Elle parle du feu et de la flamme : « Vois-tu le petit feu flamber / Entends-tu les brindilles grésiller » avec, comme en écho, ces mots d’Anjela Duval parlant de « la voix du feu », « mon complice de tous les soirs ».
Pointe en permanence, chez Nathan Katz, cette conscience aiguë de la fugacité des choses. « Un poirier se dresse quelque part dans la campagne, il dépérit ». Plus encore, c’est notre précarité qu’il souligne quand il parle des « brèves heures de l’ici-bas » car « déjà nous attend la pierre des morts ». On croit entendre, de-ci de-là, cette voix particulière des poètes chinois qui ont inspiré Nathan Katz. « Le village repose si tranquille. / La lune luit sur les toits. / Les pierres tombales sont blanches dans la nuit ». Ces vers du poète alsacien font étonnamment penser à ceux de Li Po (701-762). « Une sombre, sombre étendue de pics bleus / avec la lune ensemble nous arrivons à ta demeure paysanne ». La même intonation, le même regard, dénué de tout artifice, posé sur la vie et le monde.
Comme les poètes chinois, Katz croit à des formes de renaissance. « Et quand nous serons morts, / nous revivrons peut-être / dans tout ce qui est beau », écrit-il, « Nous seront peut-être la vie / qui monte dans le jeune blé ». Jean-Paul de Dadelsen, qui fut avec Guillevic un de ses premiers traducteurs, note que Katz était un être profondément religieux. « Religieux comme était l’homme primitif devant la nature, religieux comme pouvait l’être un paysan grec ». Ou comme l’était une paysanne bretonne nommée Anjela Duval qui, en bonne chrétienne, croyait à la « résurrection ».
L’œuvre poétique I, Sundgäu, Nathan Katz, préface de Jean-Paul de Dadelsen, postface et notes de Yolande Siebert, traduit de l’alémanique par Théophane Bruchlen, Jean-Paul de Dadelsen, Guillevic, Alfred Kern, Jean-Paul Klée, Gérard Pfister, Yolande Siebert et Claude Vigée, éditions Arfuyen, 2021, 270 pages, 19,50 euros.
 |
Yves Namur, |
| Dis-moi |
|---|
115 fragments composés chacun de six vers, introduits chaque fois par ces mots : « Dis-moi quelque chose ». Le poète belge Yves Namur (69 ans) dit avoir répondu un jour à une forme d’injonction – qui ne fut jamais une contrainte – pour réaliser ces « sizains » traversant les saisons. « Ils ne sont rien d’autre, écrit-il, qu’une prière adressée à l’inconnu, au lecteur éventuel et probablement à moi-même ».
Le procédé littéraire est connu. Il est pratiqué par les meilleurs auteurs : introduire chaque poème d’un livre par les mêmes mots. Le poète breton Marc Baron est de ceux qui aiment pratiquer l’exercice comme dans Ma page blanche mon amour (La Part Commune 2011) où il introduit chaque poème par les mots « ma page blanche » ou dans O ma vie (La rumeur libre éditions, 2018), où il fait de même avec « O ma vie ». Le Belge Yves Namur relève le même défi avec son « Dis-moi quelque chose » qui fait peut faire penser à un titre ou à un refrain de chanson. Mais il y a ici, on s’en doute, bien plus que cela. En réalité une forme d’appel ou d’interpellation de la part d’un poète aux aguets « Car tout ici-bas / N’est plus que paroles obscures / et gestes abandonnés », constate-t-il.
Yves Namur, en effet, n’est pas avare de mots pour pointer du doigt « nos pauvres manières de voir », « nos bouches terreuses », « nos cœurs trop pesants », « nos folies », « les palabres trop nombreuses »… Mais, en même temps, il souligne cet « entêtement à espérer » dont peut témoigner, à ses yeux, la parole poétique. « Dis-moi quelque chose / À porter discrètement autour du cou // Un mot comme amour / Il ouvrirait les tombes vides / Les vases les roses // Et le temps qui s’y presse déjà ».
Le poète traverse ainsi les quatre saisons qui donnent leurs noms aux quatre chapitres du livre. Mais il n’y a pas ici l’approche particulière qui caractérise les auteurs de haïku. Certes, furtivement, des notations saisonnières apparaissent (« le grand froid », « les branches mortes », « les prairies encore vertes », « le goût de la belle pomme », « les semailles abandonnées… ») mais l’essentiel est ailleurs. Il s’agit de défier le temps et cette inexorable fuite des années. De faire face, aussi, au chagrin, à la douleur, à la difficulté d’être. Yves Namur cite Paul Celan, Emily Dickinson, Paul de Roux… et peut écrire lui-même : « Dis-mois quelque chose / Qui remplisse lourdement nos mains // À tel point / Qu’elles en laisseraient tomber / Nos tristesses nos brûlures // Et nos chutes d’amour ».
Dis-moi quelque chose, Yves Namur, Arfuyen, 145 pages, 14 euros
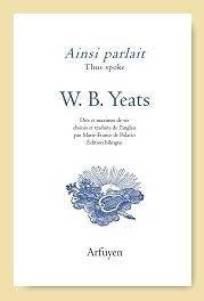 |
Marie-France de Palacio, |
| Ainsi parlait (Thus spoke) William Butler Yeats |
|---|
Il est un écrivain phare de la littérature irlandaise. Prix Nobel de littérature en 1923, William Butler Yeats (1865-1939) est une véritable figure de poète national. Les fragments regroupées aujourd’hui dans Ainsi parlait William Butler Yeats évoquent sa fascination pour le mystère de la vie. Et de la mort.
Aussi bien marqué par le symbolisme de Maeterlinck et le mysticisme de William Blake que par le théâtre nô japonais et les mythes celtiques, la poésie de Yeats a porté la voix de l’Irlande. On sait en effet qu’il a milité pour l’indépendance de son pays et qu’il a réalisé ce que François-Marie Luzel (1821-1895) a fait à son époque en Bretagne en allant recueillir dans les campagnes irlandaises les contes qui se transmettaient de génération en génération. C’est le thème de son livre Le crépuscule celtique réédité à Rennes par La Part Commune en 2013. Yeats s’est toujours fait le défenseur de l’art populaire, « la plus ancienne des aristocraties de la pensée », comme il le disait.
En regroupant dans un livre des extraits de ses poèmes, de ses essais, articles ou correspondances, les éditions Arfuyen nous permettent aujourd’hui d’apprécier la profondeur de sa vision du monde et de l’existence. « Qu’est-ce que le paradis sinon la plénitude de la vie », écrivait William Butler Yeats. C’est sa recherche éperdue du sens de la vie, associée à cette conscience aiguë de la mort, qui taraude l’auteur irlandais. Sur ce terrain-là, il rejoint cette approche commune à tant d’auteurs des pays celtes pour qui une frontière bien ténue sépare la vie de la mort. « Quand nous sommes morts, selon mon opinion, écrit Yeats, nous revivons nos vies en revenant en arrière pendant un certain nombre d’années, foulant les chemins que nous avons foulés, redevenant jeune gens, et même enfants, jusqu’à ce que certains d’entre nous atteignent à une innocence qui n’est plus un simple accident de la nature, mais le couronnement suprême de l’esprit humain ». Il dit ailleurs : « Le naturel et le surnaturel sont intimement liés l’un à l’autre ».
Yeats n’hésite pas, par ailleurs, à se placer à contre-courant des tendances lourdes de son époque, celle de l’abstraction, du dogmatisme, de l’intellectualisme… Il donne la priorité à l’émotion, à l’âme, à l’imagination, au mysticisme. « Tout ce que notre regard touche est béni ». On comprend mieux sa détestation de l’époque qui était la sienne, parlant, à son propos, de sa « lâcheté croissante » et de la montée inexorable de la « haine » ou de « l’amertume » (dans des textes écrits il y a un siècle, en 1921).
Demeure la littérature, « la grande puissance enseignante du monde, l’ultime créatrice de toutes les valeurs ». Et que vive surtout la poésie ! « Lorsque tout tombe en ruines, / La poésie pousse un cri de joie, / Car elle est la main qui répand, la cosse qui éclate, /La joie de la victime au milieu de la flamme sacrée, / Le rire de Dieu devant la dislocation du monde ». La parole de Yeats n’en a pas fini de nous interpeller, à un siècle de distance. « Nous commençons à vivre lorsque nous avons compris que la vie est une tragédie ».
Ainsi parlait (Thus spoke) William Butler Yeats, dits et maximes de vie, choisis et traduits de l’anglais par Marie-France de Palacio, éditions bilingue, éditions Arfuyen, 176 pages, 14 euros
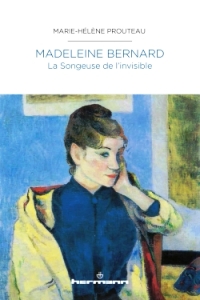 |
Marie-Hélène Prouteau, |
| Madeleine Bernard, songeuse de l’invisible |
|---|
La Nantaise Marie-Hélène Prouteau nous fait revivre l’âge d’or de la révolution picturale de la fin du 19e siècle et notamment celle liée à l’École de Pont-Aven à travers l’histoire de la vie de Madeleine Bernard (1871-1895), sœur du célèbre peintre Émile Bernard. De trois ans sa cadette, cette « jeune femme incandescente » morte à 24 ans fut à la fois muse, modèle et confidente non seulement de son frère mais aussi d’autres artistes qui ont profondément marqué cette période de l’histoire de l’art.
« Madeleine est très à l’aise dans la conversation avec ces peintres un peu fêlés qui peignent les arbres en bleu, le sable des plages en vermillon et japonisent à tout va ». Marie-Hélène Prouteau nous parle ici d’un moment décisif dans la vie de Madeleine Bernard : la venue de la jeune femme à Pont-Aven en 1888. Elle y rejoint son artiste de frère venu sur place dès 1886 à l’occasion d’un voyage à pied qu’il effectuera en Bretagne et le fera notamment passer par Saint-Briac, un lieu auquel il restera aussi profondément attaché.
En cette année 1888, la jeune Madeleine tape dans l’œil de Paul Gauguin qui signera la tableau fameux Portrait de Madeleine Bernard (musée de Grenoble). « Elle a revêtu la veste jaune, note Marie-Hélène Prouteau, la tunique bleue boutonnée et la jupe rouge serrée à la taille ». Paul Gauguin, « dans la vigueur de ses quarante ans », est sous le charme. La jeune fille, la « songeuse », « la tête appuyée sur la main, sa pose familière », est une très jeune fille de 17 ans. Mais « tout ici lui parle de la vie qu’elle voudrait vivre. La vie près de la nature, dans l’humilité de ces choses simples qui sont les vraies richesses ». Elle attire aussi l’attention d’un autre artiste, Charles Laval, avec qui elle aura une liaison.
Mais la vie de Madeleine n’est pas figée dans cette Cornouaille bohème. Elle est d’abord faite d’allées et venues entre sa famille originaire de Lille mais installée à Asnières (le père est négociant en tissus) et divers lieux où elle séjourne pour le plaisir ou par nécessité. Néanmoins, on la retrouve souvent dans les pas de son frère Émile. La voici par exemple aux bains de mer au Crotoy en 1889 (« la mer ici ne vaut pas celle de la Bretagne », écrit-elle) puis, en 1891, à Saint-Briac (« le pays est superbe, plus je le regarde, plus je l’admire », écrit-elle à ses parents). C’est de cette année 1891 que date la fin d’une relation amicale avec Paul Gauguin quand ce dernier se prévaut publiquement, ignorant Émile Bernard, d’être le fondateur du symbolisme en peinture.
Au fil des pages, Marie-Hélène Prouteau approfondit notre connaissance de la jeune femme, enrichit son texte d’un luxe de notations sur cette période d’effervescence artistique. Elle a pour cela puisé dans des écrits de toute nature, dans des correspondances et effectué un vrai travail d’investigation. Elle le rehausse par une qualité d’écriture qui porte sa marque propre (alliant fluidité et élégance), éveillant chez le lecteur le sentiment d’être de plain-pied dans un univers d’hommes et de femmes en quête d’un autre avenir possible.
« Je souffre trop du réel de la vie, écrit Madeleine à son frère Emile en 1892, je suis plus persuadée que jamais que je suis incapable de vivre selon le monde. Si je ne craignais pas de céder à la lâcheté, je me retirerais dans un cloître ». Marie-Hélène Prouteau souligne, de ci de là, l’approche mystique de son personnage. Oui, « songeuse de l’invisible ». D’où son peu d’empressement à voir sa vie de femme tracée d’avance comme lorsque son père l’inscrit dans une maison de commerce. Madeleine rompt avec sa famille quand sa mère (autoritaire) fustigera, à tort, son « amitié coupable » avec une autre femme, son amie Charlotte Joliet, de cinq ans son aînée.
Madeleine rejoint l’Angleterre, puis s’enfuit à Genève (avec Charlotte) où elle entretient une liaison avec un jeune Russe « de fort bonne famille » qui n’est autre que le frère de la journaliste et écrivaine Isabelle Eberhardt. Puis elle projette d’aller en Corse et même au Canada. Finalement ce sera l’Égypte où elle rejoint Émile qui vient de s’y marier. Madeleine meurt le 20 novembre 1892 des suites d’une phtisie pulmonaire (on attribuera cette maladie à sa liaison avec Charles Laval qui était tuberculeux).
Madeleine Bernard, femme libre, aura vécu pleinement sa courte vie. L’autrice Marie-Hélène Prouteau a trouvé les mots pour le dire et l’associer au destin qui fut celui d’Émile Bernard. Deux âmes sœurs dans une « secrète complicité » qui ne se démentira jamais. La Madeleine au bois d’amour, peinture d’Émile Bernard du Musée d’Orsay, restera pour toujours la trace visible de cette liaison. Émile a 20 ans quand il peint sa sœur. Madeleine, elle a en a 17.
Madeleine Bernard, songeuse de l’invisible, Marie-Hélène Prouteau, Éditions Hermann, 150 pages, 19 euros
 |
Marie-Josée Christien, |
| Éclats d’obscur et de lumière |
|---|
Faire halte, regarder le monde sans complaisance, mais aussi savoir s’émerveiller. La poétesse quimpéroise Marie-Josée Christien distille des graines de sagesse sous forme d’aphorismes ou de pensées lapidaires. À la manière de ses précédentes Petites notes d’amertume (Les Éditions Sauvages), elle met au jour le côté pile et le côté face de nos existences. Ou, comme le suggère le titre de son nouvel opus, leurs aspects aussi bien lumineux qu’obscurs.
Pratiquer l’aphorisme, c’est faire le choix d’aborder une grande variété de sujets. C’est parler de la vie et de la mort, du rapport aux autres, de l’amitié, de l’amour, des religions, du monde moderne et de ses travers, de la comédie humaine, des réseaux sociaux, de l’écriture, de la poésie… Marie-Josée Christien évoque tout cela dans son livre. Ce qu’elle apprécie avant tout c’est la sincérité et la loyauté. Ce qui relève de l’esbroufe suscite ses remarques les plus acerbes. Ainsi la voit-on inaugurer son livre par une série de propos bien sentis sur le « cynisme » et les « pauvres messages » des « usurpateurs de l’art contemporain ». Même sévérité quand il s’agit d’une « poésie qui se complaît dans l’incommunicabilité ». Marie-Josée Christien plaide pour la « simplicité » qui est, à ses yeux, « l’une des marques du génie poétique ». Mais s’il y a création – y compris poétique – c’est parce qu’il y a blessures et fêlures, nous dit la poétesse. « L’obscur a des fêlures d’où s’échappe et rayonne la lumière ».
La fêlure, pour ce qui la concerne, trouve sans doute sa source dans une pauvreté originelle dont elle a su, d’une certaine manière, faire un tremplin. « Mon enfance a été pauvre mais pas malheureuse puisqu’il y avait l’espoir ». C’est l’éducation et la culture qui en seront les vecteurs (Marie-Josée Christien sera professeure des écoles), ce qui ne l’empêche pas de continuer à affirmer ses engagements en faveur de ceux que le monde laisse au bord de la route. L’occasion pour elle d’évoquer ici sa sympathie pour le combat des Gilets jaunes des ronds-points. Car « écrire c’est manifester notre désaccord avec la marche convenue du monde ». Mais, dans ses textes comme dans ses poèmes, elle le fait sans esprit militant. On la voit même plaider pour les valeurs dites « désuètes » qui ont pour nom « la discrétion », « la loyauté », « la solidarité ». Dans ce livre d’aphorismes, c’est la femme Marie-Josée Christien qui se profile. Forte de ses espoirs, de ses attentes. Forte de son combat intime contre la maladie qu’elle a évoquée dans un beau précédent livre (Affolement du sang, Al Manar). « J’essaie de vivre en symbiose avec elle », écrit-elle aujourd’hui.
Enfin pour affronter le monde et la vie, elle est grande lectrice. Cioran, Kundera, Bachelard, Max Jacob, parmi beaucoup d’autres, sont sur ses étagères. Elle les cite et elle s’en inspire. « C’est quand on accepte enfin la mort que la vie peut commencer », confie-t-elle, philosophe.
Éclats d’obscur et de lumière, Marie-Josée Christien, collages de Ghislaine Lejard, Les Éditions Sauvages, 2021, 67 pages, 12 euros
 |
Philippe Jaccottet, |
| La Clarté Notre-Dame |
|---|
Philippe Jaccottet, décédé le 24 février dernier, nous laisse un véritable livre-testament. Son titre, La Clarté Notre-Dame, pourrait faire penser à une évocation de la cathédrale incendiée (comme l’a fait François Cheng dans son livre À Notre-Dame, éditions Salvator). Il n’en est rien. Plus familier des petites chapelles que des cathédrales, le poète nous raconte comment il a pu voir un « signe » dans le son de la cloche d’un couvent, réveillant en lui des sentiments profonds et suscitant à la fois émerveillement et interrogations. Tous les thèmes profonds de son œuvre se retrouvent ainsi dans ce court livre posthume.
Le sujet paraît si mince. Le son d’une cloche, sa « limpidité », sa « légèreté », sa « fragilité extrême », sous un « ciel gris » dans « un lointain vallon ». Il n’en faut pas plus à Philippe Jaccottet pour nous entraîner très loin. Il voit à la fois dans le son de cette cloche « une espèce de source suspendue en l’air » et, comment il le dit plus loin dans le livre, «une espèce de glas sans solennité ». Il y voit, quoi qu’il en soit, le signe de quelque chose. « Une sorte de tintement de cloche dans le ciel intérieur ». Une cloche qui le ramène aussi à Hölderlin (« la rencontre la plus importante de ma vie de lecteur », dit-il à propos du poète allemand) parlant, dans un de ses poèmes, de « la cloche dont / on sonne / pour le repas du soir ».
Jaccottet saisit cette occasion (le son d’une cloche) pour revisiter sa vie d’homme et de poète. Oui, il a été ce quêteur inlassable de signes, « infimes », « fragiles », dont le son d’une cloche fait partie. Il a été ce « cueilleur », ce « recueilleur » de signes dont il a été, estime-t-il, « le trop maladroit interprète ». Il nous le dit ici dans des textes en prose écrits sur le mode de La Semaison, ses carnets de poète. Nous sommes en 2012, 2016 et 2020. Jaccottet a 87 ans, 91 ans, 95 ans. Le voici dans le « trop grand âge » et il note en lui « la montée de la croissance de la mort ». Mais comme il l’a toujours fait, il persiste à s’arrimer à la contemplation en dépit de l’effroi qui peut le saisir. D’un côté « les marécages de la vieillesse », ses « fondrières ». De l’autre, « les toutes premières fleurs roses de l’amandier » où il perçoit « l’invasion du monde (…) par des essaims d’infimes anges très frêles ».
Le poète peut alors élever son chant jusqu’à l’exaltation (« exultate », « jubilate », écrit-il) mais le voilà très vite rattrapé par le doute et cette conscience aiguë du mal à l’œuvre dans le monde. Dans sa thébaïde de Grignan (« ma belle enclave protégée ») où il vit depuis 1953, le voici tourmenté par le drame syrien et la cruauté des tyrans. Il se souvient de Palmyre où il a pérégriné et imagine aujourd’hui les « caves ténébreuses » tenues dans ce pays par des « êtres démoniaques ». Mais il se ressaisit en citant ces mots d’Hölderlin qu’il aime par-dessus tout : « Mais là où il y a danger, croît / Aussi ce qui sauve ».
Être sauvé. Jaccottet l’entrevoit dans ces « rencontres inespérées » orientées vers « le très-haut », « le sacré », « les dieux ». N’y-a-t-il pas toujours chez lui, comme il le dit lui-même, « la même espèce d’émotion, toujours liée à un lieu religieux anodin, une petite chapelle, même modeste, même quelconque, pas même décorée, ou une crypte ». Ajoutant à propos de ces lieux : « Il y avait là quelque chose de beaucoup plus important que ce que j’aurais pu imaginer d’abord, qui était vraiment cette rencontre, inattendue souvent, inespérée, et pourtant… peut-être poursuivie en le cherchant, du sacré ».
Mais le poète reste sur le seuil tout en se disant « respectueux (…) de l’univers religieux ». Contemplant, au terme de sa vie, à la fois l’eau vive d’un ruisseau et les oiseaux en partance, il s’en fait des alliés pour ce qu’il appelle « une traversée impensable ».
La Clarté Notre-Dame, Philippe Jaccottet, Gallimard, 2021, 45 pages, 10 euros.
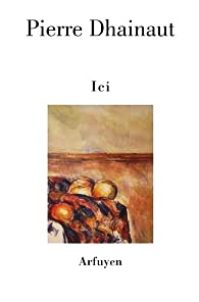 |
Pierre Dhainaut, |
| Ici |
|---|
Sous ce titre bien laconique Ici, Pierre Dhainaut (86 ans en octobre) nous ramène à l’essentiel : être attentif à l’instant présent, ne pas se dérober même si l’on traverse une épreuve. Et surtout « être capables de s’étonner et, sans comprendre pourquoi, de l’admettre » car « telle est la vertu principale de ceux qui écrivent des poèmes ».
Pierre Dhainaut revient de loin (une opération du cœur en 2019) et son recueil – du moins dans sa première partie – est profondément marqué par les événements vécus à cette occasion (« tes mains sur la poitrine / ou le long du brancard se raidissent »). Les mots « insomnies », « paupières blêmes », « veilles », « sueur » sont là pour baliser cet épisode subi dans une vie d’homme âgé qui jamais ne s’apitoie sur son sort mais choisit, bien plutôt, d’ouvrir une « perspective » en « respirant mieux ». En assument pleinement le « ici » et le maintenant. « N’accablons personne par le récit de nos malheurs, note-t-il, mais le moindre témoignage écrit arraché au désespoir nie le désespoir. Ne fût-ce qu’un instant : cet instant est souverain ». Oui, une forme « d’éthique du courage et de l’humilité », comme l’écrit son éditeur en présentant ce 9e ouvrage de Pierre Dhainaut qu’il édite. « Que vaudrait un poème s’il occultait ce qui nous oppresse, nous diminue ? », affirmait déjà le poète dans Un art des passages (éditions L’herbe qui tremble). « C’est pour respirer moins mal que, très jeune, j’ai eu recours au poème », ajoutait-il.
Il ne faut pas se laisser berner d’illusions, nous dit au fond Pierre Dhainaut. Il ne faut pas tricher, il faut revenir sans relâche au réel, l’assumer. Et les mots, en les « réengendrant », sont là pour dire ce réel. « En compagnie des mots tu n’as qu’une envie, relier, réconcilier ». Car l’important est de vivre « à portée de poèmes » pour faire entendre les voix des enfants, le chant du feuillage ou faire sentir « le parfum de l’aubépine ». Quand le mois noir de novembre pèse comme un couvercle, pouvoir dire que « les sorbiers se rallument » et, sans relâche, s’émerveiller. « Avec l’arc-en-ciel / tu diras que tout est lumière ».
Mais Pierre Dhainaut sait aussi mettre en garde. Il ne se raconte pas d’histoire. « Que devient l’ambition de changer la vie au moyen de poèmes s’ils n’agitent que des fantasmes ? », affirmait-il déjà dans son Art des passages. De la vieillesse, il dit qu’elle est « reflux de l’énergie vitale dont la poésie est l’un des noms ». Mais, en vieux sage, il peut nous affirmer aussi que « rien ne s’achève / si nous marchons / sans peser / sur les feuilles mortes ».
Ici, Pierre Dhainaut, Arfuyen, 93 pages, 12 euros.
 |
Gérard Le Gouic, |
| Respirez ! |
|---|
Comment rendre la poésie respirable
Du poète Gérard Le Gouic on dit volontiers qu’il est « rosse » avec ses congénères. Ses aphorismes, dispersés dans ses différents ouvrages et aujourd’hui regroupés dans un livre, l’attestent d’une certaine manière. Le regard qu’il porte sur le genre humain est sans concession. « Je me montre plus fidèle aux morts qu’aux vivants », écrit-il. Mais ne pas trop aimer l’humanité en général ne veut pas dire qu’on ne puisse pas aimer des gens en particulier.
Tout y passe dans ces aphorismes : la santé, la vérité, le mensonge, la liberté, la vieillesse, la bêtise, la mort, l’enfance, le mariage, le couple… Quelques types humains sont plus spécifiquement épinglés (car il les connaît sur le bout des doigts) : les gens de lettres, les artistes, les peintres et bien entendu les poètes. Gérard Le Gouic a suffisamment roulé sa bosse dans le milieu de la poésie (salons, librairies, rencontres…) pour ne pas en être un observateur avisé et souvent le plus impitoyable.
Tapant là où ça fait mal, il distille d’aimables vacheries qui sont autant de vérités criantes : « Les faux poètes vivent de poésie. Les vrais en meurent ». Ou encore ceci : « Les œuvres complètes d’un poète sont réunies pour les posséder, non pour les lire ». Sous-jacente à toutes ces saillies, il y a la critique en creux (et surtout en bosse) de certaines postures poétiques. Ainsi parle-t-il de « la faculté des poètes obscurs à s’émerveiller des poètes obscurs ». On sait que la poésie de Le Gouic a plus à voir avec celle de l’École de Rochefort, de Cadou et consorts, qu’avec celle de certains cénacles parisiens qu’il ne manque pas d’ailleurs d’épingler. « Des poètes ont tellement peur de ne pas écrire comme à Paris… comme on n’y écrit plus d’ailleurs. Où est-il le temps où un Quimpérois imposait à la Capitale sa vision de la poésie ? » Allusion à son compatriote Max Jacob dans les pas duquel il se place d’ailleurs en rédigeant lui aussi (comme l’avait fait Max Jacob s’adressant à Cadou) une forme de lettre ouverte à un jeune poète. « Ton métier sera la poésie. Choisis l’occupation qui nourrira ton corps en fonction de la liberté qu’elle t’accordera qui sera ton seul gain » (Gérard Le Gouic, poète de métier comme l’on dit de quelqu’un qui va chaque jour sur le métier, a tenu un commerce dans le vieux Quimper pendant de longues années). « N’offre que les poèmes que tu as composés quand l’air semblait sur le point de te manquer », déclare-t-il encore à ce jeune poète. Et aussi cette forme d’avertissement qui en dit long : « Sois vigilant : ce sont les poètes qui menacent la poésie ».
On le voit. Gérard Le Gouic persiste et signe. Il n’entend pas jouer un rôle, participer à la comédie humaine. Il formule plutôt des exigences, une forme d’éthique en vrai moraliste qu’il est. « La poésie démasque vite les tricheurs, c’est pourtant vers elle qu’ils se dirigent en premier », constate-t-il, amer. Pour lui, la poésie est « aventure ». Elle est aussi « solitude ». Loin d’une poésie bavarde, il peut écrire : « Le silence prend de la place, le blanc aussi, dans un poème ». Et il redit, en quelques mots bien frappés, son rejet de cet entre soi qui guette le milieu : «vUne trop forte densité de poètes au mètre carré rend la poésie irrespirable ». Ce qui encourage le poète qu’il demeure à emprunter les chemins buissonniers de sa Cornouaille, à cultiver sa passion du vélo et des plus modestes courses cyclistes. Loin des poètes.
Respirez !, Gérard le Gouic, Éditions des Montagnes Noires, 2021, 150 pages, 13 euros.
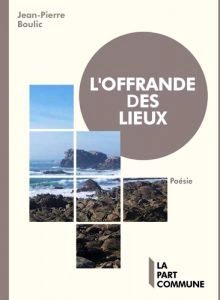 |
Jean-Pierre Boulic, |
| L’offrande des lieux |
|---|
Un Boulic inattendu. Le poète breton – une fois n’est pas coutume – s’éloigne à pas feutrés de son Pays d’Iroise pour nous faire entrer dans un autre univers, intime celui-là. Entre joie et douleur, ses proses poétiques disent – quoi qu’il en coûte – « l’éblouissement de la création ».
Que dire quand les années défilent et que le temps presse ? Sans doute regarder un peu plus qu’avant dans le rétroviseur comme l’a si bien dit le grand écrivain italien Erri de Luca. « Pour un homme né au milieu du siècle passé et qui a donc accompli depuis longtemps la plus grande partie de ses actions, le passé est toujours plus vaste, plus abondant, plus large. C’est un champ où se renouvellent les rencontres avec des personnes auxquelles on ne peut donner rendez-vous que là seulement, en arrière, dans l’écriture ». (Essai de réponse, Arcades / Gallimard).
C’est le cas de Jean-Pierre Boulic (né en 1944) qui revient ici, « poétiquement », sur son parcours personnel. « La guerre t’a vu naître », écrit-il. « Noël, c’était un livre et une orange dans les sabots (…) Tu attendais les mages ». Le voici adolescent : « Tu avais quinze ans, enfance de la sève, arôme des écorces ». Puis, c’est la caserne où il se retrouve à scruter depuis sa guérite « les étoiles gelées et les longs courriers ». Mais la toile de fond de ces années de formation est plus que mouvante. On y perçoit à la fois des traces de l’amour reçu et des stigmates de souffrances cachées. Le ton est souvent mélancolique, le monde décrit parfois crépusculaire.
Dans cette vie, il y a une rupture forte. « Averti en songe » de quitter le lieu où il vivait pour se rendre au bout du monde, fuyant « la gloire éphémère des réussites incertaines » après avoir secoué « la poussière de ses pieds », il se retrouve face à l’océan dans « le sarrau des brumes », sur une « terre où l’aria de la beauté palpite à tous les vents ».
Le voici, aussi, à pied d’œuvre pour réaliser le rêve « d’édifier une cathédrale poétique ». Mais en fait de cathédrale, il se contentera de construire des « petits poèmes sous le mode mineur ». Il le fera grâce à des rencontres décisives, à commencer par celle de Charles Le Quintrec dont on devine la présence dans ce livre. Mais il y aura aussi, entre autres, celle de Jean-Yves Quellec, voisin en Pays d’Iroise, ou encore celle de l’éditeur Yves Landrein.
Au bout du compte, le poète Jean-Pierre Boulic peut ainsi parvenir à une forme de sérénité et parler de « souffle retrouvé » pour dire les mots fétiches de son vocabulaire : « l’invisible », « l’ineffable », « l’inachevé », « l’insaisissable », « l’inespéré », « l’inconnu », « l’insoupçonné… ». Car « tout est offert sur ce chemin ouvert aux vents ». Face au « clair-obscur d’un monde occupé », face à « l’impudeur des temps », face au « chaos » qui « s’épanche » et « se défoule », face aux « faux-semblants », il brandit des mots nus, creusant fidèlement son sillon.
L’offrande des lieux, Jean-Pierre Boulic, La Part Commune, 2021, 95 pages, 13 euros
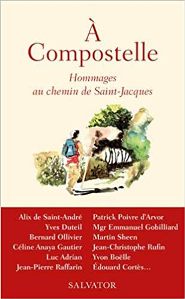 |
Collectif, préface de G. de la Brosse |
| À Compostelle, hommages au Chemin de Saint-Jacques |
|---|
À Compostelle, hommages au Chemin de Saint-Jacques
2021 est une année jubilaire pour le Chemin de Compostelle. Elle est décrétée ainsi lorsque le 25 juillet, fête de saint Jacques, tombe un dimanche. Ce qui est le cas cette année et, par là même, l’occasion de faire revivre le Chemin avec des pèlerins qui l’ont fréquenté et en ont été profondément marqués. Un livre entend, en effet, témoigner de l’histoire vivante de ce chemin millénaire. La Bretonne Gaële de la Brosse en a été la cheville-ouvrière, donnant la parole à pas moins de 34 personnalités : écrivains, journalistes, historiens, réalisateurs, artistes, religieux, hommes politiques… Tous disent à quel point le Chemin de Compostelle a pu jouer un rôle déterminant à un moment donné de leur vie. « Ils continuent, affirme Gaële de la Brosse, à nourrir cet élan de gratitude et de désir de partage ».
Une chose est sûre : les Bretons aiment le Chemin de Compostelle. Gaële de la Brosse en est, elle-même, l’exemple vivant. Mais, sans doute, tout a vraiment commencé avec le Rennais Jean-Claude Bourlès à qui l’on doit plusieurs livres sur Compostelle dont le premier paru en 1995 (Sur les chemins de Compostelle, éditions Payot). Puis il y eut l’expérience inédite du Finistérien Jacques Dary qui publia en 2002 le premier récit en aquarelles du pèlerinage (Compostelle, carnet d’un pèlerin, éditions Ouest-France).
On ne compte plus aujourd’hui les Bretons qui ont pu témoigner (par des écrits, des conférences, des causeries…) de leur expérience du Chemin. L’association bretonne des amis de Saint-Jacques de Compostelle témoigne de cet engouement. Elle a édité dès 2004 un guide des chemins de Saint-Jacques en Bretagne (Rando éditions).
Voici aujourd’hui que, dans l’ouvrage conçu par Gaële de la brosse, on retrouve des témoignages précis et autorisés de fins connaisseurs bretons du Chemin. Alain Boëlle est de ceux-là. Photographe, il avoue dans ce livre que l’aventure de Compostelle « chamboulera sa vie d’homme ». D’abord par les rencontres qu’elle permit mais aussi à cause de ce « vertige vertical qui nous submerge devant un paysage sans fin, sans repères ». Yvon Boëlle publiera de nombreux livres sur le chemin de Compostelle, la plupart aux éditions Ouest-France. « Ses images ont même été à l’origine de nombreux départs sur les routes, confie Gaële de la Brosse, tant la passion de ce Breton pour ces chemins qui convergent vers l’autre Finistère est communicative ». Autre référence bretonne : l’historien Patrick Huchet qui publiera également de nombreux livres sur Compostelle, parfois en lien avec Alain Boëlle. Sur le Chemin de Saint-Jacques, il dit aujourd’hui ceci : « J’ai vivement apprécié cette introspection quotidienne, cette lucidité qui s’offre si généreusement à tout marcheur au long cours ». Et il ajoute : « Ces fabuleux chemins de Saint-Jacques sont d’abord et avant tout d’incomparables voies d’amitié et de fraternité entre les peuples du monde entier ».
On trouvera donc dans ce livre, à, juste titre, des témoignages de pèlerins belges, québécois, américains (comme l’acteur Martin Sheen), chinois, japonais… Mais on se gardera d’oublier un autre Breton, atypique celui-là. Auteur de Garce d’étoile en 1990, le Brestois Hervé Bellec proposait une version non-conformiste du Chemin. « Ma réalité était passée à la moulinette de l’ambition littéraire », avoue l’auteur. « Je voulais faire comme les grands, les Lacarrière, les Bouvier ». Toujours est-il que Bellec a lui aussi, mais à sa manière, largement popularisé ce grand chemin de la foi mais surtout de la fraternité.
À Compostelle, hommages au chemin de Saint-Jacques, préface de Gaële de la Brosse, Salvator, 2021, 253 pages, 17 euros
 |
Gilles Baudry, |
| Il a neigé tant de silence |
|---|
Il est moine à l’abbaye bénédictine de Landévennec dans le Finistère. Il est aussi poète et – à 73 ans – auteur d’une dizaine de recueils publiés pour la plupart aux éditions Rougerie. Voici réédité, 36 ans après, Il a neigé tant de silence. Le livre avait valu à Gilles Baudry le prix Antonin-Artaud.
Il a neigé tant de silence depuis 1985 sur cette abbaye du bout du monde où vit notre moine-poète. L’homme est « entré » en poésie à la lecture des œuvres de René Guy Cadou (comme lui originaire de Loire-Atlantique). Puis il y eut très vite, dans son panthéon littéraire, Supervielle, Reverdy et tant d’autres. Gilles Baudry reconnaît volontiers certaines filiations mais sait faire résonner sa propre voix intérieure.
Avec Il a neigé tant de silence – un très bref recueil – il est entré d’emblée « dans la cour des grands ». Le poète et critique Charles Le Quintrec n’avait pas manqué, très vite, de faire part de son enthousiasme : « Gilles Baudry, avec une netteté intemporelle, nous permet ici d’entrer en communication avec le saint silence qui, à certaines heures, est une règle à laquelle il ne saurait déroger » (Poètes de Bretagne, éditions la Table ronde).
Ce « saint silence » dont parle Le Quintrec - et c’est là tout le miracle de ce recueil – n’a pas de connotation à proprement religieuse. Bien malin, en effet, celui qui pourrait affirmer que l’auteur est un moine. Ce que Gilles Baudry met ici en valeur, c’est avant tout le silence intérieur et la contemplation. Vertus monastiques, certes, mais que l’on peut retrouver sous toutes les latitudes chez des auteurs qui, comme lui, ont choisi d’ « héberger » le silence pour parvenir à une justesse de la parole. « Flatter l’encolure des arbres/apaiserait la brûlure de vivre », note le poète. Il nous dit « l’urgence de bâtir/de concilier hâte et lenteur ». Ailleurs il célèbre « le vent qui galbe les collines/module le chant des ramiers ». Il rend grâce pour « ces jours où l’invisible affleure ».
C’est cet « invisible ordinaire » qu’il célèbre dans un recueil publié en 1995 et aujourd’hui également réédité. « Nos mains grappillent le muguet / de la rosée // Un essaim tourne sur le front / de la colline ». Ainsi va le moine-poète, tel un musicien dans ses « variations sur le temps intérieur ». Il cultive l’amitié des artistes, accompagne de ses poèmes des albums de peintures ou des photographies. Il demeure un veilleur et délivre régulièrement son regard sur le monde et la vie dans la Chronique de Landévennec, revue trimestrielle de son abbaye, comme dans ces « notes éparses » de janvier 2021 : « Le présentisme : le mal du temps. Futur sans avenir, passé sans mémoire, présent sans présence pris dans les spasmes de l’immédiateté, de la réactivité, de la rentabilité. Voie ouverte au nihilisme qui tue le temps ».
Il a neigé tant de silence, suivi de « Invisible ordinaire » et de quelques poèmes inédits, Rougerie, 2021, 85 pages, 13 euros
 |
Yvon Le Men, |
| La baie vitrée |
|---|
Un poète confiné. Comme beaucoup d’écrivains, Yvon Le Men évoque ici son expérience personnelle de mise à l’écart forcé du monde lors des premiers mois de la pandémie. Le voici derrière la baie vitrée de sa maison de Lannion avec cette peur « de tomber dans la maladie / comme on tombe dans un cauchemar ». Mais le poète sait aussi nous mener ailleurs.
Écriture lapidaire. Deux vers, trois vers, puis un blanc, puis de nouveau deux vers, un vers… Comme pour témoigner de cette vie en miettes que le / la Covid nous a imposée. Yvon Le Men nous parle de sa « maison enroulée autour de ses fenêtres », des fenêtres qui deviennent des hublots pour accéder à une nature environnante faisant comme si de rien n’était. Car les oiseaux sont bien là, tout à leurs occupations (« la peur donne des ailes mais seulement aux oiseaux »), mais aussi les fleurs du mois de mars, sans oublier ses deux pommiers « côte à côte/branches à fleurs ».
Le poète a tout le temps de contempler, de s’émerveiller. Sa baie vitrée – comme le nom l’indique – ouvre de larges perspectives. Elle lui permet d’élargir la focale, sauf quand les volets roulants de bloquent et qu’il se trouve brutalement « confiné dans le confinement ». Heureusement un artisan viendra. « J’avais besoin de ses mains ». Opportune visite d’un réparateur accueilli comme le Messie. « J’avais besoin/ de quelqu’un/ d’un besoin d’humanité ». Besoin, aussi, du « pain de mots/produit de première nécessité » dont il est provisoirement privé quand il casse accidentellement son téléphone.
Mais le poète n’est pas là pour s’apitoyer sur son cas personnel. Il sait que le drame s’installe aux alentours. « La vieille dame qui est morte /hier // n’a pas vu la clochette /seule // parmi les primevères ». Cette mortalité galopante (« les morts débordent ») le ramène à une expérience intime de la mort à travers la figure d’un père trop tôt disparu. Mais s’il se met à l’écoute d’un passé douloureux, il ne se cantonne pas pour autant à son pré-carré trégorois. Le voici en correspondance avec un ami chinois. « J’étais inquiet pour lui /hier // Il est inquiet pour moi / aujourd’hui. »
Élargissant encore plus son champ de vision, Yvon Le Men nous fait envisager notre belle planète bleue (aujourd’hui bien abîmée) à travers le regard de spationautes. L’art de prendre de la hauteur. Et il cite Jean-Loup Chrétien parlant de notre planète terre : « Seul un enfant dans son innocence pourrait appréhender la pureté et la splendeur de cette vision ». C’est, sans aucun doute, cet émerveillement que le poète nous invite, en dépit de tout, à retrouver. Et si la pandémie en était l’occasion ! Au fond, laver notre regard sur le monde pour que, à l’image de son ami poète Claude Vigée, récemment disparu, on sache écouter chanter le rouge-gorge « dans l’amandier / invisible ».
La baie vitrée, Yvon Le Men, éditions Bruno Doucey, 2021, 153 pages, 16 euros.
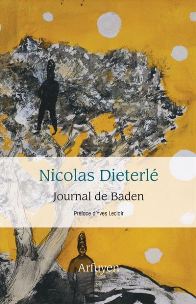 |
Nicolas Dieterlé, |
| Journal de Baden |
|---|
Poèmes, fragments, aphorismes, méditations et même récits de rêves : l’œuvre de Nicolas Dieterlé (1963-2000) cultive avec bonheur le mélange des genres, comme le confirme ce Journal de Baden. Avec toujours, en toile de fond, les « bêtes venimeuses de l’anxiété » ou « la fine épine de la douleur » que le poète combat par la seule force des mots.
Des mots. Mais quels mots ! Des mots puisés à la riche lumière du présent et de tous ces oiseaux qui deviennent, sous sa plume, des messagers de l’invisible. « Un oiseau file entre les arbres. Ô cœur vivant, cœur de hasard, cœur de certitude ». Cet oiseau est peut-être celui qui pépie comme l’oiseau-mouche d’un de ses précédents livres (Arfuyen, 2008) mais plus sûrement, ici, le faucon ou l’épervier, le goéland ou la mouette, le héron ou le pivert, retrouvés à tour de rôle au fil des pages. « Un seul oiseau passant dans le ciel immense donne à ce ciel son centre, sa maison ».
Ainsi va Nicolas Dieterlé sous des cieux incertains, souvent couleur d’encre, « rêveur solitaire seul au milieu d’une forêt, sur une plage blonde, au flanc d’une haute colline ». Mais le poète, contrairement aux apparences, ne se retire pas du monde. Il est là, comme l’écrit Yves Leclair dans la préface, pour dire « la vraie vie qui danse au milieu de notre tohu-bohu ». Oui, Nicolas Dieterlé est bien là « parmi les bris de la matière » mais le voilà, comme il le dit lui-même, saisi par « une force inouïe, mais légère, transparente, infiniment paisible ». Rêve ? Hallucination ? Transe ? Lecture mystique du monde à coup sûr à la manière d’Angelus Silesius, qu’il cite à propos de sa rose « sans pourquoi ». Cette rose, nous dit Dieterlé, est « semblable à un joyau enchâssé dans un écrin invisible (…) Sans pourquoi est le nom de cet écrin invisible ».
La parenté avec les romantiques allemands, à commencer par Novalis, saute également aux yeux quand il évoque « le royaume de la vraie ténébre » dans laquelle on pénètre à la perte d’un être aimé. « Au sommet de la douleur se disloquent et s’effacent les apparences grises, comme un écran crevé par des lances et se dispersant en lambeaux sur le sol ». Mais Nicolas Dieterlé met en garde : se méfier des « fausses ténèbres » et des « mornes apparences ». Devenir plutôt des « servants de la clarté » et ne pas s’abuser de mots : « Trop de mots sont des flammes éteintes, qu’il faut raviver. Poètes, raviveurs ! ».
L’occasion pour lui de définir – poétiquement – une poésie à son goût. Elle est, dit-il, « colonne qu’un feu très doux embrase à son sommet pour avertir et signaler ». Elle est « ruche et abeille inquiète ». Elle est « comme un puits au milieu d’un champ ». Et il ajoute avec des intonations qu’on connaissait chez Rilke et Max Jacob s’adressant à de jeunes poètes : « Il ne faut pas chercher à faire de la poésie. Tout le secret est là. Sois dans la poésie comme dans une eau et les bulles-poèmes s’arrondiront à la surface ».
Les bulles-poèmes de Nicolas Dieterlé sont bouillonnantes et éclatent à la surface des pages. Leur source est intarissable car, comme il le dit lui-même, « tout est un puits d’amour ».
Journal de Baden, Nicolas Dieterlé, préface de Yves Leclair, Arfuyen, 170 pages, 16 euros
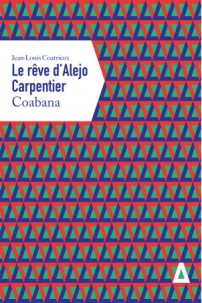 |
Jean-Louis Coatrieux, |
| Sur la piste d’Alejo Carpentier... |
|---|
Un essai et deux romans : le Rennais Jean-Louis Coatrieux – amoureux de l’Amérique latine et de sa littérature – n’a pas lésiné pour nous faire pénétrer dans l’univers du grand écrivain cubain Alejo Carpentier (1904-1980). Il était d’autant plus enclin à le faire qu’Alejo Carpentier avait une ascendance bretonne dont il se réclamait volontiers sans avoir jamais, pour autant, résidé dans notre région. « Alejo se tiendra à distance de la Bretagne, préférant sans doute rêver des prouesses de ses aïeuls », note Jean-Louis Coatrieux.v
Les racines bretonnes d’Alejo Carpentier (né à Lausanne d’un père architecte et d’une professeure de langues russe) remontent à cinq générations. Ses aïeuls, aimait à rappeler l’écrivain, faisaient partie d’une longue généalogie de marins bourlingueurs des côtes d’Afrique à la mer de Chine, de la Méditerranée aux Caraïbes et, selon l’époque, furent soldats du Roi, de l’Empire ou de la République. L’un d’entre eux, Jacques Etienne Lucas Carpentier (1764-1819) participa à la Guerre d’Indépendance américaine. Capitaine de vaisseau, il fut promu au commandement du Redoutable basé à Brest. C’est d’ailleurs à Brest qu’il décèdera. Il est enterré au cimetière Saint-Martin de la ville.
Au 20e siècle, c’est un Paul Carpentier, cousin d’Alejo, que l’on retrouve en Bretagne, précisément à Hennebont où il est chirurgien à l’hôpital (une rue de la ville morbihannaise portera son nom). Dans une lettre de 3 juin 1977 à son cousin écrivain (qui lui avait adressé un de ses livres) il lui dit espérer sa venue en Bretagne (« J’espère que quelques ailes vous pousseront jusqu’en Bretagne »). A noter, révèle Jean-Louis Coatrieux, que le grand-père de Paul Carpentier, Adolphe Carpentier, était abonné au journal autonomiste Breiz atao.
Alejo Carpentier, lui, vivait dans un autre univers, plutôt en rupture avec sa parentèle. « Ses engagements à gauche contre la dictature témoignaient contre lui dans la famille », raconte Jean-Louis Coatrieux. « Le choix de préférer Cuba envers et contre tout, y compris jusqu’à sa nationalité, ne facilitait pas les choses. Et surtout de prendre fait et cause pour les métèques, les métis, les criollos… » On sait que Alejo Carpentier se rangera du côté de la révolution cubaine. Fidel Castro lui-même assistera à ses obsèques à La Havane.
C’est cette vie d’écrivain bourlingueur, mais aussi de journaliste, musicologue, homme de radio et de cinéma, que Jean-Louis Coatrieux évoque aussi sur le mode romanesque. Un premier volume sous-titré Coabana (Cuba en langue arawak) nous parle ses premières années à Cuba durant la dictature Machado et comment il a finalement réussi à échapper à la prison. Il évoque aussi sa vie à Paris dans l’entre-deux guerres où il multiplie les rencontres avec tous ceux qui faisaient la vie artistique de l’époque, notamment les surréalistes (Breton, Eluard, Aragon…) et les peintres dont le breton de Locronan Yves Tanguy
Le deuxième volume évoque son exil volontaire au Vénézuela, avant la révolution castriste. Il y vivra de 1945 à 1959. Un séjour qui lui inspirera notamment son roman Le partage des eaux (1953). C’est aussi à cette période, en 1949, qu’est publié son premier grand roman, Le royaume de ce monde, où il évoque le mouvement révolutionnaire haïtien.
Fortement documenté, pétri de cette culture sud-américaine qu’il affectionne, Jean-Louis Coatrieux nous livre ici une vraie saga sur l’un des fleurons de la littérature sud-américaine. Alejo Carpentier, souligne-t-il, aurait bien pu, un jour, être nobélisé.
Alejo Carpentier, de la Bretagne à Cuba, Jean-Louis Coatrieux, éditions Apogée, 2017, 157 pages, 14 euros
Le rêve d’Alejo Carpentier, Coabana, Jean Louis Coatrieux, éditions Apogée, 2019, 20 euros.
Le rêve d’Alejo Carpentier, Orinoco, Jean-Louis Coatrieux, éditions Apogée, 2021, 295 pages, 20 euros
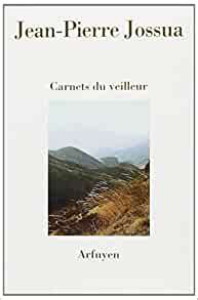 |
Jean-Pierre Jossua, |
| Carnets du veilleur |
|---|
Dans ses Carnets du veilleur publiés en 2006 aux éditions Arfuyen, il mêlait notations philosophiques ou théologiques et scènes saisies sur le vif dans sa thébaïde provençale. « Écrire#8239;», consistait pour lui à demeurer « ouvert à l’avenir de la vie qui s’offre encore à nous », sur cette ligne de crête personnelle qu’il appelait « la veille, la frontière ». Mais comme il l’expliquait lui-même, il avait osé dans ce livre une entreprise originale : « Tenter après l’écriture du présent (journaux) et celle du passé (autobiographie), une écriture de l’avenir », en étant attentif « à ce qui survient, inopiné, à ce qui surprend ». Et, aussi, en captant « ce qui s’annonce, ce qu’on espère, ce qui est promis ».
Les textes de ces Carnets du veilleur tentaient donc de répondre à cette ambition littéraire. « Renoncer au voyage pour apprendre le proche, écrivait Jean-Pierre Jossua, et se rendre digne d’y pressentir l’infini ». Ce qu’il faisait admirablement en côtoyant les hommes, les femmes et la nature éblouissante qui l’environnait.
C’est autour de son travail d’écrivain qu’avait été publié l’année précédente un riche petit livre sur le thème Création littéraire et recherche de l’absolu. On y trouvait les signatures des poètes Jean-Pierre Lemaire et Henri Bauchau et aussi celles de Claude Geffré, Michel Fédou et Jeanne-Marie Baude. Dans deux courts chapitres de ce livre, Jean-Pierre Jossua posait tout simplement la question : « qu’écrirai-je demain ? Qu’ai-je tenté hier ? »
« Toute avancée dans la vie et dans la foi est inséparable d’un travail d’écriture, écrivait-il. Il avait aussi ce terrible aveu : « Rarement ma foi a été aussi obscure qu’en ces temps-ci (…) Le désastre des vies, la violence et le non-sens apparent des événements me semble tels que, sans même évoquer ce que l’on met dans le mot de providence, il m’est difficile de penser à un Dieu créateur et aimant ». Jean-Pierre Jossua n’a jamais cessé, en effet, d’être cette pensée profondément habitée par la question de Dieu et l’énigme du mal. Et elle empruntait, pour le dire, les chemins de l’écriture poétique.
Carnets du veilleur, Jean-Pierre Jossua, Arfuyen, 2006, 130 pages, 14,50 euros.
Autour de Jean-Pierre Jossua, création littéraire et recherche de l’absolu, éditions facultés jésuites de Paris (35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris), 2005, 93 pages, 11 euros.
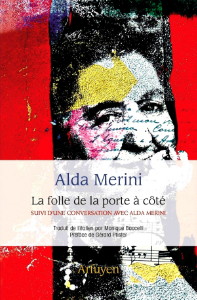 |
Alda Merini, |
| La folle de la porte à côté |
|---|
Vous avez dit folle ? « Je suis née le vingt-et-un du printemps / mais je ne savais pas que naître folle, / ouvrir les mottes, / pouvait déchaîner la tempête », écrit-elle. Mais surtout, plus loin, elle retourne malicieusement la question : « Je fais tout pour être semblable à la folle de la porte à côté, vu qu’elle est incohérente et folle, mais que tous l’admirent ». Sur l’hôpital psychiatrique (qui sera en réalité son seul foyer) elle tient un discours, lucide, que l’on n’attend pas forcément. « Asile est un mot bien plus grand / que les gouffres obscurs du rêve, / et pourtant quelquefois venait au temps, / un filament d’azur ou la chanson / lointaine d’un rossignol ou s’entrouvrait / ta bouche mordant dans l’azur / le mensonge féroce de la vie ».
Alda Merini a publié son premier livre, La presenza de Orfeo à 22 ans. Il est salué dès sa sortie par Pasolini lui-même. Son œuvre majeure, La terra santa, sortira en 1984. Mais sa vie d’écrivain restera chaotique. Elle recevra le prestigieux prix Librex Montale en 1993. Mais en 2004 la voilà de nouveau internée.
Entre-temps, elle aura mené une vie plutôt débridée, notamment sur le plan sexuel. Provocatrice, elle écrit : « Il n’y aucune différence entre moi et la dernière des prostituées du monde. Pourquoi suis-je dans un hôtel qui loue à l’heure, pourquoi ai-je besoin d’un logeur ? Parce que, moi aussi, je veux être louée, achetée, vendue, insultée ». L’éditeur peut donc parler, à propos de ce livre, d’une « autobiographie fantasmée et lucide, follement romanesque, et, en dépit de tout, profondément joyeuse ». D’ailleurs, Alda Merini le dit elle-même : « Celui qui m’a affublée de l’épithète un peu douloureuse de « poétesse de l’amour » s’est trompé. Je n’ai jamais été une femme d’amour et pas non plus une femme futile, mais une femme d’action qui n’a écrit sur l’amour que par nécessité, comme un cri de vengeance. Parce que l’amour incite à la vengeance ».
Dans les quatre chapitres de ce livre très particulier (prolongé par un entretien avec la poétesse elle-même), aux changements fréquents de ton et de rythme, Alda Merini évoque donc l’amour, mais aussi la famille, la douleur et, forcément, la séquestration. Elle s’interroge aussi à plusieurs reprises sur la poésie et la place des poètes. Sur ce sujet, elle a ces mots sublimes : « Chaque enfant a un terreau stable pour sa vie, mais le lieu où naît un poète, personne ne le sait. Dans quelle vallée de l’Éden il grandit, personne ne le sait. Le poète est un ange et il a des rotations angéliques, jamais il ne consulte les astres car le poète est un centre de vie, il connaît tous les astres du monde et toutes les lunes lui sont maléfiques ».
La folle de la porte à côté, Alda Merini, Arfuyen, 210 pages, 17 euros
 |
Julien Gracq, |
| Nœuds de vie |
|---|
« L’envie brusque m’a traversé, je ne sais pourquoi, d’être transporté aux pointes de Bretagne, dans le fleuve du vent acide, corrugant, qui décape les petites maisons blanches, sur la côte saliveuse et fouettée, vers la mer qui dans chaque échancrure grumelle et monte comme la neige des œufs battus. Là où les soleils du matin, que j’y ai adorés, sont plus neufs, plus blancs, plus crayeux qu’ailleurs ; au pays du monde rajeuni, parce qu’il semble sortir à chaque aube de l’écume ». Julien Gracq nous rappelle dans le premier chapitre du livre, intitulé « Chemins et rues », qu’il a bien connu la Bretagne quand, jeune enseignant agrégé de géographie, il enseignait, sous le nom de Louis Poirier, au lycée de La Tour d’Auvergne à Quimper. Il connut aussi Nantes où il fut lycéen et, plusieurs années après, c’est l’odeur des longues herbes de juin qui lui donne « le souvenir des promenades du lycée dans la banlieue nantaise ». C’est à Nantes aussi qu’il enseigna, plus tard, au lycée Clemenceau.
Gracq est un homme de l’Ouest mais il est, avant tout, Ligérien. Né en 1910 à Saint-Florent-le-Vieil entre Nantes et Angers, il ne manque pas ici d’évoquer à nouveau les liens qui l’unissent à ce terroir quand il nous parle, par exemple, d’un paysage d’hiver dans la vallée de la Loire inondée (« Une nappe d’eau rêche que la bise de Noël hérisse ») ou, plus prosaïquement, près de Saint-Florent, des « bonheurs domestiques tapis entre rosiers et haricots ». Plus loin, il déplore la déprise agricole sur les îles ou les bords de la Loire (« ce reflux de la colonisation d’une terre plantureuse »).
Mais ses pas l’amènent vite au-delà de son pré-carré. Le voici sur la côte du pays de Retz entre Saint-Michel et Pornic (loin de « la promiscuité débraillée et tapageuse des plages de Vendée »), dans la Gâtine tourangelle, en Sologne, sur les hauteurs d’Écouves avec ses « clairières sommeillantes de lune » et même dans le pays de René Guy Cadou sur l’autre bord de la Loire dont il souligne le manque de relief : « Peu de campagnes me paraissent aussi exilées, aussi pauvres de vie que celles qui forment la partie nord de la Loire-Atlantique ». Et il ajoute : « J’accepterais mal d’être contraint d’y vivre. Ce que je sens de pathétique dans la vie du poète René Guy Cadou tient en partie à ce qu’il a été enchaîné à ces lieux déshérités : Saint-Herblon, Louisfert ». Mais, ailleurs, dans ses notules, Gracq parle d’un autre Cadou, celui qui, comme lui, voyait de sa fenêtre « la grande ruée des terres jusqu’à l’horizon » (soulignons, pour mémoire, que Cadou meurt en 1951, l’année où Gracq refuse le Goncourt pour Le rivage des Syrtes).
Géographe jusqu’au bout des ongles, arpenteur de paysages, mais aussi géologue (des terroirs et des passions humaines), Julien Gracq sonde notre monde à l’aune des entreprises humaines. « La terreur des âges obscurs revient », affirme-t-il. Son verdict est implacable et fait de lui un visionnaire. « La terre a perdu sa solidité et son assise, cette colline, aujourd’hui, on peut la raser à volonté, ce fleuve l’assécher, ces nuages les dissoudre. Le moment approche où l’homme n’aura plus sérieusement en face de lui que lui-même, et plus qu’un monde entièrement refait de sa main à son idée – et je doute qu’à ce moment il puisse se réjouir pour jouir de son œuvre, et juger que cette œuvre était bonne ».
Julien Gracq écrit dans les années 1970 ces lignes qui prennent une résonance particulière près de cinquante ans après. Car ses notules aux allures de fragments ne sont pas datées mais quelques points de repères, de-ci de-là, aident à établir une vague chronologie. Gracq lui-même évoque les « étrangetés de ce dernier tiers de siècle auxquelles » il dit qu’il « s’habitue mal »
Ses appréhensions sur l’avenir de la terre se doublent d’une autre crainte : celle de voir s’effondrer le langage et la littérature elle-même. Car lire Julien Gracq, c’est bien sûr retrouver toute la saveur de la langue française avec une richesse de vocabulaire à faire pâlir les auteurs contemporains en vogue. Le lire, c’est plonger dans une époque qui paraît révolue, celle qui nous rattache aux grands écrivains dits « classiques ».
Autant dire qu’une forme de nostalgie imprègne ces écrits (dans les deux chapitres « Lire » et « Écrire »). « La richesse d’une langue se mesure, autant et plus qu’à l’étendue de son vocabulaire, à la qualité et à la densité de sa littérature ». Julien Gracq ne se prive pas d’épingler les tendances lourdes qui se font déjà jour à son époque quand il s’agit, par exemple, de commenter à l’école « Boris Vian, Charlie hebdo et les bandes dessinées ». Il se désole de la mise à l’écart du latin auquel on préfère l’anglais, « cet espéranto qui a réussi » et « chemin le plus court et le plus commode de la communication triviale ». Cela l’amène à ne pas se faire d’illusion sur la pérennité de son œuvre elle-même. « Je ne mets guère mon espoir, comme on pouvait le faire encore au siècle dernier, à être lu en l’an 2000 ou 2010. Mais quand la terre comptera vingt milliards d’hommes et se débattra et s’enfoncera comme un homme qui s’enlise dans la seule bouillie étouffante du social, je souhaite seulement que mes livres demeurent sur quelque rayon perdu… ».
On lit heureusement encore Julien Gracq. Il y a ses inconditionnels et ceux qui lui reprochent de ressasser le « c’était mieux avant ». Retenons, pour mettre tout le monde d’accord, la définition qu’il donne de l’écrivain et dont on peut dire qu’elle défie le temps : « L’écrivain digne de ce nom est une générosité toujours intempestive, une fraternité qui ne marche pas en rang, une aventure qui se passe du coude à coude, et une liberté qui n’adhère jamais ». Vivement 2027 pour la lire la suite…
Nœuds de vie, Julien Gracq, Éditions Corti, 167 pages, 18 euros
 |
Marie Sizun, |
| La maison de Bretagne |
|---|
Elle se distingue par sa discrétion et sa simplicité. Marie Sizun est pourtant une romancière confirmée, saluée par de nombreux prix. En 2018 elle a ainsi obtenu de prix de la Nouvelle de l’Académie française pour Vous n’avez pas vu Violette ? (Arléa). En 2017, c’était le prix Bretagne pour La gouvernante suédoise (Arléa). Au total aujourd’hui, à son actif, une douzaine de romans, pour la plupart déjà publiés en livres de poche. C’est dire sa notoriété et le capital de sympathie qu’elle a pu réunir autour de son œuvre.
La maison de Bretagne ravira, n’en doutons pas, ses lecteurs. Elle les embarque – sur la durée d’une semaine – dans les pas de Claire Werner (49 ans, Parisienne, employée chez Axa assurances) qui vient sur l’Île pour vendre cette maison de vacances que sa famille appelait « la maison de Bretagne ». Trois générations y ont passé des vacances ou des périodes plus ou moins longues, depuis la grand-mère Berthe jusqu’aux petits-enfants Claire et Armelle en passant par Anne-Marie et Albert, les parents (séparés) de l’héroïne du livre.
Mais ce retour dans « la maison de Bretagne » ne se passera pas comme prévu. Une découverte macabre dans l’une des pièces puis des relations de voisinage entretenues par Claire au cours de la semaine la conduiront à revoir ses plans. Car ce retour dans l’Île sera, avant tout, l’occasion de révéler au grand jour certains secrets de famille autour du personnage central, la mère de Claire.
La quête d’une mère est en effet au cœur de ce roman. Mais elle se fait par le truchement de la re-découverte d’une maison dont la romancière nous fait visiter les moindres recoins (avec tous les mystères qui l’environnent). « Cette maison bizarre, pas comme les autres, pas soignée. Pas belle. Différente des villas voisine ». Sur le toit de cette maison tambourinent des pluies têtues. Sur ses vitres cognent les vents hurleurs de l’Île. Le tout enveloppé par une forte odeur d’algues et par la rumeur de l’océan avant que, brusquement, un grand calme ne s’installe.
Marie Sizun nous révèle par ces multiples notations sa fine connaissance de l’Île. Aussi bien côté mer que côté rivière. Elle nous glisse dans des petites ruelles puis on s’installe avec elle à la terrasse de l’hôtel donnant sur le port. Des lieux précis sont nommés, ce qui ravira les amoureux – ils sont nombreux – de cette Île. « J’ai claqué la porte de la maison derrière moi, raconte Claire, la narratrice. Le boulevard de l’Océan était vide à cette heure matinale. J’ai traversé la rue, descendu les quelques marches de pierre. La plage s’étendait là, inchangée. Loin du monde. Et c’était déjà comme une respiration. La marée était très basse. Le sable humide et plat étincelait. Au loin, cet éblouissement vert, rectiligne, c’était la mer ». Oui, laissons-nous aussi éblouir par l’écriture limpide de nouveau roman de Marie Sizun.
La maison de Bretagne, Marie Sizun, Arléa, 257 pages, 20 euros.
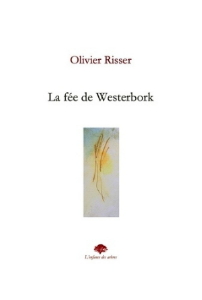 |
Olivier Risser, |
| La fée de Westerbork |
|---|
Comment parler de la Shoah à de jeunes lecteurs ? Le cinéaste italien Roberto Benigni y est parvenu merveilleusement en 1997 dans son film La vie est belle en tournant en dérision – sur un mode ludique – la vie dans un camp de concentration. Le père fait croire à son fils que les occupations dans le camp sont en réalité un jeu dont le but est de gagner un char d’assaut. Pour gagner ce char, le père lui explique qu’il faut accomplir des tâches difficiles. La farce tragique tourne au burlesque. Olivier Risser, lui, a choisi un autre registre: celui du conte.
Mais, d’abord, les faits (puisque tous les contes, n’est-ce pas, ont un fond de vérité). Etty Hillesum est cette jeune Hollandaise, née en 1914, qui au moment de la mise en vigueur des lois anti-juives aux Pays-Bas, demande de pouvoir travailler au service des personnes placées en transit au camp de Westerbork. C’est se jeter sciemment, en quelque sorte, dans la gueule du loup. La jeune Etty effectuera quatre séjours dans ce camp avant d’être embarquée le 7 septembre 1943 sur un train pour Auschwitz où elle mourra le 30 novembre 1943. Elle avait 29 ans.
Son dévouement et son profond amour des autres ont fait d’elle une figure éminente de l’amour fraternel et de la quête de lumière dans les plus profondes ténèbres. C’est ce que raconte, à sa manière, Olivier Risser en s’appuyant sur des lettres ou des extraits du journal d’Etty Hillesum mais aussi de celui de Philip Mecanicus, un journaliste codétenu avec lequel elle se lia d’amitié. « Si on voulait donner une idée de la vie dans ce camp, le mieux serait de le faire sous la forme de conte ». C’est Etty Hillesum qui l’a elle-même écrit et le romancier l’a pris au mot pour « conter l’histoire horrifique et pourtant véridique de la fée de Westerbork ». Car, ajoute Olivier Risser, « d’ici peu, fées et histoires auront disparu de presque toutes les mémoires ».
Dans ce camp où « la nuit enveloppe les âmes », il y a la figure du mal représentée par « un chef terriblement méchant, le commandant Tür ». C’est le loup du conte de fée, face à qui les enfants ne pèsent pas lourd, à commencer par Sacha, « un petit garçon à qui il manquait une jambe » mais sur qui veillera, à la manière d’un ange gardien, la fée de Werterbork. « La fée connaissait tous les recoins du camp où Sacha et ses compagnons se trouvaient enfermés. Elle survolait chaque jour l’amas de baraques disposées en lignes, pour ainsi dire collées les unes aux autres. Elle visitait les détenus. Les malades surtout. Elle cherchait sans cesse à réconforter les malheureux autant qu’il était en son pouvoir. On attendait sa venue car elle apportait, on ne savait de quelle nature, une certaine goutte d’espérance
Mais cette histoire de fée – une fois n’est pas coutume – se termine mal. « Oui tous les gens montés dans le train vont être assassinés en un lieu d’atrocités, oui avant ils vont beaucoup pleurer, oui ce sera cruel et injuste ». Oui, mais « il s’est passé quelque chose comme dans tous les contes, explique l’auteur, et ce quelque chose a eu lieu à plusieurs reprises sans que tu le remarques nécessairement. L’amour, de sa fine lumière, a réussi à pénétrer l’obscurité et à y laisser sa trace ».
Olivier Risser (qui est professeur de français en collège à Josselin) signe là un roman sur l’amour triomphant de de la mort. Et, au-delà des écrits d’Etty Hillesum, figure de référence aujourd’hui pour des femmes et des hommes de plus en plus nombreux, il nous guide, au fil des pages, vers les Épîtres de saint Paul, les Psaumes, le Livre de Job ou encore les écrits de Simone Weil. Un livre pluriel sur la compassion et le don de soi.
La fée de Westerbork, Olivier Risser, peintures d’Anne Courtine, L’enfance des arbres, 150 pages, 15 euros.
Lectures de 2020
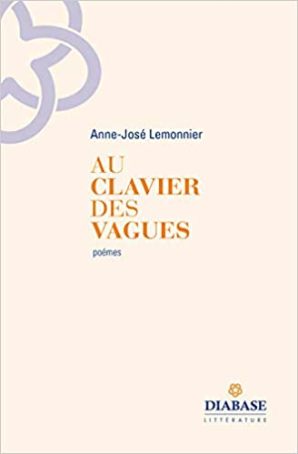 |
Anne-José Lemonnier, |
| Au clavier des vagues |
|---|
Le nouveau recueil de Anne-José Lemonnier est une variation en bleu. Après sa belle méditation contenue dans Polyphonie des saisons (éditions Diabase, 2018) autour de la figure d’une grand-mère aimée, la voici de nouveau face à l’immense : un océan qui lui donne le sentiment de vivre, chaque jour, un matin du monde.
La parole d’Anne-José Lemonnier est rare. Son précédent recueil de poésie (Archives de neige, éditions Rougerie) date de 2007. On accueille donc avec d’autant plus de curiosité et de sympathie ce qu’elle a à nous dire sur son propre univers (« Ame ravitaillée / à la table de la beauté »). Car nous sommes, ici, en permanence, dans l’exercice de contemplation scrupuleusement arrimé au passage des saisons. La poétesse sculpte avec des mots toutes les variations saisonnières qu’elle saisit sur la baie au bord de laquelle elle vit. Nous sommes en presqu’île de Crozon, au bout du bout du Finistère, et quelques lieux surgissent au détour des pages : Pentrez, plage de Goulien, Cap de la chèvre, pointe de Dinan, Les Tas de pois…
Si elle sculpte ses phrases, Anne-José Lemonnier leur donne aussi une couleur. À la manière des peintres, elle rehausse le tableau en jouant sur le bleu. Car de même qu’il y a le bleu de Delft ou le bleu de l’artiste Geneviève Asse (dont elle parle à la fin de son livre), il pourrait y avoir, au niveau de son écriture, la révélation d’un bleu particulier: le « bleu réfléchi des anses », le « bleu serein » de la baie, « le bleu translucide ». Et même, sous sa plume, « les chats ont les yeux bleus / pour voir au diapason du ciel et de la mer ». Bleu encore, celui des jacinthes du jardin. Et quand vient l’hiver, « le gel arrime / le bleu / à sa pureté / originelle ».
C’est ce bleu qui lie la poète à une nature dont elle s’abreuve quotidiennement. Nature familière, nature complice, nature consanguine. La voilà, en effet, le printemps venu, qui s’en va « demander / à chaque lieu aimé / comment il a vécu l’hiver / aux hordes sauvages de vent ». Et pour mieux souligner l’amplitude de ces lieux qu’elle arpente fidèlement, elle a ces mots : « Entre le quotidien et l’infini / il y a du bleu et rien d’autre / myosotis et atlantique ».
Face à la mer, saisie par l’amplitude des lieux, Anne-José Lemonnier nous parle d’une « pureté de Genèse », « d’accents bleus et blancs de résurrection », de « quatrain de lumière ». Elle nous laisse entrevoir un paradis dont il importe, comme le disait le poète Novalis, de « réunir les traits épars ».
Au clavier des vagues, Anne-José Lemonnier, Édition Diabase, 2020, 92 pages, 12 euros
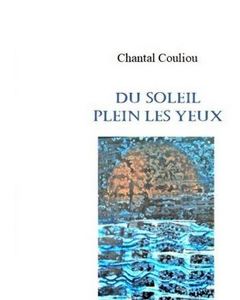 |
Chantal Couliou, |
| Du soleil plein les yeux |
|---|
« Au papillon je propose / d’être mon compagnon /de voyage ». En introduisant son recueil par ce haïku du Japonais Shiki, la Brestoise Chantal Couliou nous entraîne dans son propre voyage au cœur d’un périmètre finistérien balisé par quelques lieux emblématiques comme les Monts d’Arrée ou le phare du Créac’h. L’essentiel, pourtant, n’est pas le lieu (dans sa précision géographique) mais plutôt l’ambiance ou l’atmosphère d’un territoire que la poétesse habite assidûment dans la traversée des saisons et dont les principaux points de repère sont l’école, le jardin public, le pont et le port, la plage et la dune… Autant de matières premières pour haïku, un genre poétique que Chantal Couliou pratique fidèlement depuis des années. « Rentrée des classes / les mots sur le tableau / effacés par le soleil ».
C’est la professeure des écoles – qu’elle est dans le civil – qui nous livre ici concrètement son vécu à travers ces quelques notations elliptiques qui font le charme du haïku. « Dans la cour d’école / un moineau esseulé - / marelle sous la neige ». Oui, la neige est là en hiver, si rare pourtant dans le Nord-Finistère, mais dont la rareté même fait tout son prix quand on est haïjin : « Ipod aux oreilles / le joggeur en short / sous l’averse de neige ». Ou encore ceci : « Dans la boîte à lettres / quelques catalogues de Blanc / recouverts de neige ».
Passé l’hiver avec ses brumes, sa pluie et ses « rafales de vent » comme il sied à la ville de Brest, voici le printemps et « les frissons des jonquilles », « l’insolence des camélias » ou encore « la marée jaune » des champs de colza. Mais le vent est toujours là qui « retourne les parapluies ». À lire Chantal Couliou on a la sensation – et c’est heureux – de saisons toujours bien tranchées, en dépit des changements climatiques qui font aujourd’hui fleurir les camélias de printemps à la fin de l’automne.
L’été peut arriver dans son « odeur de grillades » même si dans les jardins « le fouet de la pluie » peut toujours faire son œuvre. Et quand ses pas l’amènent sur la côte, Chantal Couliou s’interroge : « Sur la dune / une multitude de petits chemins / lequel choisir ? » Une autre fois, partie sur la grande île voisine qu’on devine être Ouessant, elle s’amuse en écrivant : « Sur l’île, noirs ou blancs / compter les moutons - / un bon somnifère ».
Ainsi va la vie sous les cieux capricieux du Ponant. Chantal Couliou en est le témoin attentif, toujours en état de veille comme elle l’est aussi auprès des êtres chers : « Ma mère /comme les feuilles mortes - / poumon en berne ».
Du soleil plein les yeux, Chantal Couliou, éditions Unicité, 87 pages, 13 euros
 |
Ève Lerner, |
| Le chaos reste confiant |
|---|
« Nous sommes voués au chaos. Celui dont nous venons et celui que nous fabriquons ». La poétesse lorientaise ne cache pas qu’elle a surgi, elle-même, d’une forme de chaos : celui de la famille et de ses violences, prolongé par « le chaos de l’amour ». Mais le propos de son livre-brûlot est de pointer, avant tout, le chaos mondialisé. « Il se dégage du monde des odeurs de plus en plus insupportables, écrit-elle, ça sent l’abattoir ».
La liste est longue : guerres, massacres, viols, destruction de la nature… « On tire sur les Casques blancs, les hôpitaux, les écoles » (…) « Il y a des enfants-soldats dès 8 ans, il y a des filles mariées à 9 ans ». Elle ajoute : « Sur terre, prolifération des armes, dans les corps prolifération des cellules ». Une métastase qui lui fait dire que « le monde s’est délité ». La preuve ? « Les croyants n’adhèrent plus à leur foi, les cultures n’adhèrent plus aux sols, les paroles n’adhèrent plus aux actes ».
Comment ne pas penser ici au poète Armand Robin dénonçant « la fausse parole », quand Ève Lerner écrit précisément : « Le chaos construit les fausses valeurs et la fausse parole ». Elle cible donc tous les mensonges et leurs « ramifications délétères » mettant à jour le véritable drame qui se noue : « Ce qui s’éteint : la flamme de la petite bougie sur la barque de papier, les esprits hors-normes ou juste les esprits curieux. Ce qui se trame : l’obsolescence programmée des plus belles formes d’art et de pensée. Au grand jour – mais personne ne le voit – la défaite définitive d’une planète bleue » (à coup sûr celle de Paul Éluard qui était, comme on le sait, « bleue comme une orange »).
On pourrait s’arrêter à ce constat terrifiant. Mais se pose la question de la riposte, individuelle ou collective. La première tentation est de prendre le maquis, « se terrer dans le silence au fond du jardin, mais surviennent les tondeuses ». Ève Lerne croit à la « rébellion de l’écriture ». Elle propose de « gonfler le dard du poème, piquer le tyran au vif, faire flèche de tous mots ». Elle n’est pas loin de penser comme Jean-Pierre Siméon que La poésie sauvera le monde (Le Passeur, 2016.). Car, dit-elle, « le poème est un aiguillon, un éperon ». Il est là pour « inventer un réel, inédit, inconnu, à venir ».
Ce brûlot poétique a été écrit avant l’apparition de la pandémie. Dans la postface de son livre, Ève Lerner prédit de nouveaux « chaos exceptionnels » liés à cette pandémie. Ce qui lui fait dire que « le chaos reste confiant ». Car « rien ne peut venir nous assurer que cette crise majeure va changer les manières de vivre et de faire ». Tout l’indique en effet.
Le chaos reste confiant, Ève Lerner, Éditions Diabase, 2020, 102 pages, 12 euros.
 |
Roland Halbert, |
| Le cantique de Caravage |
|---|
Étonnant Roland Halbert ! Le poète nantais a l’art de nous entraîner, avec ses textes, sur des chemins inattendus, à la découverte de trésors de l’art ou de la musique. Voici qu’aujourd’hui il réserve un sort à Michel-Ange Merisi dit Le Caravage ou Caravage (1571-1610), peintre lombard dont « les toiles parlent le suggestif patois des couleurs et de l’équivoque des signes ».
Roland Halbert n’a pas lésiné sur les moyens. Il a consacré cinq années, entre 2010 et 2015, à l’élaboration de cet imposant livre/album sur Caravage, prenant le soin d’aller lui-même à Rome, à Naples, à Paris, sur les traces du grand maître italien. Son livre s’articule autour de 13 tableaux de Caravage dont il fait une approche poétique en treize « chants » (Halbert fait danser les mots sur la page et prend plaisir à y glisser parfois des notes de musique). Ces chants sont accompagnés d’un « carnet romain », journal de ses lectures et de ses visites in situ.
Caravage, affirme le poète, est « le peintre de l’ENTRE : entre la nuit et le jour, entre la rue et la légende dorée, entre le profane et le sacré ». On découvre, en effet, treize tableaux à consonance biblique (ou pour le moins religieuse) dans lesquels vibre souvent une forte sensualité. Il n’est pas surprenant, à cet égard, que Roland Halbert cite en exergue ces mots de Nikos Kazantzaki : « Je rassemble mes outils : la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat, le toucher, l’esprit ».Ce qui vaut pour Caravage vaut pour le poète nantais qui est, avant tout, ce poète des cinq sens qui a trouvé dans le haïku un art poétique à sa convenance. Il en sème plusieurs à l’intérieur de ce livre, dont certains à connotation érotique : « Voisine coquine, / viens vite au verger./ - Un abricot brille ». Ce haïku accompagne « La corbeille de fruits » de Caravage.
Les tableaux du maître lombard sont en effet l’occasion (le prétexte ?) pour le poète de parler de lui et de son propre univers. Son livre, comme il le confie lui-même, est un livre à lire « entre les lignes ». Contemplant le « Saint Jérôme écrivant » de Caravage, il écrit :« Mon encrier est un puits noir / de voix soufflées/au creux des veilles ». Ou encore :« Mais comment pourrais-je vieillir / quand il me reste tant de livres à lire ». Commentant « Saint François recevant les stigmates », il a ce haïku :« Me reconnaissez-vous / couché à la renverse / plus léger qu’un herbier de simples ». À la vue de l’ange musicien dans le tableau « Repos pendant la fuite en Égypte », ces mots lui viennent : « La musique me tient / – matin et soir ensemble – / les yeux grands ouverts / en une veille éternelle ». Devant « Jeune saint Jean-Baptiste au bélier », il fait cet aveu :« Je prends soin de m’écarter / des itinéraires recommandés / pour m’engager seul / sur le sentier des chèvres ». Et quand il s’agit d’approcher poétiquement « L’autoportrait en Bacchus malade », c’est un autre autoportrait qui se lit entre les lignes, celui du Halbert hospitalisé (déjà présent dans L’été en morceaux, en 2018) : « Pas la grande forme ! / Je me tiens au bord du monde en ruine / et de sa morne infirmerie ».
Ce livre ravira ceux qui aiment cette poésie-là mais aussi toux ceux qui veulent en savoir plus sur Caravage. Roland Halbert multiplie en effet les investigations et traque, dans les musées ou les lieux inspirés, la trace de ce peintre novateur (malgré le « classicisme » apparent de ses tableaux). On prend aussi beaucoup de plaisir à découvrir Rome sous un jour inattendu quand le poète nous parle de ses déambulations, de sa quête, de ses rencontres :avec la jeune prostituée Marta ou avec la mendiante du Latran. « Elle est là, sans âge, avec sa bosse monstrueuse et son bâton de bois (…) Pas un regard pour la pauvresse ! À quelques pas, la statue de François d’Assise ».
Le livre s’achève par l’étonnante rencontre avec un graffeur romain qui avait « détourné » une affiche de Ernest Pignon-Ernest montrant Pasolini tenant le cadavre de Pier Paolo. Et soudain affleure l’idée que les Caravage d’aujourd’hui créent des œuvres éphémères sur les murs avec, parfois, des bombes aérosols dans leurs mains.
Le cantique de Caravage ou la seule gloire de la couleur, Roland Halbert, éditions FRAction, 160 pages, 25 euros.Roland Halbert publie parallèlement Du fruit défendu (25 haïkus), un tiré à part extrait de l’ouvrage sur Caravage auquel ont été ajoutés huit haïkus, éditions FRAction, 39 pages, 15 euros.
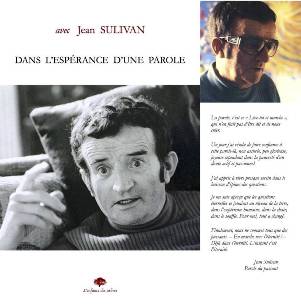 |
Jean Lavoué, |
| Dans l'espérance d'une parole, avec Jean Sulivan |
|---|
Jean Sulivan nous revient. Mais nous a-t-il vraiment quittés ? Quarante ans après sa disparition accidentelle en région parisienne, voici rassemblés dans un livre conçu par l’écrivain et éditeur breton Jean Lavoué de très nombreux témoignages sur la vie et l’œuvre de ce prêtre rennais, écrivain fécond et « électron libre » de l’Église catholique.
Comment résumer l’œuvre de Jean Sulivan ? Sans doute dire, avant tout, qu’elle porte la signature d’un homme prônant la liberté intérieure loin des dogmes et des postures convenues. Né Jean Lemarchand en 1913 à Montauban-de-Bretagne dans une famille d’exploitants agricoles, il a débuté, devenu prêtre, comme aumônier des étudiants à Rennes avant de devenir enseignant au lycée Saint-Vincent. Parallèlement, il s’est fait une belle réputation dans la capitale bretonne en lançant un ciné-club (La Chambre noire) au cinéma Arvor ainsi qu’un journal mensuel « Dialogues ouest ». Puis, c’est la rupture. En 1958, à 45 ans, il quitte sa région natale, prend la direction de Paris pour se consacrer à l’écriture. Un véritable « exode » qui l’amène à privilégier une vie dans les « marges » en s’arrachant, comme le dit Jean Lavoué, « au confort d’une culture millénaire dans laquelle se trouvait enfoui, comme dans un tombeau, le germe immémorial ».
Installé à Paris, tout en fréquentant ceux que la vie a mis dans les marges, il écrira des livres (essais, romans, bloc-notes…) qui feront mouche très vite et ne laisseront pas insensibles les plus grands critiques de l’époque, notamment ceux du journal Le Monde. « Son œuvre met en évidence l’imprévisible liberté, rend à l’homme la possibilité de se rénover », écrivait Jacqueline Piatier. « Jean Sulivan se jette simplement dans ce qui vient de son instinct et de son cœur : une adhésion joyeuse à la vie, un élan d’amitié devant les êtres et les choses », notait pour sa part Pierre-Henri Simon.
Cette pensée féconde méritait des jardiniers pour l’entretenir. Pour les trente ans de la disparition de Sulivan, Joseph Thomas (parmi d’autres) a été de ceux-là en étant la cheville-ouvrière d’un colloque organisé à Ploërmel autour de l’œuvre de Jean Sulivan. Dix ans plus tard, Jean Lavoué prend en quelque sorte le relais en publiant cette somme sur l’œuvre du prêtre « rebelle ». On y trouve les témoignages d’hommes et des femmes (écrivains, journalistes, acteurs de terrain, chrétiens en marge…) qui ont été, à un moment de leur vie, réveillés et interpellés par la parole de Sulivan.
L’écrivain Colette Nys-Mazure en fait partie. « Toujours l’incertitude, écrit-elle à propos de Sulivan, le refus de conviction avérée mais un engagement indéniable et jamais renié. Tandis que le prophète stigmatise les tares de notre société y compris d’une certaine Église institutionnelle, le poète du quotidien nous ramène à l’ici maintenant. Pour le marcheur dans la ville et dans l’univers, rien n’est insignifiant ». De son côté, l’essayiste et philosophe Guy Coq souligne que « par rapport à la foi et à l’Église, Jean Sulivan reprend toujours la question : comment une parole de foi peut-elle devenir audible dans notre société sécularisée sans tomber dans l’insignifiance ? »
Cet ouvrage qui aborde, grâce à la diversité de ses signatures, toutes les facettes de l’œuvre de Sulivan, nous livre aussi quelques bribes d’une intervention que l’écrivain-prêtre avait faite au centre de la Briantais près de Saint-Malo à la Pentecôte 1979. Ses mots nous reviennent par le truchement de notes prises sur place par Yolande Barbedette. « Si les hommes de ce temps sont étrangers au christianisme, déclarait Jean Sulivan, c’est parce que les hommes ont perdu leurs racines, parce qu’ils ont perdu leur terre intérieure. Tant qu’un homme n’habite pas sa terre intérieure, tant qu’il n’est pas accordé à son unité profonde, il ne peut entendre l’Évangile ». Paroles de prophète qui n’avait pas encore assisté à la désagrégation complète du christianisme paroissial, notamment en Bretagne, mais qui appelait déjà à construire l’avenir sur de nouvelles bases.
Dans l’espérance d’une parole, avec Jean Sulivan, éditions L’enfance des arbres, 378 pages, 20 euros. En ces temps de confinement, le livre peut être commandé directement aux Éditions L’Enfance des arbres, 3, place vieille ville, 56 700 Hennebont (3,50 euros de port)
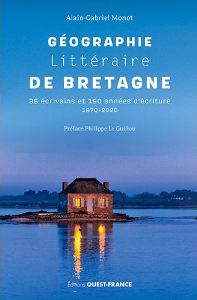 |
Alain-Gabriel Monot, |
| Géographie littéraire de la Bretagne |
|---|
Aborder la littérature bretonne par le biais de l’ancrage local des auteurs, c’est le pari de l’universitaire brestois Alain-Gabriel Monot dans un livre où il nous propose 35 portraits d’écrivains (prosateurs et/ou poètes, Loire-Atlantique comprise) sur une période allant de 1870 à 2020. L’auteur mêle ses analyses personnelles à des extraits de livres ou d’entretiens qu’il a pu avoir avec certains de ces écrivains.
Jean Guéhenno à Fougères, Xavier Grall à Pont-Aven, Pierre-Jakes Hélias à Pouldreuzic, Gilles Baudry à Landévennec, Paul Guimard à Doëlan, Yves Elléouët à La Roche-Maurice, Gérard Le Gouic à Quimper, Michel Le Bris à Saint-Malo, Yvon Le Men à Lannion… Voici donc, sous la plume de Alain-Gabriel Monot, une approche « territoriale » de la littérature bretonne des 150 dernières années. Il le fait avec beaucoup de bonheur et certains de ses portraits d’auteurs rattachés à un lieu donné sont particulièrement bien sentis. On pense notamment à ce qu’il dit de Philippe Le Guillou le long de la rivière du Faou ou encore de Yann Queffélec dans son territoire d’enfance de l’Aber-Ildut.
« Les écrivains bretons, ou intimement liés à la Bretagne, ont cette qualité première et distinctive que leur œuvre s’enracine profondément dans leur terre qui, certes, est un territoire qu’ils parcourent, déchiffrent et ne cessent de célébrer, mais bien plus, une sorte d’espace imaginaire qui se donne comme le substrat fondateur de leur travail », note Philippe Le Guillou lui-même dans la préface du livre. Ce qui ne fait pas donc pas de ces auteurs, ici triés sur le volet, des écrivains « du terroir » ou « régionalistes ». Voilà, au contraire, des auteurs à la fois enracinés et ouverts. Ce qui, on le sait, est la marque d’un grand écrivain. Alain-Gabriel Monot dit ainsi de Bernard Berrou (Penmarc’h) qu’il « aime tant son pays de Bretagne qu’il a un constant besoin de s’en arracher » et qu’il « va toujours vers l’Ouest irlandais, dans le comté de Clare, dans le Burren ».
Mais cet exercice de géographie littéraire suppose à coup sûr du doigté. Quels auteurs retenir ? Qui mettre aujourd’hui dans le panthéon littéraire breton ? Charles Le Quintrec l’avait déjà fait à sa manière dans son livre Littératures de Bretagne (éditions Ouest-France, 1992) et, bien avant lui, Philippe Durand dans Le livre d’or de la Bretagne (Seghers, 1975). Alain-Gabriel Monot, lui-même, avait fait une première approche en présentant 72 écrivains dans son livre Proses de Bretagne (La Part Commune, 2006). Mais, depuis, l’eau a coulé sous les ponts de Bretagne et de nouveaux auteurs ont émergé, dont il nous entretient, sans oublier de dresser le portrait des incontournables Tristan Corbière, Louis Guilloux, Guillevic, Henri Queffélec, Armand Robin, Hélène et René Guy Cadou, Georges Perros…
Pour les auteurs vivants ou récemment disparus, le choix était forcément plus délicat. Affaire de feeling et d’empathie pour tel ou tel parcours d’écriture. Alain-Gabriel Monot confirme ici, par exemple, l’enthousiasme que lui suscite (à juste titre) l’œuvre méconnue de la discrète poète Émilienne Kerhoas (Landerneau) dont il souligne « l’élégance feutrée » et « l’humanité lumineuse ». Même enthousiasme pour le poète/barde Louis Bertholom (Fouesnant) qui « embrasse le spectacle du monde, sa composition complexe, l’inouï du ciel et de la mer, les hauts nuages plombés ».
On notera malgré tout que, si l’on s’en tient strictement à la géographie, les auteurs ayant un ancrage finistérien y ont la part belle (près de la moitié des auteurs présentés). Ce qui amène à rappeler le caractère forcement subjectif d’une telle entreprise éditoriale. « Nous souhaitons que ces portraits ne soient pas clos, précise d’ailleurs Alain-Gabriel Monot, qu’ils laissent plutôt la porte ouverte à des ajouts, des retraits, des modifications toujours possibles, toujours souhaitables ». Dont acte.
Géographie littéraire de la Bretagne, Alain-Gabriel Monot, préface de Philippe Le Guillou, éditions Ouest-France, 254 pages, 18 euros
 |
Marie-Josée Christien et Yann Champeau, |
| Constante de l’arbre, poésie et photographies |
|---|
L’arbre est dans le vent. On l’enlace, c’est bon pour la santé. On fait une marche en forêt et tout va pour le mieux. Mais le poète – et pas seulement les thérapeutes – a aussi son mot à dire ainsi que le photographe. Le livre à quatre mains de Marie-Josée Christien et de Yann Champeau élargit en effet le champ des possibles.
« Constante de l’arbre », titrent les deux auteurs. Mais qu’est-ce-à dire ? Un détour par le dictionnaire n’est pas superflu. « Constante, n.f. Tendance, orientation générale. Donnée dont la nature et la valeur sont déterminés. Caractéristique physique qui assure la cohésion des atomes et des molécules ». Passé cette définition un tantinet scientifique, on entre de plain-pied dans le regard des deux créateurs. Pour la page de droite, le photographe. Pour la page de gauche, le poète.
Yann Champeau nous convie ici à un bel exercice de contemplation. L’arbre y est magnifié et présenté, dans le chatoiement des saisons, sous toutes ses couleurs et toutes ses coutures (branche, racine, feuille, tronc…). On reste ébahi devant tant de beauté saisie avec bonheur par l’artiste : l’arbre et ses frondaisons d’automne, l’arbre sous la neige, l’arbre séculaire, l’arbre illuminé par un soleil couchant, l’arbre dans le chaos des rochers, l’arbre enraciné, l’arbre et l’arc-en-ciel, l’arbre et la pomme… Et, au bout du compte, un arbre qui semble bien être un compagnon de route. Les saisons de l’arbre sont aussi nos saisons du cœur et de nos états d’âme, partagés entre ombre et lumière, semblent nous dire ces photographies.
Pour « faire route » avec ces arbres-là, on ne pouvait concevoir que des mots à la frontière de la poésie et de l’aphorisme. Des mots marqués, forcément, du sceau de la méditation voire de l’interrogation métaphysique. « À quel moment un arbre / quelconque/devient-il / dans nos pensées / l’arbre ? ». Marie-Josée Christien sait manier avec bonheur cette forme d’expression poétique. « Passager immobile / l’arbre n’a que le vent / pour envisager / ses destinées lointaines ».
La poète rassemble ici des textes sur l’arbre disséminés dans des recueils qu’elle a publiés entre 1982 et 2011 (Les extraits du temps, Aspects du canal, Conversation de l’arbre et du vent…). Elle y ajoute un « bonus inédit » marqué, comme ses autres courts poèmes, par une sobriété de bel aloi. « Dans le givre du matin / l’arbre somnolent / revient à la léthargie / du lierre // Il rend visible / la patience du monde / des racines ». Un très beau livre.
Constante de l’arbre, Marie-Josée Christien – Photographies de Yann Champeau, Editeur, 76 pages, 23,50 euros
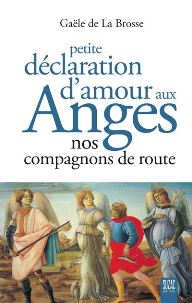 |
Gaële de La Brosse, |
| Petite déclaration d’amour aux anges... |
|---|
Elle croit aux anges et leur fait une vraie déclaration d’amour. La Bretonne Gaële de La Brosse, connue notamment pour ses écrits sur le Tro Breiz et les pèlerinages, nous entraîne entre Ciel et Terre à la découverte de ces « messagers » qui apportent, dit-elle, « une touche de poésie céleste dans notre monde trop cartésien ».
Croire en l’existence des anges. Ou, pour le moins en parler comme s’ils existaient. Est-ce bien raisonnable ? Et pourtant, ils sont nombreux tous ces artistes, écrivains ou poètes qui ont parlé des anges dans leurs œuvres, de Rilke à Dali en passant par Alfred de Vigny et Jean Cocteau. De tous ces auteurs, Gaële de La Brosse en parle dans le petit livre très documenté qu’elle publie aujourd’hui. Car il y a, ici, à la fois le regard d’une chrétienne sur les anges auxquels elle croit et celui d’une véritable entomologiste d’existences qualifiées de surnaturelles (échappant donc à la raison).
Gaële de La Brosse nous dit tout des anges, des archanges, des séraphins ou des chérubins (car il y a une hiérarchie céleste comme dans la vie terrestre). Elle évoque saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël, les plus célèbres d’entre eux. Selon elle, les anges sont des « médiateurs ». Elle parle même de « chargés de mission ». En clair, ils forment « un trait d’union entre le Ciel et la Terre, entre la matière humaine et l’esprit divin ». Mieux : les anges nous protègent. Ce sont nos fameux anges gardiens. Mais tout le monde en a-t-il un ? La théologie dogmatique a tranché, souligne l’autrice, affirmant que « à chaque fidèle de l’Église, un ange gardien est attaché depuis son baptême. Et on admet généralement que les infidèles ont un ange attaché à eux à la naissance ».
Pour autant, Gaële de La Brosse est bien loin, ici, de faire œuvre de prosélyte ou de dévote. Elle a assez de recul pour parler des anges dans un langage qui peut convenir à tous. En quelque sorte, elle « dépoussière » l’angélo-historiographie. Et surtout elle ne manque pas de rappeler, dogme ou pas, que les anges nous environnent (qu’on le veuille ou non). Toutes les expressions courantes qui donnent aux anges une certaine visibilité sont là, dit-elle, pour le prouver : « Être aux anges », « Un ange passe », « une visage d’ange », et, bien entendu, « le sexe des anges » car cela mérite aussi qu’on s’y attarde.
En signant ce livre, Gaële de La Brosse veut surtout souligner que les anges sont des « compagnons de route », des « guides », des émissaires venus de l’au-delà. « Le chant des anges (…) n’est-il pas cette musique intérieure ? », interroge-t-elle dans cette très belle formule. Profondément attachée à sa Bretagne natale, elle truffe son essai d’allusions aux anges qui font corps avec notre pays : l’ange trompettiste de l’église de Loperhet, les anges de l’église de Landerneau poussant de leurs ailes vers l’Armorique l’embarcation de saint Houardon venant d’Outre-Manche, l’ange sculpté sur l’ossuaire de Brasparts proférant son « Réveillez-vous ! » face l’Ankou qui s’écrie « Je vous tue tous ». Ce qui fait dire à Gaële de La Brosse que « les anges descendent parfois sur terre pour nous réveiller ». Merci à eux.
Petite déclaration d’amour aux anges, nos compagnons de route, Gaële de la Brosse, Suzac éditions, 112 pages, 12 euros
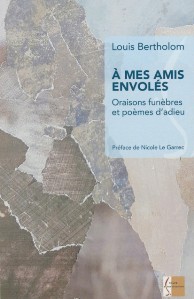 |
Louis Bertholom, |
| À mes amis envolés, oraisons funèbres et poèmes d’adieu |
|---|
À quoi reconnaît-on un poète breton ? A sa familiarité avec la mort ou, plutôt, à sa capacité à faire se rencontrer, dans ses textes, les vivants et les morts. À vous dire aussi que la mort fait partie de la vie et que les disparus continuent à nous accompagner. On le ressent profondément à la lecture des Oraisons funèbres et des Poèmes d’adieu de Louis Bertholom.
Il fallait le faire ! Regrouper dans un livre ces paroles frappées du sceau de l’émotion que l’on prononce à l’église ou au crématorium devant le cercueil d’un ami ou d’un membre de sa famille. Louis Bertholom l’a fait, n’hésitant pas à qualifier ses propres textes « d’oraisons funèbres ». Le terme peut paraître prétentieux (car l’on pense, bien sûr, aux oraisons de Bossuet) mais le poète nous ramène, dans ses mots simples, à l’humilité des choses et de la vie. Rien ici n’est grandiloquent. Tout transpire la complicité, la familiarité avec ces chers disparus, avec quelques petites embardées dans une trivialité ou un humour de bel aloi (histoire de détendre l’atmosphère et de prendre ses distances avec une forme de désarroi).
Louis Bertholom nous livre ainsi une quinzaine d’oraisons et de poèmes d’adieu. Il les a prononcés dans des églises de son cher pays fouesnantais, au crématorium de Quimper, au cimetière de Moëlan-sur-mer et même à la cathédrale de Quimper. La plupart de ces « amis envolés » sont des hommes et des femmes qu’il a connus dans sa propre vie d’artiste (parmi les plus connus on trouve notamment Jean Moign et Annaïg Baillard-Gwernig). Mais on trouve aussi des amis proches originaires de son pays natal, des gens modestes qui ont passé leur vie sur terre sans faire beaucoup de bruit. Et les oraisons sont là pour glorifier leurs vies.
Le poète (pourtant agnostique) ne se résout pas à concevoir une disparition pure et simple de tous ces êtres chers. « Mes amis partis, vous vivez en moi comme si vous étiez présents (…) Vous m’injectez de l’énergie vitale ». Il les imagine abordant des « rivages lumineux », « le monde blanc », le « Tir na Nog » (cette terre de jeunesse du paradis des Celtes) ou encore l’île d’Avalon où il les imagine « pour l’éternité à croquer des pommes » (celles du terroir fouesnantais, cela va sans dire).
« Que sont mes mais devenus / que j’avais de si près tenus / et tant aimés ». Les vers de Rutebeuf accompagnent les oraisons de Louis Bertholom. Il nous livre même son propre modèle de poème d’adieu, nous suggérant de nous en servir quand le deuil nous frappera. « Aujourd’hui je te dis au revoir mon ami / Il faisait de ce temps qui n’osait pas la pluie / Juste un peu de brume qui troublait nos regards / Nous tous bien alignés, silencieux et hagards ». Car ce livre est aussi un manuel aux allures de guide pratique sur l’usage de l’oraison funèbre. « L’évocation doit être simple et fluide, nous dit Louis Bertholom, et le poème doit éviter l’abscons ». Qu’il en soit ainsi.
À mes amis envolés, oraisons funèbres et poèmes d’adieu, Louis Bertholom, préface de Nicole Le Garrec, Collages de Sophie Denis, éditions Vivre tout simplement, 121 pages, 14 euros. Une biographie de Louis Bertholom, réalisée par Alain Gabriel Monot, sous le titre Louis Bertholom, le poème comme un cri, vient d’être publiée par les éditions Yoran Embanner, 175 pages, 12 euros.
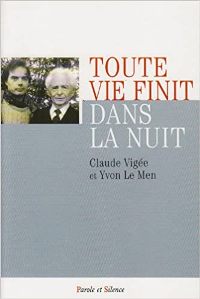 |
Claude Vigée et Yvon Le Men, |
| Toute vie finit dans la nuit |
|---|
Claude Vigée, l’immense écrivain juif d’origine alsacienne, et le poète breton Yvon Le Men ont échangé sur l’écriture, l’amour et les raisons de vivre dans un livre intitulé Tout finit dans la nuit. L’amitié et la complicité entre les deux auteurs est ancienne. Ce livre, publié en 2007 était donc, en quelque sorte, l’aboutissement d’un cheminement spirituel et intellectuel commun.
« Toute vie finit dans la nuit, bien sûr, mais en inventant sa propre lumière », écrivait Yvon Le Men à propos de la genèse de ce livre-échange qui s’articulait, dans une première partie, autour de la démarche littéraire du poète breton : depuis ses rencontres avec Jean Malrieu, Eugène Guillevic, Xavier Grall jusqu’à ses révélations littéraires, dont le poète turc Nazim Hikmet est l’une des figures les plus hautes.
Tout tournait ensuite, dans ce livre, autour de l’image du père : un père qu’Yvon Le Men a perdu alors qu’il était encore jeune et dont la disparition avait creusé une profonde blessure. Claude Vigée parlait, à propos de Le Men, de « l’anxiété créatrice » issue « d’un manque et d’une absence ». Le livre Besoin de poème était d’ailleurs né de cette absence.
Il y avait ensuite, de fil en aiguille, toute une réflexion sur le mal et la souffrance, ce qui permettait en particulier aux deux auteurs de disserter sur le « Livre de Job » et d’apporter leur vision personnelle de ce texte de la Bible. À chaque fois, le vieil écrivain juif se mettait, avec bienveillance, à l’écoute de son interlocuteur, bondissant avec allégresse sur toutes ses intuitions ou ses interprétations personnelles de la foi.
Les deux auteurs terminaient leur échange par une forme d’appel, en ces temps troublés, à la tolérance religieuse, « contre ceux qui veulent faire régner de force, et de manière prématurée, le paradis céleste sur terre ». Éloge du poème et de la prière, à travers la figure de poètes et mystiques musulmans qu’ils évoquaient conjointement. C’était une façon de clore en beauté cet échange fécond, ouvert sur une foi dans la vie chevillée au corps
Toute vie finit dans la nuit, éditions Parole et silence, 127 pages, 15 euros
Toute vie finit dans la nuit, Claude Vigée et Yvon Le Men, éditions Parole et silence, 127 pages, 15 euros
 |
Hommage, |
| Claude Vigée : la disparition d’un grand poète |
|---|
Immense auteur, Claude Vigée vient de décéder à l’âge de 99 ans. Né à Bischwiller en Alsace, il avait enseigné quarante ans la littérature comparée en Nouvelle Angleterre et à l’université hébraïque de Jérusalem avant de venir s’installer à Paris. En 1996, il avait obtenu le Grand prix de poésie de l’Académie française et, en 2008, le prix Goncourt de la poésie.
Que retenir de son œuvre importante de poète, essayiste, conteur, diariste, traducteur (notamment de Rilke), marquée par un grand éclectisme, car ses livres sont souvent des ouvrages patchwork mêlant différents genres littéraires ? Pour Claude Vigée, l’écriture était une nécessité vitale. « Il s’oppose à une conception du poème comme objet esthétique affranchi de son ancrage existentiel », notait Anne Mounic dans la préface à la publication de ses œuvres complètes. « C’est le fond rural alsacien, relayé ensuite par la poésie biblique, qui donne à la poésie de Claude Vigée cette vigueur existentielle ancrée dans la substance terrestre de l’être ». D’où, chez le grand auteur juif, « une aptitude au réel et cette méfiance à l’égard de l’abstrait, fruit d’une expérience composite, qui fonde la vigueur de ses poèmes ».
S’il fallait rapprocher Claude Vigée de certains poètes contemporains, on pourrait donc citer Reverdy, Bonnefoy, Jaccottet ou encore Guillevic. « Rien n’arrive, sinon / Étre présent au monde », résumait laconiquement Claude Vigée dans un de ses poèmes. « La poésie, disait-il encore, passe parfois à travers les pires horreurs de l’histoire, et permet d’éprouver malgré tout l’extase sur les décombres » (Le fin murmure de la lumière, éditions Parole et Silence, 2009). « Les poètes, disait-il encore, ressemblent à ces chevaux de halage que j’ai vus remonter le cours du Rhin dans mon enfance : ils soufflent et ils souffrent, mais obstinément ils marchent en traînant leurs bateaux chargés de charbon ou de graviers jusqu’au terme du long voyage de la vie ».
Claude Vigée avait trouvé dans la Bible sa référence et sa source. Les figures de Jacob, Job et Jonas ont notamment marqué son imaginaire. Dans son œuvre, il nous a montré ce que pouvait être l’espérance lorsqu’elle survit, « malgré nous, malgré tout », au lucide et terrifiant constat de « la démence meurtrière des hommes ». L’œuvre poétique était alors, selon lui, au service d’une aventure qui la dépassait infiniment : transmettre la vie. « Le secret de l’arrachement / c’est ce parfum qui subsiste/et œuvre avec patience/sous la neige hors du temps / comme le cri du rouge-gorge / caché au cœur de l’hiver / dans la floraison blanche / de l’amandier invisible », écrivait Claude Vigée, en décembre 1995, à Jérusalem.
Face au doute et à la désespérance qui hantent les auteurs dont l’œuvre est fondée sur le refus et la négation, Claude Vigée opposait l’affirmation d’une confiance lucide dans la vie et dans le langage. « Qu’est-ce donc que la poésie » ? interrogeait-t-il. « Un feu de camp abandonné / qui fume longuement dans la nuit d’été / sur la montagne déserte ».
À lire. L’homme naît grâce au cri, poésies choisies (1950-2012), Points Seuil, 336 pages, 7,80 euros. Mon heure sur la terre, poésies complètes (1936-2008), Galaade éditions, 925 pages, 39,00 euros.
 |
Gilles Baudry et Nathalie Fréour, |
| Une île seulement pour ajourer la mer |
|---|
Un moine poète et une artiste peintre unissent leur talent pour nous parler de la mer et des îles. Gilles Baudry et Nathalie Fréour poursuivent ainsi leur collaboration engagée en 2017 avec Un silence de verdure (éditions L’enfance des arbres) Le préfacier, François Cassingena-Trévedy, autre moine poète, vient aujourd’hui ajouter son grain de sel (marin) à ce duo.
Des poèmes et des pastels. Une vingtaine en vis-à-vis. Un texte sobre (de 4 à 6 lignes) au diapason de la simplicité des peintures, de leur douceur (car tout ici est calme, paisible), offrant invariablement le même point de vue sur la mer avec cette barre d’horizon séparant le ciel de l’eau. De-ci de-là, des rochers ponctuent le tableau à moins qu’il ne s’agisse de chapelets d’îles ou d’îlots posés là comme « pour ajourer la mer ».
Si l’île est présente dans ce recueil, la mer l’est encore plus. Mais c’est une mer vue de l’extérieur. On n’est pas embarqué. « Je reste l’homme de l’estran », écrit Gilles Baudry. Il parle même d’un face à face « trop inégal » avec la mer, faisant de lui « un homme distendu entre fini et infini ».
Quelques notations discrètes nous ramènent à un pays de connaissance, celui où vit le moine poète à l’abbaye de Landévennec. Ne nous parle-t-il pas de sa « presqu’île » ou des « brumes blessées de l’aube » ? Nous sommes effectivement dans un pays « d’extrême-terre ». Et les pastels de Nathalie Fréour sont bien là pour nous signifier qu’il s’agit bien, ici, d’un face à face avec l’immensité. Et l’on pense, parcourant ce beau recueil, à ce haïku de Santoka : « Me voilà/là où le bleu de la mer / est sans limite ».
Dans ce pays, les phares deviennent des « derviches-tourneurs » et les chapelets d’îles font penser à des « troménies ». Ici, nous dit encore Gilles Baudry, le crachin « ravale ses sanglots » et l’on entend « le hennissement du vent ». Parfois même, « le ciel s’en va épaules basses de goémonier ». Quant à l’île, elle est « un pacte avec la solitude » et notre « épiderme du dedans ».
François Cassingena-Trévedy, en préfaçant le livre, voit dans l’île plus qu’une île. « L’île ajourant la mer, écrit-il, ne serait-ce pas, en définitive, cette Présence au milieu de nous – d’entre nous – soudain surgie, d’entre nos mains qui écrivent et qui peignent ». S’associant au duo Baudry-Fréour, il évoque ces îles qui sont communes à ce trio ainsi constitué, « îles graves, îles austères », « îles de haute altitude » loin de la pacotille et des îles à cocotiers. Enfin, à propos de ce trio, il affirme qu’il est « de bonne espérance pour demain, car l’homme ne saurait être une île sans la femme, non plus que la femme sans l’homme ». Parole de sage.
Une île seulement pour ajourer la mer, Gilles Baudry (poèmes) et Nathalie Fréour (pastels), L’enfance des arbres, 64 pages, 15 euros
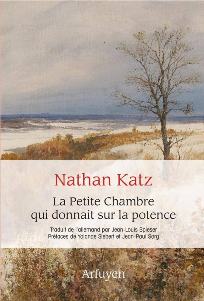 |
Nathan Katz, |
| La petite chambre qui donnait sur la potence |
|---|
Il fut le premier maître d’Eugène Guillevic et son initiateur à la poésie allemande, le poète alsacien Nathan Katz décédé à Mulhouse en 1981 à l’âge de 89 ans, a raconté dans son premier livre, publié en allemand alors qu’il avait 28 ans, son expérience de prisonnier de guerre en Russie et en France. Sous le titre Une petite chambre donnant sur la potence, il révèle l’amour de son pays natal mais aussi son profond humanisme. Ce livre est aujourd’hui, pour la première fois, publié en français.
Le destin du jeune Nathan Katz, né en 1892 dans le Sundgau à l’extrême sud de l’Alsace, fut celui de nombreux Alsaciens nés dans une région annexée par l’Allemagne après la guerre de 1870. Quand éclate la Grande guerre, le voilà donc enrôlé sous uniforme allemand, conduit sur le front russe où il est fait prisonnier en juin 1915 et interné jusqu’en août 1916 aux camps de Sergatsch et de Nijni-Novgorod. « Le temps que nous passions au travail était assez long, raconte-t-il, nous commencions au lever du soleil et nous retournions à la maison lorsque l’astre avait roulé loin derrière les collines à l’ouest et qu’il commençait à faire nuit ». Il s’agissait de travaux des champs. « Nous liions des gerbes, nous rentrions les céréales ». Et il écrit ce poème : « Loin à la ronde se dressent les champs de blé mur ! / Les robes des faucheuses sont un chatoiement de couleurs ! ».
Le jeune Nathan ne se plaint pas malgré les conditions spartiates de sa captivité. Il bénit le travail qu’il accomplit. Il compatit pour un compagnon malade. Il regarde avec affection les paysans russes. Il s’émerveille devant les beautés de la campagne. « Il n’est rien de plus paisible, de plus grand que l’automne sur la lande russe ! Lorsque jaunissent les feuilles et s’embrasent les forêts comme si une seule et même mer de flammes s’était déversée par-dessus la plaine (…) Les arbres qui se dressent là, sous le ciel cristallin, ont la solennité paisible de cierges sacrés dans un sanctuaire immaculé, majestueux, que surmonte une immense coupole bleu clair ». Cette beauté le ramène inlassablement à celle de sa terre natale (son « Heimat »). « Terre d’Alsace, pays de Sundgau ! Beau pré vert dans lequel on peut s’allonger comme un bienheureux, tout au cœur des fleurs ».
Et, surtout, bien que prisonnier, Nathan Katz sait prendre du recul et cultiver sa propre liberté intérieure (comment ne pas penser ici à la jeune Etty Hillesum au camp de Westerbork). « J’aimerais bien savoir, écrit Nathan Katz, qui pourrait m’interdire de me sentir libre ici, dans un camp de prisonniers, entouré de hauts murs, mais où le soleil brille dans la cour » et « dans une petite chambre qui donne sur une potence mais dont les murs regorgent de lumière et de clarté chaleureuse ». Plus loin, il note: « Je ne peux m’empêcher de rire à la vue de la potence. La bonne vieille potence !... Complètement ramollie par la chaude humidité, elle est recouverte de part en part de petites gouttelettes de pluies brillantes ».
Nathan Katz est rapatrié en France en septembre 1916. Il passera seize mois au camp de prisonniers de guerre de Saint-Rambert sur Loire et travaillera à Saint-Étienne dans une usine fabriquant du matériel de guerre. « Les nappes de brouillard s’empilent sur les toits gris / Des bâtiments encrassés de la forge / s’échappent, fatigués, les sons des marteaux qui s’espacent / C’est ainsi qu’autour des usines tombe la nuit ».
La paix revenue, Nathan Katz deviendra voyageur de commerce. « Mais jamais la poésie ne l’abandonne », note Yolande Siebert dans sa note biographique sur l’auteur. Il se déplacera donc beaucoup mais lors de séjours en Alsace, on le voit fréquenter un cercle réunissant à Altkirch, des jeunes écrivains et artistes. Parmi eux, un certain Eugène Guillevic, dont le père gendarme avait été nommé en Alsace. Les deux hommes sympathiseront et échangeront en alsacien.
La petite chambre qui donnait sur la potence, Nathan Katz, traduit de l’allemand par Jean-Louis Spieser, préfaces de Yolande Siebert et Jean-Paul Sorg, aux éditions Arfuyen, 165 pages, 16 euros
 |
Bernard Victor Chartier, |
| Dans tes pas, peut-être |
|---|
Retrouver son père, marcher dans ses pas, le réinventer et peut-être même le ressusciter: Bernard Victor Chartier le fait par le truchement de la poésie sans jamais quitter son jardin ni sa cabane nichée dans un sycomore. Tel un sage au cœur de son bocage sarthois, il médite sur la filiation au sein d’une nature seule à même de lui apporter une forme de résilience.
« Le presque nouveau-né que j’étais quand tu es parti ». Bernard Victor Chartier a 9 mois et son père 33 ans. C’était il y a soixante-dix-sept ans. « Taiseux étais-tu ermite toi aussi / je serais donc né ermite de toi ». Le poète lance alors un défi à son père disparu : « Défricher ensemble le pur bonheur ».
Symboliquement et métaphoriquement, cette quête se mènera, « en dehors de la ligne droite inévitable », au cœur d’un mandala qu’il a dessiné avec sa tondeuse dans l’herbe de son jardin-éden. « Tu vas ainsi réinventer avec moi la vie courbe ». Et il l’interpelle : « Suis-moi Marcel mon père » (comme si la ligne courbe pouvait le ramener à un point d’origine).
Chemin faisant, les pas de l’auteur le conduisent (ainsi que son père) sur ceux de poètes dont on connaît la communion avec la nature et l’art d’appréhender la vie avec ce détachement propre aux philosophies extrême-orientales. Bonjour, donc, à Bashô, Buson, Issa, Ryokan, tous ces maîtres en haïku que l’auteur cite à plusieurs reprises dans son livre.
Qu’un « volatile non identifié » le frôle (« un passereau certainement ») et voilà Bernard Victor Chartier citant Issa : « Viens avec moi / et amusons-nous un peu / moineau sans parents ». Ce haïku dit tout, finalement, de la démarche poétique engagée ici. Autrement dit, faire un va-et-vient permanent entre le père, le fils, la nature, le jardin et tous ces auteurs qu’il fréquente assidûment. S’engage ainsi une forme de navette que les oiseaux (mésanges, rouges-gorges…) tissent avec application au fil des jours tandis que la cabane dans le sycomore nous renvoie à l’ermitage « intérieur » du père et à une autre cabane, celle du poète Ryokan (« un calme parfait / sur un oreiller d’herbe / loin de ma cabane »).
D’autres figures de femmes et d’hommes, ceux que Chartier appelle « les résidents de mon éden », peuplent ce livre et aident à faire le saut dans le temps à la redécouverte du père. Ils s’appellent Gandhi, Angelius Silesius, Etty Hillesum ou François d’Assise. Avec eux, l’auteur entretient, dans une attention soutenue aux couleurs et aux sons, une folle espérance. Retrouver, au bout de sa quête, une forme d’apaisement et le « sentiment d’un bonheur nouveau ».
Dans tes pas, peut-être, Bernard Victor Chartier, aquarelles de Bernard Schmitt, préface de Jean Lavoué, L’enfance des arbres, 127 pages, 15 euros. L’enfance des arbres publie par ailleurs La nuit et la grâce de Claude Thevenon, poèmes-psaumes, 111 pages, 15 euros.
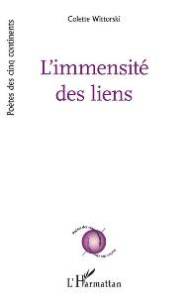 |
Colette Wittorski, |
| L’immensité des liens |
|---|
Publier un livre à l’âge de 90 ans impose le respect. Quand il s’agit de Colette Wittorski, on est, en outre, assuré d’accéder à une qualité d’écriture et une profondeur de pensée qui font dire à son préfacier, Bernez Tangi, que chacun de ses poèmes « est un diamant ». Experte dans l’élagage et le bizeautage (comme on le fait pour polir une pierre précieuse), Colette Wittorski nous propose des poèmes courts écrits pour la plupart dans l’hiver de la vie et qui sont, comme elle le dit elle-même, des « promenades intérieures », des « reflets ». Au fond, une « matière d’âme » qui ne néglige jamais le corps à corps avec la chair de la vie, au plus près d’une nature le plus souvent rassurante et rafraîchissante.
« Tourmentée comme une terre à l’herbe rare », Colette Wittorski nous livre sa « terre intérieure » depuis un pays qui est devenu le sien, dans l’Argoat finistérien, un pays « à l’extrême bord du continent parmi les rocs » où elle hume « l’haleine claire de la terre remuée » et contemple « la fourrure de blé mûr sur la terre sèche ». Ici, nous dit-elle, « une colline soulève sa masse » et une « soudure de brouillard » peut stagner la journée entière.
Mais dans ce pays (comme dans d’autres pays), « le couteau des heures accomplit son office ». Forme de compte à rebours pour une femme sur le grand âge. « Chacun fuit / les rires se taisent / le lac se vide », lit-on dans le court poème intitulé « Vieillesse ».
C’est le moment où les blessures anciennes remontent à la surface. À commencer par le choc (le traumatisme ?) originel et, en quelque sorte, fondateur : la disparition d’une mère dont l’enfant qu’elle fut se découvre « amputée ». Inconsolable petite Colette : « Commencée de rien comme posée sur la terre / ma mère sitôt enfuie ».Regardant aujourd’hui de « très loin » sa « naissance minuscule », elle s’évertue à fignoler le « polissage des larmes » (comme elle le fait de ses poèmes).
Colette Wittorski continue, en dépit de tout, à habiter la vie intensément. « Si bref est l’instant / Hâte-toi ». Elle ne rend pas les armes si facilement et délivre, au passage, de vraies leçons de sagesse. « Les roses qui se fanent embaument les alentours / Décliner n’est pas mourir ». La voici désormais, note Bernez Tangi dans sa préface, « chaleureuse dans une lumière froide ».
L’immensité des liens, Colette Wittorski, préface de Bernez Tangi, L’Harmattan, 147 pages, 16 euros
 |
Henry David Thoreau, |
| La correspondance (tome II) |
|---|
Le deuxième tome de la correspondance générale de Thoreau vient de paraître. Il couvre les années essentielles de la vie de l’auteur entre 1847 et 1854 (il a entre 30 et 37 ans), notamment celles qui l’ont vu construire sa cabane d’ermite près de sa ville natale de Concord (Massachussets) et qui l’amèneront à publier le livre lui assurant définitivement sa renommée: Walden ou la vie dans les bois.
En présentant le 2e tome de la correspondance de Thoreau, Thierry Gillyboeuf le qualifie de « bréviaire de sa philosophie et de son esthétique ». Le rapport privilégié à la nature, le détachement sous toutes ses formes, la liberté individuelle, la méfiance à l’égard de l’État : tous ces thèmes sont au cœur des lettres de Thoreau. « Laissons les choses tranquilles (…) Réussir à ne laisser qu’une seule chose en paix par un matin d’hiver, quand bien même il ne s’agit que d’une pauvre pomme gelée qui pend à un arbre » (lettre du 3 avril 1850 à Harrison Gray Otis Blake). Au même correspondant il écrit le 28 mai de la même année : « Nous qui marchons dans les rues et sommes prisonniers du temps, nous ne sommes que le refus de nous-mêmes ». Trois mois plus tard, il écrit à Blake (lettre du 9 août 1850) : « Tant que chacun suit sa route dans les bois, sans angoisse ni impatience, en faisant montre d’une sérénité joyeuse, même s’il lui faut marcher sur les mains et sur les genoux par-dessus les rochers et les arbres abattus, il ne peut être que sur le bon chemin ».
Dans cette période de sa vie, Thoreau gagne sa vie en faisant des travaux d’arpentage, en écrivant des articles ou en faisant des conférences pour parler de ses excursions et de ses découvertes. Il est très sollicité et l’on voit graviter autour de lui des penseurs, des intellectuels, parfois des ecclésiastiques en rupture, comme lui, avec l’Église et l’État. Parmi eux ce Harrison Gray Otis Blake avec qui il entretient la plus riche correspondance de cette époque. Diplômé de Harvard comme Thoreau, Blake était un enseignant. Il avait fait la connaissance de Thoreau lors d’une visite, à Concord, à Emerson, le père du transcendantalisme. Autre figure intéressante de cette époque : celle de l’écrivain Nathaniel Hawthorne (l’auteur de La lettre écarlate) qui décrivait Thoreau comme « une sorte de gars sauvage, marginal à l’indienne (…) mâtiné de transcendantalisme ».
Au-delà de son esthétique et de sa philosophie de vie, Thoreau « dessine également dans ses lettres la topographie d’une identité américaine en pleine formation », précise Thierry Gillyboeuf. Il y est question de massacres ou de déportations d’Indiens, de la grande marche vers l’Ouest, de la guerre avec le Mexique… Arrivent même en écho, par les journaux, des nouvelles de la guerre de Crimée ou des démêlés avec la Turquie.
Mais le sujet qui lui tient sans doute le plus à cœur est celui de l’esclavage. Ses prises de position en faveur de l’abolition sont au cœur de son engagement (en 1851, Thoreau aida un esclave à s’enfuir au Canada). Globalement il tient des propos désabusés sur son pays en pleine formation. Ainsi parle-t-il d’une « nation qui ne tend pas vers le haut mais vers l’Ouest »(lettre du 27 février 1853)
Enfin, on découvrira dans cette riche correspondance toutes les démarches que Thoreau engage pour la publication de ses livres, à commencer par Walden ou la vie dans les bois, le récit de sa vie d’ermite près de l’étang boisé de Walden pendant deux ans, deux mois et deux jours entre 1845 et 1847. Son livre sera publié à 2000 exemplaires en août 1854. Il connaîtra la postérité que l’on sait et deviendra même un des livres de référence de la littérature américaine.
J’écris comme ça, au petit bonheur, correspondance générale, Tome II (1847-1854), Henry David Thoreau, édition établie, préfacée et annotée par Thierry Gillyboeuf, La Part commune, 492 pages, 22 euros.
 |
J.-M. G. Le Clézio, |
| Chanson bretonne |
|---|
Un Prix Nobel de littérature raconte son enfance bretonne. Des fragments de séjours de vacances du côté de Sainte-Marine dans le Pays bigouden. J.-M. G. Le Clézio jette un regard émerveillé sur cette période de sa vie. Et il n’hésite pas à nous dire ce que lui inspire la Bretagne d’aujourd’hui.
« Je ne ferai pas de récit chronologique, écrit-il, les souvenirs sont ennuyeux, et les enfants ne connaissent pas la chronologie. Les jours pour eux s’ajoutent aux jours, non pas pour construire une histoire mais pour s’agrandir, occuper l’espace, se multiplier, se fracturer, résonner ». Voici, donc, des bribes d’enfance sous la plume de J.-M. G. Le Clézio (dont on connaît l’ascendance bretonne). Autant de tableaux impressionnistes, que la mémoire ravive, sur des choses vues ou vécues dans ce « village d’été » de Sainte-Marine où ses parents louaient une maison chaque année à Mme Hélias et où le petit Parisien qu’il est apprend à côtoyer les jeunes du pays, « pour la plupart les fils et les filles des pêcheurs qui peuplaient le village ». Une Bretagne du début des années 50 tellement éloignée de celle que nous connaissons aujourd’hui et amène l’auteur (Le Clézio est né en 1940) à dire que, depuis longtemps, Saint-Marine n’est plus dans Sainte-Marine.
Il y a une forme de nostalgie, donc, dans son récit parce que la mémoire amplifie et magnifie ces instants vécus entre terre et mer, dans un pays de fougères, de pins et d’ajoncs. « Nous allions par les chemins creux, avec nos vélos archaïques lourds comme des draisiennes, loués chaque année chez le garagiste Conan de Combrit ». Des figures locales surgissent au fil des pages. Ainsi Mme Le Dour « chez qui nous allions chercher le lait » et où il y avait deux filles, « la plus jeune, Jeannette, maigre et noire, Maryse, plus grande et plus forte, avec un joli visage régulier et de beaux cheveux coiffés en chignon ». Ailleurs, il évoque la figure d’une marquise (invisible), celle du château du Cosquer à Combrit (« château de contes de fées ») où une fête était organisée chaque année. Enfin, il y a tous ces anonymes côtoyés dans les petits ou grands moments de la vie. Le Clézio nous en donne notamment une vision très naturaliste, marquée par son souci du détail pour parler des hommes du cru dans les travaux de la moisson ou du battage.
En toile de fond demeurent l’émerveillement et les yeux écarquillés d’un enfant sur les estrans ou sur les rochers, sur « la solitude des criques encombrées de galets géants, trouées de grottes où les vagues explosent ». L’auteur a les mots pour dire l’émotion qui le saisit lors d’une virée nocturne solitaire quand « la haute mer brille à la clarté de la lune ».
Le Clézio n’est pas là pour ressasser le passé mais pour entonner une « chanson bretonne » (une forme de gwerz qui ne serait pas triste) et pour tisser la trame d’un récit qu’il qualifie de « conte » comme pour bien montrer que le merveilleux y a aussi toute sa place. Cela n’empêche pas, pour autant, une perception aiguë des douleurs et des misères qui peuvent accabler le pays, parfois issues de cette guerre dont les blockhaus de la côte en sont la trace encore chaude. Mais pour un gamin, sous les cieux changeants des étés bretons, il y a tant d’autres mystères à déchiffrer dans le pays. Mystère des monuments anciens, mystère des paysages rabotés par le temps. « Il y avait un autre monde avant le mien (…) J’étais juste de passage ».
Quant à ce nouveau monde surgi de toutes les révolutions de la deuxième moitié du 20e siècle, elles suscitent une forme de réprobation de l’auteur. Qu’il s’agisse des constructions anarchiques, de la défiguration des paysages, de la destruction du bocage. « Si je reviens au village de mon enfance, ce village d’été où je suis allé chaque année, je ne reconnais aujourd’hui à peu près rien ». Mais, s’empresse-t-il d’ajouter, « la nostalgie n’est pas un sentiment honorable ». Le Clézio (qui possède une maison en baie de Douarnenez) préfère souligner la « silencieuse constance » des Bretons, saluer ceux qui entreprennent de cultiver la terre autrement et se réjouir qu’on s’applique à entretenir la pratique de la langue bretonne (même si ce n’est plus celle qu’il a connue enfant). Il rêve même d’une forme d’autonomie pour la Bretagne (intitulant un de ses chapitres « Breizh atao ») en souhaitant que le pays soit à même « d’inventer son avenir écologique et culturel ».
Chanson bretonne suivi de L’enfant et la guerre, J.-M. G. Le Clézio, Gallimard, 155 pages, 16,50 euros. La deuxième partie de ce livre est une vibrante évocation des années de guerre vécues par l’auteur, enfant, dans l’arrière-pays niçois où sa famille s’était réfugiée.
 |
Maurice Maeterlinck, |
| L’intelligence des fleurs |
|---|
Les ouvrages ne manquent pas aujourd’hui sur l’intelligence des arbres, sur leur capacité à s’épauler et à correspondre entre eux. C’est de « l’intelligence des fleurs » dont nous parlait, au début du siècle dernier, l’écrivain belge Maurice Maeterlinck (Prix Nobel de littérature 1911), homme de théâtre mais aussi auteur naturaliste. Son livre est aujourd’hui opportunément réédité, magnifiquement illustré par l’artiste Cécile A. Holdban.
Parler des fleurs. Elles sont, le plus souvent, l’apanage des poètes. Quand Gustave Roud écrit son livre Les fleurs et les saisons (La Dogana, 1991), il l’introduit par un chapitre sur le « mystérieux langage » des fleurs. « Couleurs, parfums, présence formelle, qui ne les sait entendre ? Qui résiste à ce désir humain de leur suggérer un sens, d’en faire la figure et l’écho d’une passion, d’une pensée ? » Mais, poète, Gustave Roud ne se limite pas à ce constat. « C’est d’un autre langage des fleurs que j’aimerais parler, un langage direct, sans « comme », sans la docilité du symbole, un appel soudain, tout proche, déchirant, désespéré, comme s’il savait déjà qu’aucune réponse ne peut lui être donnée ». Avec le poète nous sommes dans le registre du précaire, du dépérissement, de la mort inéluctable après les somptueuses floraisons du printemps et de l’été.
Maurice Maeterlinck, lui, se situe sur un autre plan. On pourrait même le qualifier d’a-poétique car il relève avant tout de l’observation scientifique et plus précisément de l’entomologie (à la manière de Jean-Henry Fabre). Ce qui l’intéresse, c’est la capacité d’intelligence des fleurs. « Nous verrons que la fleur, écrit-il, donne à l’homme un prodigieux exemple de l’insoumission, du courage, de persévérance et d’ingéniosité ». Ainsi évoque-t-il la capacité des fleurs à « conquérir l’espace » grâce aux « merveilleux systèmes de dissémination, de propulsion, d’aviation, que nous trouvons de toutes parts dans la forêt et dans la plaine ». Et de donner, à titre d’exemple, « la machine à planer du chardon, du pissenlit, du salsifis ; les ressorts étonnants de l’euphorbe, l’extraordinaire poire à gicler de la momordique, les crochets à laine des ériophiles ».
Ailleurs, il évoque « les cérémonies nuptiales en usage dans nos jardins » en soulignant « les idées ingénieuses de quelques fleurs très simples où les époux naissent, s’aiment et meurent dans la même corolle ». Mariage subtil du pistil et de l’étamine décrit dans les livres de sciences naturelles de nos années d’écoliers.
Plus loin il met l’accent sur les merveilleuses capacités d’adaptation des fleurs et réserve un sort particulier à l’orchidée, la fleur la plus intelligente selon lui. « L’orchidée est celle qui l’emporte sur toutes dans l’art d’obliger l’abeille ou le papillon à faire exactement ce qu’elle désire, dans la forme et le temps prescrits ».
Les exemples sont nombreux dans ce livre pour souligner l’intelligence des fleurs. Elle fait dire à l’auteur que la nature et nous « nous sommes du même monde, presque entre égaux », parce que nous « frayons avec des volontés voilées et fraternelles, qu’il s’agisse de surprendre et diriger ». Nous sommes bien loin du poète Gustave Roud penché sur la fleur fragile.
Maeterlinck fait pourtant une concession à l’émotion à la fin de son livre quand il nous parle d’un pays où la fleur « règne sans partage » (un coin de Province où il résidait). Alors il peut écrire : « Les routes, les sentiers sont taillés dans la pulpe de la fleur, dans la substance même des Paradis. Il semble que, pour la première fois de sa vie, on ait une vision satisfaisante du bonheur ».
L’intelligence des fleurs, Maurice Maeterlinck, La Part Commune, illustrations de Cécile A.Holdban, 110 pages, 12 euros.
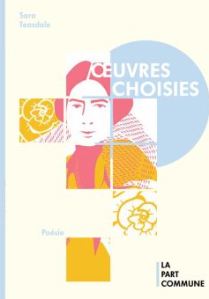 |
Sara Teasdale, |
| Œuvres choisies |
|---|
La douceur amère de l’Américaine Sara Teasdale.
Qui connaît vraiment Sara Teasdale ? C’est pourtant une figure importante de la poésie américaine du début de 20e siècle. Voici une anthologie bilingue de son œuvre qui contribuera à la révéler à un plus large public. C’est la simplicité qui domine dans ses poèmes dont « le chant témoigne d’une quête de sagesse », souligne Alain Sainte-Marie en présentant ce recueil.
Sara Tesadal fait partie de ces femmes poètes qui ont su, à un moment de leur existence, s’émanciper de leur milieu et exprimer une liberté à rebours du « sens victorien des convenances », comme le souligne Alain Sainte-Marie qui assure la traduction et la présentation de ce recueil. Elle publiera d’ailleurs ses premiers recueils dans une revue fondée par un groupe de jeunes femmes. Plus tard, en 1908, elle rencontrera Marion Cummings Stanley, l’épouse du poète E.E. Cummings et ce sera le début d’une amitié féconde.
La célébration de l’amour (qui fut pourtant, pour elle, l’objet de nombreuses déconvenues ou désillusions) mais aussi la joie et l’émerveillement devant les beautés de la nature, sont les marqueurs essentiels de son œuvre.
« Je ne mourrai pas, car j’ai goûté la joie / À la coupe du croissant de lune, / Et savouré comme on savoure le pain / Les nuits profondes de juin »
Les textes de Sara Teasdale sont empreintes d’une forme de sensualité, surtout dans ses premiers poèmes marqués par la quête amoureuse. À 23 ans, elle écrit :
« J’ai offert à mon amour un rouge pavot, / Que j’ai posé sur son cœur froid comme neige : / Mais cette fleur exige un terreau plus chaud, / Nous avons pleuré la mort du coquelicot »
S’adressant à son « très cher et très ridicule ami », elle s’exclame : « Pourquoi fais-tu la guerre à l’amour / Pour perdre à la fin la bataille » Ailleurs, la voilà qui se languit « autant que la mare / près du rivage ».
Avec le temps, les « idées noires » gagneront du terrain ainsi que les « songes froids ». Lucide jusqu’au bout sur son état, elle parle de « l’immuable douleur des choses ». Ce dont témoigne son recueil sans doute le plus abouti, La flamme et l’ombre, publié alors qu’elle a 36 ans et dont cette anthologie publie pas moins de dix-huit textes.
« Quand je mourrai, rappelez-moi / Que j’ai aimé les bourrasques de neige, / Même si elles piquaient comme des fouets; / Que j’ai aimé toutes choses charmantes, / Que j’ai fait de mon mieux pour accueillir leur dard / D’un rire gai sans amertume »
Sara Teasdale se suicide le 29 janvier 1933. Elle avait 49 ans.
Œuvres choisies, Sara Teasdale, La Part Commune, 153 pages, 14 euros
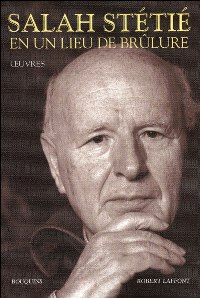 |
Hommage, |
| À Salah Stétié |
|---|
Salah Stétié est mort le 19 mai dernier à l’âge de 90 ans. Écrivain libanais d’expression française, poète est essayiste, Salah Stétié était né à Beyrouth. Il a mené une carrière de diplomate, ambassadeur de son pays auprès de diverses capitales et d’organisations internationales. Il fut notamment diplomate en poste à Paris et délégué permanent du Liban auprès de l’Unesco.
Salah Stétié s’était confié en 2004 à Gwendoline Jarczyk dans un livre d’entretien sous le titre Fils de la parole (Albin-Michel). Il y révélait sa profonde connaissance des multiples facettes de l’identité méditerranéenne : son conservatisme parfois rigide mais aussi son ouverture fertile, son goût pour la tragédie et sa tradition de l’hospitalité. Il évoquait aussi la poésie dans le rapport qu’elle entretient, à ses yeux, avec le sacré, la mystique, l’enfance. « La poésie est fiancée de la fraîcheur », disait-il.
Salah Stétié s’exprimait aussi, à cette occasion, sur le fondamentalisme et l’intégrisme. « Si l’on veut réussir vraiment à changer cet état de choses, déclarait-il, ça ne saurait être par la matraque, mais par l’assiette pleine et par l’école (…) L’opération est bien plus longue et bien plus complexe que d’envoyer des avions et des tanks en Afghanistan ou en Irak ».
En 2003, Salah Stétié nous avait livré ses Carnets du méditant (Albin Michel), un ensemble de maximes et de courtes sentences naviguant entre mysticisme et scepticisme. Ces « copeaux du menuisier », comme il les appelait lui-même, traduisaient l’attachement de l’auteur à une culture ouverte et profondément humaniste. « La poésie, disait-il dans ces Carnets, est devenue, face à la démission du religieux, ou, dans certains cas, à son dévoiement, l’autre parole spirituelle ». Salah Stétié ne manquait jamais d’interpeller ses lecteurs par de salutaires provocations : « Dans une église, faire une prière d’islam. Dans une mosquée, faire une prière chrétienne. Pour perturber nos anges ». Il donnait même, dans ces carnets, sa définition de l’âme : « J’appelle âme ce qui ne cicatrise pas ».
Le livre En un lieu de brûlure (Robert Laffont, collection Bouquins, 2010) rassemble l’essentiel des écrits de Salah Stétié. « Je suis pour le métissage, pour l’abolition des frontières de toutes sortes, pour les intériorités communicantes, pour les pollinisations les moins attendues, pour le partage des langues, des valeurs, des ressources », écrivait-il en introduction à cette anthologie de ses œuvres. À la fois homme de l’Orient et de l’Occident, Salah Stétié nous a enchanté par ses capacité à manier tradition et modernité, lui « né dans un Liban où il faisait bon naître ».
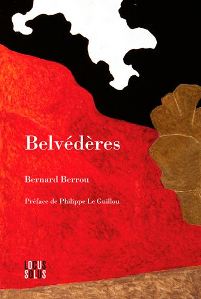 |
Bernard Berrou, |
| Belvédères |
|---|
L’écrivain Bernard Berrou, prix Bretagne 2018, nous invite à le suivre vers ses belvédères « intimes ». Ils ne sont pas ceux que l’on pourrait imaginer. L’auteur nous parle avant tout de « lieux » et « d’instants de plénitude ». Par des chemins buissonniers et aussi au contact d’écrivains qu’il a mis dans son panthéon littéraire.
« Belvédère : pavillon ou terrasse au sommet d’un édifice ou d’un tertre, d’où l’on peut voir au loin » (Le petit Larousse). Dans le nouveau livre de Bernard Berrou, c’est grâce à l’écriture subtile et élégante de l’auteur que l’on peut voir véritablement au loin. Autrement dit s’élever, quitter les contingences matérielles, parfois mesquines, jeter par-dessus bord tout ce qui avilit et obscurcit notre monde.
Nous voici, sur ses pas, dans des « lieux inspirés ». Nous voici au bourg de Lennon, sur la digue de Guissény, devant le clocher de Goulven, sur la voie romaine du nord du Cap Sizun, sur la calotte Saint-Joseph, « dont le sommet se gagne sans effort », du côté de la Trinité-Langonnet. « De ce balcon, écrit Bernard Berrou, tout se présente comme une complaisance idéale à la rêverie dans une atmosphère assez mélancolique qui flotte en permanence, même par beau temps. Rarement je n’ai éprouvé un tel sentiment d’appartenance à la Bretagne ».
Nous parlant, ailleurs, de la petite localité du Juch près de Douarnenez, il a ces mots : « Tout ici rappelle la campagne anglaise dans ce qu’elle recèle de grâce pastorale ». Puis partant au Portugal, il nous ramène des visions lumineuses des belvédères de l’Algarve. Mais ses belvédères peuvent aussi être à portée de main : là où l’écrivain vit, médite, travaille. Voici la baie d’Audierne, le hameau de la Madeleine et sa chapelle du même nom illuminée par les vitraux de Bazaine. Ce sont les belvédères de son « atlas intime ».
Pour tout dire, les belvédères de l’auteur sont des « harmonieuses élévations », des « endroits sans pittoresque » (loin de la frénésie touristique et des tables d’orientation), des lieux où il peut assouvir son rêve « d’une vie à l’ancienne, désenchantée, nourrie de marches vers la mer, de lectures essentielles et d’ennui fertile ». Aussi ne ménage-t-il pas ses salves contre les faux belvédères ou contre tout ce qui peut agresser le paysage, à commencer par les éoliennes (« une offense au paysage breton »). Dans son viseur, aussi, la « Vallée des saints » du côté de Carnoët : « C’est le contraire de l’humilité, de la solitude recueillie, les seules postures qui permettent de se conformer à une foi véritable ». Car, pour Bernard Berrou, « un haut lieu, c’est d’abord faire l’expérience exaltante d’un pèlerinage où des événements historiques, irremplaçables, ont été vécus » (il le dit dans les Monts d’Arrée, se rendant dans la commune de Scrignac).
Les belvédères de l’auteur ne sont pas que des lieux. Ils ont aussi chair humaine. Celle des écrivains qui nous élèvent. Pour Bernard Berrou le choix est vite fait : Julien Gracq, Michel Déon (nous ramenant à la sa passion pour l’Irlande), Pierre Bergounioux dont il dit qu’il « nous aide à clarifier la réponse à notre présence au monde ». Son atlas littéraire intime nous fait aussi rencontrer un « moine des confins », Jean-Yves Quellec, né au Conquet où il revenait régulièrement mais qui œuvrait dans un monastère belge. « Il croyait en la puissance fertile de l’isolement, pour éviter que l’existence ne soit ballottée au grès de courants comme des épaves à la dérive ».
Enfin, au bout du compte, demeure le belvédère de l’enfance. Sans doute la plus sûre vigie pour guider nos pas dans l’existence. Bernard Berrou le dit dans son chapitre « le lieu et le temps », sans doute un des plus puissants textes de son livre. « C’était un temps où la main était souveraine et agile, c’était un climat de noble rusticité où toute parole était bonne et sacrée ». Ses belvédères – phares dans la nuit – nous amènent très loin dans l’espace et le temps.
Belvédères, Bernard Berrou, Locus Solus, 165 pages, 14 euros.
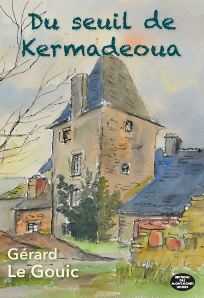 |
Gérard Le Gouic, |
| Au seuil de Kermadeoua |
|---|
Un poète nous livre son journal intime. Gérard Le Gouic publie aujourd’hui le 7e volume de journal entamé dès 1987 par son Journal de ma boutique. C’est du manoir de Kermadeoua, où il réside depuis quarante-cinq ans, qu’il nous parle désormais. Nous sommes en Cornouaille, à portée de mains de Pont-Aven, du côté de Kernével en Rosporden. Le poète nous raconte avec verve ses années 2016 à 2019, celles de ses premiers pas d’octogénaire.
Le journal intime est l’apanage de nombreux auteurs, souvent les plus grands. Qu’il s’agisse de journal intime, tel qu’on l’entend habituellement, comme celui de Claude Roy et sa Rencontre des jours, ou de carnets plus détachés de l’actualité, à l’image de La semaison de Philippe Jaccottet. Le journal de Le Gouic est à la frontière de ces deux genres. « Je rechigne à appeler ces cahiers un journal, écrit-il, ce serait plutôt un fourre-tout, une poubelle avec tri sélectif. Pardon à ceux qui y sont mentionnés ». On reconnaît bien là l’esprit caustique de l’auteur car le lecteur ne doit trop se faire d’illusion sur son entreprise. « Plus je raconte ma vie, moins j’en dévoile », ajoute Gérard Le Gouic, passé maître dans l’art du contre-pied, avec son art consommé de prendre son lecteur ou son interlocuteur à rebrousse-poil.
Que lit-on dans ce journal de 407 pages ? D’abord « la vie ordinaire » (comme dirait Georges Perros) faite d’occupations quotidiennes et ménagères, de randonnées pédestres en groupes, de courses au supermarché, de déjeuners avec des amis au restaurant, de visites d’expositions (avec l’association des amis du musée de Pont-Aven), de balades sur le circuit de courses cyclistes locales (Le Gouic a beaucoup pratiqué le vélo), sans oublier les dédicaces de livres, les rencontres poétiques, les lectures en librairies, médiathèques, maisons de la presse…
Souvent on lui pose la question : « Alors, comment va la poésie ? ». Gérard Le Gouic répond : « Elle va bien. Elle se porte très bien. Ce sont les lecteurs qui sont malades, quand ce ne sont pas les poètes ». Voilà qui est dit. « On peut être poète avec des cheveux courts », note-t-il, reprenant les propos de Jules Renard. Et il ne mâche pas ses mots à propos de certains auteurs qu’il lui arrive de côtoyer. Il en révèle ici la suffisance ou, ailleurs, « l’austérité glaciale » parlant, par exemple, d’un des poètes bretons les plus connus. Haro aussi sur « les absurdités » qu’il relève dans certains textes poétiques dont il cite des exemples « pour rire ». Car le Gouic est du côté de Cadou ou de Follain, loin des poésies hermétiques et obscures qui ont fait fuir le lecteur au cours des années passées. Il préfère nous parler de Charles Le Quintrec, de Henri Queffélec et des amis écrivains qu’il aime rencontrer (Max Alhau, Bernard Berrou…)
Mais le plus important, dans ce journal intime, n’est sans doute pas là. Il est plutôt dans ce qu’il révèle de l’homme Le Gouic : son indépendance, sa liberté de pensée foncière, son refus des compromissions, et plus encore, sa profonde empathie pour les êtres en souffrance. Il a notamment de belles pages sur des ami(e)s proches frappés par la maladie. Il les appelle, prend des nouvelles, s’apitoie. Dans ses rêves, qu’il nous raconte aussi à plusieurs reprises, lui revient souvent la figure de Lucie, sa femme disparue. Mais en dépit de tous ces liens, passés ou présents, il fait cet aveu : « Toute ma vie fut finalement de solitude, comme toutes les vies d’ailleurs, mais d’une solitude cachée ».
Que lui reste-t-il aujourd’hui ? Toujours l’amitié, mais aussi les bruits de la vie, les odeurs du pays. Car Le Gouic ne choisit pas entre la vie et la poésie. Celle-ci s’alimente de son quotidien. Ce qu’il aime, dit-il, c’est « tailler les arbres, débiter du bois, nettoyer le jardin » (mais aussi classer ses archives ou préparer un nouveau livre). Il aime le passage du maçon qui vient réparer un mur. « J’entendrai le bruit de son marteau sur la pierre, le ronronnement satisfait de sa bétonnière. Quand il partira, je percevrai un vide en moi. Le même que celui du Tour de France quand il se termine ».
Ce grand vide, ce sera aussi en septembre 2019, celui provoqué par la disparition brutale et accidentelle de son perroquet appelé familièrement Georges, compagnon de tous les jours qu’il avait acheté il y a cinquante ans sur un marché de Douala. « L’espace de Kermadeoua s’est vidé de toute chaleur, de toute vie. Le silence est palpable comme des flocons ». Ce sont presque les derniers mots de ce journal intime.
Au seuil de Kermadeoua, Gérard Le Gouic, éditions des Montagnes Noires, 407 pages, 18,50 euros.
 |
Nicole Laurent-Catrice, |
| Pour la vie |
|---|
Aphorismes, maximes, exhortations : le nouveau petit livre de la rennaise Nicole Laurent-Catrice ouvre de larges perspectives. On y parle de l’amour, de la mort, du mal… Mais surtout de la vie. Autrement dit tout ce qui doit être au cœur d’une vraie création poétique.
Il faut avoir une profonde expérience de la vie (et en avoir retenu les leçons) pour s’aventurer dans une telle démarche d’écriture. Dire en quelques mots – parfois sous la forme d’un conseil avisé – ce qui doit nous animer vraiment dans la vie. Porter, aussi, un regard distancié sur le monde et savoir – « plein d’usage et raison » – faire la part des choses. Au fond, adopter la posture (au bon sens du terme) d’un sage revenu de toutes les illusions et désormais à même de délivrer à d’autres son expérience intime. « Il y a pire que la mort / c’est la mort qu’on élude // accepter sa mort / c’est encore vivre », écrit Nicole Laurent-Catrice.
Comment, lisant ces mots, ne pas penser à ces vers du poète persan Yunus Emre, « Ta mort sera ce qu’a été ta vie, / Demain, ce qu’a été aujourd’hui ». Comment, aussi, ne pas évoquer François Cheng pour qui la mort fait partie de la vie comme il le dit dans son livre Cinq méditations sur la mort autrement dit sur la vie (Albin Michel). Car pourquoi ne pas dire ici que les courts textes de Nicole Laurent-Catrice s’inscrivent dans la lignée de tous ces grands auteurs qui nous délivrent de vraies leçons de sagesse. Citons Tchouang-Tseu, le taoïste : « S’intérioriser sans exagération / s’extérioriser sans démesure / savoir se tenir au juste milieu / ce sont là trois éléments d’essor ». Nicole Laurent-Catrice le dit d’une autre manière : « Celui qui s’avance derrière / un tonnerre de décibels / n’a pas l’assurance / de celui qui s’appuie le dos au pur filet de sa voix »
Pourquoi, la lisant, ne pas penser aussi aux quatrains d’Omar Khayyam. « Mal et bien se disputent le cœur ; /Tristesse et joie sont le lot de chaque homme. / Ne vis pas dans la crainte des planètes / Elles sont mille fois plus impuissantes que nous ». À propos, précisément, du bien et du mal, Nicole Laurent-Catrice écrit pour sa part. « Faire le mal / et dire que c’est le bien / c’est un double mal. // Est-ce cela le péché / contre l’esprit ? »
Cette filiation avec les penseurs, poètes ou philosophes vivant sous d’autres cieux, à d’autres époques, ne doit pas nous empêcher d’écouter la partition originale de l’auteure. « Écoute, / le secret est dans la distance. // Quand tu fais corps / avec l’autre / c’est toi que tu aimes encore. // Seule la distance te rend proche ». Une manière (très bretonne ?) d’exprimer sa réserve et sa pudeur, à moins qu’il ne s’agisse de faire valoir sa liberté foncière face aux injonctions de la collectivité dans laquelle on vit (un conseil sur la « distance », qui prend, en tout cas, une tonalité particulière à l’aune des événements actuels). Et que dire de ces quelques lignes : « Les femmes dites libérées / s’empressent d’abdiquer / leur liberté nouvelle /entre les bras d’un tyran. // la femme vraiment libre n’a que des compagnons ».
Pour ce qui est de la poésie, Nicole Laurent-Catrice a cette définition qui vaut largement celle que l’on peut trouver dans des ouvrages prétentieux sur le sujet. « Poésie / le doigt posé / sur la plaie vive. // Elle panse sans y penser ». Une assertion qui rejoint, dans sa simplicité et sa beauté, celle de Guillevic : « La poésie / c’est autre chose ».
Pour la vie, Nicole Laurent-Catrice, La Part Commune, 75 pages, 12 euros.
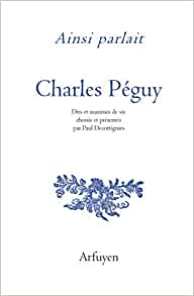 |
Paul Decottignies, |
| Ainsi parlait Charles Péguy |
|---|
Que de clichés ou d’idées fausses sur Charles Péguy facilement associé à certaines images d’Épinal : Jeanne D’arc et Orléans (où l’auteur est né en 1873), le pèlerinage de Chartres, sa mort au front en 1914… Sait-on vraiment qu’il était foncièrement républicain, socialiste, dreyfusard, et, bien que chrétien, en conflit avec l’Église catholique. Il y a plusieurs Péguy dans Péguy. C’est ce que nous montre ce livre, florilège de citations extraites essentiellement de ses poèmes ou de ses « Cahiers de la quinzaine » qu’il avait créés en 1900.
Dans le viseur de Charles Péguy, il y a d’abord le monde moderne dont les traits qu’il en tire nous amènent à établir un parallèle avec notre propre époque. Pour Péguy ce qui l’environne est un « enfer » parce que c’est « le règne de l’argent » dans un « monde bourgeois et capitaliste consacré au plaisir ».
Car l’auteur a une forme de nostalgie de l’ancienne France. « On peut dire dans le sens le plus rigoureux des termes qu’un enfant élevé dans une ville comme Orléans entre 1873 et 1880 a littéralement touché l’ancienne France, l’ancien peuple, le peuple tout court ». Cette ancienne France était celle, selon Péguy, où le travail avait un sens, où la grandeur venait du peuple, où la culture et la connaissance primaient sur le frivole et le divertissement. « Dans ces temps-là, un chantier était un lieu de la terre où les hommes étaient heureux (…) Nous avons connu un honneur du travail exactement le même que celui qui au Moyen-âge régulait la main et le cœur (…) Il n’y avait pas cet étranglement économique d’aujourd’hui, cette strangulation scientifique ».
D’où peut venir le salut ? Du socialisme ? Pas si sûr, même si Péguy se range de ce côté-là. Il est nettement en faveur de la raison libre et de la justice sociale. Mais La rupture est vite venue avec Jaurès car pour Péguy « la révolution sociale sera morale ou ne sera pas ». Sans compter qu’il reproche à l’homme politique une forme de capitulation devant l’Allemagne dès 1905 (quand Guillaume II débarque à Tanger pour contrer les visées françaises sue le Maroc). Jaurès, lui, voit chez Péguy une forme « d’anarchisme moraliste ».
Le salut pourrait-il alors venir de l’Église catholique ? Sans doute encore moins car, pour « Péguy l’hérétique » (titre de la préface du livre), elle est devenue « la religion officielle de la bourgeoisie de l’État ». On sait peu que Péguy se maria civilement, qu’il ne fit pas baptiser ses enfants et que les journaux catholiques le détestaient. Ce qui ne l’a pas empêché d’exprimer son Dieu à lui dans ses différents écrits (poèmes, articles, chroniques…).
Homme de l’emphase et souvent de l’outrance, « ardent », « inquiet », « excessif », comme le note Paul Decottignies en préfaçant ce livre, Péguy se révèle ici dans toute sa complexité.
Ainsi parlait Charles Péguy, dits et maximes de vie choisis et présentés par Paul Decottignies, Arfuyen, 174 pages, 14 euros
 |
Marie-Claire Bancquart, |
| De l’improbable |
|---|
Un livre ultime, rendu possible par la fidélité de son entourage à son œuvre. Marie-Claire Bancquart nous livre une belle méditation poétique sur le « somptueux mystère de la mort » et sur son « afflux d’interrogations ». Textes écrits dans « l’enclos de la maladie », dans la « violente solitude » et dans l’expérience d’une souffrance qui fut pour elle fondatrice. « Et toi douleur / tu t’obstines / dans les côtes, les poignets / qui seront inertes après notre mort ».
Marie-Claire Bancquart est décédée en février 2019 à l’âge de 87 ans. De l’improbable réunit des textes inédits de l’auteure, pour la plupart écrits dans la période de rémission partielle de sa maladie et recueillis par le musicien Alain Bancquart, le compagnon de toute sa vie. Marie-Claire Bancquart, qui a connu la maladie dès son plus jeune âge, a néanmoins pu mener une vie de professeur de littérature française (elle enseigna notamment à Brest) et entamer une vie d’écrivain en commençant par le roman et en le poursuivant par la poésie. Son œuvre est entrée dans la collection Poésie-Gallimard sous la forme d’une anthologie intitulée Terre énergumène.
Dans ses derniers textes, publiés aujourd’hui, elle nous dit : « Oui, belle la vie ». Et s’empresse d’ajouter que cette vie « exige d’être calcinée, bercée, tournée vers la plus petite des herbes, comme vers une existence immense, embellie ». Ah ! les herbes dont elle vante la « musique imperceptible ». Elles parcourent son livre. Marie-Claire Bancquart se penche vers elles comme si elle y trouvait un ultime secours. À moins qu’à travers les herbes elle ne nous parle, d’abord, de notre fragilité foncière. « D’ossature en ossements, se creuse toute une vie, jusqu’à l’herbe qu’on partage avec l’oiseau mort ». Ailleurs elle s’interroge : « Pourquoi est-ce que je vous aime / particulièrement / racines et mauvaises herbes »… Sans doute, comme l’a dit le poète Richard Rognet, « l’herbe a la grâce du temps qui passe avec / l’innocence du silence ou la patience / de l’espoir » (Élégies pour le temps de vivre, Poésie-Gallimard)
Marie-Claire Bancquart ne nous parle pas d’un au-delà de la mort. Elle attend sa réunion avec la terre « dans l’indistinction » pour se reconnaître « comme éléments du presque rien / désormais complices ». Quant à Dieu, « cet inconnu », il « pourrait être l’arbre du jardin /ou tel nuage / traversé d’oiseaux ». Elle en donne une autre définition qui ne manque pas de force. « N’est-il pas le nom le plus connu, le plus probable, donné à nos désirs ? »
De l’improbable, précédé de MO(R)T, Marie-Claire Bancquart, préface de Aude Préta-de-Beaufort, Arfuyen, 98 pages, 12 euros.
 |
Pierre Tanguy, |
| Billet (du confinement) |
|---|
En ces périodes très particulières, l’heure est souvent au rangement de papiers, de dossiers, et à la mise en ordre de sa bibliothèque. Cela est actuellement mon cas et je suis tombé, le faisant, sur un supplément du Courrier international (daté de novembre 2004) consacré à la poésie. L’hebdomadaire faisait le tour de l’état de la poésie dans le monde avec des articles issus de différentes revues. Il y avait, pour l’Italie, ce titre qui vous rappellera quelque chose : « Trente millions d’Italiens atteints par le virus ».
Le virus de la poésie, bien entendu. « Le public jeune afflue aux lectures de Dante, les cheminots organisent des joutes oratoires, les éditeurs croulent sous les manuscrits. La poésie serait-elle devenue une mode ? », pouvait-on lire dans le chapeau du papier.
L’article, extrait de la revue Panorama et daté de Milan, poursuivait : « La poésie se répand comme une maladie contagieuse. Le nombre peut paraître exagéré, mais il y a bel et bien eu 2 000 prix de poésie organisés en Italie l’an dernier. Internet et la technologie sont complices de la diffusion du virus ».
Et, chacun le sait, la poésie est un virus difficile à éradiquer. Une véritable herbe folle.
Quimper, 9 avril 2020
 |
Jacques Josse, |
| La vision claire |
|---|
La poésie du Rennais Jacques Josse – né natif des Côtes-d’Armor – est à l’image de la peinture qui illustre la couverture de son livre : crépusculaire, entre chien et loup, dans un paysage où cohabitent taillis, bosquets, marécages, ruisseaux… Avec, en toile de fond, quelque chose qui fait penser à des récifs sous un ciel sombre, à une côte découpée, à un pays (le Goëlo) qui a « le dos tourné à la Manche » mais qui se souvient « des pêcheurs perdus / dans des doris / fantômes / au large / de Terre-Neuve ».
Josse nous parle d’un territoire où s’ancre son écriture (aussi bien dans ses poèmes que dans ses nombreux récits). Territoire tout aussi mental qu’incarné dans lequel s’ébrouent des hommes et des femmes au bord de la rupture. À l’image de Georges, « sourire d’algues, barbe grise » qui « s’est pendu mardi soir ». Et de tous ces hommes et de toutes ces femmes que le poète côtoie sur les quais, dans les rues, dans les chemins ou au bistrot, et qui ont tous un « besoin de consolation impossible à rassasier » (Stig Dagerman). Par chance, les bons samaritains existent là où on ne les attend pas forcément. À l’image de cette serveuse qui « filtre nos prières, nos pleurs » et qui « nous guidera aux creux des digitales, entre l’absence et la mélancolie ».
Mais la mort rôde qui « déplie l’agenda / des silences / à la page / du jour ». Car, « ici nul / ne s’exerce / à retenir le sang / des morts qui coule / sous les herbes ». Ainsi, lors d’un retour en voiture la nuit du côté de Plestan, raconte l’auteur, « c’est la ronde des gyrophares » car « un pantin démantibulé gisait recroquevillé sur le bord de la chaussée. Ciré jaune, bottes sales… »
Nous sommes tous, au fond, nous dit Jacques Josse, des « voyageurs égarés » sur cette terre, des « arpenteurs de solitude ». Mais pourtant, en dépit de tout, quelque chose persiste à clignoter (« les feux de la côte nord ont pris possession de l’obscurité »). Le « lieu désir » existe (« loin des ruines, des épaves »). Il faut s’employer, comme le fait sans doute le poète, à « colorer les ornières », garder « des étoiles dans le cœur », comme le il le dit en pensant à cet homme dont le « cœur a lâché la joie / pour l’ombre obscure d’un midi / qui s’est teinté de noir ».
De ses premiers recueils (dont on retrouve certaines traces dans ce nouveau livre) jusqu’à ses textes les plus récents, Jacques Josse se maintient sur une ligne de crête. Il déroule une partition, reconnaissable entre toutes (faite de textes brefs et bien frappés), pour conter les heurs et malheurs de notre être ici-bas.
Vision claire d’un semblant d’absence au monde, Jacques Josse, éditions Le Réalgar (collection l’Orpiment), www.lerealgar-editions.fr, 130 pages, 13 euros, Couverture : Jean-Luc Brignola, peinture sur huile.
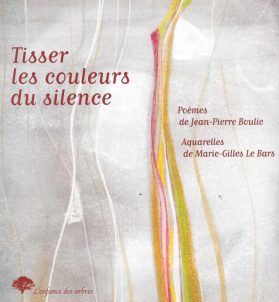 |
Jean-Pierre Boulic et Marie-Gilles Le Bars, |
| Tisser les couleurs du silence |
|---|
Un poète et une artiste peintre. Jean-Pierre Boulic et Marie-Gilles Le Bars unissent leurs talents pour « tisser les couleurs du silence » en une trentaine de poèmes pour l’un, et autant d’aquarelles pour l’autre. Leur création relève avant tout de l’exercice spirituel, marqué par cette sensibilité chrétienne qui leur est commune.
De quoi le silence est-il le nom ? Jean-Pierre Boulic esquisse une réponse : « Trouvère de l’invisible / Il s’avance gardien des mots / Passeur des signes de la terre ». Ces signes sont reconnaissables sous la plume de l’auteur finistérien. Ils se nomment « violettes », « fusains », « sauges », « hortensias », « orges » et « l’herbe drue et verte des prairies / Où se nourrissent les anges ». Sans oublier les oiseaux et « la feuillaison de leurs chants ». Mais – une fois n’est pas coutume – rien n’apparaît ici du Pays d’Iroise, où vit l’auteur, dont il a chanté les vents hurlants et les ciels changeants dans tant de ses poèmes. Sa poésie, ici, prend une tournure plus mystique.
Cette poésie-là devient, en réalité, le lieu de la méditation. On pourrait même dire de la prière, rejoignant par là-même les intonations des écrits de Gérard Bocholier, autre poète chrétien, pour qui « l’exercice de la parole poétique aspire à provoquer un surgissement, une apparition de l’invisible ». Les mots ne manquent pas d’ailleurs, sous la plume de Jean-Pierre Boulic, pour évoquer ce surgissement. Apparaissent, au fil des pages, les mots « invisible », « indicible », « insaisissable », « enfantement », « épiphanie », « éternité »… Langage quasi-liturgique pour dire l’émerveillement d’être au monde, pour « butiner / Les couleurs du silence » car « Plus que jamais / C’est au présent / Que tout se vit ».
L’artiste Marie-Gilles Le Bars est au diapason. Présentant son travail de création, elle écrit : « La nature, la poésie et la quête du fil de vie qui nous relie tous entre Terre et Ciel, restent mes inépuisables sources d’inspiration » (comme en écho à ces vers de Jean-Pierre Boulic : « Silence / Tu vis de terre à ciel »).
Les aquarelles (abstraites) de l’artiste nous laissent envisager un monde chatoyant, empreint de plénitude, riche en couleurs, marqué par « un certain sourire sur la vie » et comme irrigué par les veines du silence. À moins que, parfois, certaines peintures circulaires ne nous ramènent aux mandalas. « Mon rôle d’artiste, c’est de faire passer des messages de paix et d’amour, perçus de façon consciente ou inconsciente, note l’artiste, afin que les gens captent la résonance de la lumière divine ». On ne peut pas mieux annoncer la couleur.
Tisser les couleurs du silence, poèmes de Jean-Pierre Boulic, aquarelles de Marie-Gilles. L’enfance des arbres, 65 pages, 20 euros.
 |
Yves Elléouët, |
| Dans un pays de lointaine mémoire |
|---|
Lire et relire la poésie de Yves Elléouët. Surtout connu pour ses deux récits (Falch’un et Le livre des rois de Bretagne), il était aussi poète. Voici rassemblé, dans un recueil édité par Diabase, l’essentiel de son œuvre, marquée à la fois par ses origines bretonnes et l’influence qu’exerça sur lui le surréalisme.
« C’étaient les grandes outres du ciel / dans un pays de lointaine mémoire (…) la nuit couchée sur les troncs couchés / les bourrasques dans le cœur d’août / la pluie veuve et se traînant ». Ce pays de lointaine mémoire avec « la pierre levée des clochers » est celui dont est originaire le père d’Yves Elléouët : la vallée de l’Élorn du côté de Landerneau, plus précisément La Roche-Maurice. Le jeune Yves y passera les années d’Occupation chez sa grand-mère paternelle, avec sa tante et son oncle Yves. Il y retournera régulièrement dans les années qui suivirent (celles d’une courte vie puisqu’il mourra à 43 ans en 1975). « Je suis d’Armorique cette péninsule barbare // où les eaux de la terre crèvent sa peau d’herbe et d’épines // nous Celtes ivrognes errants / et tout pleins d’amertume ».
Des lieux surgissent dans ses poèmes qui témoignent de son attachement à ce « terroir » (Pencran, Guimiliau, Argenton…) avec ses « fermes en toit de beurre » et ses « molles pluies ». Mais Yves Elléouët n’est pas un écrivain régionaliste (surtout pas !). Ce pays de lointaine mémoire, il le transfigure d’une plume qu’il a trempée dans l’encrier du surréalisme. Ce qui rend son œuvre d’une certaine manière « inclassable », même si on peut la qualifier « de Bretagne certainement », comme le souligne Ronan Nédélec dans la préface de ce livre. « Il erra dans un lieu – la Bretagne – comme dans la langue avec le désir que ces deux errances ne fassent plus qu’une », expliquait le poète Michel Dugué dans un numéro spécial de la revue Encres vives consacré à Elléouët en janvier 1983.
Voilà donc un poète « de Bretagne », mais aussi de Paris où il vivra et travaillera. D’abord dans les métiers de l’imprimerie avant de se consacrer à l’écriture et à la peinture (il épousera en 1956 Aube la fille d’André Breton). Quelques uns des ses poèmes seront publiés de son vivant sous le titre La proue de la table (éditions du soleil noir, 1967). Mais il faudra attendre 1980 pour que paraisse Au pays du sel profond (éditions Bretagnes) puis Tête cruelle (éditions Calligrammes, Quimper 1982). Les poèmes de ces deux recueils avec quelques inédits sont aujourd’hui réédités sous le titre Dans un pays de lointaine mémoire.
À la sortie du livre Au pays du sel profond, le poète et journaliste Xavier Grall avait parlé, dans le quotidien Le Monde, à propos des poèmes de Yves Elléouët, de « scènes surréalistes », de « petits tableaux crépusculaires », de « voyances brèves ». On en retrouvera deux ans plus tard dans Tête cruelle.
Des scènes surréalistes ? Il suffit de lire ces premiers vers du poème intitulé Limericks : « une angélique ingénue de Toulouse / buvait du gin en tondant la pelouse / un crocodile survint qui lui mangea un pied ».
Des petits tableaux crépusculaires ? Il y en a dans le poème intitulé Pencran : « petit café-tabac / je m’y vois jadis lamper du vin fort / dans des grands verres / la pluie crible la vitre / on lève la tête / tout est noir / un ruban de papier tue-mouche pend dans la pénombre ».
Des voyances brèves ? Attardons-nous sur le poème « Les diables » : « au bord des routes / sur les chevaux pommelés des journées lentes / en automne / une femme noire de foudre attend / un promeneur malade ».
…/…
On voit aussi, dans de très nombreux poèmes, circuler des figures de la mort. Yves Elléouët n’a pas connu pour rien l’ossuaire de l’enclos paroissial de La Roche-Maurice. L’Ankou (messager de la mort en Bretagne) y est sculpté dans la pierre. Il interpelle les vivants : « Je vous tue tous ». Dans un de ses textes, le poète nous dit qu’il entend les morts « monter l’escalier » et, sous sa plume, l’horloge qu’on voit dans les maisons de campagne peut devenir « un grand cercueil noirci ». Quant aux danses macabres qu’il a du entrevoir sur les murs de certaines églises bretonnes, elles lui font écrire que « tous les morts sont venus danser / autour de nous autour de nous autour de nous ». Ajoutant : « il est vrai que les morts dansent depuis des temps immémoriaux ».
Ces visions de la mort – leur côté fantastique – rejoignent son penchant pour le surréalisme. C’est le cas aussi pour la mythologie celtique, dont le « flot tumultueux » (Michel Dugué) imprègne de très nombreux poèmes. « Un certain paysage celte est ancré en lui, le constitue. C’est sa signature », souligne Cypris Kophidès dans la postface du livre. On voit ainsi, au fil des pages, surgir Tintagel ou Galway, mais aussi deux grands poètes des pays celtes : le gallois Dylan Thomas, l’Irlandais James Joyce. « Je vous vois / James Joyce / je vois votre figure multicolore ».
Si le sentiment de la mort, si la Bretagne ou si la « magie » des pays celtes imprègnent l’œuvre poétique d’Yves Elléouët, il ne faut pas oublier pour autant son aspiration à la vie sous toutes ses formes et notamment à l’amour (« l’air des falaises habitait ton visage »). Ce mélange rend souvent sa poésie déroutante mais elle nous le montre « fidèle témoin de la blessure ténébreuse de l’homme », souligne Cypris Kophidès. Et elle a joute : « Ce qu’elle dit s’échappe d’un lieu et d’un temps car elle parle de la condition humaine »
Dans une deuxième partie du livre sont publiées les lettres d’une correspondance que Yves Elléouët a entretenue avec André Breton, Michel Leiris, mais aussi (lettres plus rares) avec Per Jakès Hélias, Xavier Grall, Georges Perros. Elles apportent un éclairage nouveau et inédit sur l’auteur. Il a 23 ans quand il adresse sa première lettre à André Breton en ces termes : « C’est avec le désir de me joindre à vos Mystères que je vous écris. Le surréalisme étant la seule voie menant à la Découverte. La seule lampe d’alchimiste allumée sur la nuit. Le seul guetteur sans doute accoudé aux tours de garde des siècles passés et à venir ».
Dans un pays de lointaine mémoire, poèmes et lettres, Yves Elléouët, Diabase Littérature, préface, avant-propos et notes de présentation de Ronan Nédélec, 181 pages, 19 euros.
 |
Nicolas Rouzet, |
| Villa mon rêve |
|---|
Il vit aujourd’hui à Marseille. Mais c’est un homme du Nord. Nicolas Rouzet revient, dans son livre, sur les secrets familiaux autour de ses années d’enfance du côté de Dunkerque. Tout un univers revit sous sa plume. Il le fait sous forme de fragments, dans une prose (poétique) de belle facture.
Présentant ce livre, l’éditeur souligne qu’il accueille dans sa collection « brèche », « des textes en marge, du roman et de la poésie : récits brefs, nouvelles, proses inclassables, théâtre ». Villa mon rêve, qui donne son titre au livre de Nicolas Rouzet fait à la fois partie de ces « récits brefs » et « proses inclassables » (à forte connotation poétique) qui font l’originalité et la force de certains auteurs. On pense, en Bretagne, à Jacques Josse qui revient inlassablement dans ses écrits sur un terreau familial (et plus largement de voisinage) du côté du Goëlo dans les Côtes d’Armor.
Avec Nicolas Rouzet, on est dans le même type d’écriture mais cette fois sur le littoral de la Mer du Nord (autour d’une « villa mon rêve »), pour nous parler de destins cabossés ou de personnages qui « sortent des clous », à l’image de ce grand-père Guy qui termina sa vie dans une remise, presque aveugle. « Il jouait des lieder sur un clavier muet dont il avait peint les touches blanches et noires », raconte l’auteur. « En ces temps-là, dit-il ailleurs, nous avions pour voisin l’ingénieur Wadeck et sa sœur. Trépané, Wadeck avait perdu l’usage de la parole ».
En toile de fond de ce livre, il y a la guerre et ses désastres (« cet été-là, les crevettes énormes buvaient le sang des noyés »), le temps des compromissions ou des engagements, celui de secrets familiaux soigneusement entretenus. Voilà le pays où l’auteur voit le jour. Pays plat, pays froid, avec les cris des mouettes revenant chaque hiver « avec la même régularité, la même acuité ». Pays portant les lourds stigmates de la guerre. « Dans les jours de mon enfance, nous jouions, je me souviens comme on raclait le bitume, pour extraire de la cour de l’école des cartouches, des munitions sous le sable, sous la terre ». Et quand les petits écoliers trouvaient un tibia il s’en servaient pour faire des « passes d’armes » avant de se le faire confisquer.
Le jeune Nicolas n’arrive pas à « briser la glace de l’étrangeté du monde » dans ces « jours ternes » de son enfance. Un monde s’agite autour de lui dont il ne saisit pas tous les mystères. Des adultes, souvent brinquebalants, se fourvoient dans certaines impasses de la vie amoureuse. Ainsi nous dit-il, à propos de son père, qu’il « rencontra une autre femme au sanatorium. Elle était entièrement paralysée, seul le sourire un peu crispé sur son visage et ses yeux étaient encore mobiles. Il la trouvait très belle… »
Il faut lire Nicolas Rouzet. Sa prose acérée vise juste. Il nous parle de l’humanité comme le fait, à sa manière, le cinéaste Bruno Dumont, un autre homme des rivages austères du nord de la France.
Villa mon rêve, Nicolas Rouzet, éditions Mazette, 57 pages, 10 euros.
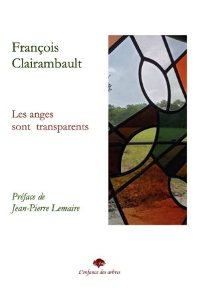 |
François Clairambault, |
| Les anges sont transparents |
|---|
« Pour écrire, il faut un cœur bouleversé », nous dit François Clairambault dans le premier recueil qu’il publie. Dans la majorité de ses poèmes – comme autant de textes écrits « sur le motif » – il nous livre une vision du monde où l’empathie se mêle à la compassion. Sans jamais se déprendre d’une forme d’émerveillement.
Comme dans les livres de Christian Bobin, il y des anges dans les poèmes de François Clairambault. Chez lui ils sont « transparents » et « contagieux ». Autant dire qu’ils sont partout. Dans le plus infime comme dans l’anecdotique. Et à la suite de Bobin affirmant que « le plus familier est tissé d’éternel », François Clairambault sait nous plonger dans les réalités les plus ordinaires en les auréolant de mystère et de merveilleux.
Dans un square, voici un homme « dans son manteau de feuilles mortes ». Dans cet autre square, des mamans tissent « des vanneries de paroles ». Sous le pont du périphérique, « une famille de carton s’accroche au mur ». Sur le grand boulevard, une femme « cuit des rissoles au feu de son petit réchaud ». Et le poète parle de sa « dînette incongrue ». Au bord de la voie ferrée, les coquelicots deviennent « gouttelettes de sang dans l’haleine brumeuse du train matin ».
François Clairambault est un homme aux aguets, traque le passage des anges à la sortie du métro, derrière la vitre d’un bistrot, à l’intérieur d’un hôpital. Il regarde une petite fille qui « course un pigeon » et voit la nuit tomber « sur des filets de jeunes dames » postées sur les trottoirs. Quand c’est la veille du printemps, il note que « les tapis volants se tiennent prêts sur les rebords de fenêtres / à côté des sous-vêtements qui respirent enfin ». Et quand il pleut, « un torrent de diamants, nous dit-il, s’abat sur le caniveau ».
Transfigurant le réel, il « repeint » sa vie « avec des gens ». Il nous parle de l’amour, d’une femme et du « grenier » de ses yeux (« Quand mes mains osent les tiennent / il n’y a plus aucune distance entre l’infini et nous »). Il nous parle de l’ami disparu et, donc, de son « cœur bouleversé ». Pour approcher ainsi le mystère de la vie, François Clairambault a su s’abreuver à certaines sources. Elles coulent en minces filets dans son recueil quand il évoque le Zacharie ou l’enfant prodigue des Écritures. « Peut-être le poème est-il l’instrument les plus approprié pour décrire ces avancées, ces retards, ces surprises de la vie spirituelle, ce voyage qui nous emmène vers une présence, si près de nous », souligne le poète Jean-Pierre Lemaire dans la préface de ce livre. Il a raison.
Les anges sont transparents, François Clairambault, préface de Jean-Pierre Lemaire, éditions L’enfance des arbres, 130 pages, 15 euros.
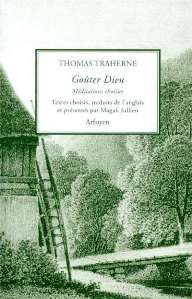 |
Thomas Traherne, |
| Les méditations d’un poète mystique anglais |
|---|
Qui connaît Thomas Traherne ? Pas grand monde en vérité. Cet auteur britannique, prêtre de l’Église anglicane, n’a commencé à sortir de l’ombre qu’au début du 20e siècle. Poète mystique, il a rédigé de nombreuses méditations à connotation métaphysico-religieuse dont des morceaux choisis sont aujourd’hui publiés en France.
Contemporain de Pascal mais aussi du poète mystique allemand Angelus Silesius (1626-1677), Thomas Traherne est né en 1637 dans une famille très modeste du Herefordshire dans l’ouest de l’Angleterre. Après son ordination, il est nommé dans une paroisse proche de son lieu de naissance avant de devenir le chapelain du Lord Garde des sceaux. Il meurt en 1674 à l’âge de 37 ans. Un seul de ses écrits sera publié de son vivant (Roman forgeries) et il faudra attendra 1903 pour qu’il sorte d’une forme d’anonymat avec la publication, à Londres, de ses Poetical works.
« O mon Âme, marche parmi ces Arbres, Regarde ces étoiles, Admire ces Cieux, ils sont le Pavé sous tes pieds. Et le soleil lui-même est fait pour te servir, allonge-toi le long de ces Doux Ruisseaux et repais-toi de ces plaisants Pâturages ». Ailleurs il écrit : « Sage et Saint doit être l’homme envers toutes les créatures du Ciel et de la Terre ». Des propos d’un « écologisme » de bel aloi qui détonent dans le contexte de l’époque.
Mais ce ne sont pas les seuls propos à détonner. Thomas Traherne prend d’autres libertés, notamment avec tout ce qui touche à la notion d’éternité. « Parce que Dieu est en chaque Instant, toute l’Éternité peut-être Perçue à chaque instant », écrit-il. En préfaçant ces méditations, Magali Jullien rappelle que « Hobbes ralliait les scolastiques pour leur conception de l’éternité en tant que séparée du temps ». Pour Traherne, poursuit-elle, « cette dualité est dépassée, car le temps ne peut être pensé indépendamment de l’éternité et le concept d’éternité s’il n’était pas articulé à l’idée du temps serait vide et inutile ».
Voila qui constitue bien la singularité de Traherne et qui justifie, entre autres, que l’on s’intéresse à cette pensée « d’avant-garde » assortie de recommandations et d’exhortations de bon sens (« l’Amour de l’argent est la Racine de tous maux », « La Tempérance dans l’Expression est l’Art qu’il faut adopter parmi les fils des hommes »). Thomas Traherne avait un art de vivre élémentaire qu’il résume en ces termes : « Ici un aphorisme, là un Chant ; ici une supplique, là une Action de Grâce. Ainsi étoilons-nous notre chemin vers le Ciel ». L’Église anglicane l’a fait saint.
Goûter Dieu, méditations choisies, textes choisis, traduits de l’anglais et présentés par Magali Jullien, éditions Arfuyen, 240 pages, 17 euros.
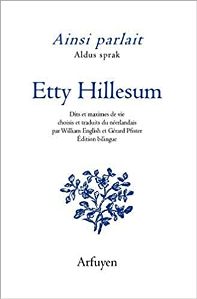 |
William English et Gérard Pfister, |
| Ainsi parlait Etty Hillesum |
|---|
Jeune juive hollandaise, Etty Hillesum est morte en déportation à Auschwitz le 30 novembre 1943 à l’âge de 29 ans. Elle est l’auteure de carnets et de lettres dont un florilège est réuni dans un ouvrage qui met en valeur l’influence exercée sur elle par l’œuvre du poète Rainer Maria Rilke.
Le destin particulier d’Etty Hillesum n’en finit pas de susciter analyses et commentaires. Voilà une jeune femme qui, deux ans après l’invasion de son pays par les nazis en mai 1940, se met – à ses risques et périls – au service des personnes placées au camp de transit de Westerbork. Quand elle-même sera déportée, elle emportera dans son sac à dos la Bible, un dictionnaire russe (sa mère avait fui les pogroms russes en 1907) mais aussi Le livre d’heures de Rainer Maria Rilke.
En présentant et en choisissant des extraits de ses écrits (288 fragments au total), Gérard Pfister note que « c’est cette qualité d’attention au monde extérieur comme au monde intérieur, c’est cette gravité qu’Etty a apprises de Rilke et intégré à sa manière d’être ». Il ajoute : « chez Rilke, Etty a appris l’acceptation du monde tel qu’il vient et la capacité de le voir vraiment, en ce qu’il a toujours de « beau » et de terrible ». Ce qui fait également dire à Gérard Pfister que « bien des attitudes d’Etty (…) peuvent plus aisément trouver leur grille de lecture dans la vision du monde rilkéenne que dans des influences religieuses, qu’elles soient juives et chrétiennes ».
On comprend mieux que la jeune Etty, au plus profond de cette détresse qu’elle côtoie au camp de transit, ait pu ressentir l’œuvre de Rilke comme un phare dans la nuit, comme une étoile qui vous guide vers d’autres horizons. « Et de quoi, écrit-elle, peut-on bien parler quand on se retrouve avec tant de soucis et de responsabilités sur quelques mètres carrés de lande grillagée dans la plus pauvre des provinces de Hollande ? De Rainer Maria Rilke, bien sûr ! ». Etty voit en Rilke « une tendresse qui s’enracine dans un terreau originel de force et de rigueur vis-à-vis de soi-même ». Elle veut lire Rilke « tout entier », « l’intégrer » en elle, s’en « dépouiller » puis vivre de sa « propre substance ».
Il y a dans ce livre de pensées, méditations, réflexions, bien d’autres considérations de sa part sur la vie et le monde : la nécessaire émancipation de la femmes (« peut-être la femme n’est-elle pas encore née en tant qu’être humain »), le refus de l’esprit de système, l’importance de la poésie (« un vers de poésie est une réalité de même grandeur qu’un ticket de fromage ou des engelures »), l’art d’économiser ses mots (« que chaque mot soit une nécessité »), une nouvelle approche de Dieu (« une chose m’apparaît de plus en plus clair : ce n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui devons t’aider »)…
Etty Hillesum renverse les perspectives. Ses pensées sont plus que jamais à méditer en ces temps de chaos. « Toutes les catastrophes procèdent de nous-mêmes », estimait la jeune femme.
Ainsi parlait Etty Hillesum. Dits et maximes de vie choisis et traduits du néerlandais par William English et Gérard Pfister, édition bilingue, Arfuyen, 180 pages, 14 euros.
 |
Bernard Perroy et Nathalie Fréour, |
| Un rendez-vous avec la neige |
|---|
Les poètes aiment la neige. Elle abolit tout, elle restaure le silence, elle nous offre un autre regard sur le monde. Et nous invite au dépassement. Bernard Perroy nous le dit en une vingtaine de poèmes, accompagnés par onze pastels de l’artiste nantaise Nathalie Fréour.
« Il a neigé tant de silence ». Bernard Perroy, poète né à Nantes mais vivant aujourd’hui en Sologne, cite en exergue de son livre le titre d’un recueil de Gilles Baudry (Il a neigé tant de silence, éditions Rougerie, 1985). Chez celui-ci, moine-poète de l’abbaye bénédictine de Landévennec comme chez Bernard Perroy, frère consacré à la communauté catholique des Béatitudes, il y a la même approche du silence. « En nous hiberne le silence, il nous allège », écrit Gilles Baudry. « Royaume du silence,// tu nous éveilles, tu nous interpelles », souligne Bernard Perroy qui, dans son recueil, fait de la neige le vecteur exclusif de ce silence. Une neige, qui au-delà du silence, nous renvoie à la « pureté » et à une « immobile clarté ».
Car les pouvoirs de la neige, sous sa plume, sont immenses. Ceux « d’effacer », « d’abolir », de « voiler ». La neige, dit encore Bernard Perroy, nous « sacre », nous apprend la patience, « éponge notre solitude », « nous met au large ». Propos métaphoriques sur les pouvoirs (insoupçonnés) d’un phénomène météorologique. Car il s’agit bien, dans ces poèmes, de signifier ce que la neige nous dit d’une forme de transfiguration voire de résurrection.
Empêtrés dans « les peaux mortes de nos âmes », dans « nos aspérités et nos lèpres », « nos cendres et nos scories », nous sommes invités par le poète à « dépasser nos peurs », à surmonter « les tumultes du cœur » et « notre solitude ». Il y a au bout du compte, dans la neige de Bernard Perroy, quelque chose qui relève de cette manne céleste, immaculée, seule à même de rassasier nos « cœurs mendiants ».
Pour accompagner cet appel, les pastels de Nathalie Fréour apportent ce qu’il faut de douceur et de légèreté même si les silhouettes d’arbres morts, dans un paysage de neige, sont là pour mieux souligner toutes ces « peaux mortes » appelées à sécher pour laisser place à de nouvelles floraisons.
Préfaçant un précédent ouvrage de Bernard Perroy (Petit livre d’impatience, éditions Le Petit pavé, 2011), le poète Pierre Dhainaut écrivait : « Bernard Perroy nous donne à lire ces empreintes à peine marquées qui nous disent qu’un enfant est passé dans la neige ». Ce sont ces empreintes-là que le poète a laissées sur les pages immaculées de son nouveau recueil.
Un rendez-vous avec la neige, poèmes de Bernard Perroy, pastels de Nathalie Fréour, éditions L’enfance des arbres (2, place vieille ville, 56700 Hennebont), 50 pages, 13 euros. Bernard Perroy publie par ailleurs Paroles d’aube dans la nuit (éditions La Porte)
 |
Yvon Le Men, Simone Massi, |
| Les mains de ma mère |
|---|
Les poèmes racontent-ils des histoires ? Oui, à coup sûr, sous la plume d’Yvon Le Men. Surtout quand ces poèmes parlent de l’enfance et racontent des aventures familières. Le poète breton s’associe pour le dire au grand dessinateur italien Simone Massi.
Courir à perdre haleine sur la plage, jeter des bouteilles à la mer (avec, de préférence, un message d’amour à l’intérieur), s’approcher des oiseaux, regarder la lumière des phares clignoter la nuit sur la mer… Autant de petites « aventures » que tant d’enfants (surtout autrefois et plus particulièrement en Bretagne) ont bien connues. Ces aventures avaient déjà été publiées dans deux des trois tomes de l’autobiographie poétique d’Yvon Le Men (Une île en terre en 2016 et Le poids d’un nuage en 2017, aux éditions Bruno Doucey). Les voici réunies en forme de best-off dans la collection Poes’histoires chez le même éditeur. Ne boudons surtout pas notre plaisir de lire ou relire ces textes poétiques (destinés à tout public) dont le dénominateur commun est l’enfance.
Si les mains d’une mère donnent le titre à ce livre, c’est parce qu’elles renvoient à une mère dont le poète a pris les mains « le jour où ses yeux se sont ouverts / une dernière fois ». Amour filial, retour sur « l’île » de parents aimés et aimants « quand les voyelles / pas si nombreuses / poussaient les consonnes / jusqu’au bout de leurs phrases / de leurs chants ». Et puis, le temps passant, la famille s’élargit jusqu’à ces « inconnus mais pas étrangers » que le poète rencontrera en Castille, en Finlande, au Danemark « le jour de Noël », à Bamako « le jour de l’Aïd », et dans tant d’autres pays.
Qu’il soit en Bretagne ou au bout du monde, Le Men conserve le regard émerveillé de l’enfance. « Nous avons regardé / à travers le vitrail / passer la mer et le ciel », écrit-il à propos d’une chapelle qu’il a visitée. « Et comme les enfants / écoutant chanter la mer / dans un coquillage // nous avons écouté / chanter les images / qui trempaient leurs couleurs / dans l’eau profonde du ciel ».
Les très beaux dessins de Simone Massi, célèbre dans le monde du cinéma d’animation, apportent une touche particulière à ce recueil. On voit un enfant sous le regard des adultes, tenant ici la main d’un père, absorbé ailleurs par la lecture d’un livre ou levant des yeux vers le ciel… Dessins en noir et blanc ponctués, à l’occasion, d’une petite touche de couleur : l’orange d’une orange dans la main, le rouge d’un rouge-gorge posé sur la tête. Magnifique !
Les mains de ma mère, Yvon Le Men, Simone Massi, éditions Bruno Doucey, collection Poes’histoires, 63 pages, 12 euros.
 |
Brigitte Maillard, |
| Il y a un chemin |
|---|
« Il y a un chemin dont le cœur porte le secret ». Brigitte Maillard propose dans le cinquième recueil qu’elle publie, un florilège de poèmes, méditations, aphorismes sur « l’épaisseur des jours » et sur l’art de réapprendre à vivre en dépit de tout. Et notamment de la maladie.
Dans un précédent recueil, Brigitte Maillard nous avait fait prendre le chemin vers la mer, du côté de la baie d’Audierne (La simple évidence de la beauté, éditions Monde en poésie, 2019). Elle nous propose aujourd’hui d’emprunter un autre chemin, celui de la vie intérieure, même si, en toile de fond, on continue à entendre vibrer « le chant ivre de la mer » et « l’humeur salée des jours ».
L’auteure nous dit avoir « traversé une longue période de maladie et, par ce chemin », avoir « commencé à parler à la rivière, chanter avec l’oiseau, rafraîchir la pluie ». Oui, c’est un regard lavé sur la vie qu’elle nous propose ici, avec un retour à ce qu’il y a de plus élémentaire : « Il y a peu de choses à savoir en ce monde, écrit-elle. Si peu. Le chant de l’oiseau, le clapotis des vagues et le mouvement des êtres ».
Brigitte Maillard nous invite à « nous ressourcer, nous relier au chant du monde ». Ce chant, dit-elle encore, est « celui de la grande fontaine » parce qu’il s’agit de « revenir à la source », de « vivre au présent, vivre sans retenue ».
La lisant, on pense à ces vers du poète iranien Sohrab Sepehri : « La vie n’est point vide : / Il y a aussi la tendresse, la pomme et la ferveur de la foi / Et, oui ! / Il faut vivre tant que demeurent les coquelicots ». Comme en écho, Brigitte Maillard vante « la nature aux pommiers sauvages » et le vent qui « chante son air limpide ». C’est la même ivresse qui entoure ses textes. Ce qu’il faut, dit-elle encore, c’est susciter « la grâce » pour défier « a bêtise humaine et sa gloire souveraine ».
L’auteure reste confiante même si « nous sommes comme des enfants apeurés ». Il y a un chemin qui mène vers une forme de délivrance. « Aujourd’hui je souffle et l’horizon ne se dérobe plus ».
Il y un chemin, Brigitte Maillard, éditions Librairie-galerie Racine, 60 pages, 15 euros
Lectures de 2019
 |
A. Dupoy de Guitard, G. Baudry, |
| Eaux intérieures |
|---|
Une photographe et un poète à l’unisson pour nous parler de nos rivières bretonnes. La photographe s’appelle Aïcha Dupoy de Guitard. Elle vit en presqu’île de Crozon. Le poète est Gilles Baudry. Il est moine bénédictin de l’abbaye de Landévennec. L’album qu’ils proposent aujourd’hui a été conçu à l’occasion des 50 ans de l’association Eaux et Rivières de Bretagne qui considère leur travail artistique comme une « contribution bien nécessaire à la préservation des droits de la rivière ».
Aïcha Dupoy de Guitard et Gilles Baudry avaient déjà collaboré dans un ouvrage consacré à l’arbre (Matin des arbres, 2017). Les voici à nouveau de connivence dans un livre qui « met en valeur, dans l’écrin le plus sobre et le plus simple, ce que nous avons de plus précieux. Cela qui nous concerne de la manière la plus urgente : la source secrète de nos vies », note Jean Lavoué dans la préface.
Nous voici, en effet, remontant à la source grâce à de somptueuses photographies ayant pour cadre les boucles de l’Aulne (du côté de Trégarvan ou de Landévennec), la vallée de l’Ellé, les gorges du Corong, les chaos du Huelgoat, les étangs ou marais des Monts d’Arrée. Paysages de légende d’une Bretagne intérieure d’où surgit, de ci de là, la figure d’une nouvelle Dame du lac à la robe immaculée et à la chevelure flamboyante. « En contrebas scintille / la rivière d’argent / où flotte / en rêve / l’ombre blanche des fées », note le poète. Le Huelgoat – car c’est de ce lieu dont il s’agit – n’est-il pas, en effet, l’autre (ou la vraie) Brocéliande du cycle arthurien ?
N’utilisant aucun trucage, aucun filtre, aucun adjuvant, la photographe nous introduit dans un monde exubérant où dominent cascades bondissantes, feuilles mortes flottant sur l’eau et mousses chapeautant les rochers. Monde élémentaire (presque primitif) où les maigres signes de vie animale ou végétale nous ramènent comme aux premiers temps de la Création (« Il y eut un soir, il y eut un matin… »). Voici le têtard, l’araignée d’eau, la libellule. Voici la plume qui signe la présence de l’oiseau. Voici la crosse de fougère, le panache de la linaigrette, la renoncule d’eau, le jonc, l’orchidée. Voici les bulles sur l’eau, l’eau irisée, les ronds dans l’eau. « Frisson de l’onde // les libellules / ne sont rien d’autre que / ce battement de cils // de la rosée », écrit Gilles Baudry en posant son regard « sur le miroir immobile des eaux / et sa mémoire baptismale ».
Car, oui, l’eau nous ramène immanquablement à la cette Vie donnée en abondance. Vigueur de la chute d’eau, transparence de son cours, éclat de sa lumière… La cascade impétueuse comme le ruisseau nonchalant dans la prairie disent tout de nos « eaux intérieures » car « syllabe par syllabe l’eau / épelle mot à mot / l’alphabet de nos pas ».
En associant la photo et le poème, c’est une « ode à l’inaperçu » que célèbre ce beau livre. Et le moine-poète est là pour nous rappeler que « la prière n’est jamais loin / de la lumière / qui marche sur les eaux ».
Eaux intérieures, Aïcha Dupoy de Guitard et Gilles Baudry, préface de Jean Lavoué, 144 pages, 29 euros (Livre disponible dans quelques librairies ou à commander en consultant le site https://aicha.photos. 7 euros de port).
 |
Jean-Claude Albert Coiffard, |
| En ma mémoire obscure |
|---|
Quelle est cette « mémoire obscure » dont parle le poète Jean-Claude Albert Coiffard ? Est-elle si obscure que cela car elle ravive plutôt des souvenirs lumineux de l’enfance ?
Autant de « petits univers » situés en Basse-Loire, du côté de Nantes et de Paimboeuf, revisités ici dans un « lyrisme puissant et sobre », comme le note dans la préface Marie-Laure Jeanne Herlédan.
Parler de la poésie de Jean-Claude Albert Coiffard, c’est d’abord évoquer les accointances qu’elle a avec celle de poètes qu’il admire : René Guy Cadou, Marie Noël, Francis Jammes…
Nous sommes ici dans une écriture attentive à tous les frémissements de la vie, restitués sobrement, sans afféterie, avec un penchant naturel pour l’empathie. Oui, Coiffard fait partie de ces auteurs ayant la « fraternité au cœur » (comme le dit Jean Lavoué à propos de Cadou dans le livre qu’il vient de publier sur le poète-instituteur de Louisfert). Ses frères en écriture sont d’ailleurs du même pays que lui. Ils s’appellent, par exemple, Yves Cosson ou Claude Serreau. À propos de ce dernier le poète nantais parle d’un homme dont le « regard nous sourit / dans le ciel de Bretagne / sous une pluie de mots / annonçant le soleil », d’un homme qui « connaît la lumière / qui brillait à Louisfert sous la lampe du cœur ».
Coiffard et tous ces auteurs qu’il évoque sont, peu ou prou, acteurs ou héritiers de L’École de Rochefort, ces poètes si familiers de jardins « où des essaims de roses / bruissent de souvenirs », si proches « des prairies / aux sources vagabondes » ou encore des plages « aux reposoirs d’écume dressés dans la lumière ». Jean-Claude Albert Coiffard, qui écrit ces mots, est bien dans cet héritage-là. Évoquant Jacques Taurand, il écrit : « Mon cher Jacques / tu me lisais Manoll / me parlais de Cadou ».
Quand on est dans cette fraternité d’écriture, on peut se contenter de noter, dans un carnet de croquis, ces simples mots et en faire un poème : « Le rouge-gorge / une tache de sang », « Le rossignol / la gorge de l’aube ». Ou encore : « En ma mémoire obscure / une lampe pigeon / survole mon enfance ».
Ce qui n’empêche pas le verbe, parfois, de monter en puissance quand il s’agit d’évoquer un pays aimé : « Mon île / ma croyance bleue », « Ma terre / aux clairières votives / et aux bois envoûtés / par les cris des corbeaux ». On croit entendre le Xavier Grall de Solo en sa terre marine de Bossulan. Mais le poète nantais revient, inlassablement, au territoire de l’enfance. C’est cette enfance « obscure » qui illumine tout ce recueil, telle cette lampe que le jeune Coiffard cherchait avec ardeur « lorsque de lourds volets se fermaient sur les songes » alors que « les braises de la nuit / étaient encore brûlantes ».
En ma mémoire obscure, Jean-Claude Albert Coiffard, Des Sources et des Livres, 85 pages, 15 euros.
Le livre peut être commandé directement à l’éditeur Des Sources et des Livres, 2 rue de la Fontaine, 44410 Assérac (3 euros de port)
| Retrouvez les publications Des Sources et des Livres |
| Découvrez la note de lecture de Claude Serreau |
 |
Marie-Laure Le Berre, |
| Lignes |
|---|
C’est Guillevic qui lui a donné envie de parler de Carnac. La Morbihannaise Marie-Laure Le Berre (elle enseigne à Hennebont) nous livre un court recueil sous le titre sommaire de Lignes. Référence aux alignements de mégalithes dont elle parle, ici, dans un alignement de mots. Elle le fait dans un langage épuré, « juste ce qu’il faut pour que le vers sonne à la manière d’une pierre frappée », note le poète Jean-Michel Maulpoix dans la préface.
Le recueil de Marie-Laure Le Berre est poids plume. À la mesure (si l’on peut dire) des poids lourds que sont les mégalithes de Carnac. Car pour parler avec justesse de ce qui pèse dans l’histoire et aussi dans l’imaginaire des hommes, il faut sans doute alléger au maximum son discours. Sans oublier que Carnac est un « objet » poétique que l’on se doit d’aborder avec circonspection. « À Carnac, derrière la mer / la mort nous touche et se respire / jusque dans les figuiers / ils sont dans l’air / les ossements / le cimetière et les dolmens sont apaisants », écrivait Guillevic.
Plus près de nous, le Breton Jacques Poullaouec a aussi pris le parti de l’épure en recourant au haïku pour dire ce qui le saisissait en parcourant ce site (Haïku des pierres, illustrations de Pierre Converset, Apogée, 2006). Marie-Laure Le Berre, elle-même, est dans l’esprit du haïku quand elle écrit : « Un tracteur une 4L bleu nuit / la pie sur la crête d’un menhir / un chardonneret / et la lande // Carnac ».
Mais son petit livre entend, avant tout, creuser un mystère (« Pourquoi êtes-vous là, menhirs ? »). Pourquoi, en effet, le poète n’aurait-il pas aussi cette préoccupation ? Et pas seulement les (pré)historiens qui continuent à s’interroger sur la signification profonde des mégalithes. « Quand on va à Carnac / il y a des questions qui se posent / La pierre connaît la réponse / mais elle ne dit rien / Elle méduse », souligne Marie-Laure Le Berre. « L’homme peint / Il peint des menhirs /mais il n’en peint pas le cœur / C’est de chant qu’il est fait le cœur // À toi de le percer », ajoute-t-elle.
Le poète ne percera sans doute pas le mystère. Mais qui le percera un jour ? Alors l’important est de continuer à contempler ces alignements portant « lichen sur la peau » et « dedans l’âme du peuple breton ». Ce qui n’empêche pas de froncer les sourcils quand la désinvolture s’accorde ici droit de cité. S’adressant aux visiteurs intempestifs, Marie-Laure Le Berre écrit : « Quelle idée avez-vous tous / de courir entre les pierres ? / Le feriez-vous dans vos cimetières ? » Envahisseurs parfois encombrants, ceux de notre temps prennent la suite d’autres occupants des lieux. Allusion discrète à l’armée de César dont on imagine le bivouac dans ces lieux au temps de la guerre contre les Vénètes. « Les grandes armées sont là / devant les colonnes de pierres // Le choc de leurs aciers ». Pour l’heure, sous des cieux qui demeurent incertains, « la pierre frissonne / mais elle tient bon ».
Lignes, Marie-Laure Le Berre, Polder 182 (publication des revues Décharge et Gros textes), 50 pages, 6 euros.
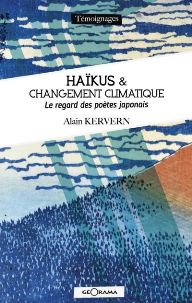 |
Alain Kervern, |
| Haïkus et changement climatique |
|---|
Axé par définition sur la nature et le passage des saisons, le haïku est un genre poétique particulièrement « exposé » au changement climatique. L’essayiste et auteur brestois Alain Kervern le montre dans un essai original qui révèle comment le poète japonais, auteur de haïkus, peut aujourd’hui devenir un véritable lanceur d’alerte.
Dans le haïku classique ou néo-classique (poème bref de trois vers, concret, saisissant une émotion fugitive), ce que l’on appelle les « mots de saison » sont primordiaux. Le poète les puise dans un Almanach qui répertorie les mots accolés à telle ou telle saison (à titre d’exemple : le cerisier pour le printemps, le coucou pour l’été, la lune pour l’automne, la neige pour l’hiver). Il serait inconvenant ou incongru d’utiliser un mot qui ne correspond pas à une saison précise.
Mais aujourd’hui, avec le dérèglement climatique en cours et avec les menaces qui pèsent sur la biodiversité (liés notamment à la pollution, à l’urbanisation effrénée ou aux industries), certains « mots de saison » ne trouvent plus leur place dans les saisons qui les concernent. On assiste à un « écart entre le contenu de l’Almanach et la situation réelle », note Alain Kervern. « Les repères anciens peuvent être brouillés ». Il cite le cas du repiquage du riz avancé ou retardé en fonction de l’arrivée de hausses de température. Le réchauffement climatique provoque aussi le déplacement de certaines espèces animales. Le cas, par exemple, de la « cigale des ours », originaire du sud de l’archipel nippon, qui aime les températures élevées mais tend désormais à investir des espaces urbains plus au nord.
Autant dire que l’auteur de haïku, parce qu’il est sensible par définition aux phénomènes naturels et météorologiques, devient en quelque sorte la vigie ou le guetteur de tous les dérèglements en cours (et cela dépasse donc la seule question des « mots de saison »).
« Les yeux tournés vers l’île / où se déchaînent les cigales / le bébé apeuré » Kurita Setsuko
« Tant de produits chimiques / se dissolvent en nous / vaporeux nuages des cerisiers en fleurs » Motomiya Tetsurô
« Au fond de la nuit / s’éteignent l’une après l’autre / les lucioles pour toujours » Hosomi Ayako
Car les lucioles ont tendance à disparaître à cause de la prolifération d’éclairages artificiels.
Ce rôle d’avant-garde du poète justifie-t-il pour autant que l’écriture de haïkus devienne en quelque sorte un acte militant. Pas certain, estime le haijin japonais Yasushi Nozu que Alain Kervern a sondé sur le sujet. Selon lui, « il est difficile et même contradictoire de s’inspirer en poésie » du thème du dérèglement climatique. Pourquoi ? « Parce que composer des haïkus sur ce thème, c’est exhaler une douleur plus qu’exprimer une émotion littéraire ». Yasushi Nozu note aussi que dans le haïku on transmet une émotion au lecteur « de façon indirecte ». Il rappelle qu’un bon haïku fonctionne « de façon allusive » (en contradiction avec un affirmation tranchée).
Alain Kervern tranche un peu lui-même le débat en prônant une forme de nouvel humanisme. « La menace de bouleversements à venir, écrit-il, nous apprend à vivre chaque instant avec une ferveur parfois oubliée » et « avec une attention plus vive à la fragilité et l’impermanence de ce qui nous entoure ». Parole de sage (breton) qui connaît sur le bout des doigts le rapport subtil que les poètes japonais entretiennent avec la nature.
Haïkus et changement climatique. Le regard des poètes japonais. Alain Kervern, Géorama, 98 pages, 12 euros.
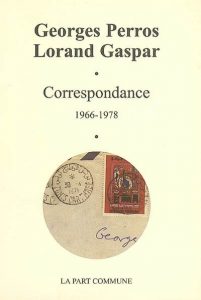 |
Georges Perros/Lorand Gaspar, |
| Correspondance |
|---|
Le poète Lorand Gaspar est décédé le 9 octobre dernier. Il avait 94 ans. Cet immense auteur avait correspondu pendant une douzaine d’années avec Georges Perros. Leur correspondance, publiée à Rennes par les éditions La Part Commune, avait pris fin en 1978, année du décès de Georges Perros à l’hôpital Laënnec de Paris.
Dans les années où se déroulent leurs échanges épistolaires, Lorand Gaspar réside à Jérusalem puis à Tunis. Georges Perros à Douarnenez. Le premier est médecin-chirurgien. Le deuxième est lecteur de manuscrits à la NRF (Nouvelle Revue Française). Une même ferveur les réunit autour de la littérature. Tous deux sont écrivains et poètes.
Enflammé par les écrits de Perros (La vie ordinaire, Papiers collés…) c’est Gaspar qui lance cette correspondance. « Une solitude fermement occupée, reliée à l’extérieur et jalouse d’elle-même, aux confins d’une communion souhaitable… ». Voilà leur point commun. C’est Perros qui le note lui-même dans un courrier du 5 janvier 1967.
Cet échange de douze années va tourner autour de leurs goûts littéraires respectifs, leurs problèmes de manuscrits, leurs démêlés avec les comités de lecture de certains éditeurs… En toile de fond, pour Lorand Gaspar : la magie du désert et du Maghreb, les voyages, mais aussi la guerre entre Israël et les pays arabes. « Ce qui se passe ici et dont l‘Occident n’est point informé est souvent assez moche (très même) pour les Arabes » (lettre du 17 juillet 1967). En toile de fond pour Perros : les fins de mois difficiles malgré les cours à la fac de Brest, les soucis familiaux, la maladie qui s’insinue (le cancer de la gorge), l’air du temps à Douarnenez. « Vous me demandez ce que je fabrique en Bretagne. Vous avez quitté Paris pour le Sud-Est lointain. J’ai fait de même pour l’Ouest, ce Finistère m’ayant toujours travaillé la peau » (lettre du 17 février 1966).
Au fil des années, l’amitié s’approfondira. Perros, le faux anachorète, fera même le voyage de Tunis pour rencontrer Gaspar. Leur échange de lettres titillera, de bout en bout, le pessimiste Perros et contribuera, à certains moments, à le tenir debout. C’est là toute la mystérieuse alchimie de cette correspondance, brillamment annotée par Thierry Gillyboeuf, qui nous révèle deux hommes pas ordinaires emportés dans les turbulences de « la vie ordinaire ». Et comment ne pas être sensible aux propos lucides (et prémonitoires) de Lorand Gaspar dans une lettre du 12 février 1971 où il évoque les Papiers collés de Perros : « Je dis que c’est un chef-d’œuvre qui pourrait être découvert dans cinquante ans si on ne savait pas que les hommes ne sauront plus lire dans cinquante ans, à condition que la vie existe encore sur la planète ». 1971-2021 : nous y sommes presque.
Correspondance (1966-1978), Georges Perros/Lorand Gaspar. Introduction de Lorand Gaspar, éditions La Part Commune 2001 puis rééditions, 256 pages, 15 euros.
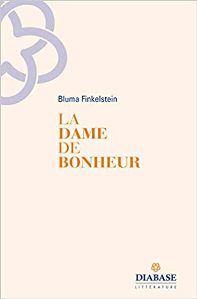 |
Bluma Finkelstein, |
| La dame de bonheur |
|---|
Bluma Finkelstein demeure un poète encore méconnu. On peut pourtant dire d’elle qu’il s’agit d’une voix majeure de la littérature israélienne francophone contemporaine. Son livre La petite fille au fond du jardin (Diabase, 2000) a profondément touché de nombreux lecteurs et elle a été, en 2019, lauréate du prix international Benjamin Fondane. Avec sa Dame de bonheur, elle continue à nous enchanter.
Mais qui est donc cette « Dame de bonheur » sur les pas de laquelle Bluma Finkelstein nous entraîne sans répit ? Quelle est cette fée qui semble l’envelopper et la protéger ? S’agit-il d’une sainte patronne ? D’un ange gardien ? S’agit-il de sa mère, cette dame à la « chevelure noire enroulée en nattes autour de sa tête » ? Ne s’agit-il pas, plutôt, de Bluma Finkelstein elle-même sous les traits d’une enfant radieuse quand « tout brillait » et que « les rosiers changeaient leurs épines en épices d’Orient » ? Oui, nous dit le poète, l’enfance est cette « divine escale sur le versant éclairé de l’existence » à une époque de la vie où l’on croit « presque à l’immortalité ».
Vert paradis de l’enfance, donc, ce « temps des mythes et des histoires heureuses où tout finit bien », avec ses « printemps embaumés » et ses « orangers en fleurs, ses rayons du soleil plus sucrés que le vin de Cana ». Mais plus dur, on le sait, sera la chute. « Pourquoi après le ciel radieux, cette avalanche de neiges grises » et ces routes « inondées du sang des innocents » ?
Alors pour faire face, Bluma Finkelstein sort sa « grammaire de survie ». Elle s’arc-boute sur un mot-clé : la connaissance. « Le bonheur est l’effet de la connaissance, écrit-elle, c’est là que Dieu respire ». Ailleurs, elle dit : « Ne te dépêche pas d’arriver, apprends » ou encore ceci : « cherche au lieu de courir ». Autant d’injonctions dans un monde qu’elle sent marquée par la montée des périls, par toute cette « chair brûlée / sur la terre des promesses ».
Le poète est là, à l’heure où l’on parle plutôt de murs et de frontières, de « routes vaines qui s’enfoncent dans les souterrains », le poète est là pour « créer des ponts ». C’est sans doute à cette condition que la dame de bonheur pourra retrouver, un jour, droit de cité.
La dame de bonheur, Bluma Finkelstein, éditions Diabase, 80 pages, 10 euros.
 |
Janine Modlinger, |
| Pain de lumière |
|---|
Elle dit du poème qu’il « ensemence le monde » et qu’il « chante parfois / l’herbe au bout / d’une ruelle ». Janine Modlinger sait porter notre regard ailleurs. Et quand elle parle de Hölderlin (« O, poète, O mien ») elle dit de lui qu’il « sut porter la lumière » et la garder « près de la Source ». C’est de lumière dont il s’agit, aussi, dans son nouveau livre.
Janine Modlinger nous livre donc aujourd’hui son Pain de lumière. Elle nous le débite en fines tranches (comme on le ferait d’un mets amoureusement cuisiné) car ses poèmes, en effet, ont la forme de très courtes respirations aux allures de méditations, voire de prières. La lumière les inonde, lumière « drue », lumière « qui foudroie », lumière qui « continue de flamboyer ».
Janine Modlinger est là pour nous parler du feu qui couve sous la cendre, de la promesse d’une vie gagnée sur toutes les formes de lassitude ou de résignation. Gagnée, aussi, sur la mort avec sa litanie de « deuils / lourds comme des filets / de pêcheurs ». Elle se met donc à l’écoute de la « Source » et nous dit, au passage, ce qu’elle perçoit du chant du feuillage ou de celui de l’été.
Sous sa plume, la nuit « ruisselle / comme une aube » et un simple oiseau peut la retenir « en vie ». Janine Modlinger guette le silence et attend de chaque jour son « inépuisable moisson ». La poésie, dit-elle aussi dans la deuxième partie de son recueil, nous ramène aux premiers mots de l’enfance. Mots extirpés au désastre intime quand la mort d’une mère vient foudroyer l’enfant qu’elle fut. « Ma vie a commencé par la mort et l’absence de mots. Ma survie se fait par les mots retrouvés, offerts ». Elle dit ailleurs : « Tout l’écriture jaillit de ce regard adorant que j’ai porté sur ma mère ». D’où ce regard lucide sur l’acte d’écrire : « Futile, parce que le premier vent dispersera nos feuillets d’écriture. Grave, parce qu’aussitôt qu’elle s’adresse à autrui, la parole est la plus haute tâche de vivre ».
Janine Modlinger le dit et le redit à travers ses courts poèmes, pains de lumière sur la page blanche (« manne poétique » comme le dit son éditeur). C’est toujours le même empressement à susciter l’émerveillement , à écrire, comme elle l’affirmait déjà dans Traversée (Ad Solem, 2018), « le poème de la douleur recommencée, de la joie toujours neuve ».
Pain de lumière, Janine Modlinger, Ad Solem, 79 pages, 14 euros.
 |
Gérard Bessière, |
| Au seuil du silence |
|---|
À 91 ans, Gérard Bessière continue à nous dire ce qui l’anime. Toujours « un peu prêtre » (comme l’a qualifié, un jour, un enfant), il nous parle de ses doutes et même de son « ignorance devant le mot Dieu ». Des figures aimées, disparues, surgissent au fil des pages comme s’il s’apprêtait déjà à les rejoindre. « Peut-être qu’à l’instant / où mes yeux s’éteindront / je verrai m’accueillir / les visages aimés ».
Gérard Bessière, qui passe aujourd’hui sa retraite à Luzech dans le Lot, fait partie de ces auteurs nés dans le giron du christianisme, devenus prêtres ou religieux, mais qui ont – peu ou prou – pris du recul avec l’institution (quand ils n’ont pas pris carrément le large comme ce fut le cas pour Marcel Légaut ou même Jean Sulivan). Ancien journaliste à La Vie et éditeur au Cerf, Gérard Bessière, lui, est l’un de ses « électrons libres » (demeurés dans l’institution) qui apportent une parole forte et neuve sur la foi, l’Église, le fait d’être chrétien.
Ses propos rejoignent, par exemple, les interrogations formulées par des auteurs comme Jean-Pierre Jossua, Gabriel Ringlet, Maurice Bellet, Jean-Yves Quellec ou François Cassingena-Trévedy, pour ne citer que quelques uns. Autant d’hommes plus attachés à creuser le message de Jésus et des Évangiles qu’à défendre à tout prix une Église au langage « fragile ou périmé » et qu’il importe de « dépoussiérer » comme le dit Gérard Bessière. Une Église qui leur semble un peu trop se crisper et ne paraît pas, à leurs yeux, répondre exactement aux attentes des hommes de notre temps. Ces convictions traversent les derniers écrits de l’auteur, comme autant de courtes chroniques ponctuées de poèmes, sous le titre Au seuil du silence.
Ce qui retient aussi l’attention dans ce nouveau livre, c’est l’approche que Gérard Bessière fait de l’existence de mondes éloignés de nous dans l’espace et que la science ne finit pas de nous révéler. Autant de sujets à lourdes interrogations pour le chrétien qu’il demeure. « L’espace et le temps où se déroulent nos vies éclatent au-dessus de nos têtes. Le ciel étoilé des soirs d’été n’est plus qu’une tenture proche. Au-delà, que d’au-delà, à l’infini ! Les religions ont été les astres qui ont guidé et guident la marche des hommes sur la terre. Le demeureront-elles ? »
Constat lucide qui, plus loin, lui fait écrire : « Les étoiles sont vouées à s’éteindre et déjà les distances interstellaires nous font ressentir le vide du ciel, mais que dire du vide, qu’est-ce que le vide ? »
Alors, au cœur du grand âge, l’homme se voit saisi de vertige. Mais s’il résiste à la peur c’est grâce au silence qui monte en lui « comme la crue de la rivière en mars ». Il peut donc rester paisible et disponible, accueillant l’inconnu, cultivant « le goût du beau et tant d’autres conduites ou réalisations qui nous élèvent ».
Au seuil du silence, Gérard Bessière, Diabase, 83 pages, 11 euros
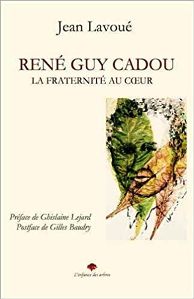 |
Jean Lavoué, |
| René Guy Cadou, la fraternité au cœur |
|---|
La poésie de René Guy Cadou (1920-1951) n’en finit pas de susciter des commentaires émerveillés. À l’occasion du centenaire de sa naissance à Sainte-Reine de Bretagne, l’écrivain et poète breton Jean Lavoué – il vit à Hennebont – nous livre son Cadou intime.
La fraternité est au cœur du livre de Jean Lavoué. Auteur d’un Perros, Bretagne fraternelle (éditions L’Ancolie, 2004), il récidive en quelque sorte dans ce livre sur René Guy Cadou. La fraternité, en effet, parcourt ce livre. Fraternité de René Guy avec ses amis poètes et écrivains de l’École de Rochefort, cette école buissonnière d’auteurs en rupture avec le surréalisme et prônant le retour à la nature et à l’émotion. Fraternité avec le poète Max Jacob. Fraternité avec le Père Agaësse, moine bénédictin de l’abbaye de Solesmes. Fraternité avec Michel Manoll, le libraire nantais qui l’introduisit dans le monde de la poésie… La liste est longue.
Cette fraternité trouve sa source, estime Jean Lavoué, dans la figure quasiment « christique » de René Guy. Car si Cadou n’était pas chrétien, il avait au cœur ce Dieu incarné qu’il entrevoyait comme le frère de tous les hommes, un Dieu loin des dogmes et des pesanteurs de l’Église officielle. René Guy Cadou avait-il dans sa poche gauche une carte du Parti communiste et dans sa poche droite une médaille de saint Benoît (que lui avait offerte Max Jacob quand il lui rendit visite à Saint-Benoît sur Loire) ? On peut en tout cas l’envisager, comme le fait Jean Lavoué, nous rappelant au passage que le curé de Louisfert, où mourut le poète, lui refusa des obsèques religieuses. « Seigneur ! Me voici peut-être à la veille de te rencontrer. Il fera nuit, je serai là debout à la barrière du pré », écrivait pourtant Cadou pressentant sa mort prochaine. « Je crois en Dieu parce qu’il n’y a pas moyen de faire autrement ».
Jean Lavoué développe, à ce propos, un thème qui lui est cher et parcourt ses propres livres : celui de l’exode. Il voit dans l’œuvre de René Guy Cadou des traces de cette approche de la vie qui fut celle de Jean Sulivan, d’Etty Hillesum et de tant d’autres, notamment les mystiques rhénans, à savoir « cet exode du christianisme religieux pour mieux nous redonner sa sève dans l’intensité d’une intériorité vécue et d’une donation dans la chair du monde ».
L’auteur estime donc que Cadou a beaucoup à dire aux hommes de notre temps. Il n’hésite pas à parler, à propos de son œuvre, de « 5e Évangile destiné au monde non religieux dans lequel nous sommes entrés », car « la poésie fut pour lui cette vie entière, cette vie rêvée, cette écriture vouée à l’autre et à l’amour, à chaque instant ».
On ne peut pas, pour autant, réduire ce livre à une approche du Cadou « christique ». Jean Lavoué insiste beaucoup, au début de son livre, sur la double identité du poète : la sienne propre d’une part et, d’autre part, celle de son frère Guy décédé huit ans avant sa naissance et dont le prénom a été accolé au sien (René devient ainsi un « Re-né »). Double identité porteuse d’interrogations, lourde de sens sur le destin individuel et sur la mort. Jean Lavoué souligne également – et on ne s’en étonnera pas – le rôle éminent joué par Hélène, son « amoureuse », auprès de lui. « René se plaira d’ailleurs à signer nombre de leurs correspondances communes « Renélène »… la fusion est parfaite ».
Cette lecture particulière de l’œuvre de Cadou amène Jean Lavoué à expliciter sa démarche : « Je ne m’adresse pas ici aux spécialistes. Derrière le poème de Cadou, c’est le Poème que je cherche avant tout à faire entendre », car « il nous parle de l’Homme (…) De l’homme que nous sommes appelés à devenir ».
Ce livre n’a donc rien d’une thèse universitaire ou d’un exercice littéraire. C’est plutôt, comme le dit l’auteur, « une sorte de libre cheminement autour de ce qui révèle la destinée d’un poète dont la vie se confond avec l’œuvre : brèves comme une étoile filante dans la nuit mais suffisantes à dire l’éclat d’une existence vécue dans le déchiffrement obscur de l’énigme qui la fonde ».
Le poète instituteur René Guy Cadou est mort le 25 mars 1951. Il avait 31 ans. Des enfants de son école apportèrent des bouquets de primevères près de son cercueil.
René Guy Cadou, la fraternité au cœur, Jean Lavoué, préface de Ghislaine Lejard, postface de Gilles Baudry, avec des aquarelles de Bernard Schmitt, éditions L’enfance des arbres, 300 pages, 20 euros. Le livre peut être acheté en librairie. On peut aussi se le procurer à L’enfance des arbres, 3, place vieille ville, 56700 Hennebont.
 |
Gérard Le Gouic, |
| Poèmes choisis, traduits en arabe |
|---|
Le poète breton Gérard Le Gouic, déjà publié dans une quinzaine de langues, voit pour la première fois ses poèmes traduits en arabe. Un choix fait par un éditeur tunisien.
Gérard le Gouic (83 ans) est l’un des auteurs de référence de la poésie bretonne contemporaine. Récompensé par plusieurs prix littéraires (dont le prix Antonin-Artaud dès 1980 pour Géographie du fleuve), continue inlassablement à publier : nouvelles, récits (souvent autobiographiques) et, bien entendu, poèmes.
Le voici traduit aujourd’hui en arabe (édition bilingue) chez un éditeur tunisien qui possède déjà à son catalogue Michel Butor, Georges Schéhadé, Lorand Gaspar, Bernard noël, James Sacré… Autant dire que Gérard Le Gouic se retrouve aujourd’hui en bien belle compagnie.
Que découvrira un lecteur arabe en lisant le poète breton ? D’abord le parfum de notre pays avec ses « vagues d’un blanc net », ses « pèlerinages de pluie », ses mouettes, ses herbages, ses pommiers, ses chevaux, sans oublier le vent, la « blonde côte plate » ou « le cap osseux au loin ». Mais Gérard Le Gouic n’est pas là pour faire couleur locale ou se faire le chantre de la Bretagne éternelle. Ce qu’il chante, en réalité, c’est la poésie elle-même. « La poésie est le seul alcool / que je me donne à boire à tue-tête », écrivait-il déjà dans un de ses premiers recueils, À la fonte des blés (Grassin, 1960). « Je n’ai rien à faire / qu’écrire un poème » lit-on dans ses Poèmes choisis. « Une heure chaque jour pour la marche, / une heure pour la poésie ».
Le Gouic s’arrime ainsi à son « bâton de solitude » et vit dans le compagnonnage d’amis ou parents disparus. « Chaque soir je salue ma mère / dans sa robe de mariée. / Au fil du temps le cadre doré / se déforme / s’élargit comme sous l’effet/d’une chaleur qui ne brûle pas ».
Un lecteur arabe notera aussi la brièveté des poèmes. Ou plutôt leur épure. Guillevic n’est pas loin, jusqu’à ces courts textes aux allures d’aphorismes à l’image de cette suite impressionniste suscitée par la vision d’un pommier. « Quand un paysage / n’est pas clos, // il manque un pommier / pour interrompre sa fuite ». Ou encore ceci : « Sans pommier une maison / ne serait pas plus supportable // qu’un puits sans poules autour, / qu’une cheminée sans oiseaux ».
Ainsi va Gérard Le Gouic. Poète en quête, poète en marche. « Ne rien posséder que l’errance / ses parcours obsolètes, / ses bagages allégés, / ne rien détenir que les adresses / approximatives de l’auberge du vent / des motels de la pluie… ». Oui, la poésie comme viatique.
Poèmes choisis, Gérard Le Gouic, bilingue français-arabe, éditions Tawbad, 10 euros. Pour se procurer ce recueil, deux adresses : tawbad 2931@gmail.com et Gérard Le Gouic, Le Moustoir, 29140 Kernevel Rosporden.
 |
Guénane, |
| Ta fleur de l’âge |
|---|
Femme et poète. Guénane porte une voix originale dans la création poétique bretonne. Elle peut aussi bien nous parler de la Patagonie que des îles bretonnes mais, de recueil en recueil, elle distille subtilement des messages de sagesse. Et c’est à nouveau le cas dans son dernier livre.
Après Un rendez-vous avec la dune (Rougerie, 2014) où elle nous parlait d’un littoral familier pour mieux parler du rendez-vous qu’elle avait avec elle-même, voici qu’elle récidive avec Ta fleur de l’âge, exercice d’introspection qu’elle nous fait partager en excluant le « je » pour privilégier le « tu ».
Être dans la fleur de l’âge, nous dit le sens commun, c’est être au summum de sa maturité et de sa forme, première étape avant le déclin lié à la vieillesse. Pour Guénane – comme pour tout le monde – il y a la sensation du temps qui passe (« Tu contemples tes friches / tu souffles sur tes derniers feux »). Sensation que le poète relativise dans ces deux vers frappés du bon sens : « On ne se sent pas toujours vieux / dans les yeux d’un enfant ». Ce qu’il faut en tout cas, estime Guénane, c’est ne pas cultiver les regrets inutiles. « Ne laisse plus le passé t’étrangler / cultive une bonne entente / avec tes démons coriaces ». Ou, plus loin : « Tant que marche le ressort / contourne tes impatiences / sympathise avec ton sort ».
Mais attention aux pièges de la mémoire. « Sans rien demander / dans le noir / sournoise à l’aise / la mémoire sort du quai des brouillards / le passé dépassé rapplique /rameute ses fourmis appliquées ». Il faut garder la tête froide, nous dit le poète. « Au jeu de la mémoire / pioche ce que tu peux quand tu peux ». Sans compter qu’à la fleur de l’âge, il n’est pas vain de réveiller « les anges des sensv» et même de risquer l’amour. « Il fait de gros dégâts / mais aussi de belles bonnes confitures / à la saison mûre ». Guénane a même cette formule délicieuse : « Quand les hommes vivront d’amour / elle aura disparu l’eau fraîche ».
Hymne à la vie, donc, au bout du compte (« Aimer être présent au présent sachant les lourds filets que nous traînons »). Hymne, aussi, en fin de recueil, à la poésie qui « n’a qu’une obligation / entretenir les ponts suspendus / entre vous et la vie ». Avec cette belle définition qu’elle nous propose : « Poésie / infini métier à tisser / le textile de nos vies ». Métier d’autant plus indispensable que le monde va à vau-l’eau (« tout ce progrès qui avance et défait ») avec « les ouragans des écrans déchaînés ».
Guénane avait pointé dans un recueil précédent (Ma Patagonie, La Sirène étoilée, 2017) les dérives du monde actuel, notamment écologiques. Elle le redit ici à « ta fleur de l’âge ».
Ta fleur de l’âge, Guénane, Rougerie, 60 pages, 12 euros.
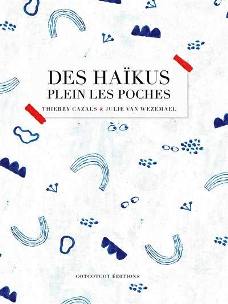 |
Thierry Cazals et Julie Van Wezemael, |
| Des haïkus plein les poches |
|---|
Thierry Cazals a une passion contagieuse pour le haïku. Depuis plus de vingt ans il transmet sa passion pour ce genre poétique venu du Japon à des écoliers, collégiens et lycéens de toute la France. En vrai pédagogue, il détaille aujourd’hui (en compagnie de l’artiste Julie Van Wezemael) l’originalité et la spécificité du haïku. Des propos qu’il accompagne de textes de maîtres du genre mais, surtout, d’enfants qu’il a initiés à l’écriture si particulière de ce nano-poème.
Il n’y a pas de lourdeur dans le haïku. Il n’y en a pas, non plus, dans le livre de Thierry Cazals. Se mettant dans la peau d’un jardinier (de la terre et des mots), il nous entraîne dans un récit vivant et coloré, fait d’échanges et de dialogues, qu’il engage notamment avec des jumeaux, « une fille et un garçon qui passent toutes leurs vacances d’été dans le coin ». Le propos est limpide, accompagné des illustrations de Julie Van Wezemael dont le graphisme et le chatoiement de couleurs nous ramènent au meilleur des albums ou livres pour enfants.
Pas de grand discours, donc. Plutôt rappeler des règles simples. Ne pas se focaliser par exemple sur le nombre de syllabes par vers mais plutôt « communiquer une impression de fraîcheur et de légèreté ». Thierry Cazals nous le rappelle : « La beauté du haïku ne découle pas du respect des règles, mais de sa simplicité, de son évidence, de sa naturalité ». Et il cite à deux ou trois reprises ce magnifique haïku de Naojo : « La cueillir quel dommage ! / la laisser quel dommage ! / Ah ! cette violette ».
« Le haïku n’est jamais autant réussi que lorsqu’il abrite à la fois le grandiose et le cocasse, la beauté sublime et le trivial » et quand il peut aussi « mélanger douce compassion et ironie », note Thierry Cazals. Exemple ? Ce haïku de Jean Féron : « Après le mariage / le curé balaie le riz / pour ses poules ».
Au-delà des conseils avisés de l’auteur (Thierry Cazals est lui-même haïjin), on découvre dans ce livre un panel d’exercices pratiques, souvent ludiques, à réaliser en classe ou en groupe. Par exemple, apprendre à repérer lequel des cinq sens s’exprime dans tel ou tel haïku d’auteur, apprendre à écrire un haïku sans verbe, faire son autoportrait en haïku, partir des quatre mots « là où je vis » pour écrire un haïku… « Là où je vis / il y a plus d’épouvantails / que d’humains », écrivait le haïjin japonais Chasei. « Là où je vis / un volubilis amoureux / d’une échelle », écrit Thierry Cazals lui-même. « Là où je vis / mon ballon / fait rage contre le mur », écrit un collégien de Cherbourg.
Le livre fourmille de suggestions pour s’approprier ce genre poétique et Thierry Cazals ramasse au fond, dans ce livre, tout ce qu’il a expérimenté. De Lesneven à Courbevoie, d’Abbeville à Condé-sur-Sarthe, de Ploumagoar à Romorantin… « Combien d’enfants ai-je rencontrés depuis que je vais dans les bibliothèques et les écoles partager ma passion du haïku ? Mille ? Dix mille ? Plus ? ». Et Thierry Cazals, manifestement, n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.
Des haïkus plein les poches, Thierry Cazals et Julie Van Wezemael, Cotcotcot éditions, 260 pages, une version à 10 euros et une version limitée cartonnée à 25 euros.
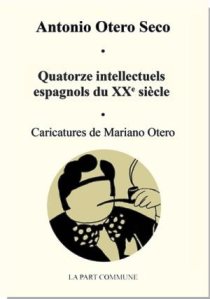 |
Antonio Otero Seco, Mariano Otero, |
| Quatorze intellectuels espagnols |
|---|
Quel lien entre des intellectuels espagnols et la ville de Rennes ? Tout simplement Antonio Otero Seco, réfugié espagnol fuyant le franquisme qui avait trouvé asile dans la capitale bretonne où il enseigna la langue et la littérature espagnole de 1952 à 1970. Un amphithéâtre de l’université de Haute-Bretagne porte d’ailleurs aujourd’hui son nom. Une série d’articles qu’il a rédigés sur des intellectuels de son pays sont aujourd’hui publiés par La Part Commune, éditeur rennais.
Antonio Otero Seco (1905-1970) était journaliste, écrivain et poète. Installé à Rennes, il collabora à la revue Iberica implantée à New-York et assura la critique de la littérature espagnole dans le quotidien Le Monde à partir de 1977. Enfin il rédigea de nombreux articles pour des journaux et revues d’Amérique latine. Il s’attacha notamment, dans la presse culturelle latino-américaine (entre 1960 et 1970) à faire connaître les grandes figures intellectuelles espagnoles de son temps, c’est-à-dire celles de la première moitié du 20e siècle.
Quatorze portraits d’intellectuels dressés par Antonio Otero Seco sont aujourd’hui présentés dans un livre édité par La Part Commune qui avait déjà publié deux livres de l’écrivain et journaliste espagnol : Écrits sur Garcia Lorca en 2013 et Écrits sur Dali et Picasso en 2016.
Ces intellectuels espagnols sont philosophes, essayistes, poètes… Il y a même un musicien, Manuel de Falla. Beaucoup d’entre eux sont issus de ce qui été désigné sous le vocable de « Génération 98 », génération de prosateurs et poètes qui se caractérisait par un refus du réalisme des époques précédentes et entendait renouer avec les fondamentaux de l’Espagne : ses paysages, son âme profonde.
Antonio Machado était de ceux-là. « Il est le poète espagnol de tous les destins, écrit Antonio Otero Seco, ou plutôt l’un d’entre eux. Sans doute le plus illustre ; mais enfin un de plus dans la longue liste des malheureux poètes espagnols de notre temps ». Parlant ainsi de Machado, il résume le sort réservé aux intellectuels espagnols par le franquisme : soit réduits au silence, soit emprisonnés, soit assassinés… Et pour beaucoup, au bout du compte, condamnés à l’exil (notamment en Amérique latine ou en France). « Oui, depuis de nombreuses années, écrire en Espagne c’est pleurer », ajoute Antonio Otero Seco. « Ou mourir ce qui peut être mieux. Ou agoniser d’amour pour la terre lointaine sous d’autres cieux qui ne sont presque jamais cléments ».
Antonio Otero Seco démontre la grande dignité de ces intellectuels bafoués par les dirigeants du pays. Il le dit d’une plume vive, alerte, révélant ses propres élans poétiques (rehaussés par la belle traduction de la Rennaise Nicole Laurent-Catrice). Au lecteur, donc, de découvrir ou redécouvrir ces intellectuels de haute volée : Juan Ramon Jimenez (« ou la solitude sans remède »), Fernando Villalon (« Poète tardif »), Leon Felipe (« pèlerin de l’exode »), Azorin (« les bras ouverts vers l’Amérique »). On découvre leur visage, leur allure grâce aux caricatures de Mariano Otero, fils de l’auteur, venu rejoindre son père en 1956 à Rennes où il est décédé au cœur de l’été dernier.
Quatorze intellectuels espagnols, Antonio Otero Seco, caricatures de Mariano Otero, traduction de Nicole Laurent-Catrice, La Part Commune, 253 pages, 17 euros.
 |
Geneviève Le Cœur, |
| Des ricochets jusqu’au soir |
|---|
Geneviève Le Cœur exerce en tant que psychanalyste à Rennes. Mais elle est aussi poète. Une auteure « rare » car on ne lui connaît que deux recueils : Pénombre en 2004 et Comme un nuage au fond des yeux en 2011. Tous les deux chez l’éditeur Tarabuste. Voici qu’elle nous livre aujourd’hui Des ricochets jusqu’au soir au cœur d’une anthologie de la revue « Triages » publiée par Tarabuste.
Avec Geneviève Le Cœur on est constamment dans le travail de mémoire, dans le retour au sein d’un passé chargé de douleurs, de chagrins étouffés. La famille où elle naît cultive pourtant le bonheur : sept enfants « jouant, riant » dans un « jardin rêveur » où « les arbres dormaient l’été ». Nous sommes peu après la Libération. La petite Geneviève vit ses premières années dans cet après-guerre peuplé de fantômes. « Au creux du berceau de son être / des morts / se tenaient / en silence » (…) « Sur le manteau troué / de la nuit / sa tête reposait ». Puis passant du « elle » au « je », ces mots : « je fus porteuse de douleurs / à peine / disparues » (…) « J’ai mis mon doigt d’enfant / dans l’œil / de vos deuils ».
La petite fille grandit, lestée d’un pesant fardeau familial. « Qui étais-tu / mon père / fascinant » (…) « voyait-il – lui – mon regard tournant sans cesse / en sa cage de détresse ? ». L’écrivain Stig Dagerman l’a dit : « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Et c’est bien le cas pour Geneviève Le Cœur qui nous le dit à mots choisis, pesés, entourés de blancs comme pour appuyer sur la touche « pause » et retrouver sa respiration, comme si un lourd héritage pesait inexorablement sur elle (« Pourquoi inconsolable / maman / j’étais ? »), au point de ne plus percevoir les signaux de la vie. « Arbres / fleurs / fruits des bois / chemins – me regardaient / la bouche close / tristes / lointains / sans contours ». Puis ce constat terrible : « Ici / en bas / mort et vie couchaient dans les mêmes draps ».
Mais il y eut, en dépit de tout, une sortie du tunnel et la possibilité d’une vie vraiment vécue. « Mon âme / longtemps / resta dormante / dans un puits // Un jour / elle en sortit / inquiète et nue / vêtue seulement de / métaphores ». C’est la poésie qui sauve (le poète Jean-Pierre Siméon dit même, dans un livre, qu’elle « sauvera le monde »). « Un poème survint (…) mes traits revinrent de leur exil », raconte Genevièce Le Cœur.
Il y eut une autre découverte : « la détresse jumelle » de la sienne « blottie » chez sa mère et une forme de retrouvailles que l’auteure avait déjà laissé entrevoir dans son précédent recueil. Tout alors devient possible. « Remettre les mots en bouche / les palper dans l’obscur / les écrire ».
Avec une telle aventure personnelle, certains écrivains auraient sans doute conçu un roman d’autofiction pour rentrée littéraire. Geneviève Le Cœur nous amène ailleurs dans une écriture épurée, effleurant le palpable, sans effets de manche, n’affichant aucune certitude, creusant le tréfonds de nos existences.
Des ricochets jusqu’au soir (44 pages), Geneviève Le Cœur, Anthologie Triages (155 pages), Tarabuste éditions, 20 euros. Six autres poètes sont présents dans cette anthologie.
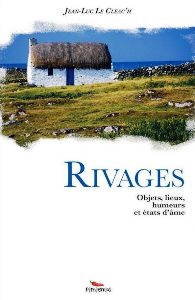 |
Jean-Luc Le Cléac’h, |
| Rivages |
|---|
Auteur d’une Poétique de la marche (La part Commune, 2018), amoureux des paysages littoraux, le breton Jean-Luc Le Cléac’h publie aujourd’hui une véritable poétique des bords de mer sous le titre laconique de Rivages. Il y parle de lieux, d’objets et n’hésite pas à faire état de son « humeur » et de ses « états d’âme ».
Que l’on se rassure. Si Jean-Luc Le Cléac’h a des « états d’âme » en parcourant les rivages, c’est avant tout pour exprimer son penchant pour la contemplation. Et forcément pour s’émouvoir quand la beauté s’offre à lui. Mais il n’est pas là pour nous décrire des lieux « magiques » ou des paysages « de carte postale » (Ah ! les tics de langage des médias). « Ce n’est pas le bord de mer spectaculaire, ce lieu du tragique qui m’attire, mais le littoral dans ses manifestations quotidiennes, banales. L’ordinaire, voire l’infra-ordinaire, plutôt que l’extra-ordinaire », affirme-t-il d’entrée.
On ne doit donc pas s’étonner qu’il nous parle aussi bien des caisses de marée que des portiques à conteneurs, des amers ou balises et des câbles sous-marins. Il nous confie d’ailleurs qu’il vit « entouré d’objets maritimes modestes et inutiles. Surtout inutiles : des œufs de raie trouvés sur les plages de la baie d’Audierne, des bois flottés rapportés de l’île de Saaremea (Estonie), des cailloux volcaniques ramassés sur les rivages d’Islande ».
Il y a chez Jean-Luc Le Cléac’h, fondamentalement, un « éloge des éléments (le vent, la pluie, l’océan) et de la matière (le rocher, le sable…) ». L’homme n’est pas marin, mais volontiers nageur et surtout randonneur. « La marche au bord de la mer possède cette vertu rare de nous rasséréner ». Mais, en même temps, ce qui caractérise, selon lui, la vie près des rivages, c’est « une anxiété constante mais de basse intensité », parce qu’il y a dans ces lieux « une histoire de lumière et de ténèbres, de silence et des vents hurlants ». Ce qui lui fait dire que la mélancolie est « une fleur qui s’épanouit volontiers en bord de mer ».
Les rivages que l’auteur a empruntés ne se limitent pas, on s’en doute, à ceux de la Bretagne. Jean-Luc Le Cléac’h nous transporte en Irlande, en Écosse, sur les rivages de la Baltique, dans des archipels de Suède et de Finlande, dans les îles Lofoten… Autant de Fragments d’Europe (titre de son précédent livre à La Part Commune). Chemin faisant, il rumine en permanence les grands textes des auteurs de bord de mer : Francisco Coloane, Alvaro Mutis, Édouard Peisson et surtout Louis Brauquier (« un des meilleurs poètes maritimes que la France compte »).
Si ce livre de Jean-Luc Le Cléac’h révèle le grand bagage culturel de l’auteur sur les rivages, il signe avant tout la posture d’un homme confronté à l’immense (à la manière d’un personnage des tableaux de Caspar David Friedrich, debout face à l’océan). Avec toutes les interrogations d’ordre existentiel qui en découlent. « Nulle part ailleurs qu’au bord de mer, écrit-il, la précarité de l’existence ne se manifeste avec plus d’acuité ». Il ajoute : « ces espaces viennent combler, confusément, le grand vide spirituel qui me semble être, à maints égards, la marque dominante de notre époque ». Ce qu’il souhaite du fond du cœur : « que cet espace fragile demeure accessible aux rêveurs patentés ». Dont il fait partie.
Rivages, Jean-Luc Le Cléac’h, éditions Pimientos, 143 pages, 14 euros, Essai
 |
François Cassingena-Trévedy, |
| De l’air du temps au cœur du monde |
|---|
Que peut bien penser un moine du monde qui nous entoure ? Contrairement à bien des idées reçues, ce n’est pas la « clôture » qui peut l’empêcher de jeter sur ce monde un regard pertinent et acéré. Le Breton François Cassingena-Trévedy, moine bénédictin de l’abbaye de Ligugé, nous en donne la preuve.
François Cassingena-Trévedy est un moine qui n’en finit pas de surprendre. Auteur de carnets de haute volée (Étincelles, éditions Ad Solem) mêlant méditations, points des vue théologiques et poèmes en prose, il est aussi marcheur et randonneur (Cantique de l’infinistère, éditions Desclée de Brouwer), émailleur de cuivre dans l’abbaye où il vit, chef de chœur, spécialiste de Pères de l’Eglise, théologien et… amateur de motos. N’en jetez plus ! Moine aux multiples facettes, il est avant tout un homme d’ouverture, de dialogue, soucieux d’une Église qui tarde, selon lui, à être en prise avec son temps (il déteste les crispations identitaires catholiques).
Les chroniques qu’il a publiées entre 2014 et 2018 dans la revue Études sont aujourd’hui rassemblées dans un livre qui nous permet de mesurer à la fois l’étendue et la profondeur de son analyse – sans concessions – sur le monde actuel. Avec cet art consommé de nous prendre à rebrousse-poil et de battre en brèche ce qu’il est convenu d’appeler le « politiquement correct ». Tout y passe : Charlie, Daech, Macron, l’effet de serre, Houellebecq, France-Allemagne de football, la manif pour tous, la « sainte laïcité », le harcèlement, les migrants, la pédophilie dans l’Église… À travers toutes ses chroniques, transpire une dénonciation de l’hédonisme ambiant, du matérialisme, du pouvoir exorbitant des médias, de la faillite des politiques… Mais ce n’est pas un homme aigri qui parle. François Cassingena-Trévedy n’est jamais dans l’amertume même s’il dénonce les vices de notre temps.
C’est ainsi qu’en amoureux des humanités classiques, un tantinet nostalgique des grandes leçons de vie distillées par les Grecs et les Romains et encore plus – on s’en doute – par Jésus-Christ, il regarde avec une certaine empathie certaines avancées technologiques contemporaines. Traduisant littéralement le mot « facebook », il parle de « livre des visages » et le « texto » pourrait devenir, selon lui, une « microchirurgie de la charité ». Quant aux « mails », il faudrait, dit-il, « que véritables viatiques de sens autant que de tendresse, ils soient aussi denses que des haïkus ». Ajoutant que « ici, comme ailleurs, la technique attend de s’épanouir en poétique ».
Plus profondément, François Cassingena-Trévedy prône une forme d’insoumission face à un monde qui lui semble engagé sur de mauvais rails. Mais une insoumission en quelque sorte positive qui ne joue pas sur l’opposition mais sur une « différence » assumée. Ce qu’il appelle au fond de ses vœux, c’est un ré-enchantement du monde et que l’on arrête de se regarder le nombril en sautant comme des cabris sur l’air de « que du bonheur, que du bonheur ! ».
Dénonçant l’effet de serre (climatique), il suggère que l’on prenne, enfin, en charge un effet de serre autrement plus ravageur. Celui secrété par la culture contemporaine. « Cette serre-là anesthésie notre sensation d’un ciel, comme elle abrutit notre tentation de l’atteindre ». Ce « ciel » qu’il voudrait que ses contemporains entrevoient est celui des « saints », des « idées », de la « poésie ». Au fond, la recherche d’une transcendance permettant « les retrouvailles avec le Mystère dans sa rafraichissante étrangeté, comme par une saine insurrection de notre regard intérieur ». C’est à cette condition, estime-t-il, que l’homme grandira pour affronter le mal et la mort.
De l’air du temps au cœur du monde, François Cassingena-Trévedy, éditions Tallandier, 252 pages, 19,90 euros.
 |
Groupe Koten, |
| En longeant la mer de Kyôto à Kamakura |
|---|
L’auteur est anonyme et son récit date de 1223. Mêlant notations prises sur le vif, poèmes de cinq vers et méditations, il nous entraîne pendant une quinzaine de jours sur environ 450 kilomètres dans une découverte du littoral japonais entre Kyôto et Kamakura. Une expérience à la fois poétique et spirituelle de moine pèlerin.
On peut appréhender un tel récit de bien des manières. S’attarder, par exemple, sur l’arrière-plan historique (l’auteur, qui vient de quitter sa vieille mère, pérégrine de la capitale Kyôto à la ville de Kamakura où s’est installé, à l’issue des guerres civiles, le gouvernement militaire des Shôgun). Y répertorier toutes les références au Japon truffant ce récit (qu’il s’agisse d’histoire, de poésie, de légendes…). On peut aussi y voir un mode d’emploi du bouddhisme, notamment dans sa version syncrétique shinto-bouddhique, celle qui inspire la perception du monde proposée par l’auteur (« Moi dont la vie n’est qu’un instant au milieu d’un songe »).
On peut, également, apprécier le caractère documentaire de ce récit de voyage dans sa capacité à nous faire entrevoir les travaux et les jours du Japon ancien. Voici, sous la plume de l’auteur, les marais salants, les bateaux de pêche, les mariniers, les marchands, les bûcherons, les rizières… « Reflétées dans l’eau / des rizières inondées / elles se montrent à nous ! / Les nuées d’épis de riz / image de l’automne ». On peut, enfin, avoir ici un aperçu des conditions de voyage de l’époque, à pied ou à cheval (comme c’est le cas de l’auteur), logeant dans des auberges de fortune ou carrément sous les étoiles. Et, quand on est moine, s’attardant dans les temples et les lieux sacrés chargés d’histoire.
Mais se contenter de dire cela, ce serait passer sous silence la portée universelle d’un récit dont la poésie est le vecteur essentiel. Cet auteur japonais d’une cinquantaine d’années (« vieillard que je suis ») s’inscrit dans la lignée des auteurs des récits de voyage (kiko) de moines ermites dormant sur des « oreillers d’herbes » (Sôséki a fait de cette expression le titre d’un de ses livres), prônant l’ascétisme, la sobriété, la pauvreté. Et invitant, de bout en bout, à la contemplation. « Aujourd’hui je l’ai passé ;/ si je reviens à nouveau / je verrai le mont Futamura :/ sentier sous les pins / dont le regret me suivra ».
Ce sont des leçons de vie que distille en effet ce moine voyageur à renfort de waka, ces quintains de trente et une syllabes qui ponctuent son texte comme le feraient des haïku dans un haïbun. « À quoi bon maintenant / ces lamentations ?/ Ne sait-on d’avance / que la rosée à la pointe de la feuille / est vouée à disparaître » (Kobayashi Issa nous parlera aussi, plus de 500 ans plus tard, d’une « monde de rosée »).
C’est le sentiment bouddhique de l’impermanence qui domine dans le récit. « Du fleuve qui va / et jamais ne reviendra / l’écume hélas ! tôt effacée / me semble la trace / de celui qui disparut », écrit-il évoquant la mort tragique d’un dignitaire japonais. Sentiment doublé d’un appel à faire le bien. « Le paradis loge dans un cœur tourné vers le Bien. L’enfer n’est pas sous terre, il se trouve dans un cœur qui nourrit de mauvaises pensées ». Le chemin littoral qu’emprunte ce voyageur anonyme devient ainsi progressivement, sous sa plume, le chemin de l’Éveil.
En longeant la mer de Kyôto à Kamakura, traduction du japonais, présentation et notes par le groupe Koten (Claire-Akiko Brisset, Jacqueline Pigeot, Daniel Struve, Sumie Tereda et Michel Vieillard-Baron), éditions Le Bruit du temps, 168 pages, 15 euros.
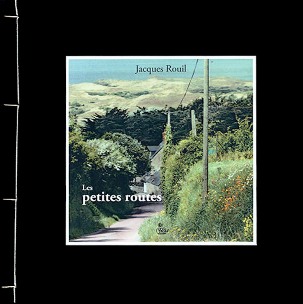 |
Jacques Rouil, |
| Les petites routes |
|---|
Les petites routes de Jacques Rouil fleurent bon l’herbe mouillée, la pomme dans le courtil et le lait dans l’étable. Ici, les prés sont « Couleur de miel / Comme un tablier ». Les automnes sont « immobiles » et, au loin, c’est « la bise qui chante ». Un pays est furtivement nommé : le Cotentin, terroir de l’auteur, du côté de Bricquebec et de Surtainville. Là où la mer et les « estrans de varech » ne sont jamais très loin de ces terres lourdes et grasses où l’on enterre les morts.
Jacques Rouil a chanté ce pays natal dans des romans ou des récits pétris d’humanité (Donadieu, Les Rustres, Une mémoire du bout du monde…). Il délivre ici, en mots comptés dans ses poèmes (parfois un seul mot par vers), sa vision d’un monde d’avant le déluge. D’avant le déluge technocratique, médiatique, informatique, boursier… Empruntant les petites routes de l’auteur – qui vont nous mener plus loin qu’on ne le pense – nous voici dans des espaces de liberté sous les pommiers, les noisetiers ou les noyers. Les gestes y sont lents (comme celui d’un père pelant une pomme de son verger).
De la nostalgie ? Sans doute. Mais, plus encore, un appel à garder intactes nos capacités d’émerveillement. Ah ! la gourmandise de l’auteur quand il s’arrête sur les mots « nénuphars », « libellules », « hérons cendré », « roseaux »… Comment, en le lisant, ne pas penser à cet autre gourmand de mots : le normand Jean Follain, né natif de Canisy, au sud de Saint-Lô, « dans un pays coloré de pommiers », où « la dentelle, la robe et les bras blancs / sans souci de la mort / tachaient le bocage » (La Main chaude, 1933).
Sur les petites routes de Jacques Rouil, place à l’écoute, à l’intériorité, à la voix de l’enfance. Loin de nous la confusion, l’esbroufe ou les effets de manche. « La terre n’a ni de grandes auréoles, ni de devantures éclatantes : elle ne vit que de bruits et de silences », a écrit Michel Manoll, pilier de l’École de Rochefort, dans son recueil posthume Une fenêtre sur le monde (1990). C’est tellement vrai ici, sur ces « petites routes » normandes.
Alors forcément « l’exil » est mal vécu. Jacques Rouil nous parle de sa maison de banlieue. Au cœur du jardin de poche qu’il entretient sur place amoureusement, il traque tous les signes de vie qui font écho à son pays natal : fleurs, oiseaux, légumes, fruits... Tout mérite d’être nommé car la vie n’arrête pas de nous adresser des signaux, même si le mal-être taraude son homme. Et que lui reviennent en mémoire – lui étreignant le cœur – l’enfance de ses enfants mais aussi la vie tortueuse des rescapés de 14-18 qu’il a connus dans sa propre enfance. Pour rehausser ce chant d’amour à un pays, à des gens, à des lieux, il y a les propres photographies en couleurs prises par l’auteur. Dans leur simplicité, elles disent à la fois la rudesse de la vie et la beauté du monde.
Les petites routes, (nouvelle édition augmentée), Jacques Rouil, éditions Le Petit Véhicule, 180 pages, 25 euros.
 |
Estelle Fenzy, |
| La minute bleue de l’aube |
|---|
Pensées, aphorismes, fragments, poèmes courts : il y a de tout cela dans la poésie d’Estelle Fenzy. Elle a l’art de capter à l’aube des instants minuscules pour en tirer des leçons de vie.
Lisant La minute bleue de l’aube d’Estelle Fenzy, comment ne pas d’abord penser à Georges Haldas, autre écrivain de l’aube pour qui il fallait – quoi qu’il en coûte – savoir « témoigner des minutes noires comme des minutes heureuses ». C’est cet état particulier de poésie que Estelle Fenzy partage en réalité avec le poète suisse, dans cette façon, comme il le disait lui-même, « d’être le plus présent à soi-même » et de témoigner du « prodigieux mystère de la vie » (Pollen du temps, éditions L’âge d’homme, 1999).
Estelle Fenzy, donc, maintient ses sens en éveil. Même la nuit. Elle nous parle d’un pays qui n’est pas nommé même si l’on repère ici une vigne et si, ailleurs, on entend souffler le mistral. Nous sommes dans le sud, mais l’important est ailleurs. Car la nuit et l’aube ont, au fond, partout la même couleur « Au mitan de la nuit/même les oiseaux dorment // Seuls les chats savent / où est caché le ciel ». Mais, note ailleurs le poète : « Le jour tarde à se lever / il a dû passer une nuit blanche ».
Les micro-poèmes d’Estelle Fenzy nous font aussi penser à ces poèmes courts coréens « écrits au creux de la main ». Elle le dit explicitement elle-même : « Souvent / mes poèmes / tiennent dans une main / humanité / de paume ouverte // un fruit et son noyau ». Pas étonnant, donc, que ses poèmes puissent flirter avec le haïku. « Deviner / sur quelle fleur / le papillon se posera ». Ou encore ceci : « Le vent tourne / les pages du livre / à l’envers ». Sans oublier les traits d’humour : « Avec mon mètre /à peine soixante /je ne serai jamais/une grande personne ».
Pointe aussi, souvent, sous un apparent détachement, une forme de douleur. « Le plus difficile / ce n’est pas la solitude // le plus difficile / c’est l’absence ». Douleur avivée par la vision, à distance, des malheurs du monde : « Alep // Il est terrible le regard de l’enfant / il sait qu’il sera le premier // à mourir ». Alors, nous dit Estelle Fenzy, il faut « écrire / pour empêcher / que tout tombe » et « alerter le jardin » car « le soleil est parfois cruel ». Pour l’auteur, dans ces conditions, « un seul pays natal / une seule langue maternelle / le poème ».
La minute bleue de l’aube, Estelle Fenzy, La Part Commune, 120 pages, 13 euros.
 |
Paul Guillon, |
| La couleur pure |
|---|
De la poésie de Paul Guillon, on appréciera surtout la «>disponibilité au présent>» comme l’avait déjà dit Jean-Pierre Lemaire en préfaçant La vie cachée, un de ses précédents recueils. La couleur pure est fait de la même encre. Ce recueil dit les jours et les heures dans leur simplicité. Mais toujours sous le signe d’une forme d’émerveillement.
Qu’il nous entraîne sur ses pas dans la contemplation de peintures italiennes ou qu’il nous parle de la vie de ses jeunes enfants, Paul Guillon dresse avant tout des tableaux. Précisément à la manière des plus grands artistes. C’est par exemple le cas quand il saisit cette femme qui allaite son enfant «>sur cette plage publique minuscule>» ou quand il fait le constat que «>ce qui subsiste du bleu / s’est rassemblé dans le balancement vaporeux des glycines>». Il y a aussi ce véritable tableau de genre à Venise quand il voit le vaporetto des touristes croiser une vedette-corbillard.
Cette « vie cachée » dont Paul Guillon nous avait parlé dans son premier recueil chez Ad Solem en 2007, resurgit à nouveau au fil des pages. Elle prend avant tout les couleurs de l’enfance quand le poète nous parle avec tant de douceur et de justesse du « premier âge » de ses propres enfants.
Ce qui se manifeste avec acuité, c’est l’attention particulière du père à l’apparition des premiers mots sur leurs lèvres. « Tu es à ce moment dont parle tout poème / où tu devines notre langage / où tu nous parles sans parole », note le papa énamouré. Tu répètes à l’envi / la fin de tous nos mots ». Et puis, un jour, les premiers mots surgissent : « é-mé, é-mé » devant la mer que l’enfant désigne par ces mots ou, sortant plus tard de l’école maternelle les doigts tachés de couleurs : « J’ai peindé, pap ».
Plus loin, l’évocation de Maud, « effondrée brusquement » à l’âge de huit ans, ravive des plaies encore bien ouvertes. « Elle a laissé en moi ce silence / d’où surgit la poésie ». Mais la vie (cachée) continue envers et malgré tout. « Avec mon fils de trois ans / je démine lentement la plage / de ses palourdes et de ses coques ».
Paul Guillon qui se laisse « visiter » par des textes bibliques (la Visitation, l’Annonciation…), nous dit l’urgence de vivre en dépit des ébranlements intimes qu’elle peut provoquer. Et de ce vieux poète qu’il « visite » sur son lit d’hôpital, il peut dire : « Il ne peut plus écrire / et c’est pour cela que le poème / est enfin là ».
Vies silencieuses, Paul Guillon, Ad Solem, 87 pages, 14,90 euros
 |
François Cheng, |
| L’un vers l’autre, en voyage avec Victor Ségalen |
|---|
Il y a 100 ans, le 21 mai 1919, Victor Ségalen trouvait la mort dans la forêt du Huelgoat. L’académicien François Cheng, poète français d’origine chinoise, a consacré un livre au grand voyageur breton dans lequel il dit l’intime proximité spirituelle qui le relie à lui. Un livre à lire ou à relire à l’occasion de l’anniversaire de la disparition de Ségalen
Ils étaient faits pour se rencontrer à un siècle de distance. Lui, Victor Ségalen (1878-1919), explorateur breton de la Chine, l’autre François Cheng, le Chinois « naturalisé français » et aujourd’hui académicien. L’un comme l’autre ont refusé l’exotisme et le voyage de pacotille pour privilégier l’immersion dans les cultures qu’ils approchaient : chinoise pour l’un, française pour l’autre. À la seule différence près que Ségalen a terminé sa vie dans son pays natal (une mort mystérieuse dans la forêt du Huelgoat) et que François Cheng a totalement adopté son pays d’accueil et épousé sa langue.
À l’heure du dialogue des cultures, on ne manquera pas de souligner l’étonnante parenté intellectuelle et spirituelle entre deux auteurs nés aux antipodes : l’un en extrême-occident, l’autre en extrême-orient.
Il y a, en effet, entre Ségalen et Cheng, une « fraternité poétique et existentielle ». Elle est patente dans ce que dit Cheng de l’écrivain breton à l’occasion de trois conférences (qui font la trame du livre) dont la plus récente prononcée à l’occasion des 100 ans de la naissance de Ségalen.
« Au travers de ses visions, écrit Cheng à propos de Ségalen, il a sondé des mystères dont les échos ont réveillé ceux de son être propre. Pour le poète, réaliser ses randonnées sur cette terre lointaine, c’était se réaliser ». Plus loin, Cheng souligne ce qui – à ses yeux – est le plus haut message de Ségalen : « Sachons accueillir le mystère de l’être ; l’inconnu est ce qui advient, qui est toujours déjà là mais toujours en avant de nous, et cet inconnu qui advient n’est autre que notre propre mystère ».
Aller voir ailleurs pour mieux voir au-dedans. Telle fut la trajectoire de Victor Ségalen, poète « exote », selon l’expression qu’il utilisait lui-même. François Cheng a su dire dans son livre comment la parole de Ségalen s’ouvrait avant tout à l’universel.
L’un vers l’autre, en voyage avec Victor Ségalen, François Cheng, Albin Michel, 183 pages, 14,50 euros. Réédition en poche, mai 2019, Albin Michel, collection « Espaces libres », 192 pages, 7,20euros.
 |
Brigitte Maillard, |
| La simple évidence de la beauté |
|---|
« La beauté sauvera le monde », disait Dostoïevski. « La poésie sauvera le monde », affirmait Jean-Pierre Siméon dans un livre-manifeste du Printemps des poètes. La beauté et la poésie font alliance dans le recueil de poèmes et des photographies de Brigitte Maillard.
Auteur/poète, éditrice, chanteuse : Brigitte Maillard a plusieurs cordes à son arc. Elle aime les gens, la nature, les paysages. Avec une affection particulière pour la baie d’Audierne, à tel point que cet espace emblématique de la Cornouaille (où la mer aborde le littoral avec fracas) est devenu pour elle le lieu d’une révélation. « Un jour, raconte-t-elle, sur une plage de la baie d’Audierne, la beauté s’est emparée de tout mon être. Inoubliable instant car la beauté a quelque chose d’incroyable à nous dire. Derrière ce monde respire un autre monde ».
Pour témoigner de ce tressaillement intime devant la beauté, Brigitte Maillard recourt bien naturellement au poème et à la photographie. Voici, offerts à nos yeux, des estrans parcourus de ruisseaux sous des cieux plombés, des vagues giclant avec fureur sur les rochers pointus, une neige de mouettes ou de goélands sur la grande bleue soudain calme … « Je suis au bord de l’eau / Fidèle au brin d’osier / Déposé par les oiseaux », écrit-elle. « De tout, je fais un endroit de mon cœur » (…) « L’onde court dans ma main ».
Le poète et académicien François Cheng, que Brigitte Maillard évoque dans ce recueil, écrivait à propos du Mont Lu dans la province de Jiangxi (dont il est originaire) qu’il offrait « des perspectives toujours renouvelées et des jeux de lumière infinis ». Ce sont ces jeux de lumière que Brigitte Maillard capte par l’image et le texte. Son mont Lu à elle, c’est d’une certaine manière la baie d’Audierne où elle se sent « vêtue d’espace ».
La simple évidence de la beauté, Brigitte Maillard, éditions Monde en poésie, 77 pages, 15 euros.
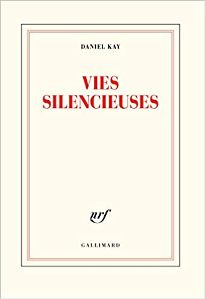 |
Daniel Kay, |
| Vies silencieuses |
|---|
Les « vies silencieuses » du breton Daniel Kay sont celles que donnent à voir les plus grandes œuvres picturales. Vies silencieuses des hommes, des bêtes, des plantes, des fleurs… tous visités par le pinceau du peintre. Le poète, lui, se met à leur écoute. Il redonne vie à tout un univers et nous propose sa propre mise en musique. Un exercice d’interprétation qui ne manque pas de sel et d’originalité. Suivons le guide…
Faire parler les peintures. Le cinéma en a fait l’expérience. Peter Greenaway nous a livré en 2008 sa version de La ronde de nuit de Rembrandt. En 2014, c’est Lech Majewski qui avait mis en scène Le portement de croix de Bruegel (tableau de 1564) en réalisant le film Le moulin et la croix.
Les écrivains ou poètes ne sont pas en reste. On pense notamment au beau recueil Archives de neige de la Finistérienne Anne-José Lemonnier (Rougerie, 2007), inspiré par les tableaux de l’Ecole de Pont-Aven ou les dessins de Jean Moulin exposés au musée des beaux-arts de Quimper.
Daniel Kay, lui, va plutôt chercher sa propre inspiration du côté de la Renaissance italienne et de l’art baroque. Apparaissent dans son recueil les villes emblématiques de Florence, Venise, Assise, Sienne, les œuvres du Quattrocento mais aussi celles de l’école hollandaise. Voilà, en tout cas, un livre surprenant sur la création artistique et sur la capacité d’une œuvre picturale à féconder l’imagination. Mieux: l’imaginaire, le fantastique, le surnaturel.
Car il s’agit bien, ici, d’une réinterprétation très personnelle des plus grands tableaux de maîtres. Le faisant, Daniel Kay aiguise notre regard. Mais, finalement, n’est-ce pas là le rôle du poète : nous révéler ce que nos yeux ne voient pas ou traquer le merveilleux derrière le visible. Ainsi, sur ce tableau, « Le crépuscule n’est qu’une chemise rouge / qui flotte sur les cyprès / et brûle les leucocytes ». Ailleurs, voici « les angelots bouffis qui tombent comme des corps stellaires dans les champs d’oliviers » . Plus loin, ce sont les anges, « ces messagers célestes semblables à de grands papillons bariolés qui butinent, parmi les fleurs des champs, le suc d’une nouvelle aurore ».
Daniel Kay ouvre aussi la porte de l’atelier du peintre. En Italie, il voit « dans la cuve d’indigo / le bleu du ciel et la robe de la Vierge » . Près de chez lui, dans l’atelier de Jean-Luc Bourel, dont il contemple les toiles, il s’interroge : « Comment l’espace donne-t-il du temps à ce regard / qui s’épuise dans le bleu ? »
Ah ! Le bleu. Il éclaire et parcourt le livre. Il l’inaugure même dans ce premier chapitre intitulé « Le bleu à l’âme » mais le poète sait mettre en garde contre « les fausses promesses du bleu » et même sa « perfidie » . Il nous dit aussi que « les Grecs ne possédaient pas de mots pour le bleu ». Et que n’aurait-il pu dire sur les Bretons pour qui le bleu et le vert se confondent dans le mot « glaz ».
Le poète nous ouvre vraiment, dans ce livre, de nouvelles perspectives sur la peinture. Il la dépoussière, lui fait endosser (quand il s’agit d’œuvres anciennes) les costumes d’une certaine modernité en faisant entrer dans ses poèmes des mots d’aujourd’hui. Ou encore des mots du langage trivial. Voici sa Madeleine de Georges de la Tour qui « s’applique à remonter sur ses cuisses / la double soie duveteuse des jarretelles / tendue comme une corde autour du cou ». Voici les Sadducéens qui ont « éraflé / les portes des bagnoles » . Voici « le dos cabossé des anges ».
Les statues, aussi, ont leur mot à dire. Silencieuses pas définition, elles « susurrent une langue étrangère / un curieux idiome / que seuls peuvent comprendre/les enfants et les muets ». Et sans doute, aussi, le poète quand il se met à leur écoute.Vies silencieuses, Daniel Kay, Gallimard, 127 pages, 14,50 euros.
 |
Jacques Rouil, |
| Si près de l’abîme |
|---|
Il y a nouvelles et nouvelles. Les nouvelles d’un journal. Les nouvelles d’un livre. Jacques Rouil fait se rejoindre le journalisme et la littérature dans ses « nouvelles du monde actuel », sous-titre de son nouveau livre Si près de l’abîme. Ses nouvelles nous parlent des marges, principalement rurales, mais avec quelques échappées vers les banlieues. Toute ressemblance avec la protestation populaire contemporaine n’est pas pure coïncidence.
Profondément attaché au département de la Manche où il est né (bien que vivant dans la métropole rennaise), Jacques Rouil nous dit dans tous ses livres (romans, récits autobiographiques, nouvelles mais aussi poèmes) ce qui l’anime profondément : un amour de sa terre, de ses paysages familiers, une fidélité sans faille à ses ancêtres, à tous ceux qui ont cultivé cette terre au cours des siècles. Et Dieu sait s’il nous parle, pourtant, de contrées où il vente, où il pleut, où la glaise colle aux sabots (« Le ciel couleur de cendre et de charbon de bois pesait comme de gigantesques sacs de patates sur cette vie ankylosée ») mais avec ces embardées de soleil qui suscitent inlassablement, chez lui, émoi et contemplation.
Mais l’époque ne lui plaît guère. Jacques Rouil nous dit, à travers les personnages de ses nouvelles, ce qui le travaille profondément et qui n’en finit pas de susciter sa réprobation : la morgue des puissants, les réflexes identitaires exacerbés, les assauts de l’islam radical et aussi toutes les formes d’intégrisme écologique, car elles touchent à ce fond paysan qu’il n’a pas perdu. Les nouvelles de son nouveau livre disent tout cela à travers une galerie de personnages à la fois touchants et truculents, parfois tragiques, toujours campés avec justesse par l’auteur. Ses nouvelles racontent ainsi l’histoire d’un paysan revenu d’un coma de plusieurs années et qui découvre que sa ferme a été expropriée pour les besoins d’une centrale nucléaire. Elles racontent l’histoire d’un jeune banlieusard pris en auto-stop par un paysan qui finira par « l’apprivoiser » et même l’embaucher. Elles racontent un kidnapping tragique pendant la Coupe du monde de football. « On a décidé d’expérimenter un jeu, comme à la télé, mais en bien plus intéressant. Si la France gagne contre le Togo, tu gagnes ta peau. Si elle perd, je te saigne ».
Le « morceau de bravoure » de ce livre est une nouvelle (qui valait un petit livre à elle toute seule) intitulée « Le prophète » dans laquelle Jacques Rouil nous livre l’histoire d’un Jésus contemporain né dans un fourgon (puisque Joseph et Marie, ses parents, n’avaient pas pu faire autrement) et qui, à force du bien autour de lui d’une manière surprenante, finira par susciter haines et jalousies.
On soulignera aussi cette nouvelle aux allures prémonitoires racontant « la mort d’une cathédrale » (à cause, cette fois-ci, d’un acte terroriste). Et aussi celle écrite pendant la crise des Gilets jaunes où l’on assiste au sort d’un manifestant frappé mortellement par son frère policier. « Putain, Armand, je t’avais pas r’connu ! Oh nom de Dieu ! Qu’est-ce qui m’a pris ? C’est moi qu’ai tapé ! ».
Si le ton est parfois tragique dans les nouvelles de Jacques Rouil, il y a le plus souvent des ouvertures. Le monde n’est pas clos malgré sa noirceur. L’auteur nous dit, entre les lignes, qu’il fait confiance à la bonté des individus pour ne pas sombrer définitivement dans l’abîme. Des formes de réconciliation existent. Des consciences peuvent évoluer. L’empathie n’est pas un vain mot sous sa plume. Mais c’est un homme écorché qui nous en parle…
Si près de l’abîme, nouvelles du monde actuel, Jacques Rouil, éditions quint’feuille, 324 pages, 20 euros.
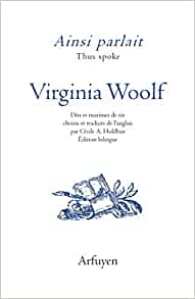 |
Cécile A. Holdban, |
| Ainsi parlait Virginia Woolf |
|---|
Que sait-on vraiment de Virginia Woolf ? Un livre nous apporte aujourd’hui un éclairage intéressant à travers les « dits et maximes de vie » de la fameuse romancière anglaise qui fut aussi épistolière, diariste, éditrice, collaboratrice de publications littéraires.
Née en 1882 à Londres et décédée en 1941 – en se jetant, les poches pleines de pierres, dans l’Ouse, une rivière qui lui était familière – Virginia Woolf a connu bien des soubresauts dans une vie marquée par des phases dépressives. Le grand public la connaît sans doute plus aujourd’hui par le film Qui a peur de Virginia Woolf ? (avec Elizabeth Taylor) que par ses romans. Et, a fortiori, par ses « dits et maximes de vie ».
En traduisant et présentant cette part méconnue de son œuvre, Cécile A.Holdban (dont on sait la fine connaissance qu’elle a des écrivaines anglo-saxonnes) nous révèle la profondeur de pensée de Virginia Woolf. Avec trois thématiques essentielles qui innervent ce livre : la femme et la famille, le sens de la vie, l’écriture et la vie d’écrivain.
Virginia Woolf – on le sait – est devenue une figure éminente du féminisme. On l’appréhende d’abord comme cela, elle qui vécut dans une société victorienne patriarcale dont elle eut à subir, dans sa propre vie, les douloureuses conséquences. Alors quand elle nous parle des droits des femmes, elle qualifie ce sujet « d’antédiluvien ». D’une plume acide, elle ajoute : « Tant qu’elle pense à un homme, personne ne voit d’objection à ce qu’une femme pense ». Et, plus loin, ceci : « Tout pourra arriver quand être une femme aura cessé d’être une occupation protégée ». Certains de ses propos sur la sexualité laissent même entrevoir ce que l’on qualifie aujourd’hui de théorie du genre. « Dans chaque être humain, une hésitation se fait entre les deux sexes, et bien souvent, ce sont juste les vêtements qui donnent cet aspect masculin ou féminin, alors qu’en-dessous, le sexe est exactement le contraire de ce qu’il paraît ».
Le « tragique de la vie » est le deuxième leitmotiv de ses dits et maximes. « Dans tous les cas, la vie n’est qu’un cortège d’ombres, et Dieu sait pourquoi, puisqu’il s’agit d’ombres, nous nous accrochons si fort à elles et nous les voyons partir avec autant d’angoisse ». C’est en effet le paradoxe de cette vie menée sous le signe de la dépression. Car Virginia Woolf manifeste sans faillir « un élan de tendresse pour les pierres et les herbes » et affirme que « chaque saison est appréciable, les beaux jours comme les jours de pluie, le vin rouge comme le vin blanc, la compagnie comme la solitude ».
Enfin, il y a l’amour de la lecture conçue comme un « exercice physique vivifiant » et, encore plus, de l’écriture « en tremblant au bord de précipices ». Virginia Woolf veut laisser « les idées abstraites se débrouiller toutes seules » et « penser d’abord aux êtres humains ». Écrire, pour elle, c’est avant tout se libérer. Tuer, comme elle dit, « l’ange du foyer ». Tout est dit dans cette exhortation de femme libre. Dans cette « insurrection par l’écriture » qui la caractérisait, comme l’affirme avec justesse Cécile A.Holdban.
Ainsi parlait Virginia Woolf, Thus spoke Virginia Woolf, dits et maximes de vie choisis et traduits de l’anglais par Cécile A.Holdban, édition bilingue, Arfuyen, 176 pages, 14 euros.
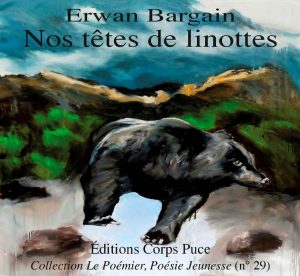 |
Erwan Bargain, |
| Nos têtes de linottes |
|---|
Avec ses aphorismes « un peu décalés », comme il le dit lui-même, Erwan Bargain nous propose, dans son nouveau livre, un bestiaire très particulier s’appuyant sur toutes ces formules et sentences dont « nos amis les bêtes » sont les héros bien involontaires.
« Prendre le taureau par les cornes », « Courir deux lièvres à la fois », « être nu comme un ver »… Erwan Bargain, amoureux des mots, s’appuie sur ces formes de dictons populaires pour proposer aux enfants (et, plus largement, à tous les grands enfants) de courts poèmes qui prennent précisément ces dictons à… rebrousse-poil.
Morceaux choisis :
« Quand il fait un temps de chien / Les chats ne sortent pas ».
« Personne n’a de raison / De se jeter dans la gueule du loup / Mis à part son dentiste »
« Comment passer du coq à l’âne / Si on joue à saute-mouton »
Mais une simple lecture amusée de ces poèmes animaliers serait réductrice. Erwan Bargain dit, entre les lignes, notre époque avec la plume acérée d’un moraliste quand il en fustige les vices et les turpitudes. Exemple ? « La politique de l’autruche / Conduit souvent / Au fond du trou ». Ou en encore ceci : « Les requins de la finance / Nagent toujours en eaux troubles / Ce qui n’empêche pas leurs dents / De rayer le parquet ».
Plus généralement c’est le genre humain – dans ses frasques et ses hypocrisies – qu’il passe au scalpel. « Noyer le poisson / Quand il y a anguille sous roche / N’empêche pas / D’avaler des couleuvres ». Ou encore : « Je connais des gens / Qui montent souvent / Sur leurs grands chevaux / Et qui ont du mal / À en redescendre ».
Tout bien considéré, ce livre de « poésie pour la jeunesse » aurait aussi largement sa place sur les rayons d’une bibliothèque de « poésie pour les adultes ». Et on ne s’en plaindra pas.
Nos têtes de linottes, poèmes d’Erwan Bargain, illustrations d’Éric Le Briz, éditions Corps Puce, collection Le Poèmier, Poésie Jeunesse (n°29), 54 pages, 12 euros.
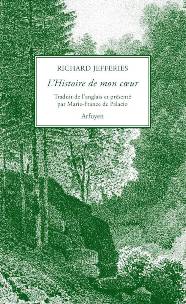 |
Richard Jefferies, |
| L’histoire de mon cœur |
|---|
L’écrivain anglais Richard Jefferies (1848-1887) demeure largement méconnu. En rééditant son livre majeur, L’histoire de mon cœur, les éditions Arfuyen jettent un coup de projecteur sur un auteur dont les propos prennent – en ces temps de dérèglements de toute nature – une résonance particulière.
On a souvent comparé Jefferies à Thoreau. Chez l’auteur anglais comme chez l’auteur américain, il y a le même amour de la nature et le rejet foncier des modes de vie induits par la société industrielle naissante. Henry David Thoreau déambulait dans la campagne et les forêts du Massachusetts. Richard Jefferies apprécie les longues balades méditatives dans les collines de son comté natal, celui de Wiltshire, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Autour de lui, « les champs heureux », « les jeunes coucous », « les bois pentus », « les ormes gracieux », « les buissons d’aubépines et de noisetiers »… Il le dit : « Je respirais l’existence à pleins poumons » (…) « J’étais absolument seul avec le soleil et la terre ». Allongé dans l’herbe, il regarde les grands nuages qui viennent de la mer. « L’herbe soyeuse soupire lorsque le vent arrive, portant le papillon bleu plus rapidement que ses ailes ne le peuvent ».
Et quand il se rend au bord de la mer, il s’empresse de plonger dans la grande bleue. « Je nageais, et qu’est-il de plus délicieux que la nage ? Elle concilie l’exercice et le raffinement ».
Autant la nature le subjugue et l’envoûte, autant la civilisation moderne, notamment son côté grégaire, suscite ses critiques. « Le spectacle le plus renversant, selon moi, est le grand gaspillage de travail et de temps, dépensés tout simplement pour subsister ». Quand il doit se rendre à Londres, il fuit « la foule, son bavardage incessant et décousu ». Pour lui la foule est un « tourbillon » et la « pensée en est absente ». Ce qu’il dénonce foncièrement : « Une morale fondée uniquement sur l’argent ». Cette détestation des normes de son époque l’amène à manifester une forme de haine, voire de violence contre ce monde « si violemment attaché à son étroit sillon égotique, si stupide et si content de soi sous l’immense poids de la misère ».
Mais au-delà de cette opposition entre une nature bienfaisante et une civilisation oppressante, il y a chez Jefferies une profonde quête spirituelle (en dehors de religions instituées) qui l’amène à formuler ce qu’il appelle « la 4e idée ». Il s’explique : « Trois choses seulement ont été découvertes en matière de consciences intérieure ». Et il cite « l’existence de l’âme, l’immortalité, la divinité ». Son ambition est de pouvoir « avancer plus en avant et arracher un quatrième élément et, peut-être même, encore plus qu’un quatrième, à l’obscurité de la pensée » et « en savoir plus sur la vie de l’âme ».
Ce questionnement d’ordre métaphysique se double d’une approche des notions de vie éternelle et d’éternité. « C’est maintenant qu’est l’éternité », écrit-il. Il n’en finit pas de faire l’éloge du « merveilleux présent ». Pas éloigné en cela des expériences spirituelles d’Extrême-Orient. Jefferies avait lu Confucius, dont il retient notamment « la voie sans effort ». Le taoïsme ne lui est pas inconnu. Il avait dans sa bibliothèque le Bhagavad Gita. Autant de marqueurs qui font étonnamment penser à la démarche d’un Herman Hesse au 20e siècle, y compris sur le thème de l’oisiveté chère à l’écrivain allemand. Richard Jefferies écrit pour sa part : « J’espère que les générations futures auront la possibilité d’être oisives ; j’espère que les neuf dixièmes de leur temps seront consacrés aux loisirs ; qu’elles pourront profiter des journées, de la terre, et de la beauté de ce beau monde ; qu’elles pourront se reposer près de la mer et y rêver ».
L’histoire de mon cœur, Richard Jefferies, traduit de l’anglais et présenté par Marie-France de Palacio, Arfuyen, 220 pages, 17 euros.
 |
Gaële de la Brosse, |
| Le petit livre de la marche |
|---|
Je marche, tu marches, elle marche. Gaële de la Brosse – Bretonne de Paris, Finistérienne des sentiers du fond de la rade de Brest – connaît par cœur le chemin de Compostelle et le Tro Breizh. Elle est l’auteure de livres sur ces deux itinéraires mythiques. Mais voici qu’elle nous propose aujourd’hui un petit ouvrage sur les différentes facettes de la marche à pied. Elle est allée, pour cela, à la rencontre de quinze marcheurs/auteurs.
Il est loin le temps – du moins en Europe – où la marche était l’acte nécessaire pour se déplacer d’un lieu à un autre (faire des kilomètres chaque jour, par exemple, pour aller à l’école comme nous l’ont raconté nos parents ou grands- parents) C’était avant le développement des moyens de locomotion modernes. Autrement dit dans un temps qui nous paraît préhistorique. Aujourd’hui on peut tout faire en voiture, en train ou en avion. Mais aussi, diront certains, « on peut aussi tout faire à pied ». Vertu de la marche à laquelle l’on découvre des bienfaits insoupçonnés au point de revendiquer que sa pratique soit remboursée par la Sécu après avis médical.
La marche, en effet, peut relever de la thérapie. Elle aide à se reconstruire après un drame ou un passage à vide dans sa vie. « Guérir et renaître », nous dit Gaële de la Brosse à propos de Claire Colette, assistante sociale dans l’accompagnement de personnes déficients mentales et qui eut besoin du chemin de Compostelle et créa en Belgique « une association qui promeut la marche comme outil de guérison du corps et d’éveil spirituel ».
Mais il y a tant de manières d’appréhender la marche et tant de profils de marcheurs. Pour l’un des plus connus d’entre eux aujourd’hui, Sylvain Tesson, la marche lui a permis de canaliser son énergie et de dompter sa « chaudière intérieure ». Pour le sociologue David Le Breton, « marcher, c’est exister pleinement, être de plain-pied dans son existence. Se sentir exister. Se sentir vivant. Passionnément vivant. Et même si cet accouchement de soi se fait dans la souffrance, même s’il nous fait toucher du doigt notre fragilité, le jeu en vaut la chandelle ».
Au fond, marcher c’est conquérir sa liberté. « Nous sommes des vivants-marchants : c’est-à-dire que nous sommes vivants tant que nous avons la liberté de nous mouvoir », estime pour sa part l’explorateur Jean-Louis Étienne.
Gaële de la Brosse est aussi allée à la rencontre de deux moines/marcheurs. L’un, Gilles Baudry, bénédictin-poète dans l’enclos de son monastère et dans les bois qui l’environnent. C’est là qu’il « accueille le silence ». L’autre, François Cassingena-Trévedy, revenu de son périple dans le Cézalier, dont il a tiré un superbe récit (Cantique de l’infinisterre, Desclée de Brouwer, 2016) et qui nous livre les trois « ingrédients » de la quête : « La précarité (voyager seul et dans le dépouillement) ; l’austérité (marcher dans des paysages sans facilités ni amusements) ; l’altérité (être ouvert à la rencontre, chemin faisant) ».
On peut aussi marcher pour « vivre l’instant en pleine conscience » comme le dit Gaëlle de la Brosse à propos de Thich Nhat Hank. Pour « philosopher » à la manière de Frédéric Gros. « Si vous voulez penser, commencez par marcher ». Eh bien, marchons !
Le petit livre de la marche, Gaële de la Brosse, éditions Salvator, 137 pages, 9,90 euros.
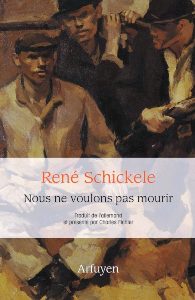 |
René Schickele, |
| Nous ne voulons pas mourir |
|---|
Le livre date de 1922. Mais il est d’une brûlante actualité. L’alsacien René Schickele (1883-1940), écrivain-journaliste de langue allemande nous parle d’un « Idéal » à réaliser en Europe après la boucherie de la Grande guerre, en dépit de la résurgence des nationalismes dès cette époque. On dirait aujourd’hui: en dépit des « populismes ».
René Schickele est né dans l’Alsace occupée par les Allemands après la défaite française de 1870. Sa langue d’écrivain sera l’allemand. Fondateur d’une revue culturelle rêvant d’une Alsace autonome faisant le lien entre la France et l’Allemagne, on le retrouve journaliste à Paris puis à nouveau en Alsace avant de transformer la nouvelle revue qu’il dirige en organe de l’Internationale pacifiste. C’est de la Suisse qu’il s’exprime durant la guerre 14-18. Puis à Berlin au moment de la Révolution allemande. Si Schickele sympathise avec le mouvement socialiste, il est avant tout du côté des pacifistes et des non-violents. Position qui le contraindra, suite aux menaces des nazis, à s’exiler en Provence alors qu’il avait pris le parti de s’installer sur la rive allemande du Rhin.
Son livre Nous ne voulons pas mourir (conçu comme un triptyque) mêle des considérations politiques et littéraires avec, en toile de fond, ce goût d’une Europe qu’il envisage déjà articulée sur cette relation particulière entre la France et l’Allemagne. De ses propres pérégrinations en Europe et de ses propres lectures de l’histoire, il tire cette conviction : « Nous Européens avions tous le même destin, simplement nous le réalisions à tour de rôle c’était vraiment toujours la même histoire ». De l’Europe il en parle aussi en ces termes : « Cette péninsule sur laquelle se referme la mer, habitée par les fils les plus jeunes et les plus insatiables du genre humain, où finit incontestablement la trop puissante Asie ».
Séduit un moment par le socialisme révolutionnaire comme moyen d’envisager cette nouvelle Europe, il réfute assez vite la lutte des classes et le recours aux méthodes violentes qu’elle implique. « On ne convainc pas par la violence (…) La terreur, quelle que soit sa forme, est l’annulation de l’idée de l’homme ». Ailleurs il écrit : « Une affaire d’ordre spirituel ne dépend jamais d’un succès des armes quel que soit le camp où il se produit ».
Car, pour René Schickele, l’Europe est d’abord une affaire « d’Idéal » à réaliser avec « des moyens spirituels » en « partant du beau et de ce qui est digne de l’humanité ». Seule la non-violence permettra, selon lui, d’accéder à cet « Idéal ».
Avec comme horizon les Vosges françaises d’un côté, la Forêt noire allemande de l’autre (« comme les deux pages d’un livre ouvert »), là où le Rhin n’est pas une frontière mais un trait d’union, Schickele se fait aussi l’héritier d’une forme d’idéalisme d’ordre spirituel dans la tradition du mysticisme allemand. C’est notamment le cas quand il nous parle de la forêt : « Des flots de vie coulaient de la forêt pour se mêler au paysage aussi loin qu’il était éclairé par la lune. La paix monta, la paix descendit en moi, car j’étais de bonne volonté, au moins cela, j’en étais sûr ». Écrivain, journaliste, mais aussi poète, auteur largement méconnu (sinon inconnu), René Schickele concevait au fond l’Europe comme une véritable patrie de l’âme...
Nous ne voulons pas mourir, René Schickele, traduit de l’allemand et présenté par Charles Fichter, Arfuyen, 163 pages, 16 euros. Ce livre a obtenu le prix Nathan Katz du patrimoine 2019.
 |
Jean-Luc Le Cléac’h, |
| Fragments d’Europe |
|---|
Breton et Européen. Jean-Luc Le Cléac’h ne nous parle pas dans son livre de l’Union européenne mais d’un continent qu’il a approché par le voyage et la littérature. « On ne naît pas Européen, on le devient », nous dit cet auteur qui vit en Pays bigouden et que le goût de la découverte démange inlassablement.
Il a un amour particulier des cartes, des atlas, de la géographie, des chemins de terre comme des tracés urbains. De tout ce qui relève, peu ou prou, de l’école buissonnière. Jean-Luc Le Cléac’h l’a dit dans deux très beaux livres : Parcourir l’atlas et Poétique de la marche (La Part Commune, 2013 et 2017). C’est le même tropisme que l’on découvre dans ses Fragments d’Europe, vision éclatée de pays qu’il parcourt depuis sa jeunesse et où l’on retrouve notamment ce goût particulier qu’il a pour la toponymie, ce qui l’amène aujourd’hui à écrire que « le simple énoncé des noms de lieux d’Europe est une forme de dépaysement, de poésie peut-être ». Mais il ajoute aussitôt qu’il y voit plutôt « le lieu d’un empaysement ». C’est le cas de la Polésie, territoire « improbable » qui s’étend sur trois pays, aux confins de la Pologne, de la Biélorussie et de l’Ukraine. Ou encore de la Podolie, une région située au centre de l’Ukraine.
La boussole de Jean-Luc Le Cléac’h lui indique immanquablement le nord (mais n’est-ce pas normal ?). Ses pas le conduisent presque naturellement vers la Norvège, vers la Finlande, vers les rivages de la Baltique ou de la Mer du nord, vers les villes hanséatiques, vers les cités des Pays-Bas au si riche passé. « Quel est cet air qui circule dans les rues d’Amersfort ou d’Utrecht ? Que possèdent – de plus ? d’autre ? – les villes de Delft ou d’Haarlem ? Quelle conjonction, au sens astronomique du terme, trouve-t-on entre canaux et briques rouges, tolérance et protestantisme, pour que je me sente à mon aise, plus libre, dès que je séjourne dans l’une de ces cités ? »
À propos de chacune de ces villes du nord de l’Europe, il parle encore de « place sûre, où rien de fâcheux ne peut nous arriver », de « lieu protégé qui n’est entaché d’aucune connotation négative et où il nous est possible de nous réfugier mentalement à la moindre alerte »
Son approche « pointilliste » de l’Europe, à la manière des artistes de cette école de peinture, l’amène à évoquer avec chaleur les villes de Gdansk, de Prague ou de Cracovie (avant ou après la fin du Rideau de fer), à se mettre dans les pas d’auteurs qui ont contribué à forger en lui cette conscience européenne : Claudio Magris, Mario Rigoni Stern, Francesco Biamonti, Jon Kalman Stefansson… Mais aussi à truffer d’anecdotes succulentes ce road-movie européen étalé sur plusieurs années (ainsi, en Estonie, cette découverte de cidre de Cornouaille AOP à la carte d’un salon de thé).
Si le nord et l’est de l’Europe (dont cette fameuse Mitteleuropa) ont les faveurs de l’auteur, le sud brille pour lui du côté de l’Andalousie médiévale et multiculturelle, ou, franchissant la Loire, du côté des bastides et des paysages du Périgord (« un baume pour nos existences »). Et quand il parle de l’Ouest, c’est pour nous entraîner, prioritairement, dans le dédale des chemins de la Cornouaille britannique.
Jean-Luc Le Cléac’h a l’humeur européenne contagieuse. Il pense que l’Union européenne « doit être défendue malgré ses imperfections » et que le Brexit est une bien mauvaise nouvelle. Ce qui ne l’empêche pas d’exprimer quelques constats amers sur l’uniformisation du continent. Ainsi est-il conduit à formuler un certain goût des frontières, conçu comme « un état d’esprit, un éventail de gestes, d’attitudes ». Il voit dans les frontières ce qui relève d’un rite de « passage » avec le « caractère sacré » qu’il implique. Et tout cela a disparu. Ou presque.
Fragments d’Europe, Jean-Luc Le Cléac’h, La Part Commune, 140 pages, 15 euros.
 |
Ernest Renan, |
| L’islam et la science |
|---|
Voici un important texte de Renan exhumé par les soins des éditions rennaises La Part Commune. Il s’agit d’une conférence que l’écrivain breton a consacrée à l’islam lors d’une intervention à la Sorbonne le 29 mars 1883. Des propos à lire à l’aune des événements qui secouent aujourd’hui le monde musulman. Et, par ricochets, le monde occidental.
Ernest Renan a 60 ans quand il s’exprime ainsi sur l’islam. Il dispose d’une chaire au Collège de France et en est même l’administrateur depuis 1883. Quelques années auparavant – en 1878 – il avait été élu à l’Académie française. Si Renan peut légitimement s’exprimer sur l’islam c’est parce qu’il en a une connaissance approfondie. Son doctorat en lettres, présenté en 1852, avait pour thème « Averroès et l’averroïsme ». Ce doctorat anticipe en quelque sorte cette conférence faite trente ans plus tard et qui tourne autour d’une idée simple : l’islam a éliminé toute pensée scientifique et philosophique à partir du milieu du 13e siècle. Renan fait le constat de « la décadence des états gouvernés par l’islam », à l’exception de la Perse qui est, selon lui « bien plus chiite que musulmane ».
Renan ne manque pas de rappeler que le monde musulman a connu une période faste de 775 environ jusqu’au milieu du 13e siècle. Il l’attribue aux califes abassides « curieux de toute chose ». C’est l’époque d’Alfarabi et d’Avicenne quand la philosophie, l’astronomie, la mathématique ne font pas l’objet de suspicions. La science grecque, souligne aussi Renan, arrive même en Occident par la Syrie, par Bagdad, par Cordoue et par Tolède. La figure du philosophe Averroès, qui meurt au Maroc, émerge de cette période (*). Et puis patatras, quand « la réaction théologique l’emporte tout à fait » et, raconte Renan, que « bientôt la race turque prendra l’hégémonie de l’islam et fera prévaloir son manque total d’esprit philosophique et scientifique », la décadence s’amorce irrémédiablement alors qu’au même moment on assiste à « la naissance du génie européen ».
Mais Ernest Renan ne s’arrête pas là dans son explication sur le déclin du monde musulman.
Pour lui, la langue arabe, qui « se prête si bien à la poésie et à une certaine éloquence », est « un instrument fort incommode pour la métaphysique ». Il explique aussi que l’islam dans sa version rigoriste (il parle d’islamisme) a toujours « persécuté la science et la philosophie » et ajoute que « la théologie occidentale n’a pas été moins persécutrice » mais qu’elle n’a pas réussi à triompher. « Ce qui distingue, en effet, essentiellement le musulman, c’est la haine de la science, c’est la persuasion que la recherche est inutile, frivole, presque impie » parce qu’elle est « une concurrence faite à Dieu » (quand il s’agit notamment de la science de la nature)
Il pointe ainsi du doigt ce qui lui semble être une forme de faute originelle de l’islam dans « l’union indispensable du spirituel et du temporel ». Pour Renan, c’est « le règne d’un dogme, c’est la chaîne la plus lourde que l’humanité ait jamais portée ». Et il affirme que les libéraux de son époque, indulgents sur cette religion, se trompent à propos de l’islam car ils « ne le connaissent pas » vraiment.
(*) Cette opinion est aujourd’hui contestée par le médiéviste Sylvain Gouguenheim dans son livre Aristote au Mont-Saint-Michel (Seuil, 2008). Il souligne la précocité d’une transmission du savoir grec par les monastères chrétiens. Il remet ainsi en cause l’opinion selon laquelle la diffusion de la philosophie, de la mathématique et de la physique au Moyen-Age serait due exclusivement à l’Espagne musulmane.
L’islam et la science, Ernest Renan, La Part Commune, collection La petite part, 59 pages, 6,50 euros.
 |
Le Goncourt de la Poésie à, |
| Yvon Le Men |
|---|
Le Goncourt de la poésie a récompensé, mardi 7 mai chez Drouant, le Breton Yvon Le Men pour l'ensemble de son œuvre, et plus particulièrement ses livres parus chez Bruno Doucey : Une île en terre (2015) et Le poids d'un nuage (2017). Le membre de l'Académie Goncourt, Tahar Ben Jelloun, a salué un « passeur qui prend le temps d'écouter le monde et interroge les mots »
Yvon Le Men est né à Tréguier en 1953. Il a écrit une quarantaine de recueils de poésie et a inauguré sa carrière poétique par son livre Vie en 1974. Il vient de publier Aux marches de Bretagne aux éditions Dialogues à Brest. Yvon Le Men s’est immergé pendant plusieurs semaines dans le Coglais, aux marches de Bretagne, dans le cadre d’une résidence d’écriture. Le voici projeté dans le pays de la poète Angèle Vannier dont un collège porte le nom. Une expérience inédite venant après celle qu’il avait menée dans le quartier rennais de Maurepas et racontée dans Les rumeurs de Babel, (Dialogues2016). Mais cette fois-ci, le poète breton s’est retrouvé sur « le plancher des vaches » au cœur d’un monde rural chargé d’histoire et où lui parvenaient, malgré l’éloignement, toutes les « rumeurs » du monde d’aujourd’hui.
Yvon Le Men pratique un genre littéraire nouveau: la poésie de reportage. Il a le flair du journaliste, aiguisé par sa curiosité naturelle et sa grande capacité d’empathie. Mais il le fait dans son langage à lui : phrases brèves, rythmées, musicales, jouant beaucoup sur les allitérations. Avec des blancs pour laisser respirer le lecteur. Il le faut bien. Son reportage poétique dans le Coglais tient en pas moins de 180 pages.
Le Coglais. Pays de la frontière (celle du Couesnon, mais pas seulement) où les deux communes de Saint-Brice et Saint-Étienne ont uni leur destinée sous le nom de Maen Roch. «La nouvelle communauté / ainsi baptisée / comme nous le fûmes à notre naissance », note le poète. Les ombres de l’histoire rôdent dans le secteur. Saint-Aubin du Cormier, lieu de la célèbre bataille qui signa la défaite bretonne en 1488, est à portée d’arbalète. « Les soldats venaient de tous les pays / pas seulement de leurs pays chéris / où les morts après la bataille n’ont plus de patrie ». C’est « dans ce pays.de granite / d’herbes / de vaches » que vivent aujourd’hui des femmes et des hommes avec qui le Men a échangé.
Voici donc des tranches de vie que le poète nous sert dans ses mots à lui. Il le fait avec beaucoup d’émotion quand il nous parle, en particulier, de tous ces destins brisés. « L’autre jour une femme s’est suicidée / dans la salle de traite aux vaches sans prénoms ». Comme il l’avait fait à Maurepas, Le Men s’approche des « gens de peu » : d’un ancien ouvrier granitier, de Lise dont le mari est « gratteur de boyaux », de tous ces ouvriers qui triment à l’abattoir (« cinq mille huit cents cochons tués / par des ouvriers / qui n’ont plus d’épaules après quarante années »)
Des préoccupations contemporaines surgissent aussi au fil des pages. Yvon Le Men se fait l’écho : les vertus ou non de la chasse, la protection de la nature, le développement du bio, la condition animale. « Comme on traite les animaux / on traitera les hommes / c’est la même chose pour les arbres / pour tout ce qui vit / même les pissenlits ». Et puis, il y a les drames du monde qui se répercutent même dans le Coglais. Hassan vit maintenant ici. Il vient de Libye, rançonné par « les fous de Dieu / sans dieu ». Le Men nous parle de ces migrants arrivés par Calais puis « par Cancale, non loin du Coglais ». Il nous parle de de « ceux d’ici / qui les ont accueillis / en amis ». Migrer. Les Bretons savent ce que cela veut dire. Et le poète breton nous rafraîchit la mémoire en donnant la parole à aux fils ou aux filles de celles, originaires du Coglais, qui sont parties faire des ménages à Paris.
Mais on ne quitte pas ces Marches sans évoquer le « fantôme » des grands écrivains qui « sont passés / dans les coins et les recoins / de ce pays ». Honoré de Balzac, bien sûr, et ses « Chouans », mais aussi Victor Hugo. « J’aurais aimé être avec celui qui a écrit / le poème Chose du soir / son refrain reprend mon prénom / entre poème et chanson », nous confie Yvon à la fin de son livre
Aux marches de Bretagne, Yvon Le Men, illustrations d’Emmanuel Lepage, éditions dialogues, 187 pages, 18 euros
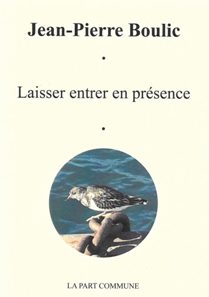 |
Jean-Pierre Boulic, |
| Laisser entrer en présence |
|---|
Faire advenir, accueillir, se mettre à l’écoute : il y a dans la poésie de Jean-Pierre Boulic cette inlassable « quête de signes au cœur d’un monde qui ne demande qu’à répondre » (Philippe Jaccottet). Le poète breton le manifeste dans un nouveau recueil où « joie » et « souffrance » se répondent, dans une tonalité parfois sombre quand sont évoqués l’hôpital, la maladie, la mort. Chaque fois qu’il voit « une âme livrée à la douleur ».
Mais on retrouve aussi dans ce recueil la toile de fond géographique – disons plutôt « cosmographique » – de l’œuvre de Jean-Pierre Boulic : ce pays d’Iroise, au bout du bout du Finistère, avec « le vaste grondement de l’océan », « l’haleine du large » et « les goélands parés de blanc ». Le poète est un homme du rivage, un homme du seuil, dans la lumière des saisons. Voici « l’automne écorché », « la fraîcheur d’avril », « l’été déchiré ». Et il nous dit : « Entre en présence / De ce silence / Où palpite la source / De l’inépuisable printemps ».
C’est sous ces cieux-là qu’il importe, nous dit-il, de « Converser avec / les humbles choses muettes / Bleuets capucines ». De déceler « signes » et « traces » d’un autre monde dans le monde qui nous enveloppe. Et de se mettre à l’écoute de l’oiseau qui « grisolle » comme de la voix qui « brasille ». Jean-Pierre Boulic aime les mots qui chantent pour mieux enchanter le monde. « Tu lèves les yeux / Vers un pays irrigué » et « Ce grand ciel est d’étoiles / Miettes sans tourments ».
Le malheur peut venir écorcher cette félicité. « Il tombe des cordes depuis des heures / On enterre la jeune morte / Au bout du chemin d’herbes et de pierres ». Ailleurs le poète nous parle d’une mère « qui vacille / De laisser partir l’enfant » ou de l’hôpital « où s’entend la souffrance ». Ce qui sauve ? « La salvatrice parole de l’amitié / Plus incisive que celle d’un bistouri ».
Jean-Pierre Boulic nous laisse alors « entrer en présence » de figures charismatiques. Celles qui ont cultivé cette amitié féconde appelée fraternité. Voici la « sœur du réconfort / Parmi les chiffons de la ville immense ». Voici Thérèse, « Inépuisable auréole / Au cœur du présent ». Voici « Tibhirine / Cet étonnant visage / D’homme aux regards sans prises / Et le cœur sans entraves ».
Rapprochant en définitive l’écriture poétique de l’exercice spirituel (ainsi que l’a défini Gérard Bocholier), Jean-Pierre Boulic peut affirmer au bout du compte : ton poème « n’est point de toi / Il est ce que dit l’indicible / Du verbe créateur ».
Laisser entrer en présence, Jean-Pierre Boulic, La Part Commune, 107 pages, 13 euros
 |
François de Cornière , |
| Ça tient à quoi ? |
|---|
« Mon émotion est toujours là / Je me demande / ça tient à quoi ? / ça tient à quoi ? » François de Cornière écrit comme il vit et vit comme il écrit. Dans la lumière des jours et parfois leur noirceur. Ses poèmes sont abonnés à la simplicité, à l’absence d’éloquence. Le poète dit « je » pour nous faire partager sa vie, mais il dit aussi « l’homme ».
Ce qui donne leur piment à ses textes, c’est cet inattendu et ce merveilleux qui se glissent dans l’ordinaire des jours et dont sait témoigner le poète. À partir d’un point minuscule, François de Cornière ouvre toujours des perspectives. Voici que, dans une salle de cinéma, il imagine (non pas la possibilité d’une île) mais la possibilité d’un poème qui serait « d’art et essai ». À un autre moment, c’est un feuillet qui glisse d’un livre de sa bibliothèque et le voici embarqué – nous avec – dans la découverte de son auteur (le poète Jean Rousselot). Comme François de Cornière le dit lui-même, il accorde sa bienveillance « à tout ce qui peut échouer dans un poème un jour » : sur un terrasse en Crête, lors d’un lever matinal, pendant une promenade nocturne, à l’écoute d’un disque de jazz… « Je poursuis ici, confie le poète, le parcours qui a été toujours le mien : celui de la vie, traversée par des instants notés au vol parce qu’ils m’ont touché ».
Mais voilà un poète aux allures de diariste ou de nouvelliste. À tel point qu’après une lecture de ses poèmes, une femme s’est approchée de lui pour lui dire : « Pendant que vous lisiez vos textes / je me suis plusieurs fois demandé / si c’étaient des poèmes / ou de très courtes nouvelles / vous voyez ce que je veux dire ? » François ne sait plus ce qu’il a répondu mais il se dit sûr que ses poèmes ne sont pas « de vrais beaux / ou modernes comme il faut ». On n’y trouve pas, en effet, ces images poétiques (métaphores, métonymies, analogies…) que l’on rencontre chez la majorité des auteurs. François de Cornière en apporte la démonstration à l’écoute enthousiaste de la bande son d’un film. « C’était formidable / sans les images j’avais tout vu / tout ressenti./ Je m’étais dit qu’écrire ainsi de la poésie /sans ce qui fait la poésie / serait un sacré beau défi ». Beau défi qu’il relève depuis des années, nous faisant penser à cette belle remarque du poète palestinien Mahmoud Darwich : « La prose est la voisine de la poésie et la promenade du poète. Le poète est perplexe entre prose et poésie » (Présente absence, Actes Sud)
Sans rechigner, partons donc dans le sillage de ce Nageur du petit matin (La Castor Astral, 2015) qu’est François de Cornière, poète des sens en éveil, à l’écoute des battements de son cœur (surtout quand la mer est fraîche). Il témoigne, sans faillir, des « minutes noires comme des minutes heureuses », fidèle en cela à l’injonction du poète suisse Georges Haldas qu’il a eu le bonheur de rencontrer à Genève et donc il évoque, dans ce livre, la mémoire.
Avec François de Cornière, les questions, les remarques, les confidences ou les exclamations – celles qui ponctuent son livre et qui sont celles de tous les jours – ont une étonnante densité dans leur simplicité. C’est pour cela qu’elles nous touchent et peuvent, mine de rien, nous mener très loin. « Tu as vu la lune ? », « Il y a combien d’années déjà ? », « Je t’aime bien sur celle-là », « Tu crois que c’était où ? », « J’ai pas été trop longue ? », « Lui, tu le reconnais ? », « À ton avis, on a fait combien de kilomètres ? » « Cette nuit tu as parlé en dormant », « ça a passé vite », « Tu veux que je prenne le volant ? », « À quoi Tu penses ?… Eh ! Oui, tout cela « ça tient à quoi ? »
Ça tient à quoi ? François de Cornière, préface de Jacques Morin, Le Castor astral, 198 pages, 13 euros.
 |
Jean-Claude Caër, |
| Devant la mer d’Okhostk |
|---|
Quand on est poète, que dire d’un voyage qu’on a fait au Japon ? « Je n’ai rien à raconter », nous dit Jean-Claude Caër, retour du Pays du soleil levant. « Pas d’histoires, pas d’anecdotes / Seulement des sensations diffuses, des malaises, / Une solitude appuyée ». Car son nouveau livre, en effet, est un récit fragmenté (on se gardera bien de parler de carnet de voyage) à la manière des grands maîtres de la poésie japonaise. Jean-Claude Caër se met dans leurs pas, visite à leur manière les campagnes comme les villes et n’hésite pas à se rendre sur la tombe des plus illustres d’entre eux (Saigyô, Sôseki…). Et, au bout du compte, appréhende le monde comme ils le faisaient. Avec distance. Dans la contemplation des êtres et des choses. En allant à « l’étang du bas », au « jardin des mousses », au « mont Koya », « dans une barque », « à la petite cabane »… Mais, toujours, sans trop se faire d’illusion sur un monde qui est aussi, nous dit Jean-Claude Caër, « un enfer ». Et nous reviennent en mémoire ces vers de Kobayashi Issa : « Nous marchons en ce monde / sur le toit de l’enfer / en regardant les fleurs ».
Dans la lignée de cette « impermanence » soulignée par le bouddhisme, Jean-Claude Caër nous dit encore que « tout nous échappe / Et file entre nos mains ». Et quand « la montagne fume après la pluie de la nuit », on a le sentiment d’entrevoir une estampe japonaise. L’esprit du haïku est là, aussi, quand il écrit : « 27° / Au bord de la rivière Kamo /On joue de l’éventail » ou encore ceci : « Une croix / sur un bâtiment gris / perdue dans Tokyo »
Mais au-delà de cette profonde imprégnation de la culture japonaise par l’auteur, il y a, ponctuellement, dans ce livre, un subtil va et vient entre deux mondes. Celui de l’Extrême-Orient où Jean-Claude Caër pérégrine et celui de cet Extrême-Occident où il est né (sur la côte sauvage du Nord-Finistère). Devant cette mer d’Okhotsk, au nord du Japon entre Sakhaline et Kamtchatka, à quoi pense-t-il ? À « a plage de Keremma / Couverte d’algues brunes en septembre ». Et quand il se rend aux « jardins de sable » du Daitoku-ji à Kyôto, « dans ce désert miniature à taille humaine », il pense à nouveau à cette plage de Keremma « quand la mer se retire à l’infini du sable ». À Keremma, comme devant la mer d’Okhotsk, une même sensation d’infini, de puissance brute de la nature et des éléments.
Ailleurs, voici l’auteur dans un temple où « dès l’aube quatre moines récitent les sûtras » et « où les tambours résonnent dans le monastère » À quoi pense-t-il ? « À ces années de collège, où nous allions à la messe avant le petit-déjeuner ». Ici, dans ce monastère, la langue lui est « inconnue » comme l’était « le latin d’Église ».
Ce retour par la pensée à la « terre natale » le rattache à sa mère dont il évoque la figure à plusieurs reprises et qu’il croit découvrir un jour sous les traits d’une paysanne japonaise au travail. « Je t’ai peut-être vue, penchée vers la terre, / Travailler ce matin dans les champs / Près d’Abashiri ou de Obihiro / Sous ton grand chelgenn / Dans la campagne paisible sous le soleil de mai » (ndlr : Chelgenn désigne une coiffe du Haut-Léon). Universalité du labeur paysan que l’on soit d’Abashiri ou de Plounévez-Lochrist, commune de naissance de Jean-Claude Caër.
« Mère, j’ai traversé des cercles de douleur / L’écriture et la vue de la mer me calment ». Devant la plage de Keremma comme devant la Mer d’Okhotsk.
Devant la mer d’Okhotsk, Jean-Claude Caër, Le Bruit du temps, 96 pages, 18 euros.
 |
Philippe Mac Leod, |
| Supplique du vivant, Variations sur le silence |
|---|
Philippe Mac Leod n’en finit pas d’écrire des « poèmes pour habiter la terre » comme l’indiquait le titre de l’un de ses derniers livres (Le Passeur, 2015). En quête de « vif », de « pur », « d’infini », de « transparence »…, il voudrait rendre à la parole poétique « ce pouvoir incomparable, non plus de nommer, de capter, de saisir, mais d’être elle-même le cœur battant du mystère ». C’est bien le cas dans cette Supplique du vivant qu’il publie aujourd’hui aux éditions Ad Solem et dans Variations sur le silence chez le même éditeur.
Né en 1954, attiré par la tradition monastique mais aujourd’hui engagé dans la voie d’une consécration laïque, Philippe Mac Leod a longtemps mené une vie solitaire, à la manière d’un ermite, dans le massif pyrénéen près du sanctuaire de Lourdes. S’il réside aujourd’hui en Bretagne, dans les Côtes d’Armor, il continue à dire sans faillir « le poème de la montagne » (titre d’un des chapitres de Supplique du vivant). « Il n’y a rien à expliquer sous un ciel si grand. Rien à éclaircir. Et pourtant, vivre réclame tes mots » (…) « Ton poème ne viendra que de ce chemin retrouvé – et sans jamais dépasser l’herbe rase des pelouses, l’étoile d’un ciel de gentianes ».
Philippe Mac Leod s’exprime en « prose poétique ». Il flirte parfois avec l’aphorisme. Mais le ton dominant est celui de la méditation, de la contemplation et de l’introspection. Il associe toujours poésie et réflexion. Il y a, en permanence, une pensée, une idée, en toile de fond de ses textes. Son écriture est exigeante. Ses poèmes, note l’éditeur, « ne décrivent pas mais écrivent ce dont l’auteur vit, ce qui l’a poussé à entamer un chemin d’écriture en rupture avec le monde et ses artifices ». Aussi peut-on lire, sous sa plume, ce type de constat : « Il faudra enfin mourir pour commencer à vivre ». Et donc, ajoute-t-il avancer « plus que d’un pas libre ». Pour retrouver quel pays ? « Les marges ». Pour faire place à quoi ? « À l’infime, l’inaperçu, l’éraflure du timbre brisé, le geste inachevé, l’étincelle perçue d’un clignement ». Car, nous dit Philippe Mac Leod, « le temps ne nous a rien pris. Il nous rend à ce que nous avons toujours été, une enfance qui ne savait que naître ». Ailleurs, il nous parle de « la voix qui brûlait dans la lumière du jour et que nous n’avons pas su entendre ni retenir ».
Nous voici donc orphelins de quelque chose ou de quelqu’un. Les mots-clés pour se mettre à l’écoute de cette voix dont il parle et pour passer sur l’autre rive s’appellent « lumière » et « silence ». Philippe Mac Leod écrit : « Le silence est ma lumière et la lumière est mon silence ». C’est ce silence qui charpente précisément ses Variations sur le silence.
Face à ce magma qu’est le monde actuel, que peut la poésie ? Dans son livre La poésie sauvera le monde (Le Passeur, 2016), Jean-Pierre Siméon esquissait une réponse. « Rejoindre le réel par l’évocation du sensible ». Comme en écho, Philippe Mac Leod affirme : « Nous entendons mais du réel nous n’écoutons rien. Nous écoutons mais nous n’entendons pas. Parce que le cœur n’est pas tourné vers le silence ». Ce que Jean-Pierre Siméon formulait aussi à sa manière : « Tout poème est un acte de résistance » car « le poème nous rend au silence dont il est né, il fait silence en nous ».
C’est bien sûr ce silence-là qui habite les textes de Philippe Mac Leod. Et qu’il entend sauver. « Silence défiguré – moqué – piétiné - puis se redressant d’un lumineux aplomb, silence de gloire au-dessus des vallées étroites de nos courtes vies, tristes vies, qui attire tout à lui, de son écume un jour lancée comme le filet d’une parole irrévocable ». Sous d’autres cieux, à une autre époque, le poète britannique Thomas Carlyle (1795-1881) n’avait pas dit autre chose : « Lorsqu’on observe l’inanité tapageuse du monde, ses mots porteurs d’un sens si maigre, ses actes si insignifiants, il est réconfortant de songer au grand Royaume du Silence ». L’espoir habite donc toujours les poètes : « Dans le grand silence des mondes ensevelis, souligne pour sa part Philippe Mac Leod, « Il neige de petites semences de silence qui mûrissent d’autres mondes où les nuits sont blanches et l’ignorance clairvoyante ».
Le silence peut devenir ainsi, pour nos âmes égarées, un « sas », un « filtre », un « tamis ». C’est ce silence qui peut nous aider à gagner « l’autre monde ». Mais cet autre monde « est de ce côté – tout proche – aussi ténu qu’une palpitation sous le fin duvet de l’oisillon ». Il nous tarde de le rejoindre car « le bain de silence toujours nous mène au bain de lumière ».
Supplique du vivant, Philippe Mac Leod, Ad Solem, 88 pages, 14 euros. Variations sur le silence, Philippe Mac Leod, Ad Solem, 96 pages, 14,50 euros.
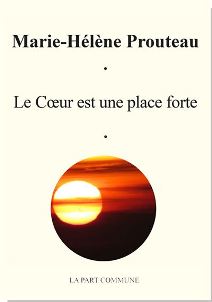 |
Marie-Hélène Prouteau, |
| Le cœur est une place forte |
|---|
Marie-Hélène Prouteau aime mêler l’histoire familiale à la grande histoire. L’histoire ancienne à l’histoire récente. Établir des rapprochements. Elle le montre encore dans son nouveau livre dont le sujet est la guerre : la Grande guerre et celle de 39-45, vues à travers l’histoire d’un grand-père puis celle de l’auteure elle-même, dans cette ville de Brest, détruite, où elle est née.
Roman ? Récit poétiqueC? Enquête ? Comment qualifier le livre de la Nantaise Marie-Hélène Prouteau ? « Il faut déranger les ruines, explique-t-elle, mettre la lampe frontale pour descendre dans les fissures de l’ombre. Les signes du silence accompagnent. Et, doucement, comme une évidence, appeler les absents ». Puis elle reprend ces mots de Paul Celan (qui donnent leur titre au livre) : « Le cœur est une place forte ». Car, dit-elle, « ces mots lèvent en nous l’idée de résistance ». Résistance au désordre et au malheur de la guerre.
L’acte I de ce livre est constitué par la découverte, en Belgique, du livret militaire du grand père de l’auteure, soldat du 19e RI de Brest, dans un grenier de Maissin (« village martyr calciné par le feu allemand ») aux côtés de 430 autres livrets. À partir de ce document (« ses feuillets fatigués ont la douceur du chiffon ») que la grand-mère conserve comme un trésor, Marie-Hélène Prouteau va mener une véritable enquête documentaire pour éclairer le drame qui s’est noué sur place.
« La guerre, c’est quand des gamins de quinze ans doivent enterrer vivants des soldats sur ordre de criminels ». Son enquête fait surgir, aux côtés du grand-père Guillaume, d’autres figures de soldats venus de Bretagne : Yves Henry de Plérin, Henri Ollivier de Saint-Nazaire qui avait gravé son nom sur le tronc d’un arbre de Maissin. Puis il y a cet événement stupéfiant : le démontage du calvaire finistérien du Tréhou par ses habitants pour rejoindre le charnier de Maissin et veiller sur les morts : « Le calvaire est remonté pierre à pierre. À Maissin, en son cadastre labouré de baïonnettes ». Et, depuis 1932, « en son lotissement de deuil, se tient le vieux calvaire, sentinelle en humanité qui se penche vers ses milliers de fils ».
Acte II du livre : Brest après les bombardements de la Seconde guerre. La petite Marie-Hélène naît dans cette ville-là, dans une clinique d’accouchement qui avait été bombardée en 1940. « Un pays natal de gravats et d’épaves, ton legs au commencement ». La fillette apprend à savoir qu’avant sa naissance le ciel a été « en exil » et qu’il brûlait toutes les nuits « sur fond de mort des étoiles ». Et elle reprend aujourd’hui ces mots de Julien Gracq parlant de « Brest, tragique et sacrificielle, tranchée comme une pyramide aztèque » (Lettrines, 2).
Mais « tout n’a pas disparu avec les murs effondrés, les maisons éventrées », nous dit Marie-Hélène Prouteau. « Les lieux ne sont plus. Restent les visages, les gestes, les élans ». Le visage de Paul, un oncle mort jeune à la guerre. Celui de James Sheridan, aviateur anglais, enterré dans le cimetière de La Forest-Landerneau, commune où ont vécu les grands parents de l’auteure. Les élans sont ceux des sauveteurs vers l’abri Sadi-Carnot bombardé.
« Que serait se tenir à hauteur de toutes ces ombres emportées dans la guerre ? », interroge l’auteure. Sans doute commencer par dénoncer, inlassablement, toutes les guerres. Celles qui ont vu les massacres de l’antique Ur comme ceux, récents, perpétrés à Alep ou à Sarajevo. Faire mémoire aussi. « Je voudrais donner chair aux silhouettes ombreuses qui se sont colletées aux plus hautes épreuves. Qui ont tenté de garder le cœur à l’heure humaine ».
Plus fondamentalement encore, « trouver l’élan qui sauve » en concevant un « sursaut de bienveillance pour ce monde qui est le nôtre ». Marie-Hélène Prouteau le dit avec talent – dans une certaine fièvre d’écriture – au cœur d’un livre où sont magnifiés à la fois le tragique et la beauté de l’existence.
Le cœur est une place forte, Marie-Hélène Prouteau, préface de Dominique Sampiero, La Part Commune, 147 pages, 14 euros.
 |
Jean Lavoué, |
| Fraternité des lisières |
|---|
Si la poésie consiste, comme l’a dit Giuseppe Ungaretti, à « apporter d’heureuses clartés sur les chemins de l’obscur », alors on peut dire que l’écriture de Jean Lavoué relève de cette démarche-là. Dans ce nouveau livre, en effet (« poèmes pour la paix »), le poète breton pointe les périls et toute l’obscurité du monde, mais il garde, en permanence, l’espoir chevillé au cœur en traçant des nouveaux chemins de fraternité.
Premiers périls : ceux du terrorisme. Jean Lavoué évoque tous ceux qui ont ensanglanté le pays entre 2014 et 2018, de Charlie à Trèbes, en passant par le Bataclan, Nice… Mais aussi ceux qui ont apporté le deuil à Palmyre et Alep. Le poète désigne le mal, parle de Daech sans le nommer. « Ils ont ouvert le livre / Comme on découvre un champ de mines / Ils ont dégoupillé les versets de la peur / Ils ont défiguré le secret, / Couvert le nom divin de leurs cris de victoire ». Mais, on l’a dit, l’auteur n’est pas là pour dire la seule noirceur du monde. Hommage donc au martyre du père Hamel et à l’héroïsme du colonel Arnaud Beltrame. Et au-delà de ces deux figures devenues charismatiques, c’est un vrai leitmotiv d’espoir que ressasse – en dépit de tout – ce livre. « Il ne reste désormais pas d’autre humus pour sa croissance / Que le cœur bienveillant de l’homme / Pas d’autre signe de sa poussée bienfaisante / Que les frêles tiges de l’amour ».
Il y a le terrorisme, mais il y a aussi les désastres humanitaires. À commencer par ceux des migrants. « Serons-nous les vigies / Offrant refuge aux naufragés / Ou bien les grilles, poings serrés / De nos fraternités mortes ? », interroge Jean Lavoué.
Il y a le terrorisme, mais aussi les périls qui pèsent sur la planète terre. « Passagers des étoiles / Nous sommes les clandestins d’une terre dévastée, / Humiliée par nos fautes ». Le poète appelle au sursaut. « Il nous faut réapprendre ensemble / À écouter la musique des étoiles / À parler aux mousses et aux forêts, / À inviter l’aube et l’océan chez nous, / À cultiver humblement nos partitions potagères ».
Jean Lavoué arc-boute, enfin, sa confiance à tous ces « vivants aux mains nues » qui signent les gestes essentiels au cœur de ces « temps de détresse ». Ainsi, à propos d’Asia Bibi, la jeune chrétienne pakistanaise accusée de blasphème, il peut écrire. « Chaque fois qu’une femme dans le monde / Meurt à douleur /Pour les sarments d’amour qu’elle porte au cœur / Le monde crie en silence ».
Fraternité des lisières, poèmes pour la paix 2014-2018, gravures de Marie-Françoise Hachet – de Salins, éditions L’enfance des arbres (3, place vieille ville, 56 7000 Hennebont) 167 Pages, 15 euros.
Lectures de 2018
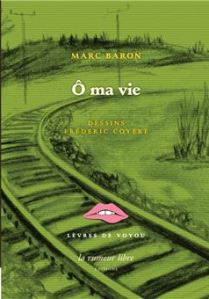 |
Marc Baron, |
| Ô ma vie |
|---|
Marc Baron écrit pour les enfants et pour les « grands enfants » que nous pouvons devenir en lisant des poèmes. Ô ma vie, son dernier recueil, est destiné à tout le monde. L’auteur nous parle – à mots feutrés – de sa vie. Et donc aussi de la nôtre.
Comment ne pas être saisi par les premiers vers de ce recueil : « Ô ma vie / tu m’en fais voir / de toutes les couleurs // La mort de mon père / et l’oiseau dans la boue ». Exercice de dédoublement. Le poète s’adresse à sa vie comme à quelqu’un à la fois d’extérieur et d’intime. Il lui parle comme à un compagnon de fortune et d’infortune. « Ô ma vie / tu m’en fais voir / de toutes les couleurs (…) moi le daltonien dont on se moque / lorsque je cueille une pomme verte ».
Marc Baron ne durcit jamais le trait mais il sait nous dire qu’il a « des bleus partout » et qu’il fuit « la bêtise humaine ». Aussi appelle-t-il volontiers au sursaut. « Ô ma vie révolte-toi toujours / n’accepte plus bonimenteurs / ni compromis ». Mais comment faire face quand la vie vous bouscule ainsi, quand le sang coule « pour une broutille ou pour la guerre » ? Le poète part sur sa « voie verte » et « tire allègrement un wagon de poèmes ». Pour s’aérer l’esprit et carrément pour survivre, il fait aussi beaucoup de « pompes ». Soulevant des haltères, il peut soulever sa « rage ». Et en musclant ses « deltoïdes », il muscle son cerveau.
Marc Baron ne nous propose pas pour autant un traité de bien-être ou de résilience. Ses poèmes ne fredonnent pas les airs à la mode. Ils creusent le sens de nos existences au-delà des traités de sagesse que l’on voit fleurir dans les devantures. « Ô ma vie, ma bien vivante / et mon étoile morte quand je m’éteins / pour un oui ou pour un non ». Son livre est un hymne à cette vie qu’il chérit au fond. Mais sans illusion ni concession. « Pas d’amour qui ne fasse mal // Pas de moisson sans guérison ». Le poète lit Rimbaud ou se met au piano, accueille le jour comme il le faisait enfant quand le soleil du matin inondait son lit.
Marc Baron a créé le salon du livre jeunesse de Fougères. Il n’a pas quitté sa jeunesse, son enfance. Et fait d’ailleurs cet aveu : « Ô ma vie / je ne fais pas mon âge ».
Ô ma vie, Marc Baron, avec des dessins de Frédéric Coyère, éditions La rumeur libre, 47 pages, 14 euros.
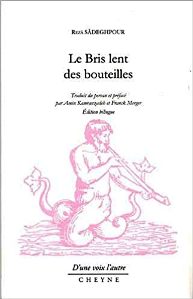 |
Reza Sadeghpour, |
| Le bris lent des bouteilles |
|---|
Il est Iranien. Il a trente-quatre ans et il est déjà reconnu dans son pays comme un très grand poète. Reza Sadeghpour – avocat dans le civil, à Ispahan – a obtenu en 2015 le « Prix du recueil de l’année » décerné lors du Festival de la poésie persane contemporaine pour son livre Le bris lent des bouteilles. Ce livre est aujourd’hui publié en France dans une édition bilingue.
Avec Reza Sadeghpour il ne faut pas s’attendre à des grandes envolées lyriques ou mystiques. Non, nous sommes ici dans le minimalisme, ce qui n’empêche pas que cette poésie soit riche de sens et garde des accointances avec la poésie classique iranienne. Le jeune auteur a été marqué, comme tous les poètes de son pays, par l’écriture de Hafez (1320-1389) et aussi d’Omar Khayyam (1050-1123). Mais Sadeghpour aborde la poésie dans une autre « posture » que ses illustres prédécesseurs. Il est sans doute plus proche des banalités de la vie quotidienne et élabore une autre architecture des poèmes avec des mots comme empilés les uns sur les autres. Plus fondamentalement, « l’ambiguïté est le maître-mot de la poésie de Reza Sadeghpour, qui compare sa poésie à un lac calme et limpide où viendraient se mêler les eaux noires de rivières agitées », notent ses deux préfaciers.
Les poèmes – au nombre de 46 dans ce livre – sont brefs. Une dizaine, une quinzaine de mots. Souvent pas plus que dans un haïku, un genre poétique auquel on pense volontiers quand on lit certains de ses courts textes. « Cerisiers en fleurs / moineaux joyeux / une ligne blanche / fait du ciel deux moitiés, / mes dents /hélas / cette année / noircissent ».
Il faut dire que, pour ce qui est de la concision et de l’art de saisir la banalité des jours, Sadeghpour a de qui tenir. Avant lui, Sohrab Sepheri (1928-1980) avait, dans L’Orient de la tristesse, repris l’atmosphère si particulière du haïku japonais (« Une ride plie la face d’un étang / Une pomme roule sur la terre / Un pas s’arrête, la cigale chante »). Plus récemment, Abbas Kiarostami (1940 – 2016) avait carrément fait le choix d’écrire des haïkus persans tels qu’on les découvre notamment dans ses deux livres Avec le vent (P.O.L.) et Un loup aux aguets (La Table ronde). Lisant Le bris lent des bouteilles, comment ne pas penser à ces quelques vers du cinéaste-poète. « Une bouteille cassée / déborde / de pluie de printemps ».
On retrouve donc chez Sadeghpour ce détachement propre au haïku et cette sensibilité au passage des saisons : « cette année l’automne /a duré quatre mois : / les feuilles du figuier / ne tombaient pas ». Et cette attention soutenue à ce qui nous entoure: « Il interrompt sa prière / pour faire boire un oiseau / dans le creux de sa main… »
Mais contrairement aux grands maîtres japonais du genre, il y a dans ce livre une forte dose d’amertume. Si l’on devient poète à cause d’une femme que l’on a perdue (comme dirait Stendhal), alors on peut faire ici le constat de la perte et du manque. C’est ce qui signe fondamentalement ce recueil. « L’amoureux / connaît ce sort : / une cigarette / à ses lèvres attristées / et des sanglots / tels des trémolos », écrit le poète. Ou encore ceci : « les photos au-dessus du lit / les narcisses dans le vase / les bougies /peuvent témoigner / que personne n’était là /pas même moi /à l’heure /où tu n’es pas venue ».
Le bris lent des bouteilles, Reza Sadeghpour, traduit du persan et préfacé par Amin Kamranzadeh et Franck Merger, éditions Cheyne, collection D’une voix l’autre, édition bilingue, 110 pages, 22 euros.
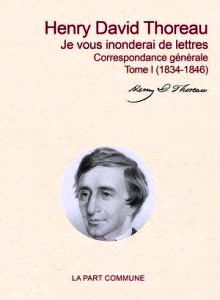 |
Henry David Thoreau, |
| Je vous inonderai de lettres |
|---|
Qui a lu et aimé Walden ou la vie dans les bois de Henry David Thoreau ainsi que son Journal ne peut qu’être curieux de découvrir sa correspondance. Le célèbre écrivain américain (1861 – 1862) a été un épistolier assidu. Le premier tome de ses lettres, que La Part Commune publie aujourd’hui, couvre la période 1834 – 1846. Le jeune Thoreau a alors entre 17 et 29 ans.
Quand débute sa correspondance, il est étudiant à l’université Harvard où il obtient son diplôme en août 1837. Il devient instituteur à l’école publique de Concord, sa ville natale dans le Massachusetts, mais démissionne très vite et entame la rédaction de son Journal. En 1838, il ouvre sa propre école avec son frère John. Il y enseigne jusqu’en 1841, date à partir de laquelle il renforce ses liens avec Ralf Emerson, fondateur du mouvement transcendantaliste, à qui il apporte son aide pour la rédaction du Dial. En 1842, Thoreau publie L’histoire naturelle du Massachusetts (La Part Commune, 2014). Puis le voici en 1843 précepteur des enfants du frère d’Emerson à Staten Island. C’est en 1845 qu’il commence la construction de sa cabane à Walden, un étang boisé près de Concord où il s’installe le 4 juillet.
Telle est la trame sous-jacente de cette correspondance de jeunesse où l’on découvre un Thoreau intime multipliant les lettres à sa mère, à sa famille, à ses anciens amis de promotion d’Harvard, à Emerson bien sûr, et à tant de personnes qui commenceront très vite, à s’intéresser au contenu de ses articles et bientôt à ses conférence. « On y découvre, loin de la légende d’ermite des bois que la postérité lui a faite, un être éminemment sociable et attentif à ceux qui lui sont chers », souligne Thierry Gillyboeuf qui a établi, préfacé et annoté cet important ouvrage contenant pas moins de 144 lettres.
On y découvre aussi un homme déjà en rupture avec les institutions et la vie sociale. « Force m’est d’avouer que j’ai tendance à considérer les métiers et professions comme autant de pièges que le Diable pose pour capturer les hommes », écrit-il dans une lettre du 14 mars 1842. On le découvre enfin délibérément engagé du côté des abolitionnistes ou des défenseurs des Amérindiens. Sa correspondance apporte également d’utiles renseignements sur les phénomènes migratoires qui touchent, à cette époque-là, la côte est de l’Amérique. Ainsi Thoreau nous parle-t-il des ouvriers anglais « que l’on reconnaît à leurs visages pâles et à leurs main tachées » ou encore de ces Norvégiens « qui emportent avec eux leurs outils agraires à l’ancienne dans l’Ouest, et qui n’achètent rien ici de peur d’être floués » (lettre du 1er octobre 1843)
Mais l’homme de Walden, celui de l’immersion dans la nature, pointe déjà le bout du nez. « Mon tempérament me porte à observer la nature avec la même sympathie spontanée que l’herbe aux yeux bleus dans la prairie scrute la face des cieux » (lettre du 21 juillet 1841). « Chaque brin d’herbe dans le champ, chaque feuille dans la forêt fait le sacrifice de sa vie quand la saison est venue avec autant de grâce qu’il a ou qu’elle a mise à pousser » (lettre du 11 mars 1842).
Il y a dans cette correspondance d’innombrables pépites de ce type. La lecture peut devenir un vrai enchantement au sein d’une correspondance qui s’éparpille, parfois, dans des considérations plus terre à terre parce que liées à des questions matérielles ou de gestion du quotidien. Et cela est bien normal. Mais Thoreau n’est jamais ennuyeux. Ses lettres nous révèlent – s’il en était besoin – la profondeur de sa pensée et ses qualités littéraires. Surtout quand la correspondance est l’occasion, comme elle l’était au 19e siècle, d’exprimer des sentiments très intimes. « Vous me faites l’impression de vous exprimer depuis des cieux dégagés et inaccessibles, où l’on peut se retrouver pour peu que l’on s’élève. Votre voix ne semble pas en être une, mais venir autant des cieux d’azur que du papier », écrit-il dans une lettre du 20 juin 1843 à Lidian Jackson Emerson, la femme de son ami Emerson, dont il était secrètement amoureux. Thoreau en amoureux transi : on connaissait moins.
Je vous inonderai de lettres, Henry-David Thoreau. Correspondance générale, tome 1 (1834-1846). Édition établie, préfacée et annotée par Thierry Gillyboeuf, La Part Commune, 445 pages, 22 euros. Thierry Gillyboeuf est l’auteur de Henry David Thoreau, le célibataire de la nature (Fayard, 2012)
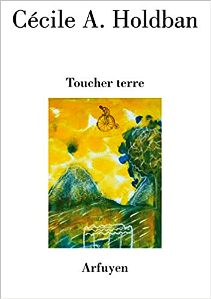 |
Cécile A. Holdban, |
| Toucher terre |
|---|
La poésie de Cécile A. Holdban touche à l’intime mais demeure en permanence auréolée d’une forme de mystère. La poète creuse l’énigme de la vie. « Il restait une fleur / sur terre / pour l’éclairer », écrit Cécile A. Holdban, comme en écho à ces mots de Philippe Jaccottet : « Prends cette fleur pour t’éclairer dans la traversée des jours ». Mais si l’écriture de l’auteure a parfois des accointances avec celle du grand poète français, son univers poétique la rattache plutôt à une veine d’écrivains anglo-américains qui lui sont chers (Kathleen Raine, Sylvia Plath…) et, encore plus, à ces auteurs des ex-pays de l’Est, notamment hongrois, pour lesquels elle éprouve une affection (littéraire) particulière.
Pas étonnant : Cécile A. Holdban est d’origine hongroise et mène à la fois un travail d’écrivain et de traductrice d’ouvrages publiés en hongrois ou en anglais. Elle introduit d’ailleurs, volontiers, dans ses propres recueils, des textes d’auteurs qu’elle traduit et qu’elle aime particulièrement. C’est encore le cas, dans son nouveau livre. Elle y publie notamment des poèmes de Sandor Weöres (1913-1989), considéré comme l’un des plus grands poètes hongrois, de Janos Pilinszki (1921-1981), poète et dramaturge également hongrois, mais aussi des Américains Howard Mc Cord ou Linda Pastan.
À propos de ce nouveau livre de Cécile A. Holdban, son éditeur affirme qu’il « impose avec une sûreté et une délicatesse infinie un monde troublant et magnifique, peuplé d’obscures menaces et des grâces envoûtantes ». Les obscures menaces sont là quand « l’aube s’efface », et « la lune rouille », quand « les arbres au loin noircissent » ou quand « le corps est bien là », mais que « le cœur se fige ». Les grâces envoûtantes, elles, s’arc-boutent à « notre seule viatique : l’espérance secrète du printemps ». La poète peut alors s’émerveiller et noter que « les yeux rubis des groseilles ouvrent des milliers de paupières » et se mettre à l’écoute de « la respiration palpitante de la pluie mêlant le sang des fleurs à la terre ».
Entre les « menaces » et les « grâces », il y a cette « obstination à chercher / l’étincelle, la part / manquante ». Car Cécile A. Holdban nous dit avoir « plongé dans le monde avec emportement ». C’est cette énergie vitale (native) qui continue à l’animer. Elle est demeurée « la fillette qui s’élance » en quête de « cette violence joyeuse, cette libération dans le jaillissement de certaines sources ». Car, s’il y a « l’hiver du monde », il y a aussi cette femme qu’elle est (et que l’amour éclaire) dont le « corps déborde » et dont la « tête chante ».
Toucher terre, Cécile A. Holdban, Arfuyen, 115 pages, 14 euros.
 |
Thierry-Pierre Clément, |
| Approche de l’aube |
|---|
Avant l’aube, il y a le noir, l’obscur. Avec l’aube surgit la lumière. Thierry-Pierre Clément, poète bruxellois, entend être le témoin – jamais lassé – de cette évidence. Qu’il se trouve « dans la montagne », « sous les arbres », ou « avec les fleurs », le poète multiplie les exercices de contemplation. « Les paroles sont inutiles / être simplement là / présent devant le monde / présent devant la rose ».
Que de paroles inutiles, en effet, ne pourraient être dites pour parler de « la beauté » de « l’ivresse », de « la joie », de « l’espérance, du « secret »… Ce sont les titres de certains de ses poèmes, autant de beaux thèmes philosophiques que l’auteur aborde en quelques vers bien frappés. Pour parler de « l’ignorance », il y a ces simples six vers : « Papillon fou / entre lampes et fenêtres / affamé d’espace // tu ne vois pas / la porte ouverte / sur le jardin ». Poèmes brefs, donc, tendus. Jusqu’à l’épure du haïku ou à ce qui y ressemble dans ces trois vers : « Chant de la grive / même le merle // écoute ».
Mais il n’y a pas chant béat dans ce recueil. Car il y a, nichés quelque part, la blessure et le manque. « Les poèmes me requièrent / je ne puis que m’y livrer / comme un captif au bûcher ». Voici donc le poète évoquant ses « paradis perdus ». Étreintes de la nostalgie et, sans doute, chagrins enfouis. « Tu regardes se perdre / ce qui n’est pas venu / s’achever le printemps / qui n’a jamais été ». Et, plus loin : « Ce qui est perdu / ce qui s’en est allé // qui a disparu / qui ne reviendra pas // à quoi l’on ne s’arrête pas / de dire adieu ».
Mais il y a toujours un pays derrière le chagrin. Une aube nouvelle après la chape noire des désillusions. Il y a l’approche de l’aube. « Ce recueil retrace un itinéraire qu’on osera dire mystique, même si Thierry-Pierre Clément se garde de toute affirmation religieuse », note très justement Jean-Pierre Lemaire dans la préface du recueil. Voici donc le poète « assis au seuil de la cabane / la nuit close derrière / le jour ouvert devant ». Il peut alors chanter « l’inépuisable sang des arbres et des chemins », « la douceur du vent sur l’épaule » ou « l’ivresse mauve des lilas ». De nouveau un feu intérieur brûle et l’on peut remonter « jusqu’à la source ». Auparavant le poète aura « roulé la pierre » sur ses chagrins.
Approche de l’aube, Thierry-Pierre Clément, préface de Jean-Pierre Lemaire, éditions Ad Solem, 117 pages, 19 euros.
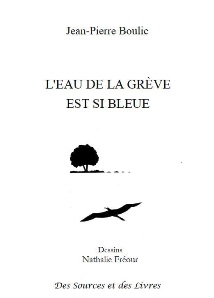 |
Jean-Pierre Boulic, |
| L’eau de la grève est si bleue |
|---|
Jean-Pierre Boulic nous attire, dans son nouveau recueil, au « royaume d’enfance ». Mais, comme dans ses précédents ouvrages, c’est pour nous dire « la trace de l’infini qui habite toute créature au monde ».
Le poète breton – il vit à la pointe nord-ouest du Finistère, dans le Pays d’Iroise - ne voit « pas autrement la poésie que parole sacrée, c’est-à-dire éclairée pour être donnée en partage comme nourriture spirituelle à l’inquiétude d’un monde profondément sécularisé qui peut empêcher l’humain d’être homme ». Il le dit lui-même dans un court texte qui clôture son livre. Et ajoute que la poésie est toujours « le fruit d’une expérience humaine ».
C’est encore le cas dans ce livre (qu’il dédie au poète Philippe Mac Leod) où dominent, cette fois, les réminiscences du pays d’enfance. Qu’il s’agisse, par exemple, du préau où « traînent » ses « songes ». Qu’il s’agisse de « L’été dans le ruisseau / De cressons et de menthes/ (…) Où glisse le sourire / D’une mère attentive ». Qu’il s’agisse encore des « châteaux d’enfants / Forteresses menues / Avant la marée haute ».
Les fleurs, les plantes, mais surtout les arbres et les oiseaux (que l’on retrouve dans trois dessins, ponctuant ce livre, de l’artiste Nathalie Fréour) forment ici, à la fois, un bestiaire enchanté et un herbier d’enfance. Si dans les Évangiles « les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent », on les découvre chez Jean-Pierre Boulic « Pauvrement habillés / Réjouis par les miettes / Tombées des mains du ciel ». Manne providentielle à quoi s’ajoute la « présence des sources » car « Qui ne viendrait s’abreuver / D’une eau si vivante ? » (le puits de la Samaritaine n’est pas loin). Des références bibliques – discrètes – innervent, en effet, ce recueil. Ici « l’estran médite » et « les anges du lieu » sont « si proches de l’invisible ». Et quand le poète arpente la grève (où l’eau est si bleue), il peut écrire : « Je crois mon pas sans vanité / Au paradis des brumes / Habité d’oiseaux gris ».
Jean-Pierre Boulic contemple le monde et n’en finit pas de s’extasier quand il côtoie, par exemple, ces « bleuets ensoleillés / Mettant sarrau d’écoliers ». Il inscrit aussi son dit dans cette « terre de Bretagne » aux « profonds horizons » et se souvient de « L’enfant tiré d’un blanc sommeil / Par la corne de brume ».
Dans un terroir où, par des temps bien plombés, le ciel et la terre parfois se confondent, le mystère de la vie s’épaissit forcément. Le poème est alors là pour dire l’invisible et l’indicible.
L’eau de la grève est si bleue, Jean-Pierre Boulic, dessins de Nathalie Fréour, 97 pages, 15 euros, éditions Des sources et des livres, 2, rue de la fontaine, 44 410 Assérac (2 euros de frais de port)
| Retrouvez les publications Des Sources et des Livres |
| Découvrez les notes de lecture d'Yves Fravalo, de Jean-Claude A. Coiffard, de Thierry-Pierre Clément, et de Stéphane Bataillon |
 |
Jean Lavoué, |
| Levain de ma joie |
|---|
Chant, mélopée, incantation, louange : le nouveau livre de Jean Lavoué est à ranger du côté des ouvrages qui interrogent notre présence au monde. Et – osons-le dire – participent de cette veine mystique qui irrigue, depuis des siècles, la littérature européenne.
On peut ne pas être sensible à cette poésie « frontale » qui joue, à la fois, sur le tableau de l’introspection et le l’exhortation. On peut aussi préférer tourner le dos à une écriture quasi liturgique, truffée de tous ces mots « qui font sens ». Citons dans le désordre : joie, offrande, silence, gloire, royaume, souffle, source, lumière, joie… Jean Lavoué, en effet, s’est abreuvé aux récits des Évangiles et a fait sienne les paroles prophétiques de Jean Sulivan, d’Etty Hillesum, de Christiane Singer… et de tant d’autres, chrétiens des « marges » qu’il appelle ici les « passants de l’obscur et des constellations ».
Mais maintenant que le temps est « compté » (comme il le dit dans Chant ensemencé, son précédent livre) et que la maladie suscite en lui une forme d’urgence de dire et de louer, son écriture s’auréole d’une forme d’exaltation et, encore plus, de cette gratitude d’être encore au monde dans la lumière des saisons et dans la présence fraternelle de lieux familiers (le Blavet, les écluses…). Autant de « lieux communs » qui peuvent un jour « devenir révélations », comme l’écrivait Jean Sulivan. « Si je tiens mon journal entre poème et chant / Ce n’est pas par oubli, c’est pour ne pas mourir / Pour accueillir l’ivresse de se savoir ici », souligne Jean Lavoué.
C’est encore une fois le Chant qui domine dans ce livre, chant synonyme de vie en plénitude que le poète François Cheng salue chez Jean Lavoué. « Ce vrai chantre, ce grand témoin, à l’heure indécise, bien avant l’aube, nous arrache à notre sommeil », écrit-il dans une lettre à l’artiste Nathalie Fréour qui accompagne de ses dessins le Chant ensemencé. Éloge de poids de la part d’un académicien saluant « l’âme noble et généreuse qu’est Jean ».
L’écriture de Jean Lavoué, en effet, est là pour nous envoûter et nous embarquer. Nous faire passer sur l’autre rive car « la nuit a dispersé nos hymnes » et « nous ruons à tout-va enserrés dans la nasse ». Le poète breton écrit donc: « Nous sommes promis à bien d’autres rivages, / À des lumières pures, à des beautés sans nom, / À des fleuves inconnus surgissant de nos terres, / À des bourgeons d’azur jaillis du même tronc ».
Le poète se permet même une escapade du côté de La Chesnaie à la Pentecôte 2018. Pèlerinage intime au pays de Félicité de Lamennais auquel il a consacré un livre (La prophétie de Féli, Golias, 2011) pour nous dire, cette fois, que « Tous les oiseaux de mai / Ont rendez-vous avec l’azur // Le vent signe d’un grand silence / Ce jour ébloui // Nous marcherons longtemps encore / Sous la verrière de l’aube // Acclamant la beauté / qui nous réconcilie ».
Oui, la gratitude et l’émerveillement « quand les âmes se font chant » comme le dit François Cheng.
Levain de ma joie, poèmes printemps 2017 - été 2018, préface d’Yves Fravalo, gravures de Marie-Hélène Lorcy, L’enfance des arbres, 167 pages, 15 euros.
Jean Lavoué publie par ailleurs aux éditions L’enfance des arbres
Fraternité des lisières, Poèmes pour la paix 201-2018, Gravures de M.F. Hachet de Salins
Nous sommes d’une source, Poèmes pour la vie 2014-2018, gravures de Serge Marzin
Chant ensemencé, chronique d’une année bouleversée par la maladie, dessins de Nathalie Fréour.
Chaque livre (14x20,5cm/170 pages) est illustré et proposé au prix de 15 euros chacun.
Pour toute souscription et commande d’ici le 31 décembre 2018, les frais de ports sont offerts.
Commande à adresser Éditions L’enfance des arbres, 3, place Vieille ville, 56 700 Hennebont
 |
Yvon Le Men, |
| Un cri fendu en mille |
|---|
Yvon le Men publie le 3e tome de son autobiographie poétique. Après l’enfance et le terroir familial (tome 1 : Une île en terre), après la découverte du monde par la littérature et la peinture (tome 2 : Le poids d’un nuage), voici les carnets de voyage du poète breton sous le titre Un cri fendu en mille. Titre sans doute inspiré par les mots du poète ami Claude Vigée cités en exergue : « L’homme naît grâce au cri ».
On sait d’Yvon Le Men qu’il est un « étonnant voyageur ». Pas seulement parce qu’il anime, chaque année à Saint-Malo, des rencontres poétiques au salon du livre du même nom. Pas seulement parce qu’il convie des poètes du monde entier au Carré magique dans sa bonne ville de Lannion. Non, il est surtout cet étonnant voyageur parce qu’il a toujours eu l’humeur vagabonde. Auteur d’un Tour du monde en 80 poèmes (Flammarion), livre où il rassemblait, pays par pays, ses auteurs favoris, il est lui-même allé à la rencontre du monde, bourlinguant de la Chine au Brésil en passant par l’Afrique et l’Europe. Pas pour nous décrire des paysages ou évoquer la nature mais pour parler, d’abord et avant tout, des rencontres qu’il a faites.
« Le métier de poète / n’est-il pas de vérifier le sens des mots ? », note Yvon Le Men qui part sans préjugés, avec un esprit d’ouverture teinté de compassion quand le drame et la folie des hommes viennent broyer des vies à Gaza, à Haïti, en Bosnie, au Liban et dans tant d’autres pays. « Il faut du silence / autour des morts / pour entendre leur vie ».
Citoyen du monde, il n’évacue pas pour autant les différences. « Toutes elles sont noires / je suis tout blanc / sauf une trop blanche parmi les noires », constate-t-il dans une école de Port-au prince. Parlant plus loin de son ami haïtien Bonel Auguste, il écrit : « Il ne vivrait pas dans mon pays / je ne vivrais pas dans le sien // trop silencieux pour lui / trop de trop pour moi // même si nous sommes frères /fils du même père / sur la même terre // malgré l’océan / le ciel / la moitié d’un globe / qui nous sépare ».
Tout le Men est là dans ce type d’affirmation. Dans le fond et dans la forme. Cette manière à lui de faire surgir les mots entre les blancs. De leur donner du poids, en poète qu’il est et dont il revendique le statut. « Dans l’avion, mon voisin m’avoue son métier. Policier en chef. Poète, je réponds. Il se rend à un congrès international contre le terrorisme et je vais rendre hommage à un ami dont les vers sont encore sur les lèvres des habitants de Sarajevo. Il y a trois ans, Izet Sarajilic mourait. De chagrin, mais en chantant, malgré les récents massacres ».
Cet hommage à ses frères en poésie parcourt le recueil. Le Men se rend sur la tombe d’Ezra Pound à Venise, nous parle du poète chinois Li Zhiyi et devant la maison de Du Fu, il lira un de ses poèmes écrits en 2015 après avoir lu un poème écrit en 745 par le poète chinois. Chez les deux auteurs – le Breton, le Chinois – une même approche de la vie simple, un même regard bienveillant sur les gens de peu. « naître / vivre / mourir // parfois du mauvais côté de la vie // si je regarde par ses poèmes / je verrai sûrement ce qu’il verrait / s’il vivait aujourd’hui // la vie/du vendeur de kiwis / du rémouleur // de la femme qui porte son restaurant / sur son vélo ».
Un cri fendu en mille (Les continents sont des radeaux perdus, 3), éditions Bruno Doucey, 157 pages, 16 euros.
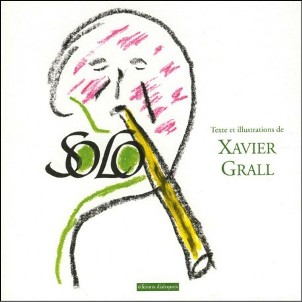 |
Xavier Grall, |
| Solo, poèmes et dessins |
|---|
Solo réédité. Oui, mais avec des dessins de Xavier Grall lui-même. « Dessins colorés, naïfs », dont le poète a « enlacé, enluminé, illuminé ce long poème », note Marc Pennec en introduction.
On a tout dit sur Solo, œuvre essentielle sinon majeure de Xavier Grall. Le livre est publié au 2e trimestre 1981 par les éditions Calligrammes à Quimper, soit quelques mois avant le décès du poète en décembre de la même année. « Solo est un long chant de réconciliation, nostalgique, très tendre, plein d’amour et de considération pour les êtres et les choses, d’un lyrisme au style laconique, précis », écrit Yves Loisel dans la biographie qu’il a consacrée au poète de Bossulan (éditions Jean Picollec, réédition Coop Breizh, 2015). « Xavier atteint le sommet de son inspiration lyrique et musicale dans Solo, en particulier dans cette fluidité de la mélodie de ses nostalgies et du temps qui passe », note pour sa part Mikaëla Kerdraon dans l’importante biographie qu’elle consacrera aussi à l’auteur (An Here, 2000).
Qui na pas désormais en tête, s’il s’intéresse peu ou prou à la poésie bretonne, ces vers qui introduisent Solo : « Seigneur me voici c’est moi / Je viens de petite Bretagne / Mon havresac est lourd de rimes / De chagrins et de larmes ». Des mots qui reviendront régulièrement dans la bouche du jeune Yvon Le Men dans les récitals où il déclame les textes de Xavier.
Xavier Grall, de bout en bout, s’adresse ici à son Créateur. Il lui parle de cette Bretagne qu’il va quitter et lui adresse sa requête au moment de Le rencontrer par delà la mort : « Seigneur Dieu c’est moi / J’ai fait un grand voyage / Permettez que je retourne en Bretagne / Pour vivre encore quelques années / Je n’ai pas grand âge / vous le savez ». La Bretagne qu’il a aimée est celle des « oraisons ferventes », celle des « bonnes auberges », celle des « grèves ivres », celle des « hymnes marins »… Dans sa « bretonne supplique » (à la manière de François Villon, sous d’autres cieux, en d’autres temps), Grall demande à Dieu de lui redonner sa « maisonnée » et sa « femme française », mais aussi ses trois bouleaux, ses deux cyprès et son « talus buissonnant ».
Aujourd’hui les dessins du poète donnent une couleur chatoyante à cette supplique. Avec les pastels qu’il s’était procurés auprès de Geneviève, une de ses cinq filles, le poète avait apporté « un contrepoint solaire, lumineux, presque enfantin, au tragique de Solo » (Marc Pennec). On y découvre un bateau toutes voiles dehors, un caboulot (« Au repos du marin »), un calvaire comme entouré de buissons ardents, un phare… Un pays « glaz », naviguant entre le bleu et le vert. Sans oublier un « Christ bleu », en référence au Christ jaune de la chapelle toute proche de Trémalo. « Mais Seigneur Dieu / Comme la vie était jolie / En ma Bretagne bleue ». Amen, Alleluia !
Solo, textes et illustrations de Xavier Grall, éditions Dialogues, 45 pages, 12 euros.
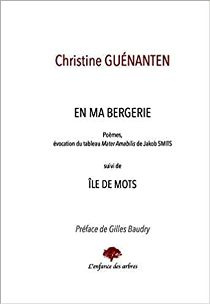 |
Christine Guénanten, |
| En ma bergerie |
|---|
Les recueils de Christine Guénanten sont de véritables OPNI (Objets Poétiques Non Identifiés), à rebours de toutes les modes, de toutes les conventions et de ce que le monde poétique peut aujourd’hui secréter. En ma bergerie, son nouveau livre, n’échappe pas à la règle. On y retrouve ces mots frappés du sceau de l’innocence, de la simplicité, de l’angélisme, voire d’une forme de naïveté qui a profondément à voir avec l’esprit d’enfance. « En ma bergerie, je bourgeonne / Je suis en généreux pays / Je coiffe l’herbe et je couronne / Le monde laineux des brebis ».
La bergerie nous parle – métaphoriquement – d’un monde en dehors du monde. L’agneau nous renvoie à l’agneau pascal et à un Royaume qui n’est pas de ce monde. « Je veux trouver la voie humaine, / La voix de la limpidité : / Crépuscule sacré du cœur ». Pas étonnant que, préfaçant ce livre, Gilles Baudry prédise qu’on puisse se gausser d’une telle parole poétique, proche de la prière et de l’incantation. « J’entends déjà les discoureurs, pourfendeurs et persifleurs. Mais je préfère les ravis de la crèche aux ramoneurs du nihilisme », écrit le moine-poète.
L’agneau, Christine Guénanten le rattache aussi à la mère et l’enfant, comme le montre ce tableau de Jabob Smits, Mater amabilis qu’elle découvre un jour au musée de Bruxelles et dont elle tombe sous le charme. « Grâce à ce tableau / Le cœur est au chaud / Louons l’ange laine / En la bergerie ». Une atmosphère de paix sereine rayonne de ce tableau dont le poète entend se faire l’écho. Une paix qu’elle trouve, pour sa part, dans une Île de mots (titre de la deuxième partie de son livre). « Ici pas de peur, pas de morts, mais des mots / Une approche bleue, paisible moment ». Dans cette île de mots, il y a « le vif écureuil », « la souveraine fougère », « les peupliers passeurs de souffle », « un parfum de lilas », « l’or du jaune des genêts », « la lune lavandière »… Bestiaire enchanté, flore au diapason.
Dans un précédent recueil, Christine Guénanten nous avait parlé « de la nécessité du poème » (Des sources et des livres, 2017). Elle nous le dit ici encore. « Seule, / La poésie brûlante / Ravive les yeux ». à ces temps de déréliction qui sont les nôtres, elle oppose la vision d’un autre monde où brille, comme le dit Gilles Baudry, une « lumière séraphique ». Qu’elle soit à la « cueillette des couleurs » ou recueillie devant la crèche de Noël, c’est toujours une lumière qui l’accompagne et la guide. « J’ai lumière de lait, lumière primevère /à promener au cœur d’une cité d’aveugles / à moi la liberté, la feuille printanière, / je ne veux plus savoir les inventions du monde ».
En ma bergerie, Christine Guénanten, L’enfance des arbres, 83 pages, 14 euros.
Les éditions L’enfance des arbres publient par ailleurs Abécéd’air, poèmes d’Agnès Léger, Calligraphies de René Myard, 65 pages, 15 euros
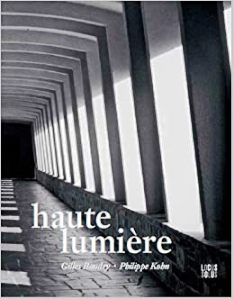 |
Gilles Baudry et Philippe Kohn, |
| Haute lumière |
|---|
Être moine bénédictin en Bretagne. Et le dire en poèmes à l’occasion des 1 200 ans de l’adoption de la règle de saint Benoît par les moines de l’abbaye de Landévennec. Gilles Baudry, moine-poète, décline en une trentaine de textes cette « vie humble à fleur de terre », accompagné par les photographies en noir et blanc de Philippe Kohn.
« Communier sous les espèces de la vie simple ». Être moine bénédiction, nous dit Gilles Baudry, c’est conjuguer louange, pauvreté, silence, sobriété. C’est accepter le « terne quotidien » et savoir entendre « l’appel des lisières ». C’est vivre à l’écart mais dans une « solitude ouverte » en trouvant la « juste distance ». C’est « oser la confiance / malgré nos indicibles contre-jours ».
Gilles Baudry nous avait déjà fait saisir du doigt les « grandeurs et servitudes » de la vie monastique dans son Demeure le veilleur (éd. Ad Solem, 2016). Il nous en parle plus directement ici, nous disant comment il faut savoir « faire vœu d’effacement » et demeurer ce « veilleur de l’invisible » qui se tient « à l’ombre lumineuse du silence ». Mais sans jamais renier le concret, la routine, le quotidien. Pour les moines de Landévennec, il y a le verger de pommiers dont la récolte donnera une production de pâtes de fruit. Mais il y encore plus le « Jardin des Écritures » arpenté quotidiennement dans le chant et la prière « à ciel ouvert ». Frère Jean-Michel, abbé de Landévennec, le dit à sa manière dans la préface du livre quand il parle de « l’intuition de Benoît invitant le moine à trouver Dieu en toute chose : à l’oratoire comme aux champs, dans la lectio divina aussi bien que dans le travail des mains ».
Landévennec (à la pointe du Finistère), où saint Guénolé, un jour, jeta l’ancre, est cette terre d’élection où la louange monte « dans le miroir / sans tain des brumes basses » comme « derrière la silhouette profilée du vent ». Gilles Baudry entend le « bruissement de l’Écriture », s’adresse à son « Seigneur », ce « premier-né d’entre les morts ». Pour accompagner ces mots sur cette vie humble, il fallait les photos épurées de Philippe Kohn. Pas de moine derrière le viseur de l’artiste, mais tout ce qui témoigne de leur vie simple : les épingles d’un séchoir à linge, un alignement de chaises en paille, une salle de réfectoire vide, un bouquet de fleurs sur une table en bois, un cloître gagné par la lumière… Tout en noir et blanc, comme ces compagnons du quotidien appelés arbres, racines, râteaux, feuilles… Oui, une prière en images « à ciel ouvert ».
Haute lumière, Gilles Baudry et Philippe Hohn, Locus Solus, 80 pages, 18 euros.
Gilles Baudry accompagne par ailleurs 11 pastels de Nathalie Fréour dans un petit livre d’art intitule L’orée (18 euros + 3,50 euros de frais de port à l’ordre de Jean Lavoué, éditions L’enfance des arbres, 3, place vieille ville, 56700 Hennebont.
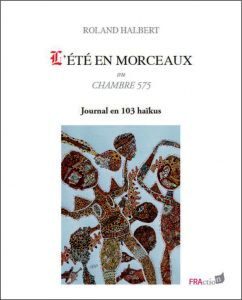 |
Roland Halbert, |
| L’été en morceaux |
|---|
Le poète nantais Roland Halbert entre avec brio dans le cercle restreint des auteurs qui ont raconté, par le truchement du haïku, un séjour à l’hôpital. On peut donc, désormais, l’associer aux prestigieux Masaoka Shiki et Sumitaku Kenshin, haïjins japonais ayant écrit sur leur maladie. Shiki, qui meurt à 35 ans, en 1902, d’une tuberculose osseuse, est l’auteur de Un lit de malade, six pieds de long. Kenshin, qui meurt à 26 ans, en 1987, d’une leucémie est, pour sa part, l’auteur de Ébauche et de Inachevé, haïkus précisément consacrés à son hospitalisation.
Roland Halbert, qui fait d’ailleurs allusion à eux dans son livre, publie Un été en morceaux, journal en 103 haïkus de l’été 2015. Il sous-titre son livre chambre 575 par allusion au « pouls métrique » du haïku classique en 5, 7, 5 syllabes. « Ce court poème à l’oreille ultra-fine, écrit l’auteur dans une introduction à son livre, est une médecine douce ». Poursuivant la comparaison, il suggère « de ne pas dépasser la dose prescrite ». Puis il cite Julien Gracq pour qui « le haïku agit à dose homéopathique » (lettre à l’auteur de 2001).
Comme dans tout haïku digne de ce nom, dominent ici l’humour, l’ellipse et l’autodérision. Faut-il rappeler que Roland Halbert (auteur d’autres excellents livres de haïkus) maîtrise à merveille le genre. « Ma belle d’été / s’appelle Morphine / – cœur en quarantaine ». Ou encore ceci : « Prendre son mal en patience… / je fais de la sonde / ma corde à sauter ». Dans cette approche du plus fragile et du plus précaire – qui caractérise aussi foncièrement le haïku – il peut aussi signer ce merveilleux haïku : « Pies, moineaux, mésanges /qui veut pour perchoir / ma potence grise ? ». Issa n’est pas loin (« Viens jouer avec moi / moineau / qui n’a pas de mère »). La lune (figure totémique du haïku) est là, aussi, consolatrice :« à l’étage un enfant hurle / couleur doliprane, la lune / le soulage ».
De bout en bout, le dehors dit le dedans. La nature est là pour exprimer les douleurs ou les désarrois du patient. Pas étonnant, donc, qu’une « figue saigne », qu’un « merle s’alarme » ou que « pris dans les boues rouges / un scarabée estropié / baratte le jour ». Confiné dans sa chambre d’hôpital, Roland Halbert fait vibrer le monde extérieur. Ses sensations de malade sont celles d’un homme de plein vent dont le corps est aujourd’hui « empli de frelons ». Et, quand convalescent, il fait ses premiers pas, tout naturellement il peut écrire : « Marche à pas pénibles / le rouge-queue chante / les progrès de la médecine ».
Pour ajouter au bonheur de lire ce journal/album si incarné, au ton si juste, Roland Halbert a fait danser les haïkus dans la page. Une manière de nous rappeler que le fond c’est aussi la forme.
L’été en morceaux, Roland Halbert, éditions Fraction, 105 pages, 25 euros.
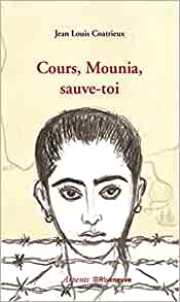 |
Jean-Louis Coatrieux, |
| Cours, Mounia, sauve-toi |
|---|
La « crise des migrants » inspire les poètes. Après le Rennais Denis Heudré qui nous avait parlé de Lampedusa (Bleu naufrage, élégie de Lampedusa, éditions La Sirène étoilée), voici un autre Rennais, Jean-Louis Coatrieux, dans les pas d’une fillette condamnée à l’exil. Elle s’appelle Mounia. Et c’est la guerre en Syrie qui constitue la toile de fond de son récit même si elle n’est jamais explicitement nommée.
« J’entends les rires / Des soldats / Dans mon dos / Les couteaux / Achevaient les blessés ». Les mots du poète sont là, quand il le faut, pour dire les horreurs de la guerre. Mounia fuit. Elle tient la main de son père. Comment ne pas penser, lisant ces passages du livre de Jean-Louis Coatrieux, à un autre exil : celui du poète Mahmud Darwich, fuyant la Palestine avec sa famille. « Ne regarde pas l’étoile, elle pourrait te ravir et te perdre. Accroche-toi à la robe de ta mère », écrit-il dans Présente absence, son autobiographie poétique (Actes Sud). « Le cauchemar te cogne de sa poigne de fer, tu cries sans voix ».
Acte I du livre de Coatrieux : la fuite, la route. « Terres blanches / Étendues gelées / Sans rien ni personne / Sauf nous dehors ». Des images nous reviennent, lisant ces mots, de ces cohortes traversant à pied les Balkans dans l’espoir d’un hypothétique havre de paix.
Acte II : retour sur le vert paradis de l’enfance. Celui de Mounia et de sa famille. « Nous avions / Des plaines de sables / Pour les après-midi / Quelques oliviers / Pour être heureux / Les soirs ». Les bonheurs simples d’une fillette avec son frère Sami : « Nous faisions / Bouger le ciel / Entre nos doigts ».
Acte III : l’irruption de la guerre et de la haine sacrifiant l’innocence. « Là-bas devant l’école / Le jardin, quelques fleurs / Les corps oubliés / En plein milieu »
Acte IV : la frontière, un jour, au bout des souffrances et des humiliations. « La terre en face / Une autre terre, si près / Des bateaux, disent-ils / La liberté / Il faut attendre ».
Jean-Louis Coatrieux a choisi l’ellipse et l’épure pour parler de cette tragédie et de tous ces destins brisés par la folie des hommes. Les mots – rares – tombent drus sur le blanc de la page comme de grands cris d’exclamation (et plus souvent d’effroi). Ce qui n’empêche pas de trouver, de ci de là, la tonalité chaleureuse des récits orientaux quand il s’agit d’évoquer avec nostalgie (acte II) les « années de miel » du pays d’enfance.
Cours, Mounia, sauve-toi, Jean-Louis Coatrieux, préface d’Albert Bensoussan, postface de René Péron, éditions Riveneuve, 72 pages, 12 euros.
 |
Michel Dugué, |
| Mais il y a la mer |
|---|
Un territoire d’enfance (le pays de Vannes) et une terre d’adoption (la côte rocheuse du côté de Plougrescant), une ville apprivoisée et parcourue en tous sens (Rennes), un bistrot où les vieux regardent le temps passer, une cour de récréation où des garçons courent après un ballon. Michel Dugué nous invite, en quatre textes, à entrer dans son univers intime. Celui des souvenirs, des sensations vraies. Mais toujours au plus près de la terre et des éléments, sans jamais oublier la pâte humaine, de préférence celle des rencontres fortuites sur ces chemins que l’auteur parcourt inlassablement.
« J’envie, j’admire l’écrivain qui sait dire les jours quelconques, agrandis secrètement par un espace tout de même inconnu qui est pareil à l’intérieur des instruments de musique ». Ces mots de Philippe Jaccottet (À travers un verger, Fata Morgana), comment ne pas les appliquer à la démarche d’écriture de Michel Dugué ? Ses proses – que l’on qualifiera volontiers de poétiques – n’ont en effet rien de prosaïque. Nous parlant de Vannes ou d’une presqu’île costarmoricaine, l’auteur nous mène très loin. Au contact de la roche, de la pluie et du vent, il creuse le sens de notre présence sur terre. Rien de moins que cela.
« La poésie consiste à convertir la mémoire en songes et à apporter d’heureuses clartés sur les chemins de l’obscur », disait Giuseppe Ungaretti. Oui, Michel Dugué déchiffre avec ardeur le monde dans lequel il vit. « Formes et mouvements participent d’une présence, la plus simple, la plus dénuée d’artifice. On a la certitude d’être, d’être avec. Ni écrasement, ni perte de soi mais des clartés mitoyennes », écrit-il à la suite d’une déambulation entre la lande et les vagues. « De ces moments-là, je tire un silence intérieur. Et, imperceptiblement, j’avance dans le silence. Ce n’est pas que la mer se soit tue, que le vent soit tombé, que les oiseaux se soient envolés. Mais la diversité des bruits s’est évanouie ». Plus loin, il écrit : « Le monde ruisselle. Pas un bruit, si ce n’est celui d’un torrent ou du cœur ».
Parcourant cette presqu’île qui devient pour lui « un monde plus tous les autres », il dit s’être « égaré dans le chantier des choses pas encore nommées ». Mais cette approche méditative, cette pensée en mouvement n’empêche pas de nommer les lieux, (Roc’h Kerlében, Beg Million, Roc’h Zemec…), de donner chair à des figures humaines, celles de vieux au comptoir ou dans leur jardin (ce qui les rend alors « massifs et clairs »), de parler d’une « soutane en bataille » à l’Institution saint-Charles, ou d’évoquer « le gris de Bretagne entre le bleu ardoise et le granit rosé » qu’il découvre au cœur même de la ville de Rennes. « Elle vient de loin la lumière », nous dit Michel Dugué, « Faudra-t-il nous satisfaire de sa fatigue en nous ? »
Mais il y a la mer, Michel Dugué, le Réalgar, collection l’Orpiment dirigée par Lionel Bourg, 80 pages, 12 euros.
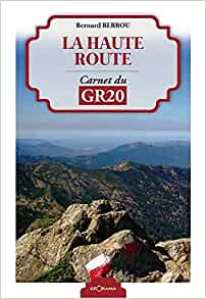 |
Bernard Berrou, |
| La haute route |
|---|
On connaît le Bernard Berrou desErrances irlandaises, passionné par une île qu’il a tant de fois parcourue au point d’en faire une seconde patrie. On connaît moins celui est qui est tombé sous le charme de la Corse à l’occasion d’un périple sur le mythique GR20. Son carnet de route, publié en 2009, est aujourd’hui réédité, accompagné d’un cahier central de photographies en couleurs.
Ce carnet du GR20 n’a rien à voir – on s’en doute – avec un guide touristique. Bernard Berrou aime à le dire (et il en est fier) : son livre est la première approche littéraire d’un sentier aujourd’hui mondialement connu. Pourquoi ce coup de foudre ? Parce que l’auteur aime la nature à l’état brut et l’immersion dans le cosmos. Il ne manque d’ailleurs pas d’établir d’emblée un rapprochement entre la Corse et l’Irlande : « Je retrouvais sur le plateau de Cuscionu la pureté des paysages que j’avais tant aimée en Irlande, au centre du comté de Clare ou dans le comté de Cork, du côté de Baallingeary ».
Son livre foisonne donc de passages où le sentiment d’être « ailleurs » est profondément prégnant (avec un brin de fantastique) quand il nous parle, par exemple, « des dents acérées prêtes à déchiqueter, des ravins où vous plongez dans l’ombre, des monstres qui vous attendent de pied ferme ». De bout en bout il y a la conscience de vivre quelques jours « dans un royaume béni », dans « une île redoutable emplie de prodiges ». Prodiges du chemin, prodiges du refuge ou de la bergerie, prodiges des rencontres. Car Bernard Berrou ne vit pas cette aventure en solitaire. Le chemin est aussi, pour lui, une belle expérience humaine : celle des compagnons de voyages, celles des rencontres inopinées (un couple d’Anglais, des femmes andalouses, un cardiologue entouré de sa cour, un berger nationaliste corse…). Bernard Berrou croque tout ce monde avec la virtuosité et la limpidité d’écriture qu’on lui connaît.
« Seules les pensées qui vous viennent en marchant ont de la valeur ». Citant Nietzsche, l’auteur nous propose aussi quelques échappées belles sur l’art et les bienfaits de la marche. « La marche dépouille l’homme de tout ce qu’il a de superflu, des pensées vaines et futiles qui le minent, des passions mauvaises qui l’assaillent ». Il truffe aussi son récit de remarques acerbes sur certains comportements grégaires et les laideurs qui nous environnent (rassemblement de camping-cars, stations de ski en période estivale…). C’est la nature dans sa beauté et sa brutalité qui l’attire irrésistiblement. À Penmarc’h (où il réside) comme en Irlande et en Corse. Il cite Kipling : « Éloignez-vous à un jet de pierre sur la droite ou sur la gauche de cette route bien entretenue sur laquelle nous marchons, et aussitôt l’univers prend un air farouche et étrange ». C’est bien le cas dans cette « haute route »
La haute route, carnets du GR20, Bernard Berrou, Géorama, 115 pages, 12,90 euros.
Bernard Berrou vient d’obtenir le prix Bretagne 2018 pour l’ensemble de son œuvre.
 |
Louis Bertholom, |
| Le rivage du cidre |
|---|
« On ne meurt que de l’oubli de l’enfance ». Louis Bertholom (né en 1955), fils de paysans, ravive, en prose et en vers, le souvenir de ses jeunes années passées entre vergers, école et cour de ferme. C’est son bien nommé « Rivage du cidre » en pays fouesnantais. À déguster sans modération.
« Le cidre de Fouesnant est pour moi un rivage de l’esprit tout autant que la situation géographique en zone littorale de son terroir. Le rivage intérieur de couleur ambrée n’est autre que la métaphore de mes jeunes années ». Si l’auteur nous dit tout – avec un luxe de détails – sur la fabrication du cidre (du ramassage des pommes à la mise en bouteille du précieux nectar), il y a avant tout dans ce livre l’évocation d’un univers. De ce que l’on pourrait appeler une civilisation du cidre. Ce microcosme cornouaillais adossé à la mer devient, en effet, grâce à la verve de Louis Bertholom, un monde empli de prodiges où le moindre geste, le moindre regard posé sur les hommes, les bêtes ou les plantes, prennent valeur d’éternité. C’est la propre des poètes de savoir l’exprimer.
« La ferme m’enseignait candeur et connivence. J’ai grandi parmi des gestes lents, robustes, où s’affirmaient la fatigue, la lassitude et règnait le cidre, grande perfusion des campagnes éreintées ». L’auteur nous parle du cidre, mais aussi du battage, du grenier, des lavandières des bords de routes, de « Marie Mousterlin », de Mathurin « vieux marin rusé », ou encore de ses frasques d’enfant et d’ado. Jeunesse plutôt heureuse à l’écoute des voix du temps, de la rumeur s’échappant du bocage (plus que de la mer pourtant toute proche).
Dans ce pays fouesnantais on parle breton mais on mélange aussi, volontiers, breton et français (nous sommes dans les années 1960). Les variétés de pommes à cidre portent le terroir breton dans leurs gènes. Elles s’appellent C’hwerv rouz, Sac’h biniou, Rouz koumoul, Dous-glas bihan… Musique des mots, bruits de la terre qui résonnent aux oreilles du jeune Louis. « Là était ma véritable religion aux cantiques de vents, aux paroles de pollens et aux douces offrandes des baies, dans les métaphores les plus floues des communions sauvages ».
Dans ce livre comme dans d’autres, Louis Bertholom ne donne jamais dans la sobriété. Il est du côté de l’ivresse. C’est sa marque de fabrique. Ivresse des mots avant tout. Écriture fleurie, enluminée, foisonnante et baroque, associant volontiers abstraction et notations les plus concrètes. « Une mythologie intime, secrète / se forgeait en odeurs inaltérables / dans le monde fractal / de ces errances bucoliques, sereines ».
« J’ai des pépins dans mes gènes », nous dit Louis Bertholom. Et comment ne pas à nouveau saluer le poète quand il écrit ces mots admirables : « Je blesse une étoile quand j’écrase une pomme ». Des mots qui nous renvoient à ce haïku du poète japonais Issa : « Tuant une mouche / j’ai blessé / une fleur »
Le rivage du cidre, Louis Bertholom, Éditions des Montagnes noires, 180 pages, 14 € Avec des dessins de Claude Huart. Ce livre est une édition augmentée du livre paru en 2003 aux éditions Blanc Silex.
Louis Bertholom publie également en juillet 2018 un nouveau recueil poétique, L’enfant des brumes, un dialogue sans concession entre un infirmier psychiatrique et son patient schizophrène en proie avec ses délires (Éditions Rafaël de Surtis).
 |
Charles Madézo, |
| La cale ronde |
|---|
La cale ronde du douarneniste Charles Madézo a été rééditée. À la sortie du livre en 1985, chez Calligrammes à Quimper, j’avais rédigé cette note de lecture dans l’hebdomadaire Le Progrès de Cornouaille. Je la reprends in extenso.
Charles Madezo récidive. Ou, plutôt, Calligrammes. On connaissait déjà de Madézo un certain Douar en enez ou Le territoire de l’île, ouvrage minuscule édité en 1982. 44 pages de bonheur (pour le lecteur) sur une enfance et une adolescence douarneniste. Mais avec un sentiment d’inachevé. 9 textes seulement. Du Madézo pour goûter, comme on goûte un bon crû. Et, ma foi, c’était bien bon.
Avec La cale ronde, le propos s’élargit. On retrouve les merveilleux textes de Douar an enez, comme « la rue monte-au-ciel », « le Ris », « le pardon de Sainte-Anne », « les crabes », « la grève des dames ». Mais de nouvelles perspectives s’offrent à nous avec « les boultous », « marée basse », « baignades » ou encore « la cale ronde » qui donne son titre au livre. « Quelquefois les marsouins venaient jusqu’au vieux port. C’était au mois d’août quand ils chassaient les maquereaux. Nous étions rassemblés au bout de la cale ronde ».
On l’a bien compris. Douarnenez est au centre du livre. Madézo nomme un site, une ville, des lieux. Le sociologue et l’historien liront, entre les lignes, la vie du port breton dans les années 50. Mais l’intérêt du livre est ailleurs, on s’en doute. « Pour que la mémoire se fasse vivier, il faudra piéger le souvenir », écrit Philippe Bosser dans la préface. Comme on piège les crabes et les maquereaux, Madézo fait remonter à la surface tous ses émois d’adolescent. Ce livre est vibrant de sensualité. Pas étonnant quand on sait la place qu’occupe la femme dans le microcosme douarneniste. Les hommes sont loin, en mer, au large, et le jeune Charles sort à peine des jupes de sa mère ou de « la mamm » quand il découvre une jeune fille dont les cheveux roux ont « l’odeur des pinèdes ».
L’éducation rigoriste des Frères des Écoles chrétiennes ne fait qu’exacerber cette sensualité explosive. Mais l’Église se permet parfois des « fantaisies ». Madézo garde ainsi un souvenir lumineux des processions de la Fête-Dieu, avec sa débauche de couleurs et d’odeurs : les fleurs sur le bitume, l’encens dans l’air frais.
La cale ronde est autant de flashes-back montés en courtes séquences. Simplicité du texte, sens du vécu font de ce livre un petit écrin, un grand livre de poésie en prose. Madézo a bien compris la leçon de Robert Bresson. « Ne cours pas après la poésie, elle pénètre toute seule par les jointures ».
La cale ronde, Charles Madézo, Stéphane Batigne éditeur, 110 pages, 12,50 €. Version revue et augmentée du récit publié par Calligrammes en 1985, réédité par Coop Breizh en 2002. Prix Tristan Corbière en 2003.
Charles Madézo vient de publier Traits de chalut aux éditions Vivre tout simplement, 116 pages, 15 €. Ce livre, note l’éditeur, « prend source dans l’empreinte indélébile et les résonances d’une enfance au plus près de la mer. Une même mer qui mène l’auteur de Brest à Dakar, de Lorient à Djeddah et Lattaquié ».
 |
Anne-José Lemonnier, |
| Polyphonie des saisons |
|---|
105 tableaux comme les 105 années vécues par la grand’mère de l’auteure. Anne-José Lemonnier signe un ouvrage étonnant qui tient à la fois du récit, du poème en prose et de la biographie. Elle raconte la vie quotidienne de son aïeule Angélique dans son jardin (son « missel du quotidien ») au bord d’une falaise, face à une baie qui s’offre, à travers les saisons, à son regard émerveillé. Un lieu « ouvert à l’infini de la mer ».
Nous sommes à Plouéden (nom d’emprunt), entre cap et presqu’île, quelque part au bout de la terre. Mais, à n’en pas douter, en Bretagne occidentale. Angélique tient un atelier de couture. Son mari, après une longue captivité en Allemagne, une petite ferme. Ils ont deux filles : Violette et Blanche. Mais l’important n’est pas là. Le propos d’Anne-José Lemonnier est de nous faire partager la véritable immersion dans le cosmos d’une femme à l’écoute des vents, du ciel et de la mer… « Dans ce récit, qui n’est pas une histoire, écrit l’auteure, avec un fil, des fils mis bout à bout, mais plutôt un rapiéçage, un ravaudage d’une vie qui a beaucoup servi, usée jusqu’à la trame, j’essaie de me souvenir par la fidélité infaillible de la mer et des fleurs ».
Ce souvenir passe, d’abord et avant tout, par l’évocation des saisons dont Anne-José Lemonnier se plaît à souligner l’enchaînement « en douceur ». Mais avec un mois-clé : mars, parce qu’il « contient tous les temps, orchestre toutes les saisons ». Avec, aussi, l’appel à la langue bretonne pour décrire « la réalité de novembre et de décembre ». Ces bien connus miz du et miz kerzu, littéralement « mois noir » et « mois très noir ».
Cette polyphonie des saisons – qui donne son titre au livre – relève de la contemplation et d’un émerveillement sans failles. Certes la bruine « emprisonnait le paysage pendant des semaines entières » mais la baie pouvait aussi réciter, « rouleau après rouleau, comme une litanie, la splendeur bleue d’une journée d’hiver ». Car c’est d’abord le bleu que glorifie ce récit. « Angélique cultivait le bleu dans toutes ses nuances et sous toutes ses formes, le bleu de la mer dans son regard, le bleu des fleurs dans son jardin, le bleu des étoffes dans la couture. Elle avait l’oreille absolue du bleu pour ainsi dire. Elle a aimé, chéri le bleu avec une passion mystique, telle une vocation ».
C’est ce bleu qu’on imagine aussi, aujourd’hui, être aimé de l’auteure elle-même. Tout comme on la pressent amoureuse des chats à l’image d’une grand’mère qui vivait, au jour le jour, dans la compagnie du bien-nommé Gant-garantez (avec amour). Anne-José Lemonnier, en effet, associe cette évocation d’une vie à son propre retour dans ce jardin où Angélique a passé de si longues heures. Son récit montre – s’il en était besoin – qu’elle sait de quoi elle parle. Pour nous raconter ce qu’Angélique a vu et contemplé, elle ne peut qu’en avoir fait, d’une certaine manière, l’expérience elle-même.
Il y a, dans ce récit, une forme de liturgie, d’extase mystique, « une religion de la nature accentuée avec l’âge » comme le dit l’auteure à propos de sa grand’mère. Le soleil couchant devient, ici, une « hostie » célébrant « l’eucharistie des falaises ». Il y a aussi, dans ce récit, l’art du peintre. Anne-José Lemonnier avait fait de la peinture le thème de son dernier recueil (Archives de neige, Rougerie, 2007). Elle y soulignait notamment « le goût des saisons » manifesté par les grands maîtres de l’École de Pont-Aven. À sa manière, par des mots, elle transfigure aujourd’hui des paysages et une vie. Celle d’une femme qui cheminait « au présent des instants » et qui « avec la mer pour clôture inviolable, se sentait à l’intérieur d’une enceinte sacrée ». Pour cette femme, l’auteure souhaite « un paradis aussi lumineux que celui de toute sa vie »
Polyphonie des saisons, Anne-José Lemonnier, Diabase, 125 pages, 14,50 euros
 |
Jean-Pierre Boulic, |
| Petites pièces pour instruments à voix |
|---|
La poésie du Breton Jean-Pierre Boulic relève du chant, de l’incantation.. On ne doit donc pas s’étonner du titre de son nouvel opus, au sein duquel « andante », « arias » et autre « musique a capella » se font entendre au détour des pages. Ce chant du monde est porté par des oiseaux musiciens (verdier, traquet, passereau…) mais plus encore par une nature à l’écoute de laquelle le poète se met sans faillir. « Mince campanule/A corolle toute nue/Réfléchit l’azur // Ce qu’elle pense en silence/m’apprivoise peu à peu ».
« La poésie m’a toujours paru être une quête de signes menée au cœur d’un monde qui ne demande qu’à répondre, interrogé, il est vrai, selon telle ou telle inflexion de voix ». Ce n’est pas Jean-Pierre Boulic qui le dit mais le grand poète suisse Gustave Roud. Une définition de la poésie qui s’applique merveilleusement à lui. Il le dit d’ailleurs à sa manière : « Ouvrir ses portes / Franchir le seuil / Cueillir les signes ». Le poète répond à un appel au cœur d’une nature sans cesse renouvelée par le passage des saisons. « Accueillir l’inespéré / Le désir qui t’habite », nous dit Jean-Pierre Boulic. Car il s’agit de pressentir « l’indicible » et de reconnaître « l’invisible ». Nous sommes ici dans une poésie de veille, d’attention soutenue. «Dire l’impossible l’impensable / Donner goût / À une célébration de la vie ». Dans une moisson de métaphores dont il a le secret, Jean-Pierre Boulic nous dit qu’il traverse « la jachère des heures », qu’il accueille « le lilas de l’instant » et recueille « un tulle de silence ».
Est-ce le paradis que peut entrevoir l’auteur chrétien qu’il est ? Sans doute. Ce paradis peut prendre la forme d’un « tout petit verger » ou s’enraciner dans un « royaume d’enfance » quand « le silence des coquillages » crépitait « à l’ombre des pas ». Cette approche franciscaine de la vie, tournée vers la contemplation, irrigue en tout cas le livre. Lilas, églantiers, giroflées, campanules… sont les interlocuteurs privilégiés du poète. Et quand le poète écrit : « Moineaux sans abri / En exil sur la jachère /Et moi tout petit », comment ne pas penser à ces lignes du poète japonais Issa (18e siècle) écrivant : « Viens jouer avec moi / moineau / qui n’a pas de mère ».
La poésie de Jean-Pierre Boulic nous mène loin. Dans une importance préface à ce livre, Jacques Le Goff note que « la belle méditation poétique » de l’auteur recèle « un questionnement proprement philosophique sur la nature profonde de ce « royaume sans limites » qu’est la réalité ». Il convoque, à l’appui de sa démonstration, Teilhard de Chardin, Bergson ou Merleau-Ponty et ouvre ainsi des perspectives inédites sur l’écriture et le message du poète breton.
Petites pièces pour instruments à voix, Jean-Pierre Boulic, éditions Pétra, 117 pages, 14 euros
 |
Jacques Josse, |
| Débarqué |
|---|
C’est l’histoire d’un homme « débarqué ». Le père de l’auteur. « Débarqué » de ses rêves de grand large et d’aventure. Empêché, à cause de la maladie, de traverser les océans et de humer les parfums de la terre. Ce père ne sera pas marin comme l’avait été son propre père, capitaine au long cours.
Jacques Josse nous livre ici un livre poignant et tellement juste sur un père au destin « terre à terre » mais qui trouva un bel échappatoire en bourlinguant dans sa tête et en voyageant grâce aux livres de Loti, London, Conrad… (« Ces auteurs aux textes portés par les embruns »). Un père qui « ne s’attardait pas sur ses rêves brisés et son itinéraire en dents de scie. Gardait cela pour lui ».
Sujet à des crises d’épilepsie (avant qu’un accident vasculaire cérébral n’altère encore plus sa santé), ce père connaîtra bien des hauts et des bas. Réparateur en électricité, il connaîtra aussi les petits boulots et des moments de chômage. Une vie fragmentée. Parfois fracassée quand meurent, avant lui, deux de ses enfants dont la jeune sœur de l’auteur dans des conditions tragiques. Mais, raconte aussi Jacques Josse, « Il y eut des années de bien-être, des accords intérieurs, de belle zébrures dans le ciel bleu roi qu’il scrutait juste avant de monter se coucher. Il flânait dans l’aire et dans les allées du jardin. Faisait le pied de grue près des arbres ».
Ah ! ce jardin où ce père creuse, bêche, plante, taille, greffe, recueille des fruits juteux. Un artisan du geste. Comme lorsque, les dimanches après-midi, il lançait sa ligne dans la rivière toute proche. Jacques Josse garde mémoire de ces moments précieux. Avec son père, il se met aussi à l’écoute du Tour de France sur le transistor familial : L’Espagnol Jimenez passe en tête au sommet du Galibier et, lui, « venait deux minutes plus tôt de chasser une vipère qui dormait au soleil ». Car, nous dit l’auteur, « il aimait mettre ces faits mineurs en perspective ».
Mais sous le ciel tourmenté des Côtes d’Armor, le père a beau « glaner des brindilles de bien-être dans les arbres, les fleurs, les étoiles, les livres », la vie persiste à vous jouer des mauvais tours. Jacques Josse nous restitue au fil des pages cette ambiance particulière qui imprègne tous ses livres. La mort n’est jamais loin, elle est toujours à l’œuvre. La faucheuse sévit sur les routes ou dans le plus intime des familles. Les morts, eux, continuent à vivre au milieu des vivants. Ils ne les quittent pas.
Il y aussi, de bout en bout dans ce livre, cette nébuleuse de gens cabossés d’où émergent les Ernest (ancien terre-neuvas), Eugène et Michel (les deux frères paysans célibataires), ces deux sœurs « en gris » qui « promenaient leur tristesse à vélo », Jean-François l’unijambiste… Jacques Josse n’a pas son pareil pour brosser un tel univers.
C’est dans ce monde-là qu’il a grandi auprès d’un père, passé en ce monde sans faire beaucoup de bruit, « vie minuscule » à certains égards, mais qui par la grâce de l’écriture de Jacques Josse, atteint une forme de plénitude.
Débarqué, Jacques Josse, Éditons La Contre Allée, 150 pages, 16 euros
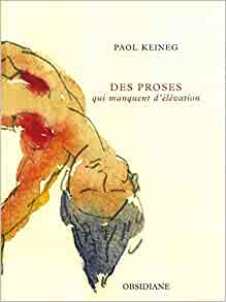 |
Paol Keineg, |
| Des proses qui manquent d’élévation |
|---|
S’il s’exprime aujourd’hui en prose, c’est toujours en poète que Paol Keineg revient vers son lecteur. Mais ne lui faites pas dire que « la poésie sauvera le monde » comme certains auteurs peuvent aujourd’hui le prétendre. Le nouveau livre qu’il publie recèle, bien au contraire, de commentaires teintés d’amertume. « J’ai presque cru en les pouvoirs de la poésie. La poésie a disparu, ou presque », affirme-t-il. Ou encore ceci : « Un poète n’a pas plus d’importance qu’une mouche sur la vitre ». Pourquoi ce constat accablant ? Parce que « la mode n’est pas à la difficulté » et donc, poursuit-il, « on ne lira plus de poésie »
Il y a dans ces mots, en réalité, une forme de douce provocation. Car en publiant ces « proses qui manquent d’élévation », l’auteur confirme en réalité qu’il croit encore en la poésie. Voici 88 textes ciselés où le poète nous prend à rebrousse-poil dans son approche d’un monde qui lui semble ne pas tourner très rond. Le lisant on pense à ces mots du cinéaste allemand Werner Herzog : « Je ne suis pas nostalgique, je contemple le désastre ».
Dans la foulée de ses deux précédents livres, Abalamour (Les Hauts-Fonds, 2012) et Mauvaises langues (Obsidiane, 2014), Keineg nous dit, sur un mode décalé associant tableaux de genre et commentaires souvent décalés, comment il continue à avoir mal à son pays. « Nous vivons en des temps heureux : on ne croit plus au diable, on ne paie plus sa chaise à l’église ». La forme est subtile pour dénoncer à la fois le monde clérical d’antan et le matérialisme partout à l’œuvre aujourd’hui. « Garder un œil sur la laideur du monde », lui paraît donc une urgente nécessité à une époque où « s’enrichir fait de vous un héros ». Des propos de ce type, dispersés dans son livre, s’inscrivent dans un terroir concret et rural où « l’on cultivait le froment et la pomme de terre (cela remonte à l’époque reculée d’avant le maïs) » et où l’on travaillait, enfant, dans les champs de petits pois. Mais, s’empresse d’ajouter malicieusement Paol Keineg, « avoir grandi au milieu des champs de pommes de terre ne garantit pas l’immortalité ».
Retour d’Amérique, le poète vit depuis déjà quelques années dans son Finistère natal. Il voit les clochers de Hanvec et de Rumengol quand il déambule dans les chemins à pied ou en vélo (et il écrase parfois des doryphores). Il cultive son jardin, sème des fleurs et fait du compost. Humant l’air du pays (un peu trop pollué par les odeurs de lisier comme il le laissait entendre dans Mauvaises langues), il nous parle de ces deux tantes « qui n’eurent jamais honte de parler breton toute la journée ». Ce qui lui permet d’affirmer à nouveau, aujourd’hui comme hier: « Quand elle est programmée, la mort d’une langue est un crime contre l’humanité ».
Des proses qui manquent d’élévation, Paol Keineg, Obsidiane, 105 pages, 16 euros
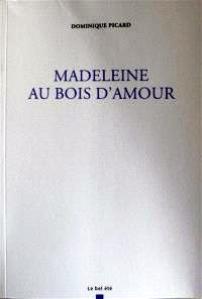 |
Dominique Picard, |
| Madeleine au Bois d’Amour |
|---|
Des textes comme autant de tableaux de peinture. Avec un penchant certain pour l’impressionnisme, le pointillisme. Sans oublier l’École de Pont-Aven comme l’indique implicitement le titre de ce livre qui nous rappelle le Gauguin du Bois d’amour. Dominique Picard croque des instants de vie (comme un peintre ferait des croquis). Nous voici, sous ses pas (sous sa plume) naviguant de la Bretagne à la Provence en passant par Paris. Souvenirs personnels et évocation d’artistes se mêlent dans ce livre placé sous le signe du fragment.
« J’aime que le texte ne se donne pas à voir tout de suite, que l’on cherche le motif qui s’efface puis apparait de nouveau ou se dilue », affirmait l’auteure dans un entretien avec Alain-Gabriel Monot (revue Hopala, n°45). « Que l’on ne sache pas qui parle par moment ne me gêne pas. Je souhaite faire surgir des images et des sensations en combinant les mots, en organisant leur agencement. J’utilise souvent une forme elliptique qui vient naturellement ». Dominique Picard a deux patries. Deux Heimat. Elle les doit à un père breton et à une mère catalane. C’est de cela qu’elle nous parle dans ce livre.
La Bretagne, ici, fleure bon les Montagnes noires, l’intérieur des terres du côté du Faouët, et aussi le littoral vers Vannes (mais les lieux ne sont pas précisément nommés). « Ma palette était très colorée, raconte Dominique Picard, parce que, dans mon esprit, il faisait toujours beau dans les Montagnes noires où j’allais en vacances. Mon frère tenait l’hôtel de la Croix verte. On arrivait par le train. La ville est animée. Des foires, des marchés aux bestiaux, des courses de chevaux, des scènes que je reproduis sur le vif… »
La Provence ? « À vélo sur le boulevard, on menait contre le mistral un véritable combat (…) La lumière était dense presque palpable, poussière, sable, on ne savait ce qui tournoyait, peut-être des paillettes de mica ».
Toute une vie défile ainsi, pleine de couleurs. Les « fantômes » de Sérusier, Dufy, Bernard et de tant d’autres, planent dans ces récits. Sans oublier « les petits maîtres » dont la grand’mère de l’auteure possédait des tableaux. « J’écris ce que j’ai vu, connu ou entendu. J’utilise mes propres expériences, les histoires transmises », affirmait encore l’auteure dans la revue Hopala.
Dominique Picard, qui vit aujourd’hui en presqu’île de Rhuys, est née en 1946. Elle nous livre des bribes de vie. Mais ne nous raconte pas « d’histoires ». Sinon celles qui sont la chair de son existence.
Madeleine au Bois d’amour, Dominique Picard, éditions Le bel été (18, route de l’île de Tascon, 56450 Saint-Armel), 227 pages, 18 euros.
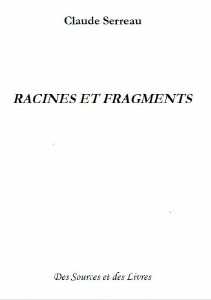 |
Claude Serreau, |
| Racines et fragments |
|---|
Claude Serreau est un auteur dans sa quatre-vingt sixième année qui publie des recueils de poèmes depuis 1966 (en majorité aux éditions Traces). Originaire du pays nantais et très attaché à la Bretagne en particulier à cette Cornouaille du côté de Fouesnant, il est l’homme de cette attention au monde et aux autres qui peut prendre la forme d’une « inquiétude », ainsi que l’affirme Eric Simon dans l’ample préface de ce nouveau livre de l’auteur. Inquiétude d’ordre spirituel au sens large du terme et qui est la toile de fond de l’état de poésie (*).
Avec Racines et fragments, nous plongeons à la fois dans l’espace et le temps. « Racines de douleurs », certes, mais aussi « racines d’un paysage au chevelu / d’arbres d’eau d’ombre et de lumière ». Fragments « d’enfance déchiquetée / comme silex au bord des routes / tranchant les lumineux étés ». Mais aussi « fragments de si petites vies / qui libèrent leur importance / au moment du plus grand déclin ».
Claude Serreau honore la vie. Il célèbre aussi bien « l’éternité d’une seule heure » que « l’humus fertile de nos deuils ». Il est du côté des poètes du « oui ». De ceux de l’acquiescement au monde, même si ce monde fait flèche de tout bois pour porter atteinte à notre humanité (« l’ombre se fait passage / au revers du passé / noirci d’un peu de sang »). Comment alors s’étonner que l’auteur fasse sienne la parole de René Guy Cadou et qu’il puisse, aujourd’hui, lui-même écrire : « Il peut bien faire froid / demeure la lumière / un regard pour aimer / les parages du jour ». Hommage aussi à « l’égale du talent de l’époux » qu’il remercie d’avoir entretenu le feu, à Hélène, « très humble saunière / avec la voix qui nous convainc ». Pas de doute, « Cadou est toujours là / les amis bien autour / en attente de mots / qu’on prononce pour soi ».
Dans ce recueil Claude Serreau évoque certes les « années-lumière », mais aussi les « années-cendres ». Il scrute les heures, renifle l’air du temps. « Parfois le ciel de pluie / oubliant sa colère / accorde sur ces terres / une anxieuse embellie ». Bel oxymore qui résume au fond sa vision du monde. Ce que l’éditeur, sous la plume de Marie-Laure Jeanne Herlédan souligne justement en parlant, à propos de l’auteur, « d’effroi et d’espérance mêlés ».
(*) L’inquiétude de l’esprit ou pourquoi la poésie en temps de crise est le titre d’un ouvrage collectif publié en 2014 par les éditions Cécile Defaut.
Racines et fragments, Claude Serreau, Des Sources et des Livres, 113 pages, 15 euros.
| Retrouvez les publications Des Sources et des Livres |
| Découvrez la note de lecture de Marie-Laure J. Herlédan et la préface d'Eric Simon |
 |
Guy Allix, |
| Au nom de la terre |
|---|
« Ma terre au fond de moi / Très loin dans ma mémoire ». Guy Allix est un homme du Nord, de ce pays de ciel bas où la terre, lourde et humide, colle aux pieds. Il a raconté, dans un très beau petit livre, cette enfance « terreuse » près des terrils (Maman, j’ai oublié le titre de notre histoire, Les Éditions Sauvages, 2016). Cette terre ne l’a jamais quitté. Il en fait aujourd’hui une vraie matière poétique en élargissant son propos à ce qui est notre terre à tous. En clair, à notre condition d’homme, de femme, ici ou là-bas, passants confrontés à la mort. « Terreuse / Cela qui grouille interminable / Dessous toi dessous tes Pas / Gonflé de la pourriture / Et des morts et du sang / Et du travail des vers / Tout cela en toi ». Oui, nous dit encore Guy Allix, « Telle est la terre / Qui t’obsède et te pétrit / Ce ventre grouillant de vers et d’eau ».
Cette antienne aux accents funèbres, voire mortifères, ne doit pas cacher l’autre versant de la terre. Terre nourricière sur laquelle ont vécu ses ancêtres paysans, « Ces hommes et ces femmes / Les très-bas / Toujours à hauteur de ce sol / Qui les avait vus naître / Et n’être que si peu ». Guy Allix les appelle les « atterrés ». Terre nourricière, en effet, parce que terre ensemencée. Terre femelle, terre/sexe. « La terre est une femme / Que tu travailles et que tu creuses ». Et encore ceci, plus loin : « Terra mater / Terre ma terre maternelle / Maternante et marâtre parfois / Terrassante ».
Cette terre, le poète nous la montre aujourd’hui objet de tant de convoitises, victime de souillures de toute nature. « Ils t’ont oubliée, ils vont trop vite. Ne savent plus ton rythme et la patience. Ils t’ont profanée, déversant du poison dans tes entrailles ». D’où cette exhortation : « Refuse l’artifice, ce qui croyant nourrir la terre, la pourrit, la corrompt. Porte ton vers au plus fragile, au très-bas ». Il y a quelque chose de franciscain dans ces mots-là. Et même d’évangélique quand Guy Allix écrit : « Il te faut mourir à toi / Pour que germe la graine ».
Guy Allix a obtenu pour ce recueil le prix Paul-Quéré 2017-2018, du nom du poète et artiste bigouden qui travaillait à la fois les mots et la terre dans sa « poèterie » du bout du monde.
Au nom de la terre, Guy Allix, Les Éditions Sauvages, collection Écriterres, 77 pages, 12 euros.
 |
Mérédith Le Dez, |
| Cavalier seul |
|---|
Le « Cavalier seul » de Mérédith Le Dez est le livre d’une femme à l’écoute (à l’épreuve ?) du temps qui passe inexorablement. Pour l’auteur, qui vit à Saint-Brieuc, il ne s’agit pas ici de cultiver une quelconque nostalgie mais bien plus de s’armer pour les années à venir en s’appuyant sur un passé fait, sans doute, de beaucoup de belles et bonnes choses. « Je vais moins vite et moins loin / que je ne suis allée / mais l’horizon toujours je creuse / dans la marche avec le sac / sur le dos ».
Si le temps passe, si « le cheval des heures enfuies » galope sans ménagement ou « trotte » dans sa tête, une forme de solitude s’installe en parallèle. « Je fais cavalier seul / désormais / dans l’horizon indifférencié ». Ce « cavalier seul », qui est le titre du troisième chapitre du livre, donne aussi son titre à ce recueil introduit par un émouvant coup d’œil dans le rétroviseur sous le titre « Souviens-moi ». Une femme parle par bribes – à coups de fines sensations – de ce qu’elle a vécu et ressenti à des moments de sa vie. Ainsi nous parle-t-elle « des pluies fades / et du vent mou / qui aiguisent le chagrin ». Ailleurs « de l’huître ouverte / dans un ciel d’écailles ». Autant de vives notations qui fleurent bon un pays de connaissance. Mais, dans ce « Souviens-moi », c’est d’abord une femme qui nous parle. De son corps. De ses émois. « Souviens-moi / d’une cadence / de hanche étroite » (…) « Souviens-moi / de la houle au ventre » (…) Souviens-moi / avec l’âge qui avance / inexorable et patient ».
Mérédith Le Dez a obtenu en 2017, pour ce recueil, le prix de poésie Vénus Khoury Ghata (du nom de la célèbre écrivaine française d’origine libanaise). Prix qualifié, par ses initiateurs, de « poésie au féminin ». La tonalité générale du livre atteste, en effet, ce regard de femme sur la vie mais aussi cette empathie pour la cause des femmes qu’embrasse Mérédith Le Dez dans le chapitre 2 intitulé « Fierté contre le temps ».
L’auteur quitte alors son monologue intime pour parler de résistance. « Résistance. Nom féminin », écrit-elle. « Je l’affirme en pleine conscience, j’appartiens à cette moitié de l’humanité qui depuis toujours est sous domination de l’autre ». Aussi fustige-t-elle, au passage, ces « hommes / prophètes / de portes cochères /à la petite semelle / à la cervelle trouée » qui tentent d’imposer leurs lois avec « leurs yeux avides/mangés mangeurs / de vase et de versets ». Pour autant, affirme Mérédith Le Dez, « la vérité n’a pas de sexe ». Sa résistance à elle est « une parole libre et créatrice de femme fière ».
Cavalier seul, Mérédith Le Dez, avec des encres de Floriane Fagot, éditions Mazette, 100 pages, 10 euros.
Mérédith Le Dez vient de publier un très beau roman Le cœur mendiant aux éditions La Part Commune, 221 pages, 17 euros.
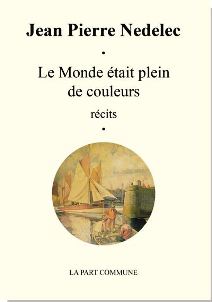 |
Jean-Pierre Nedelec, |
| Le monde était plein de couleurs |
|---|
Ce monde « plein de couleurs » (quel beau titre !) décrit par le douarneniste Jean-Pierre Nedelec dans son nouveau livre est celui de l’enfance. Il est aussi celui de peintres que, gamin, il côtoyait sur les quais du port cornouaillais.
Tout démarre dans ce récit, par une rencontre, lors d’une exposition de peinture consacrée à Jim-E Sévellec. Rencontre de l’auteur avec Charline (devenue adulte). Elle faisait partie de cette bande de copains et copines, « sauvages hilares » qui charriaient les artistes posant leurs chevalets sur les quais du Rosmeur ou de Tréboul (et n’avaient-ils pas raison de se moquer de ce Jim-E Sévellec qui tournait le dos à la mer et aux bateaux pour peindre une boucherie ?). Par le biais de cette peinture et de cette rencontre avec Charline, l’enfance revient au galop.
D’abord sous les traits de la jeune Charline avec sa « robe vichy à carreaux bleus » rencontrée à neuf ou dix ans quand les parents du jeune Jean-Pierre avaient pu trouver un appartement destiné aux « mal-logés » sur les hauteurs de Tréboul au Menez-Birou. « Au paradis », écrit l’auteur. « Des bandes d’enfants se formèrent très vite, courant, criant, flèches joyeuses vers le bord de l’eau, la digue toute proche ». Charline, « la petite fille blonde », en faisait partie, devenue aujourd’hui cette femme « élancée, vêtue avec élégance ».
Mais avant le « paradis », il y eut pour le petit Jean-Pierre de dures années. « L’exode » à quatre ans. De Plonévez-Porzay à Douarnenez. « D’un monde de paysans à celui de la mer. Et, surtout, aussi curieux que cela puisse paraître, d’une langue à l’autre, du moins d’un usage à des pratiques dissemblables ». La famille loge dans un taudis sur les hauteurs de Ploaré. « Si humide que les couvertures partirent en pillous ; sans eau, le seau pour chiottes ; une seule pièce, lits superposés. Pour bouger, il faut sortir ».
Sortir, c’est aller à la Fête de la mer avec sa « foule endimanchée le long des quais ». Sortir, c’est rencontrer Rouzig, la vendeuse ambulante de moules qui vend à la sauvette ce qu’elle a récolté entre le Ris et Trezmalaouen. Portrait émouvant d’une « femme de peu ». Sortir, c’est découvrir plus tard la Fête des mouettes. C’est aussi (on y arrive) rencontrer le monde plein de couleurs de ces peintres attirés par la lumière de la baie de Douarnenez. Jean-Pierre Nedelec évoque dans son récit les figures de Jim-E Sévellec, René Quéré, Jean Le Merdy, mais aussi Robert-Paulo Villard dont deux peintures décoratives ornent la salle des fêtes où le jeune Jean-Pierre assiste, pour la première fois, à une réunion politique « contradictoire ». C’est effectivement un monde haut en couleurs que nous dévoile l’auteur au fil des pages. Couleurs que l’on retrouve dans un 2e récit de son livre consacré à un 1er mai revendicatif et débridé. Débridé comme toujours à Douarnenez.
Le monde était plein de couleurs, Jean-Pierre Nedelec, La Part Commune, 125 p, 14 euros.
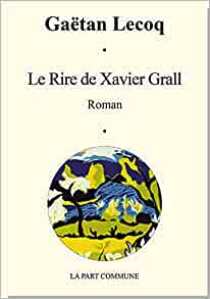 |
Gaëtan Lecoq, |
| Le rire de Xavier Grall |
|---|
« Romancer » la vie du poète et journaliste breton Xavier Grall. Personne ne l’avait encore tenté, ni forcément imaginé. C’est désormais chose faite avec le roman de Gaëtan Lecoq, Breton du pays Gallo et auteur de cet étonnant livre : Le rire de Xavier Grall.
Car de Grall on garde volontiers l’image (transmise par les photos ou les films) d’un homme au visage plutôt sévère, voire austère. Parler du « rire » de Xavier Grall semble a priori saugrenu mais ce mot « rire » apparaît déjà, concernant le poète, dans des écrits du peintre et graveur Claude Huart, ami de Grall. Gaëtan Lecoq nous le révèle au cours de son récit.
Dans ce livre s’imbriquent plusieurs approches de l’homme de Bossulan. Nous l’abordons dans le sillage de Paul, personnage central du roman, écrivain en quête d’inspiration (et d’amour), un jour subjugué par les écrits de Grall et qui entreprend de partir à sa recherche à la fois dans le temps et l’espace.
Nous voici à Ploudiry dans la maison du grand-père quand le petit Xavier de neuf ans y passait des vacances. Nous voici, une autre fois, aux côtés de l’adolescent énamouré qui s’éprend de Françoise, la sœur de son meilleur copain de collège. Nous voici encore dans l’appartement de Sarcelles où le journaliste de « La Vie catholique » résida quelques années avec sa femme et ses filles (sa « bourgade gamine ») avant le grand départ pour la Cornouaille. Nous voici à l’hôpital, à Paris, le 16 octobre 1972, quand « le médecin de Xavier lui a ordonné une semaine d’examens médicaux pour voir comment avançait la maladie emphysémateuse ». Ce sont des tranches de vie, jamais évoquées de cette manière, que Gaëtan Lecoq restitue avec bonheur pour mieux nous faire entrer dans l’intimité du poète.
L’intérêt de ce roman – qui en fait aussi son caractère inédit – est de nous faire aborder le poète breton à travers le regard d’un personnage à peine adolescent dans ces années 1970 du revival breton (Stivell, Glenmor…). L’adolescent se cherche. Cherche sa voie. « En te cherchant, Xavier, j’ai compris que c’était moi que je cherchais. Je cherche ma réalité, ma légitimité. Tout en toi m’a toujours paru plus grand, plus impressionnant, rebelle et tellement fier ». Sur le plan amoureux, la relation entre Xavier et Françoise se double notamment dans le roman d’une autre quête amoureuse, celle de Paul avec Ana, la libraire. Jeu de dédoublement qui donne sa saveur et son originalité au livre.
Gaëtan Lecoq n’élude dans ce roman (que l’on devine très autobiographique) aucune des facettes de l’homme Grall: le journaliste, le père, le poète, l’amant, le chrétien, l’homme marqué par le Maghreb… Mais aussi le militant de la cause bretonne. à celui-ci, le romancier, par la voix de Paul, destine quelques flèches concernant sa collaboration au journal « L’avenir de la Bretagne » d’Alain Guel. « Xavier, tu n’as pas interrogé Guel sur son engagement pendant l’Occupation ? Ses idées étaient les mêmes que celles de Mordrel, Lainé ou Fouéré. Des noms aux relents vert-de-gris et aux engagements inacceptables ». C’est la seule limite que Paul donne à son enthousiasme pour l’oeuvre de Grall. Et quand le poète breton meurt, sous les bourrasques, dans un mois de décembre 1981, « toute la Bretagne pleure » et la nature se met au diapason : « Dans la forêt de Huelgoat, les arbres sanglotent (…) Sur l’ossuaire du cimetière de Ploudiry, l’ankou sort de la frise de pierre ».
Mais on en revient, en définitive, au rire. Et d’abord au rire des mouettes rieuses survolant l’assistance pour l’inauguration d’une stèle à la mémoire de Grall à la pointe de Trévignon. Nous sommes en 2021, quarante ans après la mort du poète. Rire de l’assistance. Bonheur, surtout, de découvrir une stèle associant Xavier et Françoise. épilogue d’un roman écrit avec ferveur et passion pour nous parler de l’Amour sous toutes ses formes. Et dédié à Françoise Grall.
Le rire de Xavier Grall, Gaëtan Lecoq, La Part Commune, 260 pages, 17 euros.
 |
Jean Lavoué et Nathalie Fréour, |
| Chant ensemencé |
|---|
« Maintenant que le temps m’est compté ». C’est le terrible aveu de Jean Lavoué au cœur de son dernier livre Chant ensemencé. Poussé par la nécessité (et quelle nécessité !), il nous livre ici un ouvrage pétri à la fois de joie et de douleur (retenue) sur cette vie qui bouillonne plus que jamais en lui. Livre écrit sur son lit d’hôpital à Lorient ou en convalescence dans sa bonne ville d’Hennebont, livre que l’on espère – du fond du cœur – ne pas être son dernier.
Car Jean Lavoué n’en aura jamais fini de nous dire ce qui l’anime. Sourcier, veilleur, homme de l’Exode (celui qu’il a magnifié dans ses livres sur Jean Sulivan), il nous parle aujourd’hui de « la maladie tapie / Sous la faiblesse des mots ». Mais il le fait sans amertume, plutôt plein de gratitude sur ce que la vie lui a apporté et lui apporte toujours. « Si le temps est compté / Arrêtons donc les heures / Pour en faire un festin ». Festin du « bréviaire des saisons ». Festin des « graviers du chemin ». Festin des « Rives sans souci » du côté du Blavet et du Scorff.
Pour l’accompagner dans cet exode d’un autre genre, il retrouve les auteurs qui lui sont chers comme Etty Hillesum (« J’aime ta douce incandescence / et ton exacte jeunesse ») ou encore René Guy Cadou (« Il allait tête nue dans les champs / Vers cette joie enfin conquise »). Et puis, un jour, il y a cette « enveloppe de verdure et d’amitié glissée le 21 juillet dans la boîte aux lettres » par Christian Bobin. L’écriture de Jean Lavoué est pétrie de tout cela. D’une fratrie d’auteurs lus et relus pour qui « rien ne subsistera / Sauf cette soif d’aimer ».
Passant du « je » au « tu », du « tu » au « je », l’auteur ne manque pas aussi de nous parler comme à des frères. « Trouve le lieu de ton repos / Laisse-toi traverser » (…) « Fais confiance à ta nuit / Laisse germer le silence » (…) « Ne s’en remettre à rien d’autre / Qu’à la nudité des branches ». Il nous dit avoir écrit ces mots, ces lignes, tel jour à telle heure (7 h 15, 6 h 14, 2 h 20, 3 h 14, 7 h 34…) depuis le 21 mai 2017. Oui, Jean Lavoué fait bien partie, lui aussi, de ces veilleurs dont il parle au début de son livre, « bergers d’un feu qui ne faiblit pas ». Et pour le dire il a trouvé la belle lumière qui émane des dessins « blancs » de Nathalie Fréour. Avec le poète et l’artiste, on entre véritablement dans un univers où « tout espace est béni ».
Chant ensemencé, poèmes de Jean Lavoué, dessins de Nathalie Fréour, éditions L’Enfance des arbres, 60 pages, grand format à la française 21x29,7 cousu. Adresser les commandes à Jean Lavoué, L’Enfance des arbres, 3, place vieille ville, 56 700 Hennebont. 22 euros + 4 euros de port.
 |
Bruno Pellegrino, |
| Là-bas, août est un mois d’automne |
|---|
Gustave et Madeleine. Frère et sœur. Tous deux célibataires. Ils vivent à la sortie d’un village dans une maison dont la façade est couverte de vigne-vierge. Nous sommes autour des années 1960, avant la grande révolution agricole qui transformera les campagnes. Gustave, c’est Gustave Roud, le grand poète suisse (1897-1976). Madeleine, sa sœur, a quatre ans de plus que lui.
En décidant d’écrire le « roman » des dernières années de Gustave Roud et de sa sœur, le jeune écrivain suisse Bruno Pellegrino (né en 1998) prenait énormément de risques. Comment « romancer » la vie d’un si grand poète ? Comme s’inspirer librement de certains épisodes de sa vie sans trahir sa personnalité profonde ? Pour y parvenir, il faut sans doute avoir beaucoup d’empathie pour son sujet et aussi une connaissance très fine de la vie des deux protagonistes. Bruno Pellegrino s’est notamment appuyé sur sa propre connaissance des lieux (pour y avoir vécu lui-même), sur les correspondances et le Journal du poète ainsi que sur le contenu de Campagne perdue, livre publié par Gustave Roud en 1972. Il a aussi revisité l’émission qu’avait consacrée à Gustave Roud le réalisateur Michel Soutter pour la Télévision Suisse Romande.
Car nous sommes effectivement en Suisse romande (même si les lieux ne sont jamais nommés dans le roman) du côté du Jorat, dans le canton de Vaud, là où Gustave Roud a vécu à partir de son plus jeune âge. Précisément dans une maison du petit village de Carrouge qu’il n’a jamais quittée. Collaborateur de revues, traducteur, poète, il a vécu chichement, mais toujours dans l’éblouissement d’une contrée qu’il adorait et parcourait inlassablement à pied, muni de son carnet de notes et de son appareil photo. « Lorsqu’il a quitté la maison, la brume d’aube qui festonnait les prés ne s’était pas encore dissipée. La vieille sacoche à l’épaule, comme un colporteur, il a marché toute la matinée d’un pas régulier, les jambes fortes, la nuque voûtée, le regard sur la route où penchaient des lotiers mal en point ».
Le romancier nous parle, ici, de l’automne 1964. Il nous montre, au fil des pages, un poète en quête de « morceaux de paradis épars » (Novalis) dans les molles collines du Jorat, au contact de ses amis moissonneurs qu’il se plaisait à photographier de préférence torse nu (révélant au passage une homosexualité profondément ressentie mais jamais nommée). Des échos de la vie du monde parviennent, assourdis, aux oreilles de Gustave et Madeleine par les journaux, la radio et un peu la télévision. Le romancier s’attarde notamment, dans son récit, sur quelques grands épisodes de la conquête de l’espace (dont la première marche sur la lune), un sujet qui passionnait Madeleine.
Que l’on soit, ou non, attaché à l’œuvre de Gustave Roud, que l’on connaisse ou non ses écrits, il faut lire ce livre sans crainte d’y être perdu. Le romancier nous parle de la vie qu’il faut affronter chaque matin, de l’épaisseur des jours, des saisons qui passent (comme le montre le titre du livre), de la vie domestique dans sa simplicité et sa beauté (la maison, la cuisine, le ménage, le jardin…), de l’aspiration sans cesse renouvelée de dépasser sa condition au contact d’une nature offrant des sensations toujours neuves. La place de Madeleine auprès de son frère y est soulignée avec force. Quand elle mourra (subitement) quatre ans avant lui, le poète connaîtra un profond désarroi. Ils formaient à eux deux un véritable couple. Ce que ce roman sait nous montrer avec beaucoup de sensibilité.
Là-bas, août est un mois d’automne, Bruno Pellegrino, éditions Zoé, 225 pages, 17 euros
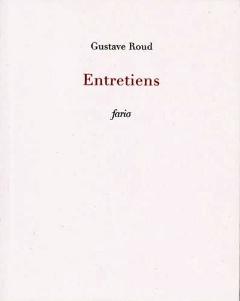 |
Gustave Roud, |
| Entretiens |
|---|
Les amoureux de l’œuvre de Gustave Roud n’en finissent pas de faire l’inventaire de sa démarche poétique. Sa correspondance avec de nombreux auteurs (Chessex, Jaccottet…) a fait l’objet de diverses publications. Voici, dans un nouveau petit livre, la « parole vive » du grand poète suisse telle qu’elle s’est exprimée dans des journaux ou revues (« La Gazette de Lausanne », « La Feuille du Valais »…), sur les ondes de la Radio Suisse Romande ou sur les écrans de la Télévision Suisse Romande. Par contre, pas un seul entretien dans la presse parisienne, très éloignée de l’effervescence littéraire de la Suisse francophone. Pour autant, l’œuvre de Roud, on le sait, n’avait rien de régionaliste : « Si j’avais vécu ailleurs, la poésie m’aurait été présente aussi », déclare-t-il dans un entretien peu du 19 août 1975 à « La Nouvelle Revue de Lausanne ».
On découvre chaque fois, dans ces divers entretiens, un poète d’une grande humilité et d’une grande simplicité. Pas du tout donneur de leçons, par exemple à des jeunes qui voudraient se lancer dans la poésie. Plutôt enclin, au contraire, à dire et redire ce qu’il doit aux poètes qui l’ont tellement influencé (Holderlin, Novalis, Rilke…). De Novalis, Gustave Roud reprend à son compte, à plusieurs reprises, cette injonction qui l’a tellement marqué : « Le paradis est dispersé sur toute la terre et nous ne reconnaissons plus ; il faut réunir ses traits épars ». Il en fera la toile de fond de sa démarche poétique. Interrogé sur sa propre définition de la poésie, Gustave Roud répond : « La poésie (la vraie) m’a toujours paru être une quête de signes au cœur d’un monde qui ne demande qu’à répondre, interrogé, il est vrai, selon telle ou telle inflexion de voix ».
Ce monde sera, sa vie durant, le Jorat suisse du côté de Moudon (où il décèdera en 1976), dans un monde rural ancien grignoté par la modernité. Marcheur impénitent, Roud connaîtra des moments d’extase, des « illuminations » comme il l’affirme lui-même, au cours de ses pérégrinations parfois nocturnes. « Certaines idées premières de la poésie ne peuvent pas naître en vous dans ce que j’appellerais l’état « normal », il faut passer dans un état « second », qu’on ne peut pas provoquer mais qui en général se produit peut-être à la fin d’une fatigue, d’un désespoir ou d’une joie extrêmes, ces moments où vous êtes alors relié à quelque chose que vous n’entrevoyez pas à l’état quotidien » (entretien avec Jacques Chessex du 19 mars 1966 sur la Radio Suisse Romande).
Roud dit aussi, ailleurs, que « tout le désir est de prolonger par la parole, par le poème, le souvenir de cet instant que l’on vient de vivre » (entretien du 15 août 1956 à la même Radio). Et, donc, lutter par le fait même contre le dépérissement et la mort, thématique dont il souligne l’importance dans la littérature de son pays : « Je suis persuadé qu’il y a en Suisse romande un goût de l’introspection qui fait qu’on se penche volontiers sur le problème de la mort ; une certaine angoisse devant le fugace, le passage du monde sensible » (« Feuille d’avis du Valais », janvier 1969). Gustave Roud l’exprimera sous la forme du fragment, en insistance sur la « musicalité » qui doit, selon lui, imprégner l’écriture poétique.
Entretiens, Gustave Roud, éditions établie, préfacée et annotée par Emilien Sermier, éditions fario, 121 pages, 15 euros.
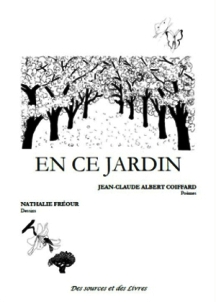 |
J.-C. Albert Coiffard (poèmes) et N. Fréour (dessins), |
| En ce jardin |
|---|
« La rose est sans pourquoi », écrivait Angelus Silesius au 17e siècle. Dans le jardin de Jean-Claude Albert Coiffard, il y a beaucoup de roses. Dans dix-huit des quarante-huit courts poèmes qui composent son livre, il nous parle de cette fleur chérie des poètes. Même si la rose est « sans pourquoi », elle n’en finit pas d’interpeller ceux qui se penchent sur elle pleins d’admiration. Et c’est bien le cas de Jean-Claude Albert Coiffard. « Que cherches-tu mon âme ? / que cherches-tu ? / l’éclat de cette rose / est déjà un miracle ».
Ce questionnement – qui n’est pas sans rappeler les plus belles intonations de la poésie mystique – donne le ton à ce beau livre où les courts poèmes de l’auteur sont superbement accompagnés (on pourrait même dire magnifiés) par les dessins en noir et blanc de Nathalie Fréour dont le compagnonnage avec les textes de certains poètes est désormais connu (avec ceux de Gilles Baudry ou de Jean Lavoué notamment).
Pour l’artiste et le poète, le jardin est un lieu de méditation et d’appel au silence. Ce n’est pas un jardin potager mais un jardin floral (pour la vue, pour les couleurs, pour les parfums) où les roses sont environnées de glycines, de lilas, d’hortensias ou de centaurées. On y surprend la libellule, l’abeille, le merle, le rouge-gorge ou le lézard. Dans ce jardin/paradis (puisque le paradis est, étymologiquement, un jardin), le poète peut lancer ses appels. « Papillon / les ailes jointes / sur le cœur d’une rose / apprends-moi à prier ».
Postfaçant ce livre, Marie-Laure Jeanne Herlédan a raison d’évoquer la parenté avec Francis Jammes, Marie Noël, Hélène Cadou mais aussi le Chinois Wang-Weï ou le Japonais Bashô. On pourrait ajouter à cette liste Anne Perrier quand elle écrit dans Feu les oiseaux (1975) : « Dans le jardin désert / un pavot glorieux / danse pour toi seul ». Oui, la poésie de Jean-Claude Albert Coiffard est de cette trempe-là. Elle ne se pousse pas du col. Elle n’a pas « la grosse tête » comme peut l’avoir l’hortensia « plus bleu que le ciel ». Elle chemine avec modestie à la recherche d’une «infinie Présence ». Elle voit dans les fleurs du lilas blanc « les tuniques des anges ». Mais on revient, inlassablement, aux roses et aux questions qu’elles posent. « Le jardin déserté / pour qui / pourquoi / éclaireront les roses ? »
En ce jardin, Jean-Claude Albert Coiffard (poèmes) et Nathalie Fréour (dessins), éditions Des sources et des Livres, 65 pages, 15 euros.
| Retrouvez les publications Des Sources et des Livres |
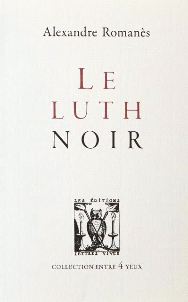 |
Alexandre Romanès, |
| Le luth noir |
|---|
Il est Tzigane et écrit de courts livres à la fois poétiques et méditatifs. « Lire Alexandre Romanès, c’est connaître l’épreuve de la plus grande nudité spirituelle ». Christian Bobin le dit dans sa préface à Sur l’épaule de l’ange, un précédent ouvrage de l’auteur (Gallimard, 2010). « Juste une voix, ajoutait-il, et surtout le ton de cette voix : une corde de luth pincée jusqu’à l’os, luth dont il a joué dans sa jeunesse ». Ce luth, qui donne son titre au nouveau livre d’Alexandre Romanès, fait encore entendre sa sonorité au fil des pages. Mais elle est désormais plus sombre, emportant le poète dans « le royaume neigeux de la mélancolie », même s’il reste attentif aux « sonorités pleines de tendresse du luth baroque ».
Alexandre Romanès n’est vraiment pas un auteur comme les autres. Avant d’être poète, il est un « enfant de la balle », fondateur du cirque qui porte son nom, Tzigane de son état. Et donc assez désespéré sur l’avenir de son Peuple de promeneurs (titre d’un autre de ses livres, Gallimard, 2011) car, dit-il, « être Tzigane / c’est ajouter une difficulté à la difficulté ». Aussi n’hésite-t-il pas à affirmer : « Quand mes filles seront vieilles / ma tribu n’existera plus ».
Si les méditations, notations ou réflexions d’Alexandre Romanès nous intéressent et nous concernent, c’est parce qu’elles nous parlent – au-delà du sort spécifique des Tziganes - de notre condition d’homme dans un monde qui tourne de moins en moins rond. Alexandre Romanès, lui, a rompu les amarres avec ce monde. « Tous ces mots qui ne veulent rien dire / tous ces actes qui ne servent à rien / et ces gens si nombreux, si bruyants / où rien d’important n’entre dans leur tête / et ces livres qui ne possèdent même pas / une phrase qui vous touche ».
Désespéré, oui, pour toutes ces raisons. Mais aussi parce que la mort rôde. « J’irai rejoindre les plus pauvres / ceux qui n’ont que le ciel / et je dirai moi aussi je cherche / le silence et la nuit pour pleurer ». Sa bouée de sauvetage ici-bas, c’est la poésie. Celle des auteurs qui l’ont subjugué : Christian Bobin, Lydie Dattas, Marceline Desbordes-Valmore. De ces deux femmes, il dit qu’elles ont « le cœur plus sensible et plus tendre / que du papier d’Arménie / et un courage d’acier ».
Enfin, il y a ses cinq filles. Ses vraies raisons de vivre (Alexandra, Rijenka…). « J’ai perdu la première de mes cinq filles. Si je dois en perdre encore une / je mourrai avec elle ».
Le luth noir, Alexandre Romanès, éditions Lettres vives, 73 pages, 15 euros.
 |
Guénane, |
| Ma Patagonie |
|---|
À chacun sa Patagonie. Son bout du monde, son lieu secret. Pour certains, c’est la porte à côté : un petit bois perdu, une cabane, un grenier, le creux d’un rocher, un sentier qui ne mène nulle part… Mais de vraie Patagonie (vrai bout du monde), il n’y en a qu’une. C’est celle qu’a arpentée maintes fois Guénane à la pointe de l’Amérique du Sud, continent où elle a longtemps vécu avant de venir poser son sac du côté de Lorient.
Poète, auteure de romans, récits et nouvelles, Guénane nous dit aujourd’hui « sa » Patagonie. Mais elle le fait – on s’en doute bien – sans recourir à cet exotisme facile qui imprègne aujourd’hui le tourisme de masse. À rebours, Guénane pointe plutôt du doigt les menaces qui pèsent sur ce territoire aujourd’hui objet de tant de convoitises. « Les arbres agonisent au bord des lacs / étendues de troncs déchiquetées ». Plus loin, elle écrit : « Qui reprisera l’ozone troué ? / Bleu satanique ciel nocif / sous la glace le feu couve ». La voici aussi sur les pas des Indiens Tehuelche, «nomades aux empreintes géantes (…) hommes d’avant la découverte / d’avant les massacres ». Elle s’inquiète aussi du sort des baleines « géantes, pacifiques, fascinantes », qu’il faut protéger des « barbares excursionnistes ». Elle nous parle avec empathie de ces « énormes sultans » que sont les éléphants de mer, ou encore des otaries ou du « manchot de Magellan ».
On pourrait parfois, lisant ce recueil, penser avoir affaire à un manifeste écolo. En fait, il n’en est rien. Si Guénane pointe du doigt les périls d’aujourd’hui et les turpitudes contemporaines, elle ne verse jamais dans la poésie dite engagée (« Ne pas l’alourdir / en peu de mots, dire la Patagonie »).
Comme dans un de ses précédents recueils (Un rendez-vous avec la dune, Rougerie 2014), l’auteure nous dit d’abord sa Patagonie intérieure. Si ce bout du monde la séduit tant, c’est parce qu’elle y trouve un souffle vital (« le même souffle depuis le premier jour »). Parce que « la Patagonie c’est elle qui vous explore / ouvre vos brèches fouille votre cœur ». Nous voici, au cœur de ce territoire, dans la « libre démesure ». La Patagonie, nous dit encore Guénane, « tacle en plein cœur / débride les ailes intérieures ». Soudain nous voici très loin de l’exotisme et plus proche d’une écologie intime, dans un bout du monde qui sonde nos fièvres et nos ardeurs.
Ma Patagonie, Guénane, La Sirène étoilée, 41 pages, 12 euros.
Guénane publie en outre Tangerine éclatée, recueil de la revue Poésie en voyage (édition La Porte), dont le cadre sont les Açores.
Lectures de 2017
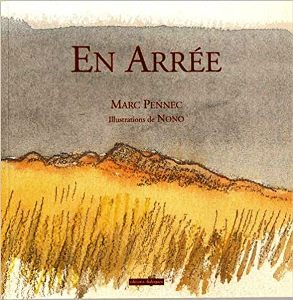 |
Marc Pennec, |
| En Arrée |
|---|
« Nous marchons en ce monde sur le toit de l’enfer en regardant les fleurs », écrivait au 18e siècle le poète japonais Kobayashi Issa. L’enfer : il est partout. C’est notre part d’ombre. En Bretagne, on le trouve dans ces Monts d’Arrée qu’arpente depuis des années Marc Pennec. Précisément dans les marais de Yeun Elez, vers la bouche spongieuse et indécise des tourbières, nous dit-il. C’est un lieu d’ombres et de faux semblants où les anges, le diable, l’Ankou s’astiquent les côtes et combattent de façon implacable.
Les Monts d’Arrée sont peuplés de songes, de mythes, de fantasmes. Il n’est pas étonnant qu’on puisse y puiser une belle matière littéraire. Grall et Gwernig ont, en leur temps, témoigné du frisson qui les saisissait en traversant ces landes dénudées et ces sommets en arêtes. Marc Pennec, lui aussi, est tombé sous le charme. Très jeune. Il faut dire que, lorsqu’on habite Landivisiau, les Everest de Roc’h Trévézel ou de Roc’h Trédudon sont à portée de main. Encore faut-il savoir discerner dans ces lieux autre chose que des monts ou des landes. Marc Pennec y a vu très vite un bout du monde, un Larzac breton, un espace en rupture avec le monde matérialiste qu’installaient les Trente Glorieuses. Pour tout dire un domaine que n’auraient pas renié tous les adeptes de la contre-culture, à commencer par ceux de la Beat Generation, Jack Kerouac en tête. Que n’auraient pas renié non plus Jim Harrison ou Rick Bass.
Il y a donc, dans ce livre, qui associe chapitres en prose et quelques poèmes, un retour sur ces années enflammées post-68 (qui sont aussi celles du revival breton) et ce désir de l’auteur de venir, précisément, vivre et travailler dans ce pays-là. Ambition que ne partageait pas sa compagne Catherine. Elle ne se voyait pas, en effet, passer toute sa vie dans ces lieux loin de tout, désolés et humides. L’auteur en a pris acte et le temps a passé, mais il n’a pas renié sa fougue d’antan sur ce territoire à part qu’il continue à fréquenter assidûment. C’est comme ça : les terres désolées, ravinées par les éléments, ingrates, frissonnantes sous l’averse, qui faussent volontiers compagnie au quotidien et se fichent des dieux et des idoles essoufflées du monde entier, me fascinent depuis le fond de l’enfance.
Cet amour de l’Arrée trouve aussi sa source dans le besoin irrépressible de trouver une forme de paix intérieure. Marc Pennec, dans un chapitre très émouvant, révèle le bouleversement opéré en lui par la lourde maladie de son jeune frère. Il trouvait alors refuge à Trédudon-le-moine pour noyer ses angoisses : Je me fondais, disparaissais dans le paysage. Je montais vers les crêtes. Dépassais les prairies et les troupeaux, les bosquets, les futaies, vers la lande (…) Ces jours-là, je me serais bien rendu aux nuages et aux ciels passants.
Pour l’accompagner dans ce livre de belle facture, Marc Pennec a trouvé comme compagnon de route le dessinateur et aquarelliste Nono, dans son art consommé d’apporter ici de la lumière sur ces paysages austères : lumière jaune des ajoncs ras, jaune pâle des chaumes, lumière rose des bruyères, parcelles brunes de fougères fanées, toits et murs gris des maisons, villages dans la nuit… Tout surgit à coups de crayon : Saint-Michel de Brasparts, Saint-Herbot, Brennilis et sa centrale… Oui, Arrée est univers.
En Arrée, Marc Pennec, illustrations de Nono, Éditions Dialogues, 100 pages, 14 euros.
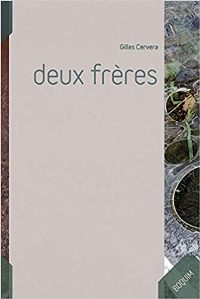 |
Gilles Cervera, |
| Deux frères |
|---|
Deux frères. Le petit et le grand. Le grand et le petit. Tout au long du livre, on les appellera le petit et le grand. Deux frères que tout sépare. L’âge, bien sûr, la taille, mais surtout le regard sur la vie. Nous sommes en Bretagne dans un pays mouillé, de bruines et de vents (Des ors d’ajoncs mouillés de rosée, des ors de genêts ployés de bruines), avec quelques échappées vers le sud de la France d’où est originaire le père. Mais on ne sait rien du père quand le livre s’engage. Il est absent. Il a disparu très tôt de la vue des enfants. Un mystère qui s’éclaircira dans le deuxième et dernier court chapitre tellement poignant de ce roman.
Le rennais Gilles Cervera, auteur de cette histoire de fratrie, écrit d’un souffle, d’un trait. Comme dans l’urgence. Presque un langage parlé, prodigieusement vivant et qui vous happe littéralement comme si vous étiez pris dans une conversation et des confidences intimes. Son histoire, en effet, pourrait être aussi la nôtre. Un peu de chacun d’entre nous s’y retrouve forcément. C’est pour cela qu’elle nous touche. Sans compter l’art que possède l’auteur de faire ce va-et-vient entre le passé (ici celui des sixteens, d’Adamo et d’Enrico Macias) et un présent où les deux frères, devenus adultes, prennent des chemins tellement différents.
Le grand râle, éructe. Des conneries, dit-il à propos de tout. Il en veut au monde entier. Le petit, depuis le temps de la chaise haute était plutôt locataire de l’admiration. Le grand, admiré, s’est plutôt logé dans le dénigrement et la persécution. La vie n’est pas tendre, sans doute le prévoyait-il. Le malheur, en effet, l’a atteint au cœur (un enfant handicapé). Le grand est un manuel, un homme du bricolage et des affaires concrètes de tous les jours. Le petit, à ses côtés, fait vite figure d’intello. Il s’intéresse à la psychologie (des conneries, lui dit le grand). La bibliothèque était la deuxième maison du petit. Elle jouxtait le lycée, son ancienne chapelle. Le petit s’asseyait où s’étaient assis Jean Grenier et Louis Guilloux, leur chaise tiède et les livre à lire sur les rayons rayonnaient. Entre le grand et le petit, il y a la mère à qui le grand téléphone deux fois par jour et qu’il materne d’une certaine manière (ou plutôt « paterne » car le père n’est plus là). Une mère-pivot entre ces deux-là. Le petit et le grand.
Pourquoi un tel roman/récit peut-il nous concerner profondément ? Parce que, contrairement aux titres clinquants de têtes de gondoles, il nous parle avant tout de ce que nous sommes profondément, du poids des liens familiaux, de notre situation d’enfant, de frère, puis d’adulte lancé dans un monde pas toujours drôle. L’enfance ressemble à un centre de tri, écrit l’auteur de ce récit très autobiographique. S’ensuivent des lignes qui divergent, des objets qu’un voit, l’autre pas, que l’un pèse et qui pour l’autre ne pèse rien. Tout paraît pareil, tout semble identique. Il n’en est rien. Tout diffère. Rien ne se ressemble, peu rassemble.
Gilles Cervera a écrit là un livre dans la lignée de L’enfant du monde, son puissant premier roman (Vagamundo, 2016). Il parle des difficultés de la vie, de nos irréductibles différences et de nos solitudes. Mais aussi de ces moments précieux où le cœur s’épanche.
Deux frères, Gilles Cervera, Vagamundo, 141 pages, 13 euros.
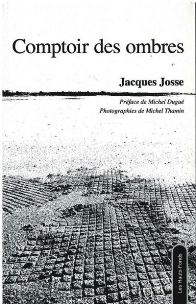 |
Jacques Josse, |
| Comptoir des ombres |
|---|
À quoi reconnaît-on un écrivain ? Un vrai. À sa capacité à créer un monde, à sa faculté de partir de lieux singuliers et familiers pour vous parler de l’univers entier, de l’homme, de ses peurs, de ses fantasmes. Le rennais Jacques Josse, en vrai écrivain, tourne et retourne, de livre en livre, les mêmes obsessions, les mêmes rêves. Les personnages de ses récits circulent d’un livre à l’autre. Et on les reconnaît bien. Ce sont des naufragés, explique l’auteur, des perdants, des exclus, des cabossés de la vie. Mais aucun d’entre eux ne courbe l’échine.
Ses personnages, on les suit même à la trace. Et c’est encore le cas dans son nouveau livre Comptoir des ombres où l’on retrouve, par exemple, le Rousseau du Café Rousseau (La Digitale, 2000) ou encore le Pedro rencontré dans Chapelle ardente (le Réalgar, 2016). Mais le temps a fait son œuvre. Fin de route, parking vide, balayé par un vent venu du Nord, le café est derrière, fermé pour toujours. Rousseau n’y est plus, gisant au cimetière depuis des lustres, ne dialogue plus qu’avec d’anciens clients triés sur le volet, Popeye, Jimmy, Jeff, Salaun, Marquier et quelques autres dérivant entre taupes et pissenlits… Quant à Pedro, il est à un endroit dans la mer et qu’en dessous veille son âme (si elle existe), lui parti un soir décrocher des ormeaux au fond et depuis jamais revenu.
Jacques Josse a une saine attirance pour les disparus. Saine parce que les morts savent nous accompagner. Il ne se contente pas d’évoquer leur mémoire mais carrément de leur redonner vie. Sous terre les morts discutent entre eux et prennent l’apéro. Le bar central se situe dans un caveau assez spacieux pour recevoir ceux et celles qui ont encore quelques souvenirs à faire valoir. Parfois ils reviennent, tels de fantômes, pour échanger avec nous. On les discerne dans la brume ou le brouillard. Il faut dire que le pays s’y prête. Dans les récits de Josse on vit dans un territoire compris entre Bréhat et Fréhel. Une vraie « géopoétique ». Des phares clignotent dans la nuit, des hommes se cassent la pipe au pied des falaises ou se noient dans des rivières. Le soir, si le père, parti pêcher, ne rentre pas, c’est parce qu’il est tombé dans la rivière. L’image s’incruste.
La mort est toujours, ici, l’autre versant de la vie. Si le ciel est plutôt sombre (nous sommes sur la côte nord de la Bretagne), les hommes savent faire face même si souvent ils ne sont « pas d’attaque » (titre d’un des chapitres de ce livre). Jacques Josse a été marqué, dans son enfance, par tous ces ex-voto accrochés dans les sanctuaires évoquant tous ces disparus en mer, ces marins de Paimpol ou d’ailleurs partis au loin et dont la mémoire hante les vivants.
Cette familiarité avec le mort nous amène à rattacher l’auteur à tout ce légendaire développé par Anatole le Braz autour des morts et des revenants (mais sur un mode ethnographique). Jacques Josse ne voudrait pas qu’on lui colle l’étiquette d’écrivain breton. Surtout pas. Mais il y a, dans son approche de la mort, quelque chose chez lui qui relève de « l’âme bretonne », celle évoquée par Ernest Renan quand il fait précisément de la familiarité avec la mort un marqueur essentiel de ce « peuple ».
Comptoir des ombres, Jacques Josse, Les Hauts-Fonds, 105 pages, 17 euros. Ce live propose aussi, dans sa partie finale, un entretien réalisé par Malek Abbou dans lequel Jacques Josse explicite sa démarche d’écriture.
 |
Amaury Nauroy, |
| Rondes de nuit |
|---|
Ramuz, Roud, Chappaz, Chessex, Cingria, Jaccottet, Perrier… Ils ont tous un point commun : être des auteurs originaires de Suisse romande et d’avoir établi entre eux, pour la plupart, des liens d’amitié et de connivence fondés en particulier sur le profond respect des jeunes pour les plus anciens. On pense en particulier à Jacques Chessex et à Philippe Jaccottet qui ont voué un véritable culte à leur maître en écriture Gustave Roud (1897-1976). Toute cette saga littéraire méritait bien un livre. Il est l’œuvre d’Amaury Nauroy, « jeune auteur » né en 1982 et pétri de cette littérature suisse. Il nous propose ici, sous l’énigmatique titre Rondes de nuit, une véritable plongée dans un monde qui a connu ses « heures de gloire » au cœur du 20e siècle mais qui continue à séduire un lectorat fidèle.
Cette grande aventure littéraire et humaine n’aurait sans doute pas été possible sans le rôle essentiel joué par l’industriel et mécène suisse (amateur d’arts, de manuscrits, de poésie…) qu’était Henry-Louis Mermod (1891-1962). C’est lui, depuis Lausanne, qui a été le catalyseur de cette véritable effervescence littéraire en devenant l’éditeur de la plupart des grands noms de la poésie de Suisse romande (Valais, Pays de Vaud, Haut-Jorat…). Amaury Nauroy consacre une large part de son livre à Mermod. Il le dit dans une langue superbe avec une abondance étonnante de détails (à la manière des meilleurs investigateurs), tout cela dans une véritable empathie avec ce milieu. Ce qui n’empêche pas quelques coups de griffe à l’encontre des frasques de tel ou tel, à l’image de Jacques Chessex (1934-2009). Il employait une part de son énergie manœuvrière et jalouse à exister, quitte à se mettre en avant. Et, pour peu qu’on eût fait devant lui l’éloge de ses compatriotes encore en vie, il se braquait, raconte Amaury Nauroy qui a rencontré l’auteur suisse à plusieurs reprises dans sa tanière de Ropraz.
Les pages qu’il consacre à Anne Perrier (1922-2017) et à Philippe Jaccottet (né en 1925) sont sans doute les plus belles, parce qu’elles nous permettent de mieux comprendre cette originale approche du monde qui caractérisait de tels auteurs. À propos d’Anne Perrier, Amaury Nauroy écrit : C’est un pays tout intérieur et désancré, celui du cœur et plus encore un pays d’âme qu’elle traduit avec des mots tout à fait simples, dans un registre qui alterne l’abstrait (le silence, le bonheur, l’amour, la gloire…) et le détail le plus réel.
De sa connaissance aiguë de l’œuvre de Philippe Jaccottet (qu’il a rencontré plusieurs fois à Grignan dans la Drôme), il tire cette leçon personnelle : De poisseuses inquiétudes ne doivent pas nous faire oublier l’effarant appel de ce monde. Aussi mouvant qu’il soit, aussi cruel et imparfait, le pays qui s’ouvre devant nos pas est le seul dont nous puissions faire l’expérience concrète. Il réclame d’abord d’être aimé puis certainement d’être dit ».
Le livre d’Amaury Nauroy (qui emprunte quelques chemins buissonniers où l’on menace parfois de s’égarer) est ainsi parsemé de notations d’une grande justesse. Il nous révèle sa profonde intimité « spirituelle » avec les auteurs qu’il nous présente, sans parler des « comparses » tellement riches et savoureux (artistes peintres, libraires…) qu’il introduit avec bonheur dans cette saga.
Rondes de nuit, Amaury Nauroy, Le bruit du temps, 285 pages, 24 euros.
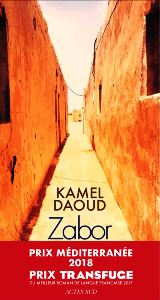 |
Kamel Daoud, |
| Zabor ou les psaumes |
|---|
Quand un livre commence par ces lignes, on se dit qu’on est dans de bonnes mains. « Écrire est la seule ruse efficace contre la mort. Les gens ont essayé la prière, les médicaments, la magie, les versets en boucle ou l’immobilité, mais je pense être le seul à avoir trouvé la solution : écrire ». C’est Zabor qui le dit, anti-héros du roman de Kamel Daoud. Roman mais tellement plus qu’un roman. Plutôt un livre-somme brassant de grandes questions existentielles (La mort, la vie, l’amour, le sexe…) et brossant, implicitement, l’univers intime de l’auteur dans les années qui ont suivi l’indépendance de son pays.
Kamel Daoud (dont on avait déjà apprécié son Meursault contre-enquête chez Actes Sud) signe ici un livre puissant, grande fable poétique sur les pouvoirs de l’écriture et de l’écrivain.
Le fil conducteur de ce roman tourne, en effet, autour de la capacité de Zabor à faire reculer la mort par ses écrits. Et d’abord la mort des gens d’un village (dont il raconte la vie dans ses cahiers quand la mort les guette), village « de peu » cerné par ses eucalyptus et ses figuiers de barbarie. Village où les femmes recluses ou répudiées n’ont pas de corps. Village où « l’innocent Zabor » (que la vue du sang des moutons qu’on égorge révulse), est ce fils chassé par son père (grand égorgeur devant l’éternel), finalement recueilli par une tante célibataire et que l’on découvre, tout au long de ce livre, à la fois méprisé et « jalouséde tous » à cause de ses dons.
Arrive le moment où Zabor se trouve face à un véritable dilemme: arrivera-t-il (mais le voudra-t-il ?) à retarder, grâce à ses écrits, la mort d’un père honni ? Kamel Daoud n’est pas là pour nous tenir en haleine ou nous ménager un quelconque suspense mais pour nous dire – entre les lignes – tout ce que les livres et l’écriture ont pu lui apporter. « La fin du monde pour moi, fait-il dire à Zabor, est le jour où l’on volera mes cahiers pour les éparpiller dans les rues, aux vents, comme à la sortie des écoles à la veille des vacances ».
Mais ce n’est pas la langue stéréotypée et englobante du Livre sacré – on s’en doute – qu’il vante ici, cette langue « puissante » et « bavarde », comme il l’écrit, et qui « comptait beaucoup de mots pour les morts, le passé, les devoirs et les interdits et peu de mots précis pour notre vie de tous les jours ». Sans compter, ajoute-t-il, que « dans le Livre, les poètes sont moqués, soupçonnés de rivalité et d’errance ». Non, Kamel Daoud est d’abord là pour célébrer la liberté de l’écriture et du langage. Le pouvoir de la fiction. Et dire implicitement tout ce que la langue française a pu lui apporter, à lui l’écrivain et journaliste algérien. Ainsi fait-il dire à Zabor : « Ma découverte de la langue française fut un événement majeur car elle signifiait un pouvoir sur les objets et les sujets autour de moi. La possibilité d’un pamphlet à l’exacte limite de la falaise ».
Kamel Daoud nous émerveille de bout en bout par la profondeur de sa pensée, sa grande exigence intellectuelle, son profond souffle poétique. C’est un appel à l’éveil qu’il lance dans ce livre (notamment l’éveil des sens), un appel à quitter tous les mondes clos. Un livre à méditer, à ruminer, à l’aune des menaces que font peser les intégrismes religieux sur le monde. Car pour ce qui est de l’islamisme, Kamel Daoud en sait déjà lui-même quelque chose.
Zabor ou les psaumes, Kamel Daoud, Actes Sud, 330 pages, 21 euros.
 |
Ben Lerner, |
| La haine de la poésie |
|---|
Le sujet n’est pas neuf. Georges Bataille a fait de La haine de la poésie le titre de l’un de ses livres (éditions de Minuit, 1947). Pour lui, « la poésie est le langage de l’impossible »L’impossible : titre qu’il donnera, en 1962, à une nouvelle édition de sa Haine de la poésie.
La haine de la poésie de Bataille n’était donc pas véritablement une haine. Rien à voir, par exemple, avec la charge contre la poésie de l’écrivain polono-argentin Witold Gombrowicz lors d’une causerie qu’il fit en 1957 à Buenos-Aires. « Pourquoi est-ce que je n’aime pas la poésie pure ? Pour les mêmes raisons que je n’aime pas le sucre pur. Le sucre est délicieux quand on le prend dans un café, mais personne ne mangerait une assiette de sucre ». Il dénonçait aussi, au passage, « le style hermétique et unilatéral » de la dite poésie et tous ces poètes « qui écrivent pour les poètes » et « se couvrent mutuellement d’éloges ».
En écrivant La haine de la poésie, l’écrivain et poète américain Ben Lerner s’interroge sur le mouvement de recul que suscite le mot poésie auprès du plus grand nombre et pose la question de la marginalisation actuelle de ce genre littéraire. Ben Lerner commence d’ailleurs son petit livre par une anecdote significative le concernant. En classe d’anglais en 3e, il fut prié par son maître « d’apprendre un poème par cœur en vue de le réciter ». Aussitôt il s’empressa, pour limiter la corvée, de demander à la documentaliste de son collège de lui indiquer « le plus petit poème qu’elle connaisse ». Il faisait quatre lignes mais s’avéra, étant donné sa structure interne, très difficile à réciter. Et le jeune Ben Lerner s’en sortit très mal.
Cette anecdote révèle bien, à ses yeux, la difficulté d’appréhender la poésie et la suspicion qui entoure ce genre littéraire (barbant s’il en est pour beaucoup). « Un art détesté du dehors comme du dedans », écrit-il. Mais comment l’expliquer ? Ben Lerner considère que « la poésie et la haine de la poésie (…) sont inextricables ». Il en fait le thème de son livre, estimant que « un enchevêtrement d’exigences se pressent autour du mot poésie » mais que « nul poème ne pourrait satisfaire ces exigences ».
Quelles exigences ? « Vaincre le temps, l’arrêter par la beauté (…), parvenir à l’universel en étant irréductiblement social, triompher du langage et du système de valeurs de la société telle qu’elle existe, proposer une échelle de valeur au-delà de l’argent ». Pari impossible. D’où l’amertume et le ressentiment. « Haïr les poèmes réels est alors souvent une façon ironique, bien que parfois inconsciente, d’exprimer la persistance de l’idéal utopique de la Poésie et, à cet égard, les jérémiades reviennent aussi à des défenses ».
Ben Lerner a écrit ici un petit livre assez complexe, parfois savant, truffé de références à des grands auteurs (John Keats, Walt Whitman, Emily Dickinson…), dans lequel il cultive volontiers le paradoxe. Il faut le lire comme un essai jouissif, porté sur la dialectique (sur l’air de « je t’aime moi non plus »), un brin provocateur et n’épargnant pas les postures qui caractérisent trop souvent le milieu.
La haine de la poésie, Ben Lerner, Allia, 95 pages, 7 euros.
 |
Marie-Hélène Lafage, |
| Le train dans le brouillard n’attendra pas minuit |
|---|
« Entrer en poésie / C’est comme / Prendre un train pour nulle part / Poursuivre des saisons ». Marie-Hélène Lafage inaugure ainsi un étonnant livre axé sur la contestation foncière de notre destinée dans ce pays qu’on appelle la France. Que l’on se rassure, ce n’est pas un livre militant au sens étroit du mot. Loin de là. Parlons plutôt d’acte de résistance à un ordre existant (sans issue, sans projet, dans le brouillard) dans la lignée d’une poésie qui conteste les enfermements, les diktats, les figures convenues. « Refuser l’acquiescement / Le pâle / Assentiment /À la laideur du monde / Ne pas y consentir », écrit Marie-Hélène Lafage.
Des essais savants et des livres de sociologues ou d’experts ont largement analysé le malaise actuel et cette « crise » qui perdure. Marie-Hélène Lafage ne prétend pas ajouter sa pierre à l’expertise. Est-ce bien, d’ailleurs, le rôle d’un poète ? Non, elle creuse bien plus profond pour évoquer à la fois le désenchantement et le désarroi de cette génération née à l’issue des trente Glorieuses. « Proclamés / Bâtisseurs / Mercenaires / Malgré eux / Nos pères avaient ouvert / De nouvelles portes // À présent / Plus personne ne savait / Ce qu’étaient devenues / Les clés ». Le constat est impitoyable. Le pays a perdu la tête. « Et la crise / Nous faisait figure / De quotidien » à « Nous autres / Enfants de la modernité / Héritiers du désastre ».
« Désastre » : le mot est lâché. On s’est mis dans ce pays, estime le poète, à piétiner et à récuser l’avenir. « Les colporteurs du temps /Sillonnaient les avenues / Bruyantes / De l’ère médiatique / Chargés de leur orgueil / De leurs remèdes / Miracles / Seuls capables / De mettre fin / Aux mots du siècle ». Partagé entre « les lamentations » et le « rire », le pays, « en représentation continuelle », écoutait aussi les « prédicateurs » car « Le temps appelait / De nouvelles radicalités ». Pas plus d’espoir du côté d’une Europe « vieillie, nerveuse et pâle ». Diagnostic sans concession, donc, sur un monde sans boussole vivant à crédit sous un « bombardement sonore ».
Que faire ? Que dire ? Marie-Hélène Lafage n’a pas de programme politique. Simplement l’exigence du poète qui interpelle sans relâche. « Il faut toujours choisir / Entre une prison dorée /Et le tumulte de la rue // Entre l’étau du silence / Et le course exsangue /Des mots // S’établir / Progresser sur la brèche ». Garder aussi son pouvoir d’indignation. Dire le beau. « Pourquoi a-t-on coupé / Tous ces pommiers en fleurs / Arraché la glycine / Qui dormait sous le porche ? ». Marie-Hélène Lafage appelle, sans le dire, à la conversion des cœurs. Cofondatrice d’un café culturel à Lyon, elle fait partie des Altercathos ».
Le train dans le brouillard n’attendra pas minuit, Marie-Hélène Lafage, Ad Solem, 143 pages, 19,50 euros.
 |
Jean-Claude Albert Coiffard et Nathalie Fréour, |
| Encre de mer |
|---|
Ah ! La mer. L’inépuisable sujet poétique que l’on peut décliner de tant de tant de manières. Comme Alain Kervern, par exemple, dans ses récents Haikus de la mer accompagnés par les dessins de Marion Zilberman (Géorama, 2017). Comme aujourd’hui le Nantais Jean-Claude Albert Coiffard dont la mer se décline en aphorismes, courts poèmes, pensées ou réflexions, parce que la mer est par excellence le lieu de la méditation et de l’introspection (comme la montagne peut l’être pour d’autres). À lire ses textes, en effet, on conçoit que la mer puisse être cet horizon mental que l’on se donne, ainsi que l’attestent, par ailleurs, les merveilleux pastels de Nathalie Fréour (accompagnant les poèmes) tous conçus de la même manière : la mer, le ciel et, au milieu, une ligne d’horizon qui les sépare ou, le plus souvent, les fait se rejoindre.
Où commence la mer ? Où commence le ciel ? Nathalie Fréour, au fond, nous interpelle. On sait ce qu’il en est, dans nos contrées, quand le brume de mer ou le crachin effacent les distances et donnent les mêmes intonations (colorations ?) au ciel et à la mer. « D’avoir tant scruté l’horizon/mes yeux s’embuent de rêves », écrit Jean-Claude Albert Coiffard. Sous d’autres cieux, dans le Japon du 12e siècle, le poète Saigyô pouvait écrire : « Mes yeux se sont usés / à contempler la mer ».
Pour le poète nantais, la mer est avant tout le lieu de toutes les révélations. « Je regarde la mer / et rêve d’une barque ». Au fond la mer nous interpelle parce qu’elle parle de nous. Le poète lui donne une âme, un langage, et même des sentiments humains. « Devant le rocher au cœur dur / la vague éclate en sanglots ». Plus loin : « Le songes de la mer / finissent en écume ». Malgré son immensité, la mer invite aussi à la simplicité, voire à la sobriété. « Plus j’ôte de mots / et plus je vois la mer ».
Le pas est vite franchi pour évoquer la figure de Celui à qui les flots obéissaient. « Qui pourrait me montrer / la tendresse des flots / lorsqu’ils furent apaisés ». Et ailleurs on trouve cette autre allusion au miracle raconté dans les Évangiles : « D’un pas léger / il marchait sur la mer / et nous / d’un pas lourd / nous écrasons la terre ».
Dans l’avant-dire de ce livre élégant, Jean-Pierre Boulic note avec justesse que la mer est d’abord faite « pour les humbles chercheurs de l’essentiel ». Jean-Claude Albert Coiffard et Nathalie Fréour sont, à coup sûr, de cette trempe-là. Tandis que dans la postface, le moine poète Gilles Baudry évoque cette « haute mer de l’âme qui met au voisinage de l’éternité ».
Encre de mer, Jean-Claude Albert Coiffard (poèmes) et Nathalie Fréour (pastels), éditions L’enfance des arbres, 105 pages, 25 euros.
L’enfance des arbres publie par ailleurs un recueil d’Alain Durel intitulé Ei Taï-Ji ou la montagne du silence, fruit d’une expérience de sesshin (retraite) dans les Alpes maritimes (80 pages, 11 euros). Les Sourciers : c’est le titre d’un CD, qui vient de paraître comprenant des poèmes de Jean Lavoué sur une interprétation et musique de Pierre d’Andrea. Prix 15 euros, frais d’envoi 2 euros. À commander à Jean Lavoué, L’enfance des arbres, 3, place vieille ville, 56 700 Hennebont
.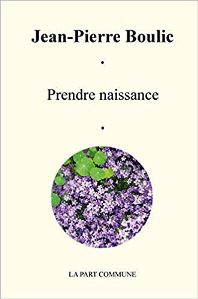 |
Jean-Pierre BOULIC, |
| Prendre naissance |
|---|
Prendre naissance comme on prend corps ou comme on prend feu. Ce « prendre » n’a rien à voir avec une quelconque saisie, c’est au contraire, le consentement nécessaire à ce que tout l’être prenne vie d’une grâce donnée, reçue : « Et tu consens à ce qui vient / Se reçoit d’un souffle secret » ».
Le dernier recueil de poèmes de Jean-Pierre Boulic nous entraîne tout doucement dans l’espace de la beauté et de la grâce : « En ce temps de la grâce » – c’est le titre de la dernière partie –, il suffit d’attendre, de s’abandonner « aux mots secrets de la parole », de la recueillir car « Toujours elle rend grâce / Au milieu des autres pages ». Le poète, avec patience, comme « violettes et perce-neige / raccomodant la terre », reprise les mots pauvres et humbles pour tisser « un sarrau de tendresse ».
Et nous cheminons lentement, en lecteurs attentifs guettant « les temps d’émerveillement », à travers « les vergers pensifs » et « les bois essoufflés », vers « la chapelle des frondaisons » qui écoute notre âme ; c’est alors que le souffle de l’invisible nous précède. Tout bruisse d’une vie intense, généreuse, mais silencieuse, car le chant jubilatoire des oiseaux, loin de rompre le silence, offre toutes les résonances « De cette frêle présence / Qui attise le désir ».
Même si affleurent, fugacement, quelques traces de blessure, elles ne peuvent assombrir les rais de lumière filtrant à travers la treille des feuillages et des pages, ni rompre l’harmonie des chants d’oiseaux, dans le jaillissement printanier de leurs trilles : « Les mois noirs s’effacent… s’en vient l’allégresse du jour »
Le poème célèbre les « clartés de l’enfance », cette lumière en avant de nous et non du passé. Si « l’enfance en sarrau / Accourt sans s’épuiser », ce n’est pas celle qui se loge dans la nostalgie, c’est celle du commencement du jour, celle qui illumine le visage, « La brise matutinale » qui « défroisse les yeux » : c’est à la lueur de l’invisible que s’ouvrent « les yeux assagis ». Seule l’âme d’enfant peut accueillir la vie nouvelle : « La vie insaisissable Vient et demeure ». Les yeux sont ouverts, car c’est maintenant que « Le jour s’accomplit ». C’est l’oreille de l’enfance qui, à l’heure favorable, permet d’écouter « Le chant d’imprévisible beauté / Des jeunes mésanges / Flûte de l’ange / passant parmi les heures d’enfance »
Comment ne pas percevoir les frémissements de l’aube pascale au fur et à mesure que l’on se laisse toucher par le poème dans sa progression ? L’arbre biblique, le figuier « S’habille de tendresse / et d’un chant inouï » ; l’arbre qui a poussé près de la Source « Donne fruit / à son heure ». A la lecture de ce recueil de Jean-Pierre Boulic se répand un subtil parfum d’éternité qui nous donne de prendre naissance d’en-haut.
Gratitude à toi, poète, à toi qui « reprises les mots » : « Âme si pauvre / Tes mots s’élèvent / En bénédiction ».
Prendre naissance, Jean-Pierre Boulic, éd. La Part Commune
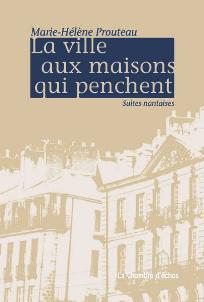 |
Marie-Hélène Prouteau, |
| La ville aux maisons qui penchent |
|---|
Née à « Brest même » mais profondément Nantaise, la bretonne Marie-Hélène Prouteau quitte « la petite plage » nord-finistérienne décrite amoureusement dans un précédent livre (éditions La Part Commune) pour nous parler de sa ville d’adoption, cette « ville aux maisons qui penchent » du côté du quai de la Fosse, cette « ville aux pierres blanches » où « le tuffeau règne en maître de lumière » et « doit composer avec le granit janséniste ».
Nantes a toujours été une belle matière littéraire et poétique. Marie-Hélène Prouteau s’inscrit dans une lignée prestigieuse et nous propose, à son tour, sa « forme d’une ville » (Julien Gracq) en présentant un kaléidoscope d’émotions fugitives ou de sensations éprouvées, sur place, au fil des ans. Ses « suites nantaises » (sous-titre du livre) sont des échappées belles, des fugues à la manière de compositeurs brodant sur le motif. La culture y tient la part belle, qu’il s’agisse de l’évocation d’un marché de la poésie où l’éditeur Yves Landrein expose ses livres, d’une rencontre avec Michel Chaillou au lycée, d’un livre de poète tchèque aperçu à la devanture d’un libraire et amenant l’auteure à évoquer des séjours pragois. Et quand Marie-Hélène Prouteau voit un pianiste et un violoniste roumains verbalisés dans les rues de Nantes, elle s’indigne et nous entraîne vers un livre du poète Mandelstam évoquant la confiscation d’un piano à queue. Mais quand la poésie peut à nouveau retrouver doit de cité lors d’une création collective de la Maison de la poésie, elle ne peut que se réjouir. Rue des bateaux-lavoirs, elle peut alors écrire : « Buée bleutée des lessives sur les bateaux-lavoirs / Les lavandières aux mains rougies lavent les battoirs / Les corps fatiguent et les voix chantent la vie à la peine ».
Dans d’autres textes (il y en a vingt au total), Marie-Hélène Prouteau inscrit son propos dans l’histoire de la ville. Ainsi ce souvenir de Libertaire Rutigliano (19 ans) embarqué dans les vents mauvais de l’histoire, torturé puis déporté à Dachau. Mais l’histoire rejoint vite la poésie. « Deux mois auparavant, il aurait pu y faire la connaissance de Robert Desnos. Parler ensemble de poésie, de liberté. Lui, le jeune émigré qui, à quatorze ans, dans une lettre à son père, parlait de poètes romantiques et de Shakespeare ».
Il y a, enfin, dans ce livre, des souvenirs d’enfance qui remontent à la surface (comme autant de bulles à la surface de la Loire) : une excursion d’écolière dans les marais de basse-Loire ou de lycéenne aux Floralies de Nantes. Ne manquent pas au tableau, non plus, dans d’autres chapitres, le pont Éric Tabarly, la Tour Bretagne et le Lieu Unique. On sent une auteure faisant corps avec sa ville, à l’écoute de ses battements de cœur. Et pour cause : « Nantes respire à la bonne hauteur, écrit Marie-Hélène Prouteau, elle a vocation de patience. Son pas est lent, la ville fait la part des choses, indifférente aux emblèmes éphémères dont s’entiche la postmodernité»
La ville aux maisons qui penchent (suites nantaises), Marie-Hélène Prouteau, La Chambre d’échos, 80 pages, 12 euros.
 |
Olivier Cousin, |
| Les riches heures du cycliste ordinaire |
|---|
Il y a tant de manières de raconter sa passion du vélo. De Paul Fournel à Luis Nucera, les auteurs ne manquent pas. Le Breton Olivier Cousin fait aussi partie de cette cohorte (mais sur un mode mineur, celui d’un homme qui enfourche sa bicyclette bleue chaque matin pour aller au travail). Il ne s’agit donc pas, pour lui, dans son nouveau petit opus, de remonter à l’enfance, de nous faire goûter « la madeleine de Proust » des premiers pédalages et des premières chutes dans les fourrés ou sur le gravier et, encore moins, d’évoquer des passions vélocipédiques liées au passage du Tour de France.
Olivier Cousin n’est pas, non plus, celui qui regarde le passage des saisons depuis la selle de son vélo même si quelques références au printemps (des fleurs de cerisiers du Japon restées accrochées à ses cheveux) ou à l’automne (quand il roule / sans réfléchir / au cœur des feuilles tombées /des châtaigniers et des hêtres ») sont là pour montrer qu’il sait aussi renifler l’air du dehors. Non, le poète breton est plutôt là pour nous livrer ses méditations et réflexions de poète pédalant : «Le monde chavire / il ne fait pas assez attention en traversant / le monde perd l’équilibre/entre ses valeurs et ses désirs d’aller de l’avant / Le cycliste regarde ce naufrage permanent / en haut de sa selle / jamais assez rembourrée ».
Olivier Cousin nous parle aussi de lui. Il se jauge dans ses pédalées vers le lycée où il enseigne le français. « Le poète est un cycliste ordinaire / Hors au commun des modèles / Au même titre que le cycliste / est parfois un poète ordinaire ». Mais il y a chez lui l’art de tourner le dos à certaines arrogances ou postures littéraires et, en définitive, à se moquer de lui-même. « J’aime la simplicité / le concret et le cambouis /Je garde ma tenue de tous les jours / pour monter en scène / ‒ en selle, pardon ». Pas dupe, en effet, de ce « chic » qui entoure volontiers aujourd’hui la pratique vélocipédique. Il peut donc tranquillement écrire : « J’ai toujours eu tendance / à ne pas être tendance ». Ses « riches heures pédalantes » sont donc l’occasion de distiller quelques maximes ou propos goguenards. « Il n’y a jamais de pire moment / pour perdre les pédales / que lorsqu’on a la tête ailleurs » (…) La vie est simple / comme un tour de vélo / Rien ne sert de bomber le torse / il faut pédaler / un point c’est tout / en gardant le tempo ».
En écrivant aujourd’hui sur le vélo et ses pédalages quotidiens, Olivier Cousin garde le sillon qu’il a commencé à tracer dans ses précédents recueils de poèmes : jeter un regard amusé sur les grandes simagrées et grandes turpitudes du monde. Sans jamais oublier de témoigner d’une forme d’inquiétude liée au temps qui passe. Au point d’évoquer, dans un ultime poème, son propre enterrement et même de formuler certaines « directives anticipées » : être enterré près de son vélo bleu. « Il témoignera pour moi / que la roue continue de tourner ».
Les riches heures du cycliste ordinaire, Olivier Cousin, Gros Texte, 50 pages, 6 euros.
 |
Gilles Baudry, |
| Les questions innocentes |
|---|
Un poète n’est-il pas là, d’abord, pour nous interpeller sur le sens de l’existence ? À lire les poèmes de Gilles Baudry, moine bénédictin de Landévennec (Finistère), cela ne fait aucun doute. Et cela depuis longtemps. N’avait-il pas, d’ailleurs, dès 1987, donné un titre interrogatif à l’un de des livres (Jusqu’où meurt un point d’orgue ?, éditions Rougerie). Dans le court recueil qu’il publie aujourd’hui, le questionnement est permanent. Nous voici invités à méditer autour de 50 courts textes se terminant tous par un point d’interrogation.
Les questions sont limpides. Placées, pour la plupart, sous le sceau du bon sens et d’une forme d’évidence. « Tout ce qu’on a porté / aux nues / ne nous fera-t-il pas /tomber de haut ? ». Sous ces questionnements un peu « bonhommes », il y a forcément un appel à plus de sagesse et de discernement dans la conduite de nos vies. Les « questions innocentes » de Gilles Baudry sont tout sauf innocentes. « Si le temps / passe plus vite / que gagne-t-on / à vivre plus longtemps ?»
La poésie rejoint ici l’interrogation philosophique et le questionnement métaphysique. Sous la naïveté (feinte) de certaines questions on voit aussi pointer les exercices de contemplation et de méditation d’un moine à l’écoute des interrogations que lui adresse la nature elle-même. « Dorment-ils / les grands arbres / en renversant la tête / dans le lit des rivières ?» (…) « Ondoiement des collines / d’un haussement d’épaules / peux-tu te délester comme elles / du poids du monde ? » (…) « Qui sait entendre / la coda des sources / le récitatif des ruisseaux / derrière les larmes ? ».
Il y a, enfin, dans ce livre, quelques interpellations salutaires sur les dérives du monde actuel. « Propriété privée / de quoi ? / Sentier battu / par qui ? » Plus loin : « La vraie urgence n’est-elle pas / de repousser les avances de la hâte » ?
Gilles Baudry n’avait pas habitué ses lecteurs ce genre d’exercice. Mais on y retrouve, sans difficulté, ce qui anime le poète et sa manière de nous ramener à l’essentiel, « aux sources de la rêverie, de la création et du langage », comme le précise lui-même son éditeur.
Les questions innocentes, Gilles Baudry, éditions L’œil ébloui, 31 pages, 13 euros
 |
Jean Onimus, |
| Qu’est-ce que le poétique ? |
|---|
« Qu’est-ce que le poétique » ? Voilà qui ferait un beau sujet de philosophie pour le baccalauréat. L’essayiste Jean Onimus (1909-2007), lui, en a fait un livre dans lequel on entre avec bonheur, ébloui à la fois par la profondeur de la pensée et par la clarté du propos. Car Jean Onimus ne s’embarrasse pas d’abstraction ou de théories fumeuses pour souligner la nécessité du poétique dans nos vies.
Le « poétique » selon lui s’oppose au « prosaïque » (et, bien entendu, le poétique ne se limite pas à la seule poésie). Ce qu’il appelle le poétique, c’est « la constatation émue, émerveillée, mais traversée d’angoisse, de l’étrangeté d’exister ». Il dit aussi ceci : « Le poétique se dissimule partout, comme une sorte de trace presque invisible d’une innocence originelle, étonnée, admirative ». À l’opposé, il appelle « prosaïque » « tout ce qui peut être un jour technicisé, c’est-à-dire fabriqué automatiquement et indéfiniment répété ». Le prosaïque, dit-il, domine notre époque, placée sous la signe de l’efficacité, de la rentabilité. Le poétique, lui, relève de l’émotion, de l’intime. C’est l’ubac par rapport à l’adret, l’ubac ce « versant ombreux auquel on accède quand le travail s’interrompt, quand on peut rêver, contempler, se livrer aux suggestions de l’imagination, prendre possession de soi et se développer librement ».
Tous les arts, selon lui, relèvent de l’ubac. La poésie en est l’un des fleurons mais elle doit, à ses yeux, s’appuyer sur le réel, l’instant présent, viser une écriture concrète, évacuer « l’abstrait qui l’encombrerait d’idées et de sentiments ». Jean Onimus cite à cet égard, à plusieurs reprises, ses auteurs de référence : Jaccottet, Guillevic, Follain, Rilke, Giono, et même les auteurs japonais de haïku. Haro donc sur l’hermétisme et sur tous ceux qui y ont recours parce qu’ils « manquent tout simplement d’inspiration ».
Il s’agit plutôt, quand on se prétend poète, de trouver « la note juste », de cultiver « l’art de la suggestion » et, plus fondamentalement encore, de « célébrer et de contempler » car le poétique « en notre temps est, avant tout, d’inspiration cosmique ». Jean Onimus n’est d’ailleurs pas loin de penser que le poétique a aujourd’hui pris le relais du religieux car « l’exigence poétique est liée à un désir de vivre intégralement « et donc à être « attentif à la trace des dieux enfouis » (comme le disait Heidegger, inspiré par Hölderlin, lors du 20 anniversaire de la mort de Rilke).
Quant à savoir pourquoi la poésie « n’a plus guère de lecteurs », il répond : « C’est parce que nous préférons recevoir des informations plutôt que des suggestions » et qu’on nous a « habitués à une stricte cohérence conceptuelle ». Pour autant, le poétique n’a pas fini de tracer son chemin car il est « d’autant plus saisissant qu’il est presque imperceptible».
Qu’est-ce que le poétique ?, Jean Onimus, éditions Poesis, 212 pages, 18 euros.
 |
Pierre Dhainaut, |
| Un art des passages |
|---|
« C’est pour respirer moins mal que, très jeune, j’ai eu recours au poème. Ce « recours au poème », Pierre Dhainaut l’explicite dans un livre rassemblant à la fois des poèmes inédits et des textes qu’il a publiés, au fil du temps, dans différentes revues littéraires.
Le poète du Nord, aujourd’hui âgé de 82 ans, nous livre par bribes les ressorts de sa démarche poétique engagée sous les auspices du surréalisme, mouvement dont il s’est progressivement détaché. « J’ai peu à peu compris que l’approche d’une parole juste nécessitait la contestation de ce à quoi j’avais adhéré ». Cette « toute puissance du langage », Pierre Dhainaut estime qu’en réalité elle « fonctionne à vide ». Et il ajoute même : « Que devient l’ambition de changer la vie au moyen de poèmes s’ils n’agitent que des fantasmes ? ». Pas question, donc, de laisser « le beau langage » nous « étourdir » car « que vaudrait un poème s’il occultait ce qui nous oppresse, nous diminue ? »
Pierre Dhainaut est du côté du réel, du côté de la vie (« Plus je vais, moins je tolère un art qui tournerait le dos à la vie »). S’il réfute la place trop importance qu’on accorderait à l’imagination, il met tout autant en garde contre une subjectivité débridée. « La poésie n’obéit qu’à sa propre urgence. De mes émotions, de mes indignations, elle tire parti, elle les transmue ». Évoquant sa mère et les fleurs sur lesquelles elle veillait, il peut ainsi noter : « Ce qui nous tient à cœur, le poème ne le dit qu’à sa manière, détournée ».
Pierre Dhainaut croit à « l’influence bienfaisante du poème ». Pour lui, « est poète celui qui accepte de balbutier ». Comme lui-même l’a sans doute fait en privilégiant la forme poétique du fragment. L’auteur ne dit pas que « la poésie sauvera le monde » (Jean-Pierre Siméon). S’il note qu’elle est « la mal aimée, la délaissée », il estime malgré tout que nous n’avons pas à la défendre. «Nous ne convaincrons jamais ses détracteurs : insoumise, elle est la vie même ». D’où sa curiosité sans failles pour tous ceux qui, malgré des vents contraires, ont eu comme lui recours au poème : Tristan Tzara, Gérard Bayo, Max Alhau, Yves Bonnefoy, Nicolas Diéterlé… Sans parler de son admiration pour les artistes car, dit-il, « la peinture et la poésie ont les mêmes exigences ». Il s’attarde donc sur les œuvres d’Eugène Leroy, Jacques Clauzel, Alfred Manessier… « La peinture à chacune de ses apparitions, en nous obligeant à réinventer le regard, nous oblige à réinventer notre emploi du langage ». En vieux sage, séduit lui aussi par un certain Orient littéraire à la forme brève, Pierre Dhainaut peut ainsi écrire : « Trois vers suffisent / à l’essor des poèmes / ils sont tous au long cours ».
Un art des passages, Pierre Dhainaut, éditions L’herbe qui tremble, 260 pages, 19 euros.
 |
Jean-Pierre Denis, |
| Tranquillement inquiet |
|---|
Après avoir « interpellé » la forêt dans un bel et étonnant ouvrage (Me voici forêt, Le Passeur, 2015), Jean-Pierre Denis dresse ici une forme d’autoportrait d’homme « tranquillement inquiet », bel oxymore pour parler de ses doutes, de ses peurs, du sens qu’il est amené à donner à l’existence, mais aussi pour nous parler de ses rages intimes quand il voit le monde comme il tourne. Car au-delà de l’homme Jean-Pierre Denis (que beaucoup connaissent pour être le directeur de l’information de l’hebdomadaire La Vie), il y a dans ce livre une charge plutôt percutante sur les turpitudes de notre époque. Mais, chaque fois, l’auteur le fait avec cette distance amusée, cette forme d’agacement doux qui lui permet de lancer, d’emblée, à ses lecteurs cet avertissement : « Malgré tout le soin que nous apportons à leur élaboration, ces poèmes peuvent contenir quelques traces d’ironie ».
Cet homme « tranquillement inquiet » n’hésite pas, d’abord, à se moquer de lui-même et à révéler ses failles. « Je ne me sens pas de taille / À lutter à mots nus // Il me faut des gants / Une cote de mailles ». Il fait aussi cet aveu : « Je redoute mes doutes / Je les vois venir de loin / Ils ont la tête / Des mauvais jours ». Jean-Pierre Denis n’hésite pas à jouer avec les mots pour témoigner (avec humour) de ses tiraillements intimes : « Quand je tombe / Dans l’oreille d’un sourd / Nous nous entendons / Vraiment à merveille ».
Ce « moi » qui s’interroge et s’expertise se tourne aussi vers les origines, ce que l’auteur appelle « les racines », dans un chapitre du livre qu’il intitule « Autoportrait en animal besogneux ». Jean-Pierre Denis regarde (mais sans nostalgie) dans le rétroviseur, celui d’un homme dont on sait que la terre pyrénéenne colle toujours aux souliers. « Je demande à mes racines / De me révéler qui je suis / Elles m’expliquent tout au plus / L’humus qui les recouvrent ». Homme des montagnes, et donc « verticaliste », il peut donc tisser la métaphore et affirmer : « Les plaines les sermons / La tyrannie des idées plates / M’est souffrance / Ce qui ronfle et moralise ».
Car son regard est acéré sur notre époque. Parfois même abrupt, sans concession. Ainsi sa « visite à la ferme », prend vite des allures de fable ou de parabole et n’est pas faite précisément pour tomber dans l’oreille d’un sourd. Aux vers du poète breton Paol Keineg écrivant « Je renâcle devant le maïs / et les porcheries / elles sont les vraies héritières / de la terreur » (Mauvaises langues, Obsidiane, 2014), répondent comme en écho ces vers de l’homme tranquillement inquiet: « Aliments de langage / Nourriture pour le détail rentable / Poules et dindes porteuses / Vaches et veaux participatifs ». On y décèlera volontiers une féroce charge contre certaines dérives actuelles (ou à venir) visant l’espèce humaine. « Vingt-quatre heures sur vingt-quatre / Le manège tourne sur lui-même / Et la trayeuse automatique soustrait / Ses litres de contribution volontaire ». C’est clair. Sous la plume de Jean-Pierre Denis, le poème ne parle pas pour ne rien dire.
Tranquillement inquiet, Jean-Pierre Denis, Ad Solem, 141 pages, 18 euros
 |
Jean-Marc Sourdilon, |
| La vie discontinue |
|---|
Exaltations et angoisses, heurs et malheurs, fureurs et silences, émerveillements et désolations : la vie « discontinue » peut nous faire passer, on le sait, de charybde en scylla. Dans huit textes ancrés dans des expériences personnelles (existentielles, dirait-on) Jean-Marc Sourdillon nous le fait toucher du doigt et nous livre ce qu’on appelle – par facilité – des tranches de vie, des instants qui furent pour lui des moments de révélation. « Un proche qui meurt nous rappelle à l’immense. Il s’est absenté d’un coup, au beau milieu de l’été, évaporé dans le ciel bleu au sommet d’une montagne ». Il le dit, par exemple, dans un texte poignant autour d’une escapade au Puy Mary. « Oui, un bel été. De longues semaines le soleil avait été devant nous ; et soudain brutalement, il a été derrière nous »
Jean-Marc Sourdillon inscrit ses récits dans des paysages, dans des lieux que l’écriture transfigure. Parce que des images affluent. « La vie poétique consiste pour l’essentiel à se rendre disponible à la venue de certaines images, à les accueillir et à les retenir au moyen de l’écriture. Quelles images ? Celles qui, surgies de la vie, se signalent par une certaine qualité d’émotion qui fait que quelque chose s’allume en elles, qu’elles se font transparentes à la vie qu’elles nomment », notait l’auteur dans un dossier consacré à Philippe Jaccottet (Revue Lettres, printemps 2014).
Comment, d’ailleurs, ne pas penser à Philippe Jaccottet dans cette approche éblouie des lieux, quand les images surgissent dans un paysage naturel. Tel Jaccottet écrivant au col de Larche (titre d’un essai de l’auteur aux éditions Le Bateau fantôme), Jean Marc Sourdillon raconte une pérégrination dans les Cévennes du côté d’Auzillargues et de Saint-André-de-Valborgne. Une libellule le sort de sa torpeur. Puis le voici sur le « diamant brut » d’une « route ancienne taillée dans la montagne » alors que « là-bas, sous la barre argentée des rochers, c’était le torrent ». Peu à peu, l’auteur se sent comme happé, saisi, au point d’éprouver la certitude de faire partie du paysage lui-même. « Un fil tendu dans l’air » finissait par le relier aux insectes à ses pieds « en même temps qu’aux montagnes dans les lointains avec leurs nuages étalés ».
Dans un autre texte, Jean-Marc Sourdillon fait l’expérience de l’autre dans sa singularité en regardant vivre son voisin de l’autre côté de la rivière. L’homme y a son enclos, ses animaux et ses petites cultures. Et il regarde cet homme bien occupé mais si différent. « Lui dans son jardin où il bêche aux premières lueurs, moi à ma table, la fenêtre ouverte, au-dessus de la rivière ». Des regards se croisent, une forme de connivence tacite s’instaure entre hommes du matin. Chacun dans son royaume. C’est cela « la vie discontinue » de Jean-Marc Sourdillon. C’est dit à la fois avec simplicité et profondeur.
La vie discontinue, Jean-Marc Sourdillon, La Part Commune, 154 pages, 16 euros.
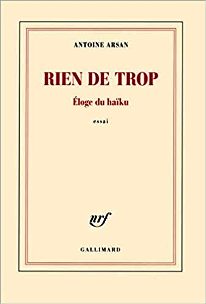 |
Antoine Arsan, |
| Rien de trop, éloge du haïku |
|---|
Encore un essai sur le haïku, direz-vous ? Le genre poétique n’en finit pas, en effet, de susciter commentaires et appréciations de toute nature. Avec le livre d’Antoine Arsan, publié dans la prestigieuse collection blanche de Gallimard, on aborde le haiku par le biais « civilisationnel », comme l’a déjà fait le Brestois Alain Kervern dans son Histoire du haïku (éditions Skol Vreizh) et dans La cloche de Gion (éditions Folle avoine).
Antoine Arsan, pour sa part, souligne la rupture entre l’époque d’Edo (qui commence vers 1600) et les temps qui ont suivi l’ère Meiji (1868-1912). Chaque période a sa façon à elle d’appréhender le haïku. Dans la première, selon l’auteur, le haïku participe profondément de la culture japonaise notamment dans sa dimension spirituelle (même si on ne peut le réduire à cela). Dans la seconde, le haïku s’ouvre au monde, s’ouvre au « je » : le poète devient véritablement le témoin des troubles de son temps, ce que n’étaient pas les ermites ou les moines pérégrins de l’époque d’Edo. « Du fonds de la pivoine /sort l’abeille / à contrecœur », écrit Bashô au 17e siècle. Tandis qu’au 20e siècle, un haïjin japonais peut écrire : « Dans un coin de mon ventre / il y a le ciel / de Pearl Harbour ».
Antoine Arsan détaille, bien sûr, dans son livre tout ce qui fait le charme du haïku : son grain, son timbre, sa tonalité si particulière, sa capacité à cultiver l’intériorité, le lâcher prise, sa sensibilité au cycle inaltérable des saisons, son humour, parfois sa trivialité, son art de la divagation et à faire « vivre l’éternité en restant terre à terre ». Tout cela été développé par de nombreux essayistes mais il sait l’exprimer avec beaucoup de talent.
La poésie occidentale est-elle « haïku-compatible » (permettez ce tic de langage contemporain) ? Difficilement, estime l’auteur, eu égard à « l’écart des cultures » du moins quand il s’agit du haïku classique. « Nous vivons dans une civilisation née d’un Dieu créateur où l’homme se perçoit comme un achèvement des espèces et se flatte de s’être détaché de la nature, ce vieux foyer de paganisme, avant de l’avoir dominée », estime Antoine Arsan. « Au Japon, où la Création ne signifie rien, la nature est sacrée depuis les origines ». Il n’y a que de rares exceptions en Occident. L’auteur souligne en particulier ces « collines, sources, bois sacrés » qui participaient de la civilisation des Celtes. Sur un autre registre, il rappelle que chez nous « le poète change l’ordre établi, on attend de lui un nouveau regard sur le monde alors que le haïku s’inscrit dans le quotidien sans relever de l’historicité ».
Ce profond fossé culturel amène Antoine Arsan à considérer que le poème court peut être cet« avatar du haïku » parce que « plus accessible, moins ambitieux que le haïku, il est à, la fois école de légèreté et apprentissage permanent, long cheminement qui permet l’errance du regard jusqu’à rencontrer le caillou blanc ». Et il cite à tire d’exemple ce poème court d’Octavio Paz : « Crépuscule / l’oiseau sur la clôture / un contemporain ».
Cet « éloge du haïku » maintient donc surtout le haïku dans le terreau qui l’a vu naître, ceci en dépit d’un constat que l’on peut faire aujourd’hui : la mondialisation galopante de ce genre poétique.
Rien de trop, éloge du haïku, Antoine Arsan, Gallimard, 95 pages, 11 euros.
 |
Jean-Luc Le Cléac’h, |
| Poétique de la marche |
|---|
S’il avait vécu au Japon au 17e siècle, Jean-Luc Le Cléac’h aurait pu être un disciple de Bashô, ce poète marcheur auteur de La sente étroite du bout du monde. Chez les deux hommes, le même amour de la pérégrination, de la lenteur, de la méditation. Mais Jean-Luc Le Cléac’h vit en Bretagne au 21e siècle. Et alors que Bashô s’exprimait sous la forme courte du haïku, l’auteur breton, lui, raconte dans une prose élégante, ce qui l’enivre dans cette découverte des paysages permise par la marche au long cours.
Chez l’auteur japonais comme chez l’auteur breton, en tout cas, une forme de « sobriété heureuse », non seulement culinaire (le bol de riz pour l’un, les biscuits et la thermos de thé pour l’autre) mais surtout spirituelle qui les amène à porter attention au plus minuscule ou au plus insignifiant rencontré au bord du chemin. « La marche, avec la lenteur relative qui l’anime, est inséparable du détail sous toutes ses manifestations, note Jean-Luc Le Cléac’h, mais dans le même temps ou presque, l’œil et l’esprit se hissent jusqu’à l’infini, happés qu’ils sont par une étendue du territoire qui se laisse découvrir depuis une hauteur, ou plus simplement, par le ciel qui apparaît à la fois proche et immense ».
Ce microcosme et ce macrocosme, l’auteur breton les mesure dans leur plénitude sur les sommets « bossus » d’Alsace ou d’Auvergne, dans les collines d’Europe centrale, mais plus encore sur les sentiers côtiers de Bretagne, à commencer par ceux du Cap Sizun qu’il affectionne plus que tout. « à chacun ses Amazonies : les miennes se tiennent à l’extrême pointe de la Bretagne, dans les vallons insoupçonnés du Cap Sizun ». L’auteur, né à Concarneau, vit dans le Pays bigouden. Il est ici en pays de connaissance, mais n’en finit pas de déchiffrer (défricher ?) son territoire. Son « terrain de jeu » comme il l’appelle.
Qu’il y ait une « poétique » de la marche, cela va donc de soi pour Jean-Luc Le Cléac’h. Mais « s’agissant de la marche, affirme-t-il, il n’est de règles ou de conventions que celles que nous nous donnons, que nous élaborons au gré de nos randonnées et de nos humeurs ». D’où le côté discursif de son propos, nous entraînant par des chemins buissonniers, vers une approche émerveillée du monde. Jean-Luc Le Cléac’h s’arrête, renifle, savoure. Il nous parle l’odeur sucrée de l’ajonc en fleur avant de nous entraîner dans une réflexion toute philosophique sur « l’horizontalité » de tel paysage et sur « l’apaisement » qui en découle. Marcheur-philosophe (à la manière d’un vieux sage), marcheur-lecteur aussi par cet art de la « digression », du « détour », de « l’écart ».
On se dira, malgré tout, pourquoi encore un livre sur la marche (après ceux de Jacques Lacarrière, Bernard Ollivier, David Le breton, Pierre Sansot et tant d’autres) ? N’a-t-on pas tout déjà dit sur le sujet ? Jean-Luc Le Cléac’h rétorque : « Peut-être parce que le plaisir de la marche, la sensation de légèreté, parfois même le bonheur qui nous traverse, ce serait une forme d’égoïsme coupable de le garder pour soi seul, de ne pas essayer de la faire partager ». Goûtons donc, sur ses pas, ce plaisir partagé.
Poétique de la marche, Jean-Luc Le Cléach, La Part Commune, 142 pages, 15 euros.
 |
Christine Guénanten, |
| De la nécessité du poème |
|---|
Christine Guénanten est une heureuse exception dans le paysage poétique breton. Peu d’auteurs écrivent comme elle et certains pourraient être enclins à considérer son écriture complètement désuète. Voire mièvre et au ton compassé. D’un autre temps, en somme. Sans compter qu’elle n’est pas là pour décrire la noirceur du monde (comme la mode le veut tant aujourd’hui) mais, bien au contraire, pour s’émerveiller, dire le beau et le vrai. « Ne te laisse pas englober/par la gorge du monde/contente-toi/de la contemplation », nous dit Christine Guénanten.
Il y a, chez la poéte bretonne, quelque chose de Maurice Carême écrivant « Je n’aurai mangé que mon pain / Respiré que mes seuls rosiers » (Et puis après, Arfuyen 2004). Quelque chose aussi d’Anne Perrier écrivant « Un trèfle frais / plein de galops flamboyants / m’appelle » (Feu les oiseaux, 1975). Christine Guénanten répond, elle aussi, à des appels. Ceux des fleurs, des nuages, des oiseaux, des libellules, des papillons… Elle a, en permanence, un jardin enchanté devant les yeux, comme l’avait à sa manière Emily Dickinson. On discerne, en effet, une forme de parenté spirituelle – à un siècle de distance – entre les deux femmes. « Voir le ciel d’été / C’est Poésie, bien qu’elle ne se trouve jamais dans un livre », écrit la « dame blanche » d’Amherst (Ainsi parlait Emily Dickinson, Arfuyen, 2016). « La perle du poème /est dans le ventre doux / des nuages de laine », écrit, comme en écho, Christine Guénanten.
La « nécessité du poème », qui donne son titre à ce livre, est donc une évidence. Mais Christine Guénanten ne recourt pas à l’essai savant pour le dire. Ses poèmes parlent pour elle. Pas de démonstration, pas de grands mots, pas de plaidoyer pro domo. Simplement cet aveu. « J’étais faite de fleurs /j’avais sans le savoir / un jardin dans les yeux ». Ce qui l’intéresse, c’est d’inventer, face à la solitude et aux tourments du cœur et de l’âme, un « monde léger », de trouver une feuille où « reposer ses yeux », de suivre le vol d’un papillon (« voyelles colorées / au-dessus de l’ennui »), de trouver le bonheur « entre une primevère /et un premier bourgeon ».
Charles Le Quintrec, Antony Lhéritier, Hélène Cadou appréciaient sa poésie simple et fraîche, teintée d’innocence, portant un regard naïf d’enfant sur le monde. Christine Guénanten voit « la vie / en folle averse d’hirondelles ». Elle voit dans l’aube « l’habit de l’âme », mais constate « le peu d’amis fidèles / au rendez-vous des fleurs ». Elle n’hésite donc pas à interpeller ses « frères » poètes si éloignés d’elle aujourd’hui. « Où est la douceur, la tendresse / que vous portez entre vos lignes ». Elle va même plus loin : « Poètes, poètes, je vous fuis ! / Vous êtes loin (…) / De mes enchantements d’étoiles ».
De la nécessité du poème, Christine Guénanten, préface de Jean Lavoué, Des sources et des livres,108 pages, 12 euros. Le livre peut être commandé à Des sources et des livres, 2, rue de la fontaine, 44410 Assérac (3 euros de frais de port)
| Retrouvez les publications Des Sources et des Livres |
 |
Gilles Baudry et Nathalie Fréour, |
| Un Silence de verdure |
|---|
Le « silence de verdure », dont il est question ici, est-il celui de l’enclos monastique ? Cela paraît ne pas faire de doute sous le plume du poète Gilles Baudry, moine de l’abbaye bénédictine de Landévennec (Finistère) dont les poèmes s’accordent aux superbes dessins en noir et blanc de la peintre et illustratrice nantaise Nathalie Fréour. « On vit ici / en compagnie des arbres / l’ailleurs / est-il si loin ? », écrit le moine-poète. « Il est beau le silence / dès qu’il se met à rayonner ». Si la verdure est là, omniprésente dans cette thébaïde au fond de la rade de Brest, c’est pour « vous mettre de plain-pied / avec le ciel », note encore le poète.
Gilles Baudry écrit là où il vit. Là où il prie et rend la louange. La « dormance du sous-bois » et les « sentiers forestiers » proches de l’abbaye, il les connaît par cœur tout comme « le chant insulaire du vent dans les arbres ». Dans ce « cloître végétal » qui jouxte le monastère, il s’extasie sur « les reflets de pourpre des érables », « les tendre aubiers », « la rouille des lichens », les « ramures de corail », les « accords subtils des bruns, des verts ». Oui, « déchirante beauté / à ciel ouvert / même le vent / retient son souffle ».
Les dessins de Nathalie Fréour sont au diapason pour exprimer, dans un trait épuré, le « sous-bois voûté » ou « l’abside végétale ». Éloquente rencontre d’une artiste et d’un poète dans cet exercice de contemplation qui trouve sa source dans le « chant » de la « sève ».
Mais se cantonner à l’enclos monastique et à son auréole végétale serait forcément réducteur. Si le poète nous parle de l’arbre et du silence, c’est pour nous inviter à « communier sous les espèces / de la vie simple ». Il fait même cette exhortation (à lui-même et à ses lecteurs) : « Laisse la sève / infuser le silence / et irriguer les veines de ton âme ». Et lance cet autre appel : « N’est-il pas temps / de reboiser / nos terres intérieures » ?
Entre sentences, aphorismes, pensées et méditations, le texte poétique de Gilles Baudry résonne en forêt profonde, comme un écho (venu du fond des âges) sur les mystères qui nous entourent et bruissent dans les feuillages. « Dans le visible / se cache l’invisible ». Le moine poète sait nous le révéler avec talent. Et la femme artiste aussi.
Un silence de verdure, poèmes de Gilles Baudry, dessins de Nathalie Fréour, éditions L’enfance des arbres, collection Poésie et intériorité, 107 pages, 15 euros et 3 euros de frais de port (l’ouvrage peut être commandé à Jean Lavoué, L’enfance des arbres, 3, place Vieille Ville, 56700 Hennebont)
 |
Marie Le Gall, |
| Mon étrange sœur |
|---|
Voilà un livre « dont on ne sort pas indemne ». L’expression, certes, est convenue. Mais n’hésitons pas à l’utiliser pour parler de Mon étrange sœur, le troisième ouvrage de Marie Le Gall.
L’auteure nous avait déjà profondément touché (et remué) en racontant La peine du menuisier, ce livre qu’elle avait consacré à son père taiseux et à sa famille dans le Brest du milieu du siècle dernier (Phébus, 2011). Voici qu’elle creuse à nouveau l’héritage familial en évoquant la figure de cette « étrange sœur » plus âgée qu’elle de dix-neuf ans et qui connut – sa vie durant – une forme de handicap mental (de l’extravagance nourrie de tourments) dont les symptômes iront en s’accentuant au fil des ans.
Tout dans ce « roman » (autobiographique) est d’une profonde justesse. Marie Le Gall parle d’un vécu et d’une douleur incommensurable. Elle arrive, par la grâce et la précision de son écriture, à nous faire véritablement appréhender les tréfonds de la détresse humaine. « Les adultes dorment. La nuit les emporte comme les maisons ou le village entier avalé par les ombres. Certains enfants veillent, c’est leur devoir. Dans ce lieu devenu une sorte d’isoloir, j’avais la certitude que je pouvais empêcher le naufrage d’une famille trop souvent et si injustement en danger ».
Nous sommes dans le Finistère. Du côté de « Brest-même », des campagnes et des bourgs environnants. L’auteure montre sa profonde imprégnation des lieux et truffe son texte d’expressions « bien de chez nous ». Un parler populaire qu’elle retranscrit avec bonheur. « Et maintenant, la p’tite qui imite la grande ! Hopala ! La pov’mère, elle n’est pas arrivée avec ces deux-là ! Y’en a qu’ont des croix à porter, ma Doué, disait Jo Fourn ». Le rivage est proche. On s’y rend volontiers quand on est brestois, de préférence sur la côte sauvage du Nord-Finistère. « La mer s’en va si loin qu’on peut la confondre avec le ciel (…) Les dunes de Sainte-Marguerite sont vastes et hautes, qu’on ne voit pas la deuxième qui cache la troisième puis la quatrième et ainsi de suite ».
Ces séquences sont comme autant d’occasions pour reprendre de souffle dans un récit qui vous prend à la gorge. Comment aider (aimer) cette Sœur qui n’est pas comme les autres. Cette sœur que Marie Le Gall anoblit en lui donnant une majuscule mais qui connaîtra, très jeune, le semi-enfermement puis l’enfermement. En hôpital psy, en établissement tenu par des religieuses, et même en maison de retraite. Parcours chaotique fait de départs puis de retrouvailles s’espaçant au fil des ans… La maladie de la Sœur, d’ailleurs, n’est pas explicitement nommée et l’accès au dossier médical impossible malgré tous les efforts de la jeune sœur.
Ce roman est d’une grande noirceur. Il est empreint d’une profonde tristesse et d’un profond désarroi. Mais l’amour de deux sœurs l’une pour l’autre domine ce naufrage. Dix-neuf années les séparent. Et l’une « pourrait » même être la mère de l’autre.
Mon étrange sœur, Marie Le Gall, Grasset, 215 pages, 18 euros.
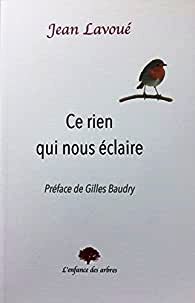 |
Jean Lavoué, |
| Ce rien qui nous éclaire |
|---|
Il a écrit des livres sur Grall, Perros et Lamennais… Il est l’auteur d’essais proposant une compréhension nouvelle du christianisme. Mais Jean Lavoué est aussi poète. Il a déjà fait paraître plusieurs petits recueils, notamment aux éditions La Porte. Voici qu’aujourd’hui il publie Ce rien qui nous éclaire dans une petite structure d’édition (« L’enfance des arbres ») qu’il vient lui-même de créer.
On peut aborder la poésie de Jean Lavoué sans rien connaître des élans (spirituels) qui l’animent et découvrir avant tout, dans son livre, l’incantation d’un homme qui s’est mis « à l’écoute des troubadours » (comme le note très justement Gilles Baudry dans la préface). Bon nombre de poèmes, en effet, pourraient être mis en musique. Parce qu’ils ont du rythme, parce qu’ils sont cadencés, parce qu’ils célèbrent le monde. « Aux ailes d’un oiseau / Remontant les courants / J’ai ouvert ma maison / Il a fait passer sur mes jours / Un grand torrent d’eau vive ». Le poète nous laisse entrevoir un monde gagné par la beauté (cette beauté célébrée par François Cheng). « Retrouve en toi la splendeur des saisons / Accorde toi de marcher / à l’amble de ton chant secret ».
Mais on peut aussi aborder la poésie de Jean Lavoué en y décelant les traces de l’héritage spirituel qui est le sien et qui trouve sa source dans la pensée de l’écrivain et prêtre breton Jean Sulivan. Ces « marqueurs » se nomment l’exode, les marges, l’intériorité. Et le poète déploie son chant à l’aune de ces balises qui lui sont familières.
L’exode. « Si tu veux écrire / Pars / Quitte tes habitudes / Tes ferveurs routinières / Prends ton bâton de pèlerin / Trouve ta solitude / Adresse-toi au vent / à la pluie / Aux grands espaces / Au soleil.
Les marges. « Poème après poème / Je plante une forêt / Dans les trouées du monde / J’y convoque en secret / Les oiseaux de ma race / J’y butine des aubes ».
L’intériorité. « Si le silence t’échappe / Échappe-toi avec lui ! / Suis le premier oiseau / Écoute bien son chant / Comme il résonne en toi d’un amour infini »
Plus foncièrement encore, il y a chez l’auteur cette remise en cause d’une transcendance surplombant l’homme, et l’aliénant, comme il l’avait déjà exprimé dans son Évangile en liberté (Le Passeur, 2013) et La Voie libre de l’intériorité (Salvator, 2012). On peut donc lire, sous sa plume, ces vers que ne renierait pas Christian Bobin. « Aucun accord / Ne se fera d’en haut / Aucune puissance ne descendra des cieux / C’est du très-bas que naissent les prairies / que s’allument au printemps des bouquets de jonquilles ». D’où, en définitive, « ce rien qui nous éclaire ». Et que l’auteur décline au fil des pages.
La poésie de Jean Lavoué est une poésie d’exhortation. Presque didactique. L’impératif domine dans de nombreux poèmes (« Accueille en toi l’étincelle », « Ouvre grand » « Invente un jour neuf »). Elle s’incarne aussi dans un pays. Le poète signe ici son attachement à la Bretagne dans un chant qui rappelle celui de Xavier Grall. « De grèves et de rivières / Bretagne familière / Tu ressembles au pays dont j’ai souvent rêvé ».
Ce rien qui nous éclaire, Jean Lavoué, L’enfance des arbres, 153 pages, 13 euros. L’enfance des arbres est, au départ, un blog que Jean Lavoué alimente avec ses propres textes, des textes de poètes amis et des photographies d’arbres (www.l’enfancedesarbres.com). Contact : Jean Lavoué, 3, place Vieille ville, 56 700 Hennebont.
 |
Jacques Josse, |
| Chapelle ardente |
|---|
Jacques Josse aime raconter les bistrots et les vies cabossées. Sa Chapelle ardente s’inscrit dans cette lignée. Un patron de bar vient de mourir. Ses clients et amis s’inclinent devant sa dépouille et revisitent leur passé commun. Le cercueil n’est pas posé dans une anonyme chambre funéraire mais au cœur du bistrot lui-même.
« Je ne suis qu’un philosophe de comptoir », affirmait le poète et écrivain rennais dans un entretien avec Pascal Rougé (éditions Le Temps qui passe, 2013), « un type qui essaie de capter des morceaux de vie ordinaire. Je côtoie, j’écoute, je regarde. J’éprouve de la sympathie pour tous ceux dont on sent la fragilité mais aussi l’envie de lutter, de ne pas s’en laisser compter, de ne jamais abdiquer ».
Ces hommes, à la fois fragiles et déterminés (un peu « grandes gueules »), on les avait rencontrés au bar « Chez Pédro » dans son livre Cloués au port (Quidam éditeur, 2011) ou encore au Café Rousseau (La Digitale, 2000). Dans Chapelle ardente, nous sommes au bar nommé « La Iza », et également, comme dans d’autres récits de Jacques Josse, à proximité de la mer et non loin d’une falaise. C’est là que le Barbu, patron du bar, a accidentellement trouvé la mort (« L’ankou en maraude sur la grève cette nuit-là… »). Ce pays que ressasse dans ses récits Jacques Josse, c’est le Goëlo, un territoire natal abordé également dans un livre plus intimiste (Liscorno apogée 2014). Le vent ici « souffle en rafales », « les chiens gueulent dans les fermes », et « une étrange sérénade » provient des porcheries. La nuit on aperçoit « le faisceau lumineux du phare des Roches-Douvres ».
Dans cette chapelle ardente qui paraît, soudain, comme isolée du monde, « le bistrotier est un beau mort ». Ses amis sont là : Morellec qui a combattu en Indochine, Le Her qui aligne une dizaine de tours du monde, Eugène M. qui fut terre-neuvas, Didier Pouilly « l’ancien cascadeur aux jambes mortes », Pierrot Le Loup ex-cheminot, Pitbull instituteur à la retraite… Galerie de portraits hauts en couleurs, dont le parler franc n’a d’égal que la capacité à avaler moult pintes de bière. On disserte sur le temps révolu, sur les chantons que le Barbu aimait (Richtie Valens, John Lee Hooker, Bob Dylan…)
On décharge surtout son chagrin à coups de trait d’humour noir. « De toute façon, dès ce soir, affirme un des veilleurs du mort, « le patron commencera à vieillir en fût de chêne et ce sera à nous de veiller sur lui pour qu’il continue à se bonifier dans les mémoires ». Écoutant ces mots, comment douter de la nécessité d’une « philosophie de comptoir » ?
Chapelle ardente, Jacques Josse, éditions Le Réalgar, 43 pages, 8 euros.
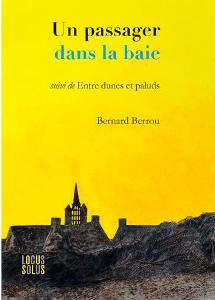 |
Bernard Berrou, |
| Un passager dans la baie |
|---|
Le livre de Bernard Berrou Un passager dans la baie vient d’être réédité dans le Finistère. Il avait été publié en 2005 par les éditions La Part Commune à Rennes. Voici la lecture que j’en avais faite, à l’époque, dans le journal Ouest-France. Son très beau livre reparaît aujourd’hui « augmenté » d’un texte également admirable intitulé « Entre dunes et paluds ».
Quel souffle ! Quelle puissance d’évocation ! On sort ravi de la lecture du dernier livre de Bernard Berrou. L’arpenteur de chemins irlandais est revenu, cette fois, sur les pas de son enfance. Dans un autre bout du monde, le voici en baie d’Audierne, face au rugissement de l’océan. C’est là qu’il vit aujourd’hui « dans une contrée indécise entre la mer et la campagne » et un pays qui « renferme cent fois plus d’ossements dans ses entrailles que d’habitants ». Il y a, en effet, quelque chose d’archéologique dans ce récit.
Bernard puise, dans les bosquets et les paluds, la sève qui monte de son enfance. Il y a aussi, ici, quelque chose de primitif. « La civilisation, écrit-il, nous apprend à nous arracher à nous-mêmes, à nous soumettre à un conformisme ambiant. La baie d’Audierne a plus à nous révéler que mille débats intellectuels ». Bernard Berrou reprend donc les chemins buissonniers du pays, franchit les barrières et nous livre, au bout du compte, sa « réserve intime ».
On retrouve parfois, chez lui, les intonations de l’Écossais Kenneth White et, encore plus, de l’Irlandais Seamus Heaney. Il nous parle sans afféterie, et loin des clichés, d’une Bretagne qui lui colle à la peau. « Avant de lire les livres, j’ai connu la lecture des talus, des chemins creux, des branches, des visages anciens et des horizons hallucinés ». Aujourd’hui, à tout moment, la rumeur de la mer sert de caisse de résonance à son récit. Bon Dieu, quel beau livre !
Un passager dans la baie, suivi de Entre dunes et paluds, Bernard Berrou, préface de Alain-Gabriel Monot, Locus Solus, 144 pages, 12 euros.
 |
Gérard Le Gouic, |
| Passant |
|---|
La jaquette noire de son nouveau recueil annonce – si j’ose dire – la couleur. Gérard le Gouic, qui nous avait livré, en 2016, un nostalgique J’aimerais que quelqu’un (éditions Telen Arvor), affronte cette fois, de front, la question de la mort. Il le fait par le biais d’aphorismes, de sentences ou de courts poèmes. Sans pesanteur, avec ce détachement amusé, souvent grinçant, voire ironique, qui signe l’écriture du poète breton. Pour le dire, il propose un triptyque sur le cimetière (intitulé « Enclos »), sur un disparu s’adressant aux vivants (« Passant, ») et, enfin, sur le veuvage (« Éloge des veuves »).
Il y a chez Le Gouic quelque chose de La Rochefoucauld dans ces maximes percutantes qui parsèment son recueil. Morceaux choisis : « On mesure sa solitude au nombre de tombes à fleurir », « Un pays meurt quand ses cimetières se dépeuplent », « Le veuvage idéal serait sans défunt. La veuve a toutefois besoin des pompes et des colifichets de l’absence ».
C’est une cohorte de veuves plutôt joyeuses, débarrassées des lourdeurs d’un mari encombrant, que nous fait entrevoir le poète. Et il n’y va pas de mainmorte. « Une veuve se reconnaît de loin ; des ailes la déplacent », « La douleur est publique, la satisfaction intime », « Le veuvage n’est pas seconde naissance d’une femme, mais véritable première ». Cet « éloge des veuves » ne manque pas de sel sous la plume d’un homme aujourd’hui veuf et qui trouve ici, sans doute, les moyens de masquer son profond chagrin. « Le veuf est un mort qui s’est ravisé », écrit-il.
Son chapitre « Passant, » est, par contre, d’une tonalité presque biblique. On pourrait le rattacher à certaines intonations du Livre de l’ecclésiaste (« Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel / Un temps pour enfanter et un temps pour mourir »…) Le Gouic, lui, écrit : «Passant, / Consulte l’horloge / Que je te dévoile ici / Seule la mort / Accorde au temps sa nudité ». Ou encore ceci : « Passant, / Je déclarais que je n’étais rien / J’avais raison », « Passant, / Je relève ton défi / Sache avant / Que ma distance favorite est l’éternité »
Le Gouic a décidément l’art d’aborder, à la fois avec gravité et légèreté, ce grand âge que le poète Claude Roy qualifiait « d’hiver de la vie ». Son regard, fut-il mordant et un brin désespéré, nous est utile.
Passant, précédé de Enclos suivi de Éloge, Gérard Le Gouic, Telen Arvor, 87 pages, 9 euros.
 |
Anne-Lise Blanchard, |
| Le soleil s’est réfugié dans les cailloux |
|---|
Mettre des mots sur les maux. Les chaos du monde contemporain mobilisent aujourd’hui des poètes. Une forme de poésie engagée refait surface ici et là. Dans Bleu naufrage, élégie de Lampedusa (éditions La Sirène étoilée) le Rennais Denis Heudré a ainsi voulu rendre toute leur dignité aux migrants disparus en mer, faire part de sa propre émotion devant les drames actuels en Méditerranée (« La mer, même pas en deuil / arbore son bleu des beaux jours ») et aussi dénoncer l’impuissance ou l’indifférence du monde occidental. Cette forme d’engagement on la trouvait aussi chez Yvon Le Men après les terribles catastrophes subies par l’île d’Haïti (Sous le plafond des phrases, éditions Bruno Doucey, 2013).
Les guerres cruelles qui sévissent aux quatre coins de la planète suscitent aussi le sursaut. à commencer par la guerre en Syrie qui amène Anne-Lise Blanchard à prendre fait et cause pour les chrétiens d’Orient. Elle le fait à la suite de déplacements sur place dans le cadre d’une organisation humanitaire œuvrant précisément pour ces chrétiens persécutés. En août 2014, elle découvre ainsi les villes fantômes de Gousaye, Homs et Maaloula. « Cette dernière, rappelle-t-elle, est une bourgade syrienne connue du monde entier parce qu’on y parle encore la langue du Christ, l’araméen ».
Dans son livre, des phrases en italique sont placées en regard des poèmes. Elles émanent de témoignages recueillis sur place, en Syrie, au Liban ou au Kurdistan irakien, se faisant à la fois l’écho des déclarations guerrières des milices islamistes (à commencer par Al Nosra, la branche syrienne d’Al Qaïda) et de la volonté des chrétiens de pouvoir revivre un jour sur la terre de leurs ancêtres. « Ce sang répandu, il me fallait en rendre compte, comme de la dignité et de la spiritualité vivante », explique le poète.
Les poèmes d’Anne-Lise Blanchard sont lapidaires, épurés, comme si la guerre entraînait aussi les mots à trancher dans le vif. « Sous les gravats / un dessin d’enfant / page froissée / d’une frêle vie / dont les murs / ne recueillent plus/les rires ». Pour Cristina, 3 ans, arrachée des bras de sa mère par les djihadistes, elle écrit cette berceuse : « Le jour s’est fait nuit / nuit de longue prière / chante mes entrailles / sans commencement sans fin / berçant l’abîme / de ton petit corps / Cristina mon bébé / fleur oiseau / l’impossible trace / qui se dérobe / dans l’innommé ».
Le sort des enfants, de bout en bout, bouleverse le poète. « Sans fracas les enfants d’Alep / se faufilent entre les brûlures / venues du ciel ». Anne-Lise Blanchard cite Nelly Sachs et Anna Akhmatova. Elle se met dans leurs pas pour témoigner de l’horreur et tenter de soulever les consciences. Livre coup de poing. Mais où pointe, malgré tout, l’espérance. « Le rebond / d’un ballon / à Qafrun / et c’est l’été recommencé ».
Le soleil s’est réfugié dans les cailloux, Anne-Lise Blanchard, Ad Solem, 105 pages, 16,90 euros.
 |
Xavier Grall, |
| Les billets d’Olivier |
|---|
Relire Xavier Grall : l’écrivain, le poète, le journaliste. Mais aussi le chroniqueur. Pendant plus de dix ans (de 1972 à 1981), il a livré chaque semaine de courts textes à l’hebdomadaire La Vie catholique sous le titre « Chronique du Logeco » (avant son retour en Bretagne) puis « Les Billets d’Olivier », enfin « Les vents m’ont dit ». Ces chroniques ont largement contribué à construire sa réputation d’écrivain au-delà des cercles principalement intéressés par sa poésie. Elles ont fait de Grall un écrivain « populaire » (au bon sens du mot) que tout le monde pouvait lire (et comprendre) en feuilletant l’hebdo catholique. Ce rendez-vous était attendu par des nombreuses familles bretonnes puisque Grall parlait à ces lecteurs de ce pays où il revenait vivre après des années parisiennes passées du côté de Sarcelles. Saluons-donc la réédition de ces Billets d’Olivier par les éditions Terre de Brume (1).
Ce qui y domine, à l’évidence, c’est le retour aux racines, le bonheur de humer un terroir par tous les pores de la peau, de voir grandir ses « divines » (cinq filles) sous le soleil capricieux ou les vents hurlants de la Cornouaille. Son point d’ancrage (son « royaume »), à partir de 1974, sera le hameau de Botzulan « dans la campagne de la belle Aven, au pays du cidre et de l’hydromel ».
Xavier Grall nous invite, durant toutes ces années de grande effervescence culturelle et politique en Bretagne, à partager ses joies et ses humeurs. à mesurer aussi, au détour d’un billet, les difficultés d’une vie d’écrivain et journaliste freelance : « Mes filles, que mettrai-je donc dans vos sabots ? Ces jours sont rudes qui ne savent pas où nous serons demain. J’ai attendu des droits d’auteur qui ne sont pas venus. Que mettrai-je dans vos sabots ? » (19 décembre 1973).
Mais il y a, autour de lui, foisonnant, la nature qui apaise, cette « Cornouaille préservée, secrète et bocagère » qu’il arpente. Il y a aussi ces « moissons d’amitié » qu’il engrange « au doux grenier de la mémoire ». Il y a, surtout, le cercle familial : les filles qui grandissent et qui commencent, pour certaines, à prendre leur envol. « Ah, les temps passants ! Mais n’est-ce pas nous qui passons ? » Demeurent les saisons. « L’été fut splendide et l’automne somptueux. Ne nous plaignons pas. Soumettons-nous à la loi des saisons. Au temps de la lumière et des couleurs succède celle de l’ombre. Et de la méditation » (3 décembre 1975).
Relisons Grall. Ces billets ont gardé tout leur « jus ». Ils nous parlent d’amour, d’amitié, de fraternité, de complicité avec les plantes, les fleurs, les bêtes. C’est d’abord un poète qui parle.
Les Billets d’olivier, Xavier Grall, préface de Alain-Gabriel Monot, éditions Terre de brume, 180 pages, 17 euros.
De l’œuvre de Xavier Grall, les éditions terre de brume ont déjà réédité L’inconnu me dévore (préface de Alain-Gabriel Monot), Barde imaginé (préface de Marc Pennec), La fête de nuit (préface de Bernard Berrou), Africa Blues (préface de Pierre Tanguy), Arthur Rimbaud ou la marche au soleil (préface de Marc Pennec), Cantique à Melilla (préface de Pierre Tanguy), Mémoires de ronces et de galets (préface d’Erwan Vallerie)
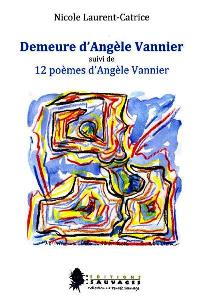 |
Nicole Laurent-Catrice, |
| Demeure d’Angèle Vannier |
|---|
On célèbre cette année le 100e anniversaire de la naissance d’Angèle Vannier. Née en 1917 à Saint-Servan, elle décédera en 1980 d’une attaque cérébrale. Le souvenir de la « poétesse bretonne » reste vivace chez de nombreux fidèles de son œuvre, à commencer par la rennaise Nicole Laurent-Catrice qui lui consacre un court essai à l’occasion de cet anniversaire.
Il faut dire que la destinée – à la fois humaine et poétique d’Angèle Vannier – n’est pas banale. Élevée par une grand’mère jusqu’à l’âge de huit ans (à Bazouges-la-Pérouse), elle deviendra aveugle à l’âge de 22 ans suite à un glaucome opéré sans succès. « Une fille qu’avait perdu ses yeux / traînait son cœur, traînait sa peine / Sous le grand ciel du Bon Dieu » (Choix de poèmes, Seghers, 1961). Ses talents de poète la conduiront aussi à côtoyer un certain gotha parisien du côté de la célèbre brasserie Lipp. Elle fera la connaissance de Paul éluard « qui la tient en très grande estime, raconte Nicole Laurent-Catrice, et préface son premier recueil L’arbre à feu. » Elle fréquentera aussi Édith Piaf, Catherine Sauvage, Suzy Delair, « pour qui elle écrit des chansons ».
La poésie d’Angèle Vannier est marquée du sceau du surréalisme. Ce courant littéraire marque l’époque. Place au magique, à l’imaginaire, au fantastique, aux mythes… Enracinée dans sa Haute-Bretagne (malgré ses allées et venues à, Paris), Angèle Vannier est « en prise directe sur les grands mythes aussi bien gallois que du roman breton ». Brocéliande est là à portée de main et de cœur. Elle plonge avec délice dans cet un univers féerique. à plus forte raison quand ses héros mythiques partagent une part de sa destinée (Le barde Merlin n’était-il pas aveugle ?). Elle célébrera notamment la grande forêt arthurienne dans son dernier recueil Brocéliande que veux-tu ? (Rougerie, 1978).
« De la Bretagne, Angèle Vannier a le goût des rêves, des paroles magiques, des légendes de mort et des rites auprès des fontaines ou menhirs », note encore Nicole Laurent-Catrice. « Elle entretient cette réalité équivoque avec la réalité, l’amour, la terre ». Ce qui n’en fait pas, pour autant, une « poétesse bretonne ». Femme poète, certes enracinée, mais avec «une ouverture sur d’autres cultures, d’autres époques et sur le cosmos». Angèle Vannier fera des émissions de radio, s’exprimera sur de nombreuses scènes en Bretagne (Rennes, Hédé…) souvent en compagnie du harpiste Myrrdhin qui démarrait sa grande carrière de musicien. «Aveugle chaque jour j’entre dans mon miroir/Comme un pas dans la nuit comme un mort dans la tombe / comme un vivant sans cœur dans un cœur de colombe ».
Demeure d’Angèle Vannier, Nicole Laurent-Catrice, suivi de 12 poèmes d’Angèle Vannier, Les Editions Sauvages, 56 pages, 10 euros.
 |
Claude Albarède, |
| Le dehors intime |
|---|
Claude Albarède sur le Causse. Un homme arpente son pays. En quête de signes, d’empreintes d’un temps révolu. Des mots surgissent : « source », « vent », « garrigue », « sentier », « buisson », « village », « herbes », « pierres »… Nous sommes sur le Causse du Larzac, le pays intime du poète Claude Albarède (80 ans).
« Bois tombé branches mortes/un fagot plein de souvenances/mais le feu ne prend pas », écrivait le poète en 2009 dans le recueil Résurgences publié en Bretagne par Yves Prié (Éditions Folle Avoine). Le même chant lancinant s’élève de son nouveau livre, si bien nommé Le dehors intime. Car le dehors exprime – inexorablement – ce que l’auteur ressent au fond de lui-même. « Le temps erre et ne passe pas/nous partons, revenons, tentons d’atteindre/parmi les ruines la vie qui dure/Leur pauvreté nous dépossède/elles n’ont d’intime que le dehors perdu ».
Voici les villages fossiles, les espaces retournés à la friche. Voici les « copains disparus » à qui Claude Albarède dédie l’un de ses poèmes. « à peine sommes-nous congédiés/que nous nous attablons à la même mémoire/tisonnant l’amitié/réanimant les mots ». Mais il y a – de ci de là – tous ces signes d’une vie cachée qui ne rend pas les armes. « Maisons en ruines/leurs petits jardins/continuent de pousser ». Plus loin : « En hiver/près des sources/des retours de violettes ».
Ce n’est donc pas une nostalgie béate qui parcourt ce recueil. Le propos du poète n’est pas de faire une simple lecture dans le rétroviseur. S’il persiste à arpenter ce pays aux grands espaces et porteur de tant de mémoires, c’est pour mieux distiller – l’âge venu – quelques graines de sagesse. « Ne pas souiller/ni ajouter/trop de poids/au silence ». Ou encore : « Gagner le large/du plus secret/nicher l’immense/au plus intime ». Comment ne pas penser, ici, à la définition que donnait de la poésie Giuseppe Ungaretti : « Elle consiste, disait-il, à convertir la mémoire en songes et à apporter d’heureuses clartés sur le chemin de l’obscur ». Sous la plume de Claude Albarède, on peut lire – comme en écho – ces trois vers : « Heureuse clarté/que la chair donne aux rêves/dans la lumière du soir ! ».
Mais le poète n’est pas dupe. Pour révéler les mystères enfouis d’un pays (et l’homme à lui-même), pour témoigner d’un temps qui engloutit les demeures et leurs habitants, se laisser gagner par l’émotion ne suffit pas. « Le poème attendra/que retombe l’essor/et que l’énigme/pénètre un peu ». C’est cette énigme, grâce au pouvoir des mots, que le lecteur est invité à déchiffrer tout au long d’un livre qui nécessite aussi, de sa part, une forme d’effort et d’abnégation.
Le dehors intime, Claude Albarède, éditions L’herbe qui tremble (4e trimestre 2016), 125 pages, 16 euros, avec six peintures de Marie Alloy.
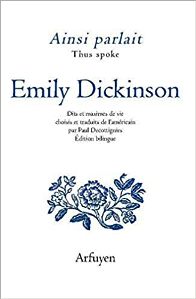 |
Paul Décottignies, |
| Ainsi parlait Emily Dickinson |
|---|
Emily Dickinson nous revient dans un florilège de pensées, dits et maximes de vie, extraits de ses poèmes, de ses fragments ou de sa correspondance. Il n’est pas superflu, en ces temps chaotiques, de faire halte quelque temps en sa compagnie. La « couturière céleste », comme l’appelait Christian Bobin dans le livre qu’il lui a consacré sous le titre La dame blanche (Gallimard, 2007) nous ouvre, en effet, de tels vastes horizons. à tel point que Paul Décottignies, traducteur et préfacier de cette anthologie, peut affirmer que les textes rassemblés ici nous font « apercevoir des réalités si profondes que ce n’est pas seulement à Eckhart, mais aussi à Héraclite, Silesius ou Spinoza, qu’elles semblent apporter des clartés nouvelles ».
Paul Décottignies souligne aussi, très justement que «ce qui importe chez la dame d’Amherst, ce ne sont certes pas des formes ni des matières poétiques, dont elle a réussi bien au contraire à s’affranchir mieux qu’aucun poète en son siècle : ce qui anime son œuvre, c’est une pensée féconde et bouleversante ».
Les textes réunis ici s’échelonnent de 1846 à 1885 (des 16 ans d’Emily à ses 55 ans). De la part de celle qui vécut quasiment recluse toute sa vie, on mesure par exemple la finesse de ces vers écrits en 1872 : « La simple Rénommée d’un Trèfle/Dont la Vache se souvient – /Est meilleure que les Royaumes émaillés/De la notoriété ». Mais ce qui sous-tend foncièrement son œuvre, c’est l’étonnement constant d’être au monde et de vivre. « Je trouve dans le fait de vivre une extase – la simple sensation de vivre est joie suffisante » (lettre de 1870). « Vivre est si stupéfiant que cela ne laisse que peu de place pour d’autres occupations, bien que l’Amitié soit, s’il est possible, un Événement encore plus beau », écrit-elle en 1872 à son fidèle complice T.W. Higginson. Dans une autre lettre de 1873 à Louis et Frances Norcross, elle écrit : « La vie est un enchantement si délicieux que tout conspire à le briser ». On trouve aussi, parcourant ce livre, des maximes aussi fulgurantes que celle-ci : « Seul l’Amour peut blesser - / Seul l’amour soigne la Blessure » (lettre de 1872 à Elizabeth Holland).
Enfin, il y a, parcourant toutes ces pensées, une pénétrante approche des thèmes de l’immortalité et de la divinité. « L’immortalité des fleurs doit enrichir la nôtre, et nous n’accepterions pas une Rédemption qui les exclurait », écrit-elle en 1877. à sa mort, neuf ans plus tard, le journal local (dans sa rubrique nécrologique) fit état de l’amour qu’Emily Dickinson portait aux fleurs et aussi de ses talents de botaniste, mais très peu de ses dons poétiques. Il faut dire que, malgré l’importance de son œuvre, seulement une douzaine de poèmes ont paru de son vivant. Le « mal » a été réparé depuis.
Ainsi parlait Emily Dickinson, Thus spoke Emily Dickinson, dits et maximes de vie choisis et traduits de l’américain par Paul Décottignies, édition bilingue, Arfuyen 2016, 150 pages, 13 euros.
 |
François Cheng, |
| La vraie gloire est ici |
|---|
Le livre de François Cheng La vraie gloire est ici vient d’être édité en poche dans la collection Poésie/Gallimard. Voici la note de lecture que j’avais rédigée en 2015 à la sortie du livre.
La vraie gloire. Quelle est cette « vraie gloire » dont nous parle François Cheng dans son dernier recueil de poèmes ? « La vraie gloire est ici, écrit-il, nous passons à côté ». Cette « vraie gloire », il l’assimile en réalité à la « vraie voie » (dans la tradition taoïste qui est la sienne) et encore, plus simplement, à la « vraie vie ». Pour François Cheng, l’homme manque d’attention et de présence : il se disperse et s’annihile lui-même. Ancré dans cet « ici », le poète le pousse donc à aiguiser le regard, à sortir de ses aveuglements. « Encore un jour de gloire/Pour ceux d’ici qui voient/gloire des corps, gloire des fruits/Mystère même des étoiles ».
On l’a compris. La vraie vie est ici et maintenant. Elle s’éprouve dans « le diamant de l’instant », « l’éclair de l’instant », « l’innocence de l’instant », « le don de l’instant » (François Cheng le ressasse). Il n’en finit pas d’égrener ces moments de gloire entre « les coloquintes habillées d’or » et « le murmure des pêchers en fleurs ». La nature est omniprésente dans son livre car « Tout est signe/Tout fait signe/Souffle qui passe ». On retrouve aussi des références aux thématiques chères à l’auteur et développées dans d’autres ouvrages. « Toi, comment tu assumes/La beauté qui te hante » (1). Et à propos de la mort (2), cette piqûre de rappel : « Elle nous signifie l’extrême exigence de la vie ». Il y a même une allusion précise à un livre réalisé avec le peintre Kim en Joong (3). « Lorsque enfin les âmes se font chant/Par-dessus l’abîme des jours/Une étincelle suffit pour rallumer/Toute flamme immémoriale ». Enfin, il y a le vide médian (4), alpha et oméga de sa propre démarche. « Au royaume de l’intervalle, où/Circule le souffle du vide médian/Celui qui naît d’un double élan de vie/Voit son âme germer et croître ».
François Cheng, en effet, nous appelle à grandir. Il a de grandes ambitions pour l’homme car « le divin, dit-il, nous traverse de bout en bout » et « nous savons qu’impérissable/Restera notre soif/De rosées, de jus d’érable/De fraises sauvages ». Pour autant le poète n’élude pas la cruauté et le mal. Ses paroles résonnent en ces temps de chaos et de barbarie. « Nous sommes des violents, des violeurs/Bourreaux, tortionnaires, exterminateurs/Dévastant tout sur notre passage/Si bref passage sur la planète offerte ». D’où son appel au sursaut.
Cinq méditations sur la beauté (Gallimard, 2006)
Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie (Gallimard, 2013)
Quand les âmes se font chant (Bayard, 2014)
Le livre du vide médian (Albin Michel, 2004)
La vraie gloire est ici, François Cheng, Poésie/Gallimard 2017, Gallimard 2015.
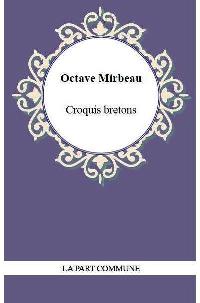 |
Octave Mirbeau, |
| Croquis bretons |
|---|
Octave Mirbeau a disparu il y a exactement 100 ans. Un colloque intitulé « Octave Mirbeau et la Bretagne » a été programmé en février à Morlaix soulignant les accointances du journaliste et romancier avec notre région. Car on oublie un peu que l’auteur du célèbre Journal d’une femme de chambre a bien connu la Bretagne et en a fait la matière de nombreux de ses écrits. C’est notamment le cas de ces Croquis bretons opportunément re-publiés aujourd’hui.
De la Bretagne, Octave Mirbeau a d’abord connu le lycée jésuite de Vannes où il arrive à 11 ans en 1857 (suite à une mutation de son père, officier de santé). Il y passera quatre ans de sa vie. Il retrouvera la Bretagne en 1884 lors de son séjour de sept mois à Audierne (il rencontrera à cette époque le poète cornouaillais Frédéric Le Guyader et visitera Quimper qu’il qualifiera de « ville la plus extraordinaire du monde »). Puis ce sera le Morbihan : trois ans à Kerisper près d’Auray avec sa compagne Alice Reygnault. En 1886, on le retrouve à Belle-île où il côtoie le peintre Claude Monet. Il reviendra en Bretagne en 1899 pour assister, à Rennes, au procès en révision du capitaine Dreyfus, en faveur duquel il s’est engagé avec Zola.
Le tempérament progressiste –voire anarchiste – d’Octave Mirbeau transpire dans ses nombreux écrits. C’est le cas dans ces Croquis bretons où il ne manque pas de fustiger le pouvoir clérical qui s’exerce sur les autochtones. « La main du prêtre, qui fut toujours si pesante, écrit-il, pèse d’un poids plus écrasant sur le crâne et sur le ventre de ces malheureux qu’on voit lutter, avec la résignation des bêtes domestiques, contre l’âpre terre inféconde ». Parlant du « pays morbihannais » il note « l’amour entêté de la langue natale », « le culte idolâtre des souvenirs », « les coutumes anciennes ». Et, plus généralement la pauvreté et la dureté du sol.
Dans les nouvelles qui composent ce petit livre, il évoque la figure d’un gentilhomme ruiné (et alcoolique) vivant « dans des pièces humides et froides, d’un froid de sépulcre et presque exclusivement meublées de portraits du Pape, du général de Charrette, du comte de Chambord, et de photographies de la basilique de Sainte-Anne ». Ailleurs, il nous évoque le sort d’un malheureux condamné au cachot pour posséder une vache tachetée (« Une chose qui n’est pas bonne par le temps qui court »). Plus loin, c’est l’histoire d’un vieux paysan de 80 ans que sa femme laisse mourir de faim parce qu’il n’est plus en état de travailler… Au fond, Octave Mirbeau ne se ménage pas pour souligner, au-delà de la misère, les turpitudes d’un peuple et ses superstitions. C’est l’image qu’ont renvoyé de la Bretagne de nombreux textes du 19e siècle. Comment ne pas penser aux écrits, quelques années avant Mirbeau, du voyage en Bretagne de Gustave Flaubert et Maxime Du Camp : « Les villages où nous passâmes sont tristes, sombres, humides, misérables et taciturnes (…) des enfants en guenilles grouillent sur le portes », racontent les deux voyageurs en passant à Plogoff.
Croquis bretons, Octave Mirbeau, La Part Commune, 2016, 77 pages, 6,5 euros.
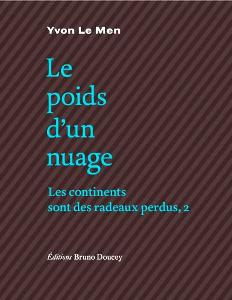 |
Yvon Le Men, |
| Le poids d’un nuage |
|---|
Tout Le Men est là. Dans cet art – qui lui est si particulier – de faire rouler ou de s’entrechoquer les mots (comme autant de petits cailloux dévalant dans le torrent) et d’apporter les notes de couleur qu’il convient (comme le ferait la palette d’un peintre). C’est d’ailleurs vers les peintres que se tourne à plusieurs reprises le poète. Pour y retrouver cette lumière qu’il tente, lui aussi, d’introduire dans ses textes. Son panthéon va de Rembrandt à Munch en passant par Van Gogh, Millet, Hokusaï, Boudin, Monet, Cornélius… Parlant d’Hiroshige, il écrit : « Est-ce d’avoir regardé les estampes/toujours, comme une première fois/qui a protégé mes yeux d’avoir regardé le paysage/toujours, comme une dernière fois ».
Les peintres, donc. Mais aussi des grands auteurs dont il a cultivé le compagnonnage. Salut à Guillevic. Salut à François Cheng (87 ans) et à Claude Vigée (95 ans), qui furent parmi ses « pères » en poésie. « Nous nous parlons peu/maintenant/nous nous sommes beaucoup parlé/avant (…) une longue phrase/avec questions en virgules/des réponses en points-virgules/et des points sur la carte/du tendre ».
Yvon Le Men, pourtant, ne verse pas dans la nostalgie. Il peut avoir « le vague à l’âme » mais entend « vivre l’instant comme une eau qui déborde ». Il n’hésite pas non plus (comme pour se conforter) à sonder à la voix des saints fondateurs de Bretagne, à écouter le chant des moines, à méditer sur l’ermitage de l’île Millau près de chez lui. Dans ce livre, confie le poète, « J'ai écouté les paysages, oreilles ouvertes, jusqu’au bout du silence qu’ils font dans nos yeux ». Le Men ou la poésie des sens.
Le poids d’un nuage, tome 2 de Les continents sont des radeaux perdus, Yvon Le Men, éditions Bruno Doucey, 135 pages, 15 euros.
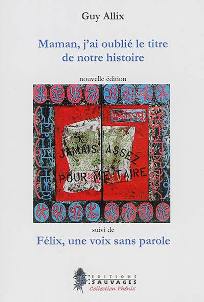 |
Guy Allix, |
| Maman, j’ai oublié le titre de notre histoire |
|---|
Le poète Guy Allix se raconte. Des « fragments d’enfance » et une « enfance en fragments », comme l’écrit Marie-Josée Christien dans la préface de ce livre profondément touchant. Car on ne s’expose pas sans risque. Il y faut du naturel et, surtout, une forme de naïveté, celle qui sied à l’enfance quand elle n’a pas encore été encombrée par des non-dits ou des vrais mensonges.
L’enfance de Guy Allix se place sous le signe de la mère. Une mère qui fait partie de la cohorte de celles qu’on appelait autrefois les « filles-mères » et que de bons paroissiens qualifiaient de « putains » (et l’auteur, en exergue nous renvoie à l’Évangile de Jean : « Que celui d’entre-vous qui est sans péché lui jette la première pierre »). Guy Allix est donc un « bâtard ». Mais pourquoi en avoir honte ? Guy Allix aime sa mère, sa mère l’aime. « On m’a traité de bâtard mais j’ai appris par la bouche de mon grand maître en littérature que, souvent, à l’époque romantique, les bâtards pouvaient aussi devenir des héros », note malicieusement l’auteur.
Ce rapport particulier à la mère l’amène à évoquer des épreuves bien intimes vécues par elle (la pilule n’existait pas encore). à nous parler aussi de Charly, ce petit frère handicapé (« La maladie bleue contrariait son intelligence qui ne pouvait être que grande ») mort avant les autres. « C’était le dernier arrivé et c’est le premier parti ».
De bout en bout Guy Allix nous émeut. Sans mélo. Sans pathos. Nous sommes dans le Nord ouvrier au cœur des années 1960. « J’habitais dans le Nord tout près de Marchiennes à l’endroit même où Zola situe l’action de Germinal ». Pour chauffer la maison, les gamins volent des gaillettes, ces morceaux de houille « qui dévalaient le terril quand les rames déchargeaient les détritus de la mine ». Aux beaux jours on se jetait dans la Scarpe (qui se jette dans l’Escaut) et, par effluves, nous arrivent – passant la frontière – les échos des chansons de Brel. Et aussi, des poèmes de Frank Venaille qui écrivait dans sa Descente de l’Escaut : « Voici l’enfant surgi du long couloir/Le voici victime de si terribles blessures intimes ».
Maman, j’ai oublié le titre de notre histoire, suivi de Félix, Une voix sans parole, Guy Allix, Les Éditions Sauvages, collection Phénix, 97 pages, 12 euros.
 |
Anne Goyen, |
| Paroles données |
|---|
Les arbres sont ses compagnons. Elle leur a consacré un livre (Arbres soyez ! Ad Solem, 2016). Anne Goyen aime la nature et le silence. Contemplative par inclinaison naturelle au cœur de cet Île-de-France (où elle a enseigné les Lettres classiques), voici qu’elle nous livre ses Paroles données.
Anne Goyen fait partie de ces poètes à l’écoute d’une voix, d’une révélation, d’une « Parole transmise / Au commencement / Du monde », d’une « Parole faite chair/Dans notre nuit », pour qui l’écriture relève en définitive de l’exercice spirituel. Dans cette poésie-là, il n’y a pas de gras. Le verbe est épuré. Parce qu’il va à la racine et ne s’encombre pas de préoccupations superflues. Parce qu’il interroge nos existences et notre capacité, ou non, à répondre à des appels, ceux d’un Dieu qui n’est pas explicitement nommé mais dont la présence irrigue la majorité des poèmes.
Pour accueillir la Parole, il faut, nous dit Anne Goyen, « Faire silence/Comme on veille / Auprès d’une flamme de bougie / Dans la maison endormie ». Il faut savoir se recueillir dans « la cathédrale des saisons » et voir dans l’hiver « Fervent retour / Aux racines / Baptême de la neige / Sur les silences / de nos forêts intimes ». Voir dans le printemps « Chantante eucharistie / Des fleurs de cerisier / Concélébrant / à la volée / Dans l’allégresse ».
Pas de doute. Dans sa traversée des jours, Anne Goyen voit (comme le dit Gérard Bocholier dans sa préface) « le divin que recèle chaque parcelle de réalité ». Dédiant un de ses poèmes à Philippe Mac Leod, elle peut écrire : « Un autre que toi parle / Avec des mots / Que tu ne connais pas / Il t’apprend le cristal / D’un langage de source ». Anne Goyen et Philippe Mac Leod labourent les mêmes espaces. Ceux d’une terre « Où tout psalmodie / où tout s’incline », ainsi que la poétesse l’affirme dans ces Paroles données.
Paroles données, Anne Goyen, Ad Solem, 95 pages, 19 euros.
 |
Gilles Baudry et Pierre Denic, |
| A tire-d’île, Molène et Sein |
|---|
Le moine poète Gilles Baudry et le peintre Pierre Denic ont déjà cheminé ensemble. Un compagnonnage artistique les a conduits à publier Brocéliande en 2011 (Liv’Editions). Les voici aujourd’hui réunis par deux îles emblématiques de l’ouest breton : Molène et Sein.
Virtuose « de la couleur avant toute chose » (comme le dit Valérie Glémont-Prigent dans la préface du livre), Pierre Denic nous montre deux îles comme on ne les a jamais vues ou conçues. Bleu turquoise des eaux (comme celle de lagons), taches brunes de laminaires, feux des crépuscules, reflets sur la mer, grands nuages blancs (« Ciel d’encre ou d’un bleu de myosotis », écrit Gilles Baudry). Mais aucun réalisme. Ces embardées de couleurs vives laissent libre cours à notre imagination. Valérie Glémont-Prigent le note avec justesse : « Ni peintre figuratif, ni peintre abstrait, Pierre Denic cherche à abstractiser ». C’est aussi le cas dans ces tableaux en noir et blanc qui parsèment le livre. Mais si, partout, la nature paraît exploser, l’homme demeure absent.
Le poète aussi, à sa manière, prend de la distance. Il aborde les deux îles comme des lieux de méditation. Des lieux pour « s’adosser à son âme » et « s’arc-bouter/contre le sentiment d’éternité/qui finit par vous habiter ». Mais pas plus que Pierre Denic, le poète ne se réfugie dans l’abstraction pure et dure. Il nous parle du « ciel si lent/Que les mouettes se fanent en plein vol » ou du « ciel si bas/Qu’il va épaules basses/De goémonier » Plus loin voici « La corne de brume voix brisée/Dans la nuit hauturière » et « La neige des embruns/En plein été ». Gilles Baudry prie et contemple. « Mission » de moine, serait-on tenté de dire. « Entre aube et aurore/à perte de vue/L’illimité intime ».
Dans un texte liminaire à ce livre, la poétesse Guénane a les mots justes pour parler de l’île entrevue par le moine et le peintre. « L’île n’est-elle l’éternel départ vers soi-même ? »
A tire-d’île, Molène et Sein, Gilles Baudry et Pierre Denic, 64 pages, prix non indiqué (ce livre est en vente à la librairie de l’abbaye Saint-Guénolé, 29560 Landévennec)
 |
Jean-Pierre Boulic, |
| Ouessant sans fin, Eusa evid atao |
|---|
Ouessant est une valeur sûre. Écrivains et poètes le savent. Alexis Gloaguen a ausculté l’île depuis sa Chambre de veille (Maurice Nadeau, 2012). Jacques Poullaouec et Hervé Inisan nous ont conduits à Rêver Ouessant (Géorama, 2012). Et tant d’autres auteurs, séduits par la matière brute de l’île et la puissance des éléments qui s’y déchaînent. Jean-Pierre Boulic, lui, parle d’Ouessant en voisin. Habitant le pays d’Iroise, il a depuis longtemps l’île dans sa focale (« Ile toute mauve », avec son « liseré blanc ») Déjà en 2004 il publiait, chez Minihi Levenez, son Royaume d’île (Rouantelez eun enezenn). Le voilà qui récidive chez le même éditeur, dans une publication bilingue français/breton, avec cet Ouessant sans fin (Eusa evid atao), récit d’amour à un « territoire de l’âme » dans lequel le poète déambule en quête de signes. « Vois rien ne manque à ton île/Qui est aussi le royaume/De la parole où surgit/Ce qui demeure invisible ».
Il est clair qu’avec Jean-Pierre Boulic Ouessant ne se résume pas à ce que la mémoire collective en retient le plus souvent (les phares, la mer déchaînée, les îliennes, mais aussi les moutons et l’abeille noire). S’il évoque toutes ces figures tutélaires de l’île, le poète les sublime. Car l’île – on s’en doute – est sous sa plume plus qu’une île. C’est un mystère à déchiffrer. C’est un secret à révéler et à divulguer. Car « Ici palpitent mille reflets d’âmes/à la lisière des eaux ».
Ouessant, nous dit Jean-Pierre Boulic, est « l’œuvre de la création ». Nous sommes dans un monde primordial. Et l’on ne doit pas s’étonner que des références bibliques – comme autant de petits cailloux semés au fil des pages – parsèment le texte. Ainsi « la voix de l’étoile/Au-dessus de l’océan/ouvre le chemin ». Plus loin, les phares en mer deviennent « les lumignons de la sagesse ». Et il y a, de bout en bout, « cette lumière irrésistible/Qui annonce chose nouvelle ».
Une lumière que l’on retrouve dans les photographies de l’auteur accompagnant son texte : cieux au crépuscule, nuits tombantes sur les hameaux, jaillissement des vagues… Autant de tableaux loin d’un certain « folklore » ouessantin, faisant penser à des peintures de Corot ou de Constable. Ce n’est pas rien.
Ouessant sans fin, Eusa evid atao, Jean-Pierre Boulic, brezoneg gand Job en Irien, Minihi Levenez, 88 pages, 15 euros.
 |
Terada Torahiko, |
| L’esprit du haïku |
|---|
On écrit aujourd’hui beaucoup de haïkus dans le monde. Et aussi beaucoup de commentaires sur ce genre poétique particulier. Le sujet paraît inépuisable et le Brestois Alain Kervern a bien montré, dans ses deux derniers essais (Histoire du haïku chez Skol Vreizh et La cloche de Gion à Folle avoine), la richesse et la complexité du sujet.
Mais il n’est pas inutile, parfois, de revenir aux auteurs japonais eux-mêmes pour savoir ce qui les guidait. C’est la cas avec Terada Torahiko (1878-1935), disciple de Sôseki et auteur d’un essai intitulé L’esprit du haïku. Il insiste sur deux points pour expliquer l’appétence particulière des japonais pour ce genre littéraire. D’une part, explique-t-il, la fusion avec la nature considérée par les Japonais comme une « présence fraternelle ». Pour Terada, en effet, « l’esprit du haïku ne peut être pensé que comme une expression poétique de ce sens de la nature ». à cela s’ajoute – c’est le deuxième point – « l’existence plus que millénaire de formes poétiques brèves dans la tradition littéraire japonaise ». Nature, brièveté : on a là les deux ingrédients de base du haïku, un genre ayant le don « d’appartenir à la mémoire collective de tout un peuple qui partage donc les mêmes associations d’images ou de pensées ». Ce qui fait dire à Terada Torahiko que « le haïku n’existe et ne peut qu’exister au Japon » 1. Mais il formule aussi, dans son essai, certaines mises en garde. « Si le poète introduit des éléments qui expriment directement sa subjectivité, il n’y aura plus de place pour exprimer des éléments symboliques de la nature » (Terada, dans cette logique, conteste « l’éloquence » dans la poésie).
Il pose aussi la question – qui fait souvent débat – des racines bouddhistes ou non du haïku. S’il convient que « le sentiment d’impermanence » (héritée du bouddhisme) « ne pouvait qu’envahir le monde des haïkus », il considère qu’il « n’appartient absolument pas à la nature même du haïku ». Selon lui, la pratique du haïku n’est « ni une fuite » (…) « ni un exercice de philosophie passive », « ni non plus une mise en scène pleine de complaisance de soi ».
Bien au contraire, souligne-t-il, le haïku suppose « une distance critique de soi vis-à-vis de soi » et permet « d’exercer l’acuité de l’œil de notre esprit à faire en sorte que nous veillions à maintenir sa liberté »
1 - lire, en contrepoint à cette affirmation, le livre de Alain Kervern, Pourquoi les non-Japonais écrivent des haïkus (éditions La Part Commune)
L’esprit du haïku suivi de Retour sur les années avec le maître Sôseki, éditions Philippe Picquier, 80 pages, 11,50 euros.
Lectures de 2016
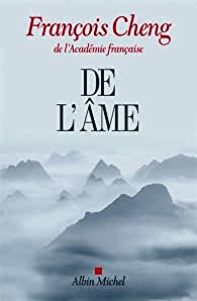 |
François Cheng, |
| De l’âme |
|---|
L’âme. Vous avez dit « l’âme » ? Parlez-moi du corps. Ou, à la rigueur, de l’esprit. Mais de l’âme, quelle idée ? François Cheng en fait pourtant le sujet d’un livre, dans le prolongement de ses méditations sur la beauté et sur la mort 1. L’écrivain et poète français d’origine chinoise livre, ici, sa réflexion sous la forme de sept lettres à une amie qui l’interroge sur la nature de l’âme.
François Cheng admet qu’il affronte des « vents contraires » en abordant un tel sujet. Il commence par nous parler de la France, « ce coin de terre censé être le plus tolérant et le plus libre, où il règne néanmoins comme une « terreur » intellectuelle, visualisée par le ricanement voltairien ». De cette France, il ajoute qu’elle « tente d’oblitérer, au nom de l’esprit, en sa compréhension la plus étroite, toute idée de l’âme – considérée comme inférieure ou obscurantiste – afin que ne soit pas perturbé le dualisme corps-esprit dans lequel elle se complaît ». Voilà qui est clair…
S’appuyant sur les grande traditions religieuses, mais aussi sur les textes des plus grands écrivains (à commencer par les poètes), François Cheng entreprend donc de réhabiliter l’âme. Pas pour le plaisir d’être à contre-courant mais pour « apprendre à y déceler le témoignage de notre vraie liberté ».
Mais, d’abord, qu’est-ce que l’âme ? Et en quoi se distingue-t-elle de l’esprit ? L’âme, nous dit François Cheng, est « le terreau des désirs, des émotions et de la mémoire (…) Indivisible, irréductible, irremplaçable, absorbant les dons du corps et de l’esprit, donc pleinement incarnée, elle est la marque de l’unicité de chacun d’entre nous et, par là, de la vraie dignité de chacun de nous ». L’esprit, explique-t-il, relève du « seul raisonnement » et « déploie pleinement son pouvoir d’agir dans toute l’organisation sociale, que celle-ci soit politique, économique, juridique ou éducative ».
Mieux, poursuit-il, l’âme survit à la déchéance du corps ou à la déficience de l’esprit parce qu’elle est « reliée au courant de vie en devenir ». Ce que François Cheng, arc-bouté à la tradition taoïste, appelle « la Voie », autrement dit « le souffle originel qui est le principe de vie même ». Et de rappeler, au passage, la phrase du Christ : « Je suis la Voie, la Vérité, la Vie ».
Une telle approche lui permet, enfin, « d’affirmer une perspective de l’âme située au-delà de la mort corporelle ». La jonction se fait alors, facilement, avec le devenir de l’âme tel que le conçoit la tradition judéo-chrétienne.
Une forme « d’œcuménisme » tranquille imprègne donc cet ouvrage qui ose parle de « transcendance » et même de « communion des saints » (celle des âmes après la mort corporelle). Un ouvrage où apparaissent, au fil des pages, des figures de poètes (Rilke, Claudel, Rimbaud…), de penseurs ou de philosophes avec qui l’auteur se sent en étroite communion, à commencer par Simone Weil, philosophe de « l’enracinement » de l’âme,dont il développe la pensée avec pertinence.
De l’âme, François Cheng, Albin Michel, 156 pages, 14 euros.
1 - Cinq méditations sur la beauté, Cinq méditations sur la mort, Albin Michel, 2006 et 2013
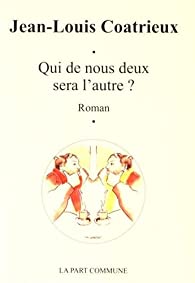 |
Jean-Louis Coatrieux, |
| Qui de nous deux sera l’autre ? |
|---|
Il y a deux Jean-Louis Coatrieux : le chercheur et l’écrivain 1. Le scientifique appelé à enseigner et à parcourir le monde, l’écrivain à la fois enraciné et ouvert. Ces frères jumeaux (il faudrait plutôt dire siamois) deviennent, par la magie d’un roman autobiographique, Paul et René. Paul, l’homme de science. René, le passionné de littérature et d’écriture. Les deux hommes ont cohabité toute leur vie. Avec parfois des accrocs et des turbulences, des silences et des incompréhensions. Qui des deux, en effet, prendra le pas sur l’autre ?
Jean-Louis Coatrieux témoigne de ce tiraillement et son livre a un premier mérite : celui de l’originalité dans l’approche d’un sujet qui touche à l’intime et interroge sur nos vocations profondes. « Nous étions, Paul et moi, de vrais jumeaux et nous avions en quelque sorte une identité plus grande », note l’écrivain René. Et quand il regarde son alter ego Paul, il peut affirmer : « Je l’enviais pour ses certitudes. Mes tentatives de récit paraissaient bien pâles à son regard ». Car Paul « soutenait que la science serait la meilleure lectrice du monde des vivants et du monde tout court, qu’il fallait interroger la physique quantique, l’indétermination des états de matière et leurs interactions paradoxales ». René, lui, pensait que la littérature valait bien la science dans la lecture du monde.
Dans ce parcours en « gémellité » que nous propose le rennais Jean-Louis Coatrieux, il y a l’arrière-plan familial et historique qui donne le vrai tempo au récit. Enfance en région parisienne, retours réguliers au berceau de la famille en Centre-Bretagne (du côté de Locuon et de Saint-Nicolas du Pélem), études universitaires à Rennes dans l’effervescence des années pré et post-soixante-huitardes, sympathies politiques à gauche et empathie pour la révolution socialiste chilienne… Mais jamais le scientifique qui perce sous l’écrivain (et réciproquement) ne se satisfait de réponses toutes faites, qu’elles soient politiques ou littéraires, fustigeant aussi bien les oukases maoïstes que ceux de la revue TXT et ses « diatribes verbales s’autorisant la dévastation la plus radicale ».
À 20 ans, Jean-Louis Coatrieux pense déjà « la Bretagne au monde » (sous-titre de la revue « Hopala » dont il est membre du comité de rédaction). Il écoute aussi bien Le Quintrec que Keineg, Blanchot que Robin, Neruda que Perros… Mais l’écrivain tarde à exister alors que le chercheur (que l’on retrouve au Venezuela ou en Colombie) a, depuis longtemps, fait son chemin. Une forme d’impuissance, chez René, à trouver « un matériau, un style, du relief, du vif ». Le matériau littéraire est là, encore faut-il pouvoir « capter ce flux en urgence ». Mais « l’irruption, car c’en est une, s’est produite sans aucun signe prémonitoire ». Tout deviendra alors plus limpide et la rencontre avec un éditeur à l’écoute (Yves Landrein) contribuera à réconcilier Paul avec René. Et réciproquement.
Qui de nous deux sera l’autre ? Jean-Louis Coatrieux, La Part Commune, 222 pages, 16 euros.
1 - Jean-Louis Coatrieux a publié six livres aux éditions La Part Commune dont un, précisément, sur la recherche (Une vie à chercher). Deux de ces six livres sont consacrés à des auteurs qui lui sont chers : À les entendre parler (Grall, Guillevic, Guilloux, Perros, Robin, Segalen) et In absentia (Lorca, Neruda, Hikmet)
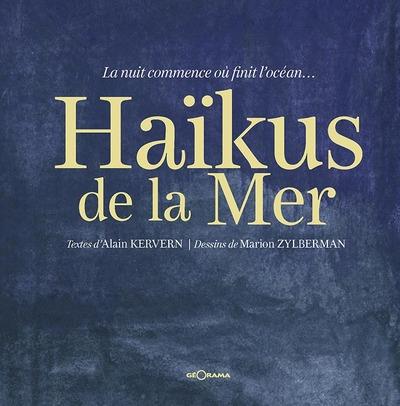 |
Alain Kervern et Marion Zylberman, |
| Haïkus de la mer |
|---|
Elle vit aujourd’hui à Penmarc’h. Lui, depuis longtemps, à Brest-même. Elle est artiste-peintre et voyageuse. Lui est poète et traducteur. Tous les deux ont de l’eau salée dans leurs veines, car on ne vit pas impunément devant la grande bleue surtout quand elle souffle les grandes orgues par temps de tempête (comme c’est le cas dans le Finistère). Elle, c’est Marion Zylberman. Lui, c’est Alain Kervern. Ils publient aujourd’hui Les haïkus de la mer.
Les dessins et les peintures de Marion Zylberman ne nous montrent pas des criques isolées où viennent mourir gentiment des vagues, ni des étendues de mer d’huile quand souffle un vent de terre. Non, ils nous montrent une mer houleuse où viennent s’abattre de puissantes averses. Le noir domine. Le bleu nuit aussi. Sur la côte bigoudène, la mer a de ces fureurs (roulant les galets avec fracas) que l’artiste, d’un coup de griffe sur la toile, nous restitue avec force et talent.
Alain Kervern, lui, mêle ses haïkus à ces tableaux de mer démontée et de ciel bas, tels qu’il les connaît aussi en pays léonard. L’écrivain n’est pas dépaysé par les tableaux de l’artiste. Ils ont, tous les deux, le même horizon tourmenté. « Tailladée/de rafales d’acier/la haute mer ».
Le poète part aussi au large. Le temps d’une marée. « Cap sur le large/abandonnant le monde/à ses métamorphoses ». Si la houle creuse l’angoisse, elle peut aussi conduire vers des mondes insoupçonnés. « Cap à l’ouest/là où l’horizon/aspire le grand large ». Les trouées de lumière dans la nuit deviennent même de vraies épiphanies. « Venus des horizons noircis/voici l’extase blanche/de la lumière ». Il y a aussi ce « ressac d’étoiles/à l’écoute/de la nuit » et «Sur l’horizon/la voie sans retour/du coucher du soleil ».
Dans ce macrocosme (celui de l’immensité marine et des cieux étoilés au-dessus de la tête des hommes), le poète approche aussi bien les détails infimes de la vie marine que le microcosme de l’activité humaine. Il le dit dans un raccourci saisissant : « Mille mouettes/dix mille vagues/et le bruit du moteur ».
Haïkus de la mer, textes de Alain Kervern et dessins de Marion Zylberman, préface de Anne-Marie Kervern-Quéfféléant, Géorama, 96 pages, 18 euros.
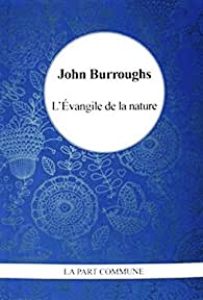 |
John Burroughs, |
| L’Évangile de la nature |
|---|
L’Évangile de la nature aurait pu être le titre d’un livre du regretté Jean Bastaire, cet écrivain qui s’était mis à l’école de François d’Assise dans sa défense et illustration de la nature. Ce n’est pas le cas. Son auteur est l’Américain John Burroughs (à ne pas confondre avec William Burroughs, un des représentants de la Beat Generation). Il a 75 ans quand, en 1912, il publie dans une revue de Boston, un très long texte sous le titre « The Gospel of Nature ». Ce texte est aujourd’hui, opportunément, réédité en France.
Y-a-t-il un Évangile de la Nature ? Burroughs se pose la question à la suite de la proposition qui lui avait été faite, par un pasteur, de « venir en parler à ses ouailles ». On découvre que l’auteur américain a une bonne culture biblique et qu’il ne manque pas de faire référence à ces versets bien connus sur les oiseaux du ciel « qui ne sèment ni ne moissonnent » ou encore à ces lis des champs aux « atours plus royaux que Salomon dans toute sa gloire ».
Mais Burroughs ne s’arrête pas là bien sûr. à la suite de l’Américain Ralf Emerson et du poète anglais William Woodworth, dont il a lu assidûment les livres, il estime lui aussi que « la nature possède clairement une valeur religieuse », ajoutant que l’amour de la nature « ne peut pas naître chez un homme ou une femme uniquement préoccupé par des considérations égoïstes, terre-à-terre ou matérielles ». Pour autant y-a-t-il, à proprement parler, un Évangile de la Nature ? « La Nature enseigne plus qu’elle ne prêche », estime John Burroughs. Aussi ne se précipite-t-il pas dans les bois ou les champs comme le ferait un naturaliste armé de jumelles ou de sondes. Il y va, lui, par amour et par plaisir. « Je vais m’y baigner comme dans une mer ; j’y vais pour donner à mes yeux, mes oreilles et tous mes sens un terrain libre et dégagé ». Aucune leçon morale ne se dégage de cette plongée.
Le seul Évangile que l’auteur puisse formuler, au contact de la nature, est celui « de la joie, de la reconnaissance, de l’attention aux choses simples qui nous entourent ». Avec, en retour, « l’humilité » et la « sobriété » que peut susciter un tel contact. Mais Burroughs insiste: la Nature n’est pas « Bienveillante ». Elle « ne sait rien des vertus dont l’Évangile et les Béatitudes du Christ font si grand cas (…) Mettez-vous sur sa route et elle vous écrase ».
Ce texte de Burroughs mérite d’être relu à l’aulne des désordres écologiques actuels (et à venir) qui menacent la planète. L’auteur insiste fortement sur la précarité de notre destinée et sur celle de la planète terre elle-même. Un vrai visionnaire.
L’Évangile de la nature, John Burroughs, traduction de Thierry Gillyboeuf, éditions La Part Commune (collection La Petite Part), 62 pages, 6,5 euros.
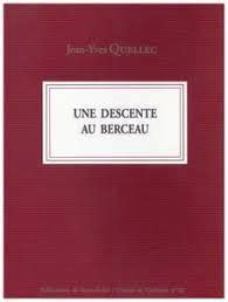 |
Jean-Yves Quellec, |
| Une descente au berceau |
|---|
Les obsèques du moine et écrivain breton Jean-Yves Quellec ont eu lieu le 17 novembre dernier au monastère Saint-André de Clerlande en Belgique. Une cérémonie a ensuite été organisée, le 23 novembre, dans sa commune natale du Conquet (Nord-Finistère). En hommage à cet auteur fécond, re-voici ma note de lecture sur un de ses plus beaux livres, publié en 2011.
Il est des livres que l’on aborde le cœur battant parce que leur charge poétique et l’univers qu’ils nous laissent entrevoir enrichissent notre vision de l’existence. Ils nous rassurent, au fond, sur la capacité de certains livres à nous aider à vivre. Ou, pour reprendre les mots de Philippe Jaccottet, parlant de la poésie qu’il aime, ils « ouvrent ou entrouvrent la porte de l’autre monde présent dans celui-ci ».
C’est le cas, notamment, des oeuvres de Gilles Baudry (éditions Rougerie) ou des Étincelles de François Cassingena-Trévedy (éditions Ad Solem). Deux auteurs-moines ou moines-auteurs, comme l’on voudra. Rejoints dans cette confrérie de veilleurs chrétiens par Jean-Yves Quellec, prieur de l’abbaye de Clerlande en Belgique, mais né natif du Nord-Finistère (« Le pen ar bed des Bretons, je connais, j’y suis né »). Déjà auteur d’un livre remarqué sur son expérience de solitude et de retraite dans la petite île de Quéménès, non loin d’Ouessant (Passe de la chimère, grand prix 2007 des îles du Ponant), il publie aujourd’hui un nouveau livre de fragments sous ce titre énigmatique – Une descente au berceau – qui fait penser à un tableau de genre.
Arrivé à l’âge où l’on parle de partir en retraite, Jean-Yves Quellec continue d’habiter le monde avec appétit et à jeter sur lui un regard malicieux et distancié, y compris quand il évoque sa propre communauté monastique ou l’Église catholique elle-même. « Le temps qui reste ne sera pas fatalement une glissade vers la tombe, confesse-t-il, mais une humble et magnifique descente au berceau ». à condition que « tu désencombres ton cœur ».
Se désencombrer, c’est d’abord, pour lui, se mettre à l’écoute de la nature. « Il neigeote », écrit-il. « En poursuivant ma route, peut-être apercevrai-je un inconnu débouchant de l’invisible ». Sa sensibilité particulière au chant des oiseaux lui fait, ailleurs, entrevoir « quelques notes d’espérance dans l’obscurité ». Le voici, une autre fois, extirpant un papillon de la toile d’araignée dont il était prisonnier. « Les ailes tremblantes, il agonise sur ma main ».
« Le miracle d’exister, confie-t-il, me tient en haleine ». Et il dit, au passage, aimer cette exhortation du Talmud : « Si tu veux connaître l’invisible, scrute très exactement le visible ». Jean-Yves Quellec revendique donc « le choix du grand angle pour accueillir en soi le flux de la nature, la cohorte des visages ».
Cette vision de la vie et de l’homme, chevillée à la foi qui l’anime, l’écarte de « la ceinture des dogmes » et de toutes « ces âmes pieuses » que rebute « la netteté du monde » et qui prient « les yeux mi-clos ». Quand il le faut, le prieur de Clerlande n’hésite pas à hausser le ton. « Il faudrait à l’Église catholique un nouveau Siècle des Lumières, une puissance levée d’esprits libres qui, de toutes les couches de la société, fassent honneur à l’Évangile sans crier gare ».
Plus proche de Teilhard de Chardin ou de Maurice Zundel que du Thomas d’Aquin qu’on lui enseignait au séminaire de Quimper, Jean-Yves Quellec a des accointances certaines avec Jean-Pierre Jossua et surtout un autre Breton, Jean Sulivan. Dans cet art d’appuyer là où ça fait mal et d’appeler à une forme d’insurrection personnelle. Mais en restant fidèle à l’écoute, à l’intériorité et à la voix de son cœur : « Modulation de la pluie. Un merle entonne la première antenne des Matines ». Avec cet aveu : « Je ne vois pas comment je pourrais être croyant à l’avenir si j’omettais de penser à l’air libre ».
Une descente au berceau, Jean-Yves Quellec, préface de Gabriel Ringlet, publications de Saint-André – Cahiers de Clerlande n°12 (allée de Clerlande, 1, B.1340 Ottignies), 2011, 161 pages, 14,80 euros.
 |
Gérard Bocholier, |
| Nuits |
|---|
Gérard Bocholier nous avait dit, dans un précédent livre, que le poème était avant tout, à ses yeux, un « exercice spirituel » (Ad Solem, 2014). Autrement dit que le poète devait, d’une certaine manière, s’effacer devant quelque chose – ou quelqu’un – de plus grand que lui, qu’il devait faire « étinceler l’encre de l’invisible » et que ses mots devaient faire voir ce que nos yeux ne voient plus. A fortiori quand la nuit tombe (et nous plombe) comme il le montre dans son nouveau livre à travers « le vécu » des disciples d’Emmaüs et de Saul.
Nuit d’Emmaüs, d’abord, quand après la mort du Christ, ses disciples errent perclus de chagrin (« Agneaux perdus/Nous avancions ») et envahis par le doute : « Où est la source/Que nous rêvions/Pauvres fous/De retenir/De nos mains frêles ». Mais le Consolateur ne tarde pas à révéler sa présence (« C’est un murmure/Bientôt qui gagne ») et à forger des cœurs nouveaux («Joyeux départs/Pour la moisson ») prêts à rendre témoignage : « Nus et hardis/Nous avançons/Les mains levées ». Le monde entier, au diapason, exulte : « Le ciel afflue/Au fond des puits » et « Mille collines/S’aplanissent ».
La nuit de Saul est celle du futur Paul, persécuteur des premiers disciples du Christ dont Étienne (« Je n’ai pas retenu la main/ Ni le caillou ») avant d’être « ébloui » sur le chemin de Damas au point de perdre la vue et de connaître aussi sa nuit (« Sur cette paille de ténèbres ») mais d’en sortir transfiguré. Car une voix appelle « qui traverse le rocher/désarçonne les pins ».
Qu’on ne se trompe pas. Le poète ne fait pas, ici, de l’exégèse biblique. Il nous parle bien d’aujourd’hui. Qu’il s’agisse de Saul ou d’Emmaüs, Gérard Bocholier actualise le récit évangélique par ses poèmes. Il témoigne à sa manière d’une conversion possible des cœurs, du profond retournement apporté par la Résurrection. Le poète interpelle au fond son Créateur en se mettant dans la peau de Paul et des disciples d’Emmaüs. « Dis où tu veux que j’aille/Mène-moi comme l’enfant/Qui a laissé la feuille de sa main/Dans une grande main rugueuse ». Comme saisi de doutes, il peut même confier : « J’ai besoin de la nuit/Pour m’ouvrir à l’averse/Des plus infimes grâces ».
Depuis Jean Grosjean, peu de poètes qualifiés de chrétiens n’avaient sans doute à ce point – et de façon si explicite – convoqué l’Évangile pour témoigner en poèmes de la Parole. Et faire ainsi de l’écriture poétique un véritable « exercice spirituel ».
Nuits, Gérard Bocholier, Ad Solem, 79 pages, 19 euros.
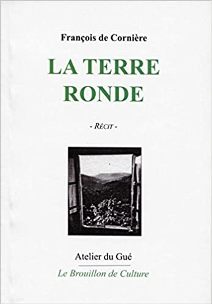 |
François de Cornière, |
| La terre ronde |
|---|
La terre ronde réédité. Savourons notre bonheur. Voici l’histoire d’une maison et d’une famille, quelque part dans la montagne ardéchoise. Un récit dans lequel le poète François de Cornière nous raconte comment, un jour, il a épousé ce terroir. La maison ? C’est une forme « d’héritage » du côté de sa femme, dont les ancêtres ont vécu sur cette terre ingrate. Des patates, des châtaignes, un peu de vigne, quelques chèvres… C’était la vie d’avant.
François de Cornière y arrive au début des années 1970. « Deux fenêtres à l’étage. Deux portes de plain-pied sous la tonnelle. Le ciel. La montagne. Du bleu. Du vert. Et le grand silence que soulèvent les sauterelles sous les pieds. Des hectares de silence ». On se dit – le lisant – que Giono et Ramuz (cité en exergue du livre) ne sont pas loin. Et on le pense encore plus quand l’auteur entreprend, comme l’ont si souvent fait les deux grands écrivains, de rembobiner le fil de l’Histoire. « Ceux qui pourraient parler, ils sont là. Au fond d’un tiroir de la table, ou dans une boîte en fer blanc sur le haut de l’armoire. Ils posent pour la photo ». Voici Gaston et Gabriel, la petite Hélène empoisonnée par les grains de raisin sulfatés qu’elle a picorés, Hermine qui, par un soir d’hiver, s’est enfuie de ce monde clos. Le temps passe. Et puis, un jour, « la maison est oubliée, abandonnée contre un rocher. Le vent qui enlève une tuile, puis deux, puis trois ».
C’est cette maison-là qui va renaître. Avec son évier en pierre, son grenier « à droite, en haut du méchant escalier », sa chambre qui laisse passer le ciel à travers les tuiles. Vite nettoyer, éloigner les souris, les serpents, les araignées. Débroussailler tout autour. Beaucoup débroussailler. Mais il y a toujours « le bruit que font les vers de bois » et « quand on ouvre, c’est l’odeur qu’on retrouve en premier ». Cette maison deviendra la maison d’été, villégiature sobre, lieu de prédilection. L’été, mais aussi un Noël, celui de 1971. Quatre jours sous la neige. « Il n’y a plus de chemin, il n’y a plus de pré, il n’y a plus de distances ». Il faudra tracer un SOS dans la neige.
On pourrait dire – lisant ce récit – que c’était le temps du retour à la nature. Il y a sans doute un peu de cela. C’était dans l’air du temps. Mais il y a bien plus. François de Cornière ne fera pas un passage éphémère dans ce terroir. Il y viendra avec ses enfants. Plus foncièrement, il nous ramène à l’élémentaire. Franciscain à sa manière, il réhabilite l’eau et la terre. Il chante le vent et le soleil. Les nuits étoilées. Et surtout il garde mémoire. Du passé, il ne fait pas table rase. Il s’inscrit dans une lignée, celle de sa femme et de sa parentèle. Il honore les disparus. Il les ressuscite et, avec eux, ce petit bout de terre ardéchoise.
La terre ronde, François de Cornière, Atelier du gué/Le Brouillon de culture, 116 pages, 13 euros.
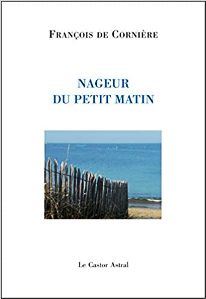 |
François de Cornière, |
| Nageur du petit matin |
|---|
Il n’est jamais trop tard pour parler d’un livre qui vous a touché. C’est le cas de Nageur du petit matin. Car le nageur, dont il est question, a fait bien des brasses depuis juin 2015 (date de parution de son livre), fendu le frais et le froid de ces eaux de l’Atlantique où il plonge chaque matin de l’année. Une vieille habitude sans doute renforcée par un drame intime : celui de la mort d’une femme aimée. Oui, retrouver, en nageant, les gestes qu’ils faisaient parfois de concert. S’immerger et reprendre son souffle.
Pour dire son chagrin et son désarroi, François de Cornière parle en poète mais ne s’embarrasse pas de formules ou d’images poétiques. Pas plus qu’il ne cache ce cancer que l’on ne saurait voir. Son récit poétique est écrit dans une forme d’urgence ou plutôt par nécessité comme tous les livres venus du cœur et qui parlent vrai.
Il y a l’avant de la maladie évoqué comme autant de flash-back. « On avait pris le bateau/pour un tour de la baie/on était tous les deux/le temps était parfait ».
Il y a la maladie, invasive, destructrice. « Ton dos/calé par un traversin/tes pauvres jambes/et ces chiffres rouges/ces écrans verts ».
Il y a la mort : « Le téléphone avait sonné/en pleine nuit/pas besoin de parler ».
Et il y a l’après : « J’ai nagé avec toi dans la mer/avec toi dans le ciel/avec toi partout/au cœur de ce grand vide/où maintenant j’habite ».
Ce livre aurait pu jamais ne voir le jour. « Je croyais ne pouvoir jamais écrire sur ta mort / – question de pudeur ou de dignité ». François de Cornière a osé. Et nous a rejoints, nous tous les endeuillés de quelqu’un ou de quelque chose. Nous tous les inconsolables.
Nous avons aussi rejoint son auteur dans ses moments de souffrance, de doute mais aussi de bonheur. Le nageur du petit matin ne peut pas sombrer. Nous sommes, d’une certaine manière, à ses côtés. Sa femme, aussi, est toujours là. Vivante autrement. Il lui donne d’ailleurs de ses nouvelles. « Te dire que j’ai vendu/ notre maison de ville/et que maintenant j’habite/ici toute l’année (…) que je nage tous les jours/que je ne vais pas trop loin/que je m’occupe du jardin/que l’ai taillé le laurier/un peu plus bas qu’avant/que tes sculptures sont là/qu’elles me tiennent compagnie ». Que dire de plus ?
Nageur du petit matin, François de Cornière, Le Castor Astral, 163 pages, 13 euros.
 |
Dominique Picard, |
| Ludré |
|---|
Dire un lieu. L’aborder par ses couleurs, ses senteurs. Dire un lieu sans le nommer mais en faire un tableau. Dominique Picard a posé son chevalet dans un lieu familier, quelque part au bord du golfe du Morbihan où elle réside. Car son écriture est d’abord picturale, sa plume court comme pinceau sur la toile. « Cet enchevêtrement de verts, cette masse de teintes chaudes au premier plan, me donnent envie de peindre », confie-t-elle. Mais aucun maniérisme, aucune abstraction non plus. Non, une description fouillée et précise des paysages ou des scènes de la vie quotidienne. Avec toujours cette touche impressionniste qui signe les atmosphères du lieu. « Des oiseaux s’envolent, des grillons bruissent. Les bleus se diluent dans une légère buée sur les lignes de l’horizon ».
Dominique Picard nous parle du passage des saisons, de « la marée basse au mois de mai », de l’atelier du peintre, du retour des oies bernaches… Un monde élégant, raffiné, comme épargné par les agressions du monde (« Le temps permet de prendre le thé sur la pelouse »). Il y a quelque chose qui fait penser aux tableaux de Watteau (que cite l’auteure) ou aux estampes japonaises (également évoquées dans son livre).
Des couleurs mais aussi des odeurs. « Le chemin sent la compote. Il est bordé de chênes qui l’ombragent. Les pommiers sauvages supportent leurs branches alourdies de fruits odorants ». Ailleurs, il y a ces « senteurs de vase mêlées à celles du foin coupé » ou encore « les odeurs d’herbe coupée, de terre mouillée, de lilas, de varech et de vase selon la saison ».
Dominique Picard respira son terroir par tous les pores de sa peau. Elle le dit dans des séquences en prose poétique à géométrie variable, mais toujours en gardant la distance avec son sujet. Pas d’affect, pas de réflexion philosophique. Pas de « pensée », serait-on même tenté de dire. Simplement (mais n’est-ce pas suffisant ?) la liberté offerte à son lecteur d’entrer dans son univers, comme on le ferait en se penchant sur le chevalet d’un peintre au bord du chemin. « En joignant les index et les pouces, je dessine un cadre qui contient des herbes hautes, des arbustes et des vieux chênes. Ils laissent deviner des murs blancs et des toits ». On le voit, l’écrivain n’est jamais loin du peintre.
Ludré, Dominique Picard, (éditions Le Bel été, 2016, 18, route de l’île Tascon, 56450 Saint-Armel, avec quatre peintures de Claude Briand-Picard, 43 pages, 15 euros.
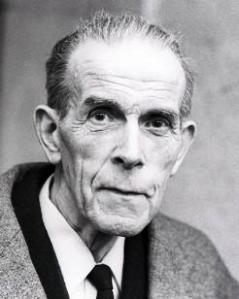 |
Pierre Tanguy, |
| Hommage à Gustave Roud |
|---|
Le poète suisse Gustave Roud a disparu il y a quarante ans, le 10 novembre 1976, à l’hôpital de Moudon. Comment parler d’un auteur qui vous est si cher et dont les livres vous sont toujours à portée de main ?
J’ai découvert Gustave Roud au début des années 1980 à la vitrine de la librairie Calligrammes à Quimper, attiré par le titre d’un livre: Essai pour un paradis, suivi de Petit traité de la marche en plaine (éditions L’âge d’homme, poche, 1984). Le libraire/éditeur, Bernard Guillemot (qui éditera plus tard, en 1987, Promenade avec Gustave Roud, entretien avec Mousse Boulanger), appréciait lui-même particulièrement Gustave Roud. J’ai vite partagé son enthousiasme.
J’aime les livres de Gustave Roud pour une raison simple: le poète allie deux perceptions de la vie et du monde dans lesquelles je me retrouve profondément. D’une part le sentiment aigu de la précarité de nos existences, de la mort, de la disparition (à l’image de cette civilisation paysanne qui brille de ses derniers feux dans cette campagne que le poète arpente sans relâche). D’autre part, le sentiment de la beauté du monde et de la présence, autour de nous, de miettes de paradis. Gustave Roud, on le sait, avait repris à son compte la fameuse injonction de Novalis : « Le paradis est dispersé sur toute la terre et nous ne le reconnaissons plus, il faut en réunir les traits épars ».
J’ajouterai que la « parole poétique » de Gustave Roud navigue entre prose et poésie. Elle est toujours lisible, accessible. « La prose est la voisine de la poésie et la promenade du poète. Le poète est perplexe entre prose et poésie ». Ces mots de Mahmoud Darwich dans son dernier livre Présente Absence (Actes Sud), s’appliquent bien au poète suisse.
Je ne cesse de m’émerveiller de cette connivence « spirituelle » avec Gustave Roud depuis mon Finistère natal (loin de Carrouge et du Jorat où il vivait). Chez les auteurs bretons, il y a aussi ce sentiment aigu de la précarité, ce regard « familier » sur les disparus, mais aussi cet appétit pour le « dehors », pour la nature dans ses expressions les plus diverses. Je retrouve ce penchant chez de nombreux auteurs de Suisse romande, Gustave Roud en tête. « Merveille de pureté cette matinée où j’avance à travers les prairies multicolores, les ombres fraîches, les feuillages (…) les fleurs se tendent vers moi comme des corps affamés de tendresse » (Essai pour un paradis).
Dans un de mes livres (Que la terre te soit légère, La Part Commune, 2008), j’ai cité en exergue ces lignes tirées de Requiem, livre où Gustave Roud évoque la mort de sa mère et le deuil : « Je pose un pas toujours plus lent dans le sentier des signes qu’un seul frémissement de feuilles effarouche. J’apprivoise les plus furtives présences ». Oui, lisons et relisons Gustave Roud.
Une sélection de textes de Gustave Roud a été publiée dans la collection Poésie/Gallimard, sous le titre Air de la solitude et autres écrits, avec une préface de Philippe Jaccottet.
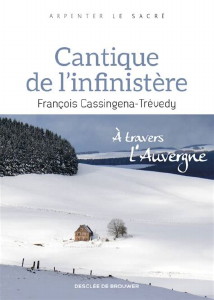 |
François Cassingena-Trévedy, |
| Cantique de l’infinistère |
|---|
Julien Gracq l’avait désignée comme « une province de l’âme ». Il parlait du Finistère. « La mer, le vent, la terre nue, et rien », écrivait-il dans ses Lettrines (José Corti, 1967). C’est d’une autre Finistère dont nous parle le Breton François Cassingena-Trévedy, ou plutôt d’un « infinistère », « selon que les impressions conjuguées du regard et des pas suggèrent de le baptiser ». Ce Finistère-là n’est pas bordé par la mer, mais il possède aussi de larges horizons. Les terres y sont rudes, frustes et austères. Propices à la méditation. Il s’agit du Cézallier, terres hautes d’une Auvergne ignorée des touristes, entre Mont-Dore et Cantal, dont les occupants principaux sont des éleveurs et leurs troupeaux d’estive. De modestes hameaux et villages s’y accrochent. C’est ce pays-là que frère François, moine de l’abbaye bénédictine de Ligugé (Fanch pour ses amis bretons) a pérégriné pendant une semaine au début de l’automne, un territoire avec lequel il avait des affinités (un héritage, notamment, de vacances familiales passées sur place).
Son livre est sans doute un carnet de route. Quittant le hameau de Chaumiane, il écrit : « Le ciel est très bas, le jour encore indécis. Une fine couche de neige, tombée dans la nuit, donne aux tracteurs un air de jouets abandonnés ». Un carnet, mais bien plus que cela. à Dienne, il échange avec sa bonne hôtesse : « Nous tombons d’accord sur la liturgie des saisons, sur l’extrême densité des choses rurales, sur ces riens de la terre et du temps qui pèsent de tout leur pesant d’or, comme le balancier d’une horloge, dans le cœur de l’homme ».
François Cassingena annote. Il est le scribe scrupuleux de son équipée solitaire. Il parle des gens, des lieux, de leur histoire. La petite musique des psaumes l’accompagne mais aussi Ignace d’Antioche, Jean de la Croix, Augustin, François d’Assise, Bachelard, Pascal, Teilhard de Chardin, Péguy, Virgile, Lucrèce, Dante, Elisée Reclus, Saint-John Perse, Rilke, Rimbaud, Anne Perrier… dont des citations truffent son texte.
Notre moine pèlerin n’est pas là pour nous livrer des anecdotes, mais pour (sur ses pas) nous ramener à l’essentiel : la fraîcheur, l’innocence, la sobriété. Sur ces terres qu’il parcourt, aucun artifice. Simplement des « aridités adorables ». Oui, un moine bénédictin aux accents franciscains. « Je chavire dans une oraison qui n’est fait que d’acquiescement sans bornes à ces espaces ». Au mitan de sa pérégrination, il peut même écrire : « Le Cézallier apparaît alors pour ce qu’il est et me livre ce que j’allais y chercher sans peut-être le savoir : une estive élevée à l’état d’éternité… dont l’austérité ne le cède qu’à la douceur, et qui induit insensiblement à la tendresse autant qu’au repentir »
Les terroirs d’Auvergne ont eu leur chantre : le pays d’Ambert avec Alexandre Vialatte, le Livradois avec Henri Pourrat (celui de Gaspard des montagnes). Aujourd’hui, il y les beaux textes de Marie-Hélène Lafon sur le Cantal et la vallée de la Santoire. François Cassingena-Trévedy, « casanier de l’immense » et appuyé sur son « bâton de chantre », peut entrer dans cette prestigieuse lignée. Il suffit d’un livre, ce livre, Cantique de l’infinistère, où l’on vous parle d’une « terre étrangère à toute colonisation intempérante, à toute civilisation emballée, à tout encombrement pandémique ». Au fond, Une vraie « province de l’âme ». Dépouillez-vous du vieil homme (tel un pèlerin qui se délecterait du superflu), marchez, contemplez, cultivez le beau, nous dit frère François, entre les lignes, sur cette vieille terre d’Auvergne.
Cantique de l’infinistère, à travers l’Auvergne, Desclée de Brouwer, 175 pages, 16,90 euros.
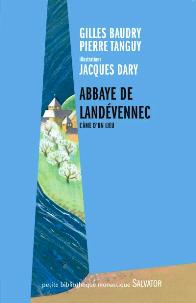 |
Gilles Baudry, |
| L'âme d'un lieu et autres livres avec des artistes |
|---|
Le moine poète de l’abbaye de Landévennec, Gilles Baudry, fréquente de nombreux artistes. En 2015, il avait publié avec l’aquarelliste Jacques Dary un livre intitulé Abbaye de Landévennec, l’âme d’un lieu (éditions Salvator). Un livre auquel j’avais apporté ma contribution. Plusieurs publications récentes attestent ce goût de Gilles Baudry pour des livres où ses poèmes cohabitent avec des œuvres picturales ou photographiques.
En tirage limité, mentionnons d’abord le très beau « livre d’artiste » du plasticien Michel Remaud (peintures non figuratives éclatantes de lumière) sous le titre Nomade. Ce livre, qui comprend des poèmes inédits de Gilles Baudry, a été tiré à cinq exemplaires (26x22) : une grande planche en leporello sous coffret. Prix de vente : 300 euros 1
Sous le titre Fil de vie, Gilles Baudry rejoint avec ses poèmes les aquarelles de Marie-Gilles dont l’œuvre, « toute de vibration, est profondément empreinte de spiritualité », note le poète, avec « comme chez Manessier, l’invisible en filigrane par les interstices de la surface évidée » 2.
Avec Nathalie Fréour, le dialogue se tisse sur L’abbaye saint-Guénolé de Landévennec. Des poèmes inédits de Gilles Baudry et des poèmes extraits de deux de ses recueils publiés chez Rougerie cohabitent avec les pastels à l’huile de l’artiste. « Jamais haut lieu ne fut plus humble / nef végétale / palmiers / en guise de piliers » 3
Changement de registre avec Rostellec, requiem sous un ciel de traîne. Hommage d’un photographe (Guy Malbosc) et d’un poète (Gilles Baudry) aux chalutiers langoustiers construits à Rostellec, près de l’Île-longue, et devenus, sous l’action du temps, bois et ferraille. « Vieilles coques,/naguère la mer vous portait/à présent que le temps vous déporte/vous avez pris la forme de l’absence » 4
Avec le peintre Pierre Denic, le poète avait déjà publié Brocéliande (Liv’éditions, 2011). Les deux hommes ont, cette fois, élaboré de concert un hymne à Molène et à Sein sous le titre à tire d’île. « De mémoire d’île/chacun ici héberge en lui/la fulgurance/ou le chuchotement du monde en ses métamorphoses » 5. Un livre magnifiquement mis en page et introduit par un texte de Guénane, femme/poète du Morbihan.
Tous ces livres (mis à part le « livre d’artiste ») sont en vente à la librairie de l’abbaye bénédictine de Landévennec. On peut aussi trouver quelques uns d’entre eux dans les « bonnes librairies », notamment à Quimper.
1 - Contact : www.michelremaud.com
2 - Les éditions buissonnières, Crozon. www.editions-buissonnieres.fr et www.marie-gilles.book.fr. prix du livre non indiqué
3 - www.editions-crer.fr prix du livre : 13 euros
4 - Éditions Trez rouz. Ouvrage disponible sur le site de la librairie Dialogues.www.librairiedialogues.fr. 14 euros
5 - Graphisme : les éditions buissonnières, Crozon. Prix non indiqué. Livre publié à l’occasion de l’exposition des peintures de Pierre Denic au fort de Combrit/Sainte-Marine au cours de l’été 2016
 |
Christine Guénanten, |
| Père-fille, sens interdit |
|---|
« Je ne sais rien faire. Rien faire que d’écrire des poèmes. Je me réfugie dans le jardin sous le pommier près de Poupette. J’écris en m’appliquant jour et nuit ». Une jeune fille – encore une enfant – parle de sa passion. Christine Guénanten, femme/poète en Bretagne se raconte avec cette innocence et cette fraîcheur qui sont la marque de l’enfance dans une biographie croisée avec son père.
La fille évoque la sensation qu’elle a toujours eue d’être un peu à part. Elle dit comment l’écriture a fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. Le père, lui (« Pierrot »), raconte sa vie d’ouvrier des Ponts et Chaussées et, surtout, l’épreuve traumatisante du STO en Allemagne. Mais la mère (« Marcelle ») est loin d’être absente, évoquée par l’une comme par l’autre au fil des pages.
La petite Christine a du mal à l’école (« J’avais toujours peur, toujours honte »). Mais il y a un jour ce déclic : un texte qu’elle écrit sur un animal de basse-cour et qui lui vaut les félicitations de sa maîtresse et même une lecture devant tous les élèves. « Quelle joie d’être ainsi complimentée pour mon écriture ».
Complimentée, elle le sera plus tard par Charles Le Quintrec dont elle fera son poète de référence. « Il correspond régulièrement avec moi » et il lui écrit : « Vous tissez, filez, gouvernez un univers en perpétuelle état de fraîcheur ». Christine Guénanten, en effet, ne rentre pas dans les codes de la poésie engagée et encore moins dans les codes de ceux qui ont choisi les voies de l’obscur et l’hermétisme. Elle n’est pas de ces poètes fustigés par Le Quintrec se retranchant « derrière des exercices qui ne peuvent intéresser que quelques mandarins masochistes ». Lisons plutôt, pour s’en convaincre, Christine Guénanten parlant de la nature : « Je suis en quête d’une fleur/D’une merveille abandonnée/Vos cœurs sont devenus des pierres/Je suis paralysée d’amour/J’ai à rechercher le visage/qui jamais n’oublie les fontaines/Beautés, rivières des sous-bois ».
Le cœur de Christine Guénanten penche du côté de René Guy Cadou, Yves La Prairie, Antony Lhéritier... Elle le dit dans ce livre où elle évoque largement, parfois dans les détails (souvent savoureux), sa vie de jeune fille de milieu modeste à Vannes. « Il ne faut pas attendre le jugement des autres, confie-t-elle, mais se donner jour après jour au silence et à la solitude ». Une solitude (littéraire) dont elle commencera à sortir quand elle sera invitée sur les antennes de Radio Armorique et qu’elle décrochera ses premiers prix (tout en pointant à l’ANPE avant de décrocher un emploi de service dans un lycée professionnel).
Il n’est pas courant qu’une femme poète de Bretagne s’expose ainsi à sa manière dans un livre. Denise Le Dantec l’a fait dans Le rappel des jours (La Part Commune, 2015). Christine Guénanten le fait dans un langage presque enfantin comme si l’adulte (née en 1958) écrivait sous la dictée de la gamine qu’elle fut. Aucune recherche stylistique dans ce livre, simplement la plume qui court sur la page (comme encore empreinte d’encre violette), pour dire à la fois la douleur et le bonheur d’être au monde. Aux côtés d’un père, d’une mère, d’une sœur. Oui, un livre touchant.
Père-fille, sens interdit, Christine Guénanten, éditions du traict, 141 pages, 12 euros.
à découvrir aussi sur http://creation.guenanten.monsite-orange.fr
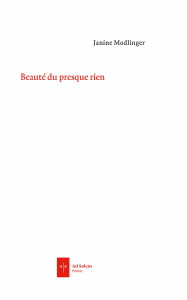 |
Janine Modlinger, |
| Beauté du presque rien |
|---|
Avec Janine Modlinger, le « presque rien » est d’abord là pour révéler « l’invisible ». Derrière le voile des apparences, se cache un mystère que traque le poète. Il y a, dans cette démarche, matière à « éblouissements », pour reprendre le titre d’un de ses précédents livres (Ad Solem…). « Chaque jour, un feu m’illumine, écrit-elle, il a la forme de visage, d’arbres, de ciel, une herbe parfois. Ces lueurs m’ouvrent à l’immense ». Ou encore ceci : « Voici qu’une pluie fine parsème le feuillage. Que nous est-il demandé, sinon de nous rassembler, d’acquiescer, de faire accueil à l’immense ». Et, au passage, cet aveu : « Je n’étais faite que pour cela, veiller, aller dans les pas de la beauté ».
On n’est pas loin du poème « exercice spirituel » tel que le conçoit Gérard Bocholier. Encore moins loin de cette fratrie de veilleurs à l’affût de la Parole et qui peuvent, comme le dit Gilles Baudry dans l’un de ses poèmes, « Passer toute une nuit à guetter le passage / De l’ange ou la naissance d’une étoile ». Pour autant, il n’y a jamais ici, dans ces fragments de prose poétique, d’incantations béates. L’auteure a une conscience vive de la cruauté du monde. « Mais que dire de celui qui, à cette heure même, fait naufrage, celui que nul ne vient consoler, qui perd confiance en la bonté ? »
Janine Modlinger vit à Paris mais nous parle aussi de la mer et de la montagne. Elle le fait à la manière des grands sages, sous formes de pensées, de méditations arc-boutées sur le quotidien ou les beautés de la nature. Le Livre est son rocher. « Il habite nos corps et nos visages, rien ne nous détournera de la promesse ». Aussi célèbre-t-elle avec ferveur « Le Cantique des cantiques ».
1 - Cinq méditations sur la beauté, par François Cheng (Albin Michel)
2 - Pollen du temps, carnets, par Georges Haldas (Bibliothèque l’Âge d’homme)
Beauté du presque rien, Janine Modlinger, Ad Solem, 69 pages, 29 euros.
 |
Jean Lavoué, |
| La vie comme une caresse |
|---|
Si l’auteur introduit son livre par le portrait de trois femmes (Etty Hillesum, Magda Hollander-Lafon et Christiane Singer), ce n’est pas le fait du hasard. « Les amantes se reconnaissent de loin », écrit-il. Plus loin il parlera « d’amoureuses », un peu comme le ferait Christian Bobin. « Les amoureuses écrivent un poème avec leur vie. Elles se tiennent là, disponibles ». Alors Jean Lavoué émet ce vœu : « Vienne le temps où certaines structures religieuses encore beaucoup trop cléricales et masculines s’effacent pour leur laisser le soin de porter elles-mêmes au monde la Parole de feu qui illumine leur cœur ».
Chrétien des « marges », aux côtés de tous les « chercheurs de sens » (cet « archipel fraternel »), il ne peut se satisfaire du « monde rapetissé que l’on nous fait et dont nous sommes souvent complices ». Il rêve, avec d’autres, de pouvoir « moduler un chant nouveau » dans « le miracle de l’ordinaire des jours ». Comme Xavier Grall, il dénonce la « chape de tristesse » qui a pu, à une époque, tomber sur le christianisme. Alors il aspire au « baume de la joie » et au « chant des jours » au sein d’une religion qui retrouverait vraiment « la saveur évangélique ». Et aujourd’hui, il peut même poser la question : « Le pape François ne serait-il pas le prophète de cette conversion-là pour l’Église catholique ? ». Au-delà du « chant » ou de la « tendresse », c’est l’appel au retour vers les « marges » que Jean Lavoué salue chez le pape argentin. Ce que ce dernier désigne sous le terme de « périphéries ».
L’auteur pointe donc très bien les nouveaux enjeux liés à ces appels venus d’un pape « homme de miséricorde qui se sent d’abord et avant tout un pécheur pardonné : lui qui invite tout homme de bonne volonté à vivre en lui profondément, existentiellement, cette expérience de libération et de réconciliation ». Aller vers les marges, cultiver le Souffle et l’intériorité. Pape François et Jean Sulivan, même combat ?
La vie comme une caresse, Dieu nous sauve par sa tendresse, Jean Lavoué, éditions Mediaspaul, 178 pages, 16 euros.
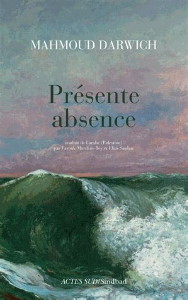 |
Mahmoud Darwich, |
| Présente absence |
|---|
Dans un livre d’entretiens (La Palestine comme métaphore, Payot 2002), Mahmud Darwich, décédé en 2008, soulignait que « le poète n’était pas tenu de fournir un programme politique à son lecteur » et que la poésie était, avant tout, « la trace de l’absence ». L’homme, bien sûr, a vécu l’exil (sa famille fut chassée des terres de Galilée par l’occupant israélien) mais cet exil – ou cette absence – pouvait selon lui prendre plusieurs formes. « Il y a l’exil social, l’exil familial, l’exil dans l’amour, l’exil intérieur. Toute poésie est expression d’un exil ou d’une altérité », déclarait-il, en 1993, dans un entretien avec un critique littéraire syrien. Et il ajoutait : « L’exil n’est-il pas l’une des sources de la création à travers l’histoire ? L’homme qui est en harmonie parfaite avec sa société, sa culture, avec lui-même, ne peut être un créateur. Il lui faut une forte tension intérieure pour transgresser les règles, condition nécessaire de toute création ».
Il y a beaucoup de pages sur l’exil dans son nouveau livre (Le Caire, Beyrouth, Tunis… et même Paris). Mahmud Darwich a vécu la prison, il a galéré, il a frôlé la mort. « Tu sauras plus tard que ton cri de douleur était la preuve de ton retour à la vie qui commence et se termine par un cri ». Il nous parle de tout cela avec justesse. Mais les pages sans doute les plus poignantes sont celles où le poète raconte l’enfant qu’il fut (on l’appelait « le turbulent » ou « le rêveur »). « Ne regarde pas l’étoile, elle pourrait te ravir et te perdre. Accroche-toi à la robe de ta mère », écrit-il en évoquant la fuite de son pays et cette enfance chaotique. Et, surtout, il y cette passion des mots qui naissent à l’école. « Tu cours vers elle avec la joie de celui à qui on a promis une découverte. Non seulement pour retenir ta leçon mais pour apprendre l’art de nommer les choses. Tous les lointains se rapprochent, toutes les choses closes s’ouvrent. Ecris correctement fleuve, il coulera dans ton cahier. Le ciel aussi sera l’un de tes biens personnels si ton orthographe est correcte. Qui écrit une chose la possède ».
D’une certaine manière tout est dit dans ces lignes superbes. L’écriture sauvera plus tard le poète exilé car, grâce aux mots, « la nostalgie est capable de doter ce qui était de ce qui ne fut pas, faisant de l’arbre une forêt et du caillou une perdrix ».
De retour en Palestine, le poète prend du recul, s’absente pour ne pas être absorbé. « Que pouvait le poète face au bulldozer de l’Histoire, sinon veiller sur les arbres, visibles ou invisibles, qui jalonnent les vieilles routes et s’élèvent près de la source d’eau ». Mahmud Darwich le dit ici sous forme de fragments où alternent sensations et émotions, petites sentences ou aphorismes. « Si l’on t’interroge sur la force de la poésie, dis : l’herbe n’est pas aussi fragile qu’il y paraît ». Parfois il nous parle comme dans les contes orientaux quand le merveilleux s’insinue dans le prosaïque, quand l’homme sait dialoguer avec les fleurs et les étoiles. Sur la forme d’écriture employée dans ce livre, ces mots de Mahmud Darwich résument tout : « La prose est la voisine de la poésie et la promenade du poète. Le poète est perplexe entre prose et poésie ».
Présente absence, Mahmud Darwich, traduction de l’arabe (Palestine) par Farouk Mardam-Bay et Elias Sanbar, Actes sud Sindbad, 148 pages, 17 euros.
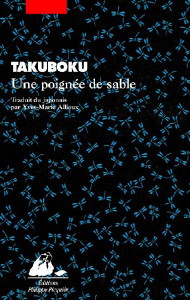 |
Ishikawa Takuboku, |
| Une poignée de sable |
|---|
Takuboku – qui fut instituteur puis collaborateur de différents journaux – écrivait des tankas, ces poèmes de 31 syllabes (5-7-5 puis 7-7) disposés sur cinq vers, dont il révolutionna le genre en les formulant sur simplement trois vers et « en s’amusant à en faire le triste jouet de ses humeurs aigries ou capricieuses », note Yves-Marie Allioux dans la postface de ce livre, mais surtout « en conduisant cette forme classique à coller au plus près des malheurs et bonheurs de notre vie moderne quotidienne ».
Nous sommes, en effet, à la fin de l’ère Meiji, période de blocages et de désillusions dont témoignent les tankas de Tokuboku. « Avant le jour / dans ce train attrapé de justesse pour un départ en début d’automne / comme le pain était dur ! ». Le poète évoque ses problèmes d’argent, ses problèmes familiaux ou conjugaux, ses ennuis de santé : « Venu dans ce parc un jour de beau temps / en marchant / j’ai pris conscience du déclin tout récent de mes forces ». Il dit ses regrets, sa nostalgie de l’enfance et évoque souvent avec émotion son lieu de naissance. « Comme une bête malade /mon cœur / dès qu’il entend parler du pays s’apaise ».
Dans un essai intitulé Poésie à croquer, Takuboku avait lui-même développé les principes de son art poétique : « La poésie ne doit pas être une soi-disant poésie. Elle doit être une relation rigoureuse des variations de la vie émotionnelle de l’être humain (…), un journal tenu en toute honnêteté. Par conséquent, elle doit être nécessairement fragmentaire ». On le vérifie dans ce livre de tankas qui sont comme autant de pièces éclatées d’une existence, de saisies d’instants éphémères ou transitoires, avec des jeux de correspondances ou d’oppositions. Et beaucoup d’interrogations adressées à lui-même, à des amis perdus de vue ou à cette jeune fille qu’il a aimée. « Dans les faubourgs de la capitale d’Ishikari / il y a ta maison / les fleurs de pommiers y sont-elles déjà tombées ? » On reconnaît, dans ses nombreux textes, cette sensibilité particulière au passage des saisons qui est la marque des grands maîtres du haïku, auxquels Takuboku fait implicitement référence, à commencer par Buson.
Une poignée de sable, Ishikawa Takuboku, éditions Philippe Picquier, 200 pages, 20 euros.
 |
Richard Rognet, |
| Elégies pour le temps de vivre |
|---|
Mais la nature est là, celle des campagnes et des montagnes vosgiennes où vit l’auteur.
Une nature omniprésente dans ses textes dont il s’approche avec empathie, à la manière d’un Francis Jammes (dont il se réclame aussi). Richard Rognet, au fond, nous ramène au romantisme mais il le fait sans affèterie, sans pause narcissique.
Il y a, au fil des pages, les jours où le regard est comme lavé par la beauté des arbres, des fleurs ou des nuages. « Je parlerai du mot pluie, du mot silence / sous la pluie, je parlerai du jardin / sous la pluie, de la facilité des fleurs / à accepter les confidences du matin ».
Il y a aussi les jours où l’homme en a « gros sur le cœur » et s’en va « étreindre un arbre ». Comme le dit justement, dans la préface, Béatrice Marchal, « l’être se dilate à des proportions cosmiques » quand Richard Rognet écrit : « Le moindre détail découvert porte / en lui les remous du monde, ce qui / nous occupe un instant prend la forme / de l’éternité, notre respiration est celle des étoiles ».
Béatrice Marchal note aussi que « l’ampleur lyrique est renforcée par la façon particulière dont Richard Rognet pratique l’enjambement en opérant la coupure entre deux mots inséparables pour le sens, laissant souvent la fin du vers en suspens sur un mot outil ».
C’est ce qui surprend et souvent désarçonne dans ce livre où les mots relèvent le plus souvent de la prose poétique. Mais ces mots sont, en général, rigoureusement agencés au sein de sonnets où de vers bâtis sur le modèle des alexandrins, y compris dans le superbe dernier chapitre de ce livre quand le poète évoque, avec ferveur, la disparition de sa mère. « Elle était là quand on rentrait, la mère / elle était là, assise, aux beaux jours dans / la véranda, en hiver, dans sa cuisine où elle / ne lisait plus que les poèmes qu’elle aimait ».
Elégies pour le temps de vivre suivi de Dans les méandres des saisons, Richard Rognet, Poésie Gallimard (catégorie 4), 245 pages.
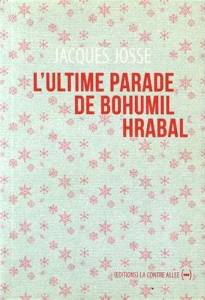 |
Jacques Josse, |
| L’ultime parade de Bohumil Hrabal |
|---|
Réunissant à la fois son attrait pour la littérature, pour les destins singuliers et, enfin, pour la bière, l’écrivain et poète rennais nous propose aujourd’hui un petit livre sur Bohumil Hrabal, l’écrivain tchèque (1914-1997) qui occupe une place de choix dans son panthéon littéraire. Avec Hrabal, souligne en effet Jacques Josse, « tout part de la palabre, ces propos que l’on entend en priorité au bistrot et qui dépassent la réalité pour entrer dans l’exagération passionnée » 1
Nous voici donc à Prague « au 17 de la rue Husova », au café Le tigre d’or où Hrabal avait ses habitudes, « pour y passer l’après-midi et retrouver sa place au centre, sous les grands trophées de chasse (…) C’est là qu’il recevait, buvait, mangeait et palabrait. C’est là aussi qu’il prenait plaisir à tous ceux qui venaient s’asseoir près de lui ».
Dans un luxe de détails, digne de certains récits d’investigation, Jacques Josse (qui s’est rendu lui-même sur les pas de Hrabal à Prague) évoque la vie quotidienne de l’auteur à Prague, mentionnant au passage les figures de ceux qui lui tenaient habituellement compagnie : un peintre, un poète violoncelliste, un docteur en philosophie, un joueur de viole, mais aussi un ancien ouvrier du métro de Prague, sans oublier « un ex-garde du corps en arrêt maladie prolongé pour cause de torse, poitrine et ventre entrelardés de plus de cent coups de couteau » et qui « veillait sur sa tranquillité ».
Jacques Josse nous dit entre les lignes son admiration sans faille pour l’auteur de Une trop bruyante solitude édité dans la clandestinité en 1976. Ce livre, rappelle-t-il, « retrace l’arrivée au cimetière des mots d’un lent cortège d’ouvrages à l’agonie, de collections en lambeaux, de bibliothèques entières lancées à la fourche dans la gueule mécanique d’une presse chargée de broyer des tonnes de papier ». Roman fulgurant dénonçant l’emprise sur les consciences dans ces années de plomb précédant la Révolution de velours.
« L’ultime parade » de Bohumil Hrabal, c’est son suicide, le 3 février 1997, quand il saute du 5e étage de l’hôpital de Bulovka et meurt dans la neige. A l’annonce officielle de sa mort par Vaklav Havel lui-même, « les tireuses de bière tournèrent à plein régime et les pintes de bière valsèrent de table en table en se vidant à une vitesse effrénée », raconte Jacques Josse. « Veillée funèbre placée sous le signe du houblon », tandis que, sous d’autres cieux, des pétitions commençaient à circuler, à l’initiative de différents écrivains, pour qu’on décerne à Bohumil Hrabal, à titre posthume, le prix Nobel de littérature. Une pétition – soyons-en sûr - qu’aurait volontiers signée Jacques Josse.
1 - Entretien avec Pascal Rougé, dans Jacques Josse, écrivain, poète et éditeur (Editions Le Temps Qui Passe, 2013
L’ultime parade de Bohumil Hrabal, Jacques Josse, Editions La Contre Allée, 55 pages, 6 euros.
 |
Gilles Cervera, |
| L’enfant du monde |
|---|
Le malheur dont il est question dans son livre est celui qui touche un enfant. « Il ne fait rien, ne dit rien. Il ne bouge que par ressauts ou risques de convulsion ». On l’apprend vite, quelques instants seulement après la naissance. Les parents viennent au chevet de l’enfant. « Il est tubé, monitoré. Comme tous les grands malades. Sauf qu’il n’y aura pas de guérison. Il vit, c’est déjà ça ».
Gilles Cervera raconte la rage du père, l’effroi de la mère (« l’enfant est contre elle dans la nuit noire qui s’étend »). Leur premier enfant. Tout s’écroule. « Ceux qui savent l’histoire de l’enfant sont soit tétanisés, soit ils ont des solutions. Ils disent qu’ils le tueraient. Ils disent qu’ils l’abandonneraient. Ils disent qu’il vaudrait mieux qu’il soit mort. Ils disent qu’on ne peut pas se faire à cet enfant tel qu’il est ». Mais Gilles Cervera répond : « Si, justement. Ils se trompent. L’enfant est un enfant du monde ».
Enfant du monde ? L’auteur le dit sans pathos, sans leçon morale à délivrer. « L’enfant n’agit pas sur le monde. Il le domine. Il domine tous les vivants qui savent de sa naissance à aujourd’hui son alitement ».
On sort ébranlé de ce récit fiévreux. Comme écrit dans l’urgence. Gilles Cervera aurait pu faire de la vie de cet enfant un récit méticuleux et « clinique ». Il a choisi la simple force des mots (ceux de la « matière poétique » chère à l’éditeur Yves Landrein) pour nommer la souffrance, l’hébétude, l’éloignement, la vie sans la vie. Tant de récits complaisants sur des minuscules états d’âme (qui encombrent parfois la vitrine des libraires) paraissent tellement dérisoires au regard de ce récit puissant. Cervera laboure profond, va au cœur de nos propres angoisses, de nos propres raisons de vivre ou de ne pas vivre. Son écriture fragmentaire, séquentielle, tourne en boucle autour de cette annonce qui foudroie, fait des allers retours entre l’enfant d’aujourd’hui (presque quarante ans) et celui d’hier sur lequel se penchent des sourires « avant l’immensité profonde du chagrin ».
Le récit ne manque pas d’évoquer le parcours de combattant des parents pour des prises en charge ou des placements en institution. Il évoque la froideur du milieu. Mais l’auteur avoue aussi ses propres manquements quand tout cela est arrivé, et surtout après. Alors, l’enfant, « il faut qu’il soit soutenu par l’écriture. Puisque parler est impossible ».
L’enfant du monde, Gilles Cervera, éditions Vagamundo, 136 pages, 13 euros.